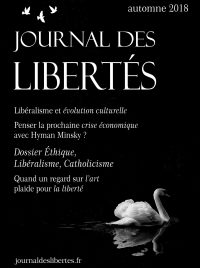Tel est le titre de l’ouvrage de Robert Sirico édité par les éditions Salvator en cette fin août 2018. Il est peut-être la meilleure réponse à donner aux accusations que beaucoup de catholiques ; et non des moindres, adressent à l’économie de marché. Il est vrai que l’auteur n’est pas un prêtre catholique ordinaire : après une vie mouvementée il a connu son chemin de Damas grâce à la lecture des auteurs libéraux, et notamment ceux de l’école autrichienne, de Mises à Hayek.
Cet ouvrage réussit l’exploit d’être tout à la fois vivant, abordable, très lisible (dans la traduction faite par Solène Tadié) et néanmoins profond, didactique, convaincant. Il s’affiche résolument favorable à l’économie de marché et à la liberté économique, non pas pour elles-mêmes, mais comme des éléments de l’ordre naturel de la liberté, capables d’offrir « des règles justes et égales pour tous, un respect strict des règles de propriété, des opportunités de charité, et un usage avisé des ressources » (p.19). Partout où il a réellement été tenté, le capitalisme, dit-il « a été synonyme de créativité, de croissance, d’abondance et surtout de l’application économique du principe selon lequel tout être humain est doté d’une dignité devant être respectée » (ibidem).
Né d’une famille d’immigrés italiens vivant à New-York dans le quartier de Brooklyn, le père Sirico prend alors conscience
« que la concurrence, tant qu’elle est soumise à l’état de droit, est un moyen d’améliorer la qualité et le prix des biens et des services » et qu’elle ‘planifie’ l’économie d’une manière nettement supérieure à toute autre planification économique centralisée » (p.36).
Il se rend compte que l’économie de marché est fondée sur la coopération et la créativité humaine qui sont des éléments constitutifs de notre humanité avec la raison et la recherche de la vérité.
La question reste celle de savoir ce qu’est la liberté et il y répond avec l’aide de Tocqueville : « La liberté est, en vérité, une chose sacrée », souligne-t-il[1]. « Il n’y a qu’une seule autre chose qui mérite ce nom : c’est la vertu. » Et il interroge ensuite : « Qu’est-ce que la vertu si ce n’est le libre choix de ce qui est bon ? » (p.48). A partir de ce constat, il découvre que « Si le droit de propriété n’est pas garanti, le respect des autres droits de l’homme ne l’est pas non plus » (p.43). Un système fondé sur la propriété privée « permet de commercer, d’offrir des cadeaux ou de partager de manière volontaire. C’est la solution pacifique au problème de rareté » (p.50). A l’inverse, la négation de la propriété privée est toujours une régression. Il raconte à cet égard l’histoire des Pèlerins de la colonie de New Plymouth arrivés en 1620 sur la cote de Cap Cod qui avaient d’abord cru bon de mettre leurs propriétés en commun dans l’idée que la productivité serait ainsi supérieure. A l’inverse, cette décision mena à une situation catastrophique si bien que le gouverneur de la colonie permit dès 1622 à chacun de cultiver son propre champ et d’en garder les fruits, ce qui permit une récolte abondante.
Il ne s’agit pas pour autant de considérer que le système de la propriété privée et de la libre entreprise sont parfaits « pour la simple et bonne raison que les hommes ne le sont pas » (p.58). Mais
« dans une économie de marché ou l’état de droit est respecté, les entreprises ne fleurissent pas en détroussant les autres. Elles ont du succès lorsqu’elles savent anticiper les besoins d’autrui et qu’elles fournissent des biens et services à des prix que les consommateurs sont disposés à payer. » (p.75)
Et il lui paraît incontestable que la liberté d’entreprise est ce qui permet le mieux de sortir de la pauvreté au plus grand nombre de gens. C’est la raison pour laquelle l’Institut Acton, créé par ses soins aux Etats-Unis il y a 30 ans, « en explorant les moyens de venir en aide aux pauvres, ne se demande jamais « quelle est la cause de la pauvreté ? », mais plutôt « quelle est la cause de la richesse ? » (p.71). L’erreur majeure des socialistes et autres étatistes, souligne-t-il, est de penser l’économie et plus généralement le monde comme des jeux à somme nulle, ce qui est ignorer complètement l’immense capacité humaine à créer de la valeur, à répondre aux défis qui naissent chaque jour, et souvent du progrès dû à notre propre créativité. Et c’est sans doute parce que la politique est, elle, un jeu à somme nulle que le monde politique se réfugie si volontiers dans une vision aussi réductrice.
C’est pourquoi le père Sirico insiste sur les méfaits de l’aide internationale aux pays pauvres qui les détruit plus qu’elle ne les assiste, ainsi d’ailleurs que le prix Nobel Angus Deaton l’a lui-même, observé.
« L’envoi de marchandise gratuite, écrit le père Sirico, ne résout pas le manque de liberté économique des pays qui en sont les destinataires. Aussi illogique que cela puisse paraître, ces biens gratuits compliquent à tout point de vue la vie des personnes du ‘monde en développement’ qui tentent effectivement de développer leurs économies .» (p.81)
C’est le commerce, la liberté des échanges qui a permis qu’entre 1800 et 1950, la proportion de la population mondiale vivant dans l’extrême pauvreté se soit réduite de moitié, et de 1950 à 1980 se soit encore divisée par deux. C’est ce qui a permis d’encourager le travail et d’agrandir le gâteau plutôt que de le partager en réduisant la part de chacun.
Le père Sirico avance inéluctablement dans sa démonstration en soutenant que la liberté du travail est favorable aux salariés et à la prospérité générale, que la « destruction créatrice » du capitalisme est plus créatrice que destructrice, que la concentration du pouvoir nuit à la liberté et à la concurrence, ce qui induit la corruption et l’anémie de la société. Il soutient que le système de sécurité sociale est perverti, même aux Etats-Unis, par la prévalence du tiers payant dans le service d’assurance maladie : « Cette séparation entre le payeur et le bénéficiaire est à l’origine de la plupart des difficultés dans notre système de sécurité sociale, notamment la hausse des tarifs » (p.187).
Bien entendu note-t-il « le libre marché n’est ni le monstre dévastateur que ses détracteurs de gauche dépeignent, ni une potion magique capable de bénir une société en l’absence d’un cadre moral » (p.112). Il s’agit en quelque sorte d’établir ou consolider, selon les cas, l’état de droit, la liberté de contracter et le respect des contrats, l’objectivité des tribunaux pour faire respecter les droits et devoirs de chacun… Ce qui serait aussi un des meilleurs moyens pour les Etats de protéger l’environnement.
Mais le plus important dans le livre du père Sirico n’est pas la défense et l’illustration des bienfaits du libéralisme, même s’il le fait très bien, en racontant des histoires, et parfois la sienne, avec humour et intelligence. L’important est dans sa démonstration que les mécanismes de marché sont plus attentifs aux individus que le socialisme parce qu’ils favorisent l’exercice de la charité, du don de soi de personne à personne. L’Etat n’est pas l’unique institution qui existe, affirme-t-il avec raison, et son rôle est moins d’intervenir que de faciliter l’intervention des acteurs au plus près des attentes légitimes de chacun, selon le principe de subsidiarité qui veut que
« les besoins sont bien mieux satisfaits au niveau local, et que les personnes au sommet de l’ordre social devraient prendre soin de ne pas interférer avec les niveaux les plus bas, et de ne leur venir en aide qu’en cas de nécessité, de façon temporaire et solidaire » (p. 173).
A cet égard, le père Sirico n’hésite pas à défendre l’efficacité de la charité qui se réalise dans l’attention aux personnes nécessiteuses quand la mentalité bureaucratique qui caractérise toute intervention publique « privilégie les études, les commissions, le développement de plans impersonnels adaptés à des numéros et non à des personnes… » (ibidem). Plus l’Etat s’implique, moins les individus se sentent responsables d’eux-mêmes et de leurs proches. La plus grande charité est sans doute de permettre à ceux qui en sont capables et qui en ont perdu le sens, de retrouver la responsabilité d’eux-mêmes, celle de leur propre santé, de leur avenir, de leur famille…
Robert Sirico fonde son appréciation du libéralisme sur une analyse anthropologique en même temps que sur ses convictions. Il conclut que
« la liberté, en dépit du désir qu’elle inspire aux hommes, n’est ni un but, ni une vertu en elle-même. Nous disposons de la liberté pour autre chose… La liberté est un objectif instrumental… L’objectif de la liberté doit être la vérité… »
Et pour lui qui, après bien des péripéties, est devenu prêtre catholique, cet objectif ne peut être que celui de « la Vérité dans toute sa plénitude » (pp. 237-238).
[1] Alexis de Tocqueville, « Voyage en Angleterre », in Voyages en Angleterre et en Irlande (1835), Gallimard, 1982.