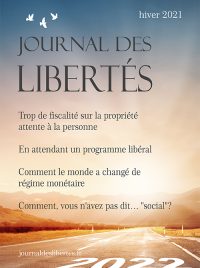Pour qu’il y ait inflation, il faut de la monnaie, beaucoup de monnaie. Mais la monnaie n’est pas là, parce que le monde a subrepticement changé de régime monétaire. L’image des banques centrales et des gouvernements inondant le monde dans un torrent de création monétaire n’est qu’un mirage. Tout comme l’inflation qui devrait suivre.

Il y a un an arrivaient les premiers vaccins. Le soulagement s’est accompagné de la montée d’une autre peur : le retour d’une immense inflation, voire une hyperinflation qui ranimerait de biens mauvais souvenirs. En cause : le tsunami de liquidités soi-disant engendré par les politiques non conventionnelles des banques centrales (les QEs), auxquelles s’ajoute la politique budgétaire du « quoi qu’il en coûte » pour atténuer les coûts économiques et sociaux de la pandémie.
Dans le cadre d’une pensée monétaire élémentaire, ce pronostic va pratiquement de soi. Si les opérations de Quantitative Easing, comme nous le disent – ou nous le laissent croire – les banques centrales, s’accompagnent d’une création massive de liquidités, n’est-il pas réaliste de voir dans le comportement des indices de prix depuis plusieurs mois l’amorce d’un retour de l’inflation ? Dans un régime de fiat monnaie à réserves fractionnaires, cette perspective est cependant liée à une double hypothèse :
1) celle d’un multiplicateur monétaire liant la création de monnaie scripturale par l’ensemble des banques à l’émission de monnaie de base par la banque centrale (la high-powered money de Milton Friedman ; et
2) celle d’une pénurie structurelle de réserves bancaires qui fait que, sur le marché interbancaire il existe toujours plus de banques en recherche d’un financement court de dépannage que de banques disposant de liquidités excédentaires[1].
Première hypothèse : La théorie du multiplicateur monétaire
Le multiplicateur monétaire est la théorie qui explique quel montant total de crédits (ou de masse monétaire) peut être distribué par les banques à partir de la base monétaire créée par la Banque centrale. L’argument central est que la masse monétaire distribuée par les banques (monnaie de banque) dépend de la base monétaire créée par la banque centrale. Cette monnaie de base est essentiellement constituée des billets de banque imprimés par la banque centrale et des avoirs en compte déposés par les banques commerciales au titre de réserves.
Ce concept découle de la pratique bancaire qui, en régime de monnaie fractionnaire, consiste à admettre qu’une banque peut continuer à prêter pour autant qu’à chaque nouvelle transaction elle conserve en réserve un pourcentage minimum des dépôts collectés et utilisés pour financer son activité de crédit. L’exemple le plus fréquemment pris en exemple est celui d’un ratio de 10%. Pour un crédit financé par un dépôt initial supplémentaire de 100, et en appliquant ce pourcentage à l’ensemble d’un système bancaire hypothétique totalement clos, ne comprenant que des banques toutes identiques, on calcule que le maximum de monnaie pouvant être ainsi collectivement créé est de 1000 : soit 900 de prêts distribués plus 100 de dépôts transformés en réserve, soit un multiplicateur bancaire de 10.
Ce ne sont que des chiffres théoriques. Les ratios de sécurité varient considérablement d’une banque à l’autre (selon la taille, les parts de marché, le type de clientèle, etc.). Par ailleurs, sur le plan global, ces calculs à vocation seulement illustrative ne tiennent pas compte d’un grand nombre de contingences qui, dans le monde réel, constituent des sources de fuite de monnaie et réduisent considérablement la valeur du multiplicateur : flux monétaires extérieurs, le paiement des impôts, les prélèvements d’épargne, la variation des préférences pour le cash, le pourcentage de mauvaises créances, l’évolution des attitudes vis à vis du risque, etc.
Dans un souci de sécurisation du système bancaire, les autorités de régulation ont imposé à toutes les banques le respect d’un ratio minimal de réserves obligatoires parquées à la banque centrale. Dans la pratique, les banques y maintiennent un volant de réserves supplémentaires à titre de précaution. Pendant toutes les années qui ont précédé la rupture de la Grande Récession, le système bancaire américain a fonctionné avec un niveau de réserves totales (réserves obligatoires + réserves volontaires supplémentaires) très faible. Jusqu’à 2007 elles n’ont jamais dépassé les 30 milliards de dollars, à mettre en rapport avec le total de la masse monétaire de l’époque (M2) : 7500 milliards, soit… 0,4%, ce qui donne un multiplicateur de 250 !
Le même calcul effectué sur la base de chiffres 2009 donne un multiplicateur de 10,8, et pour 2021 un coefficient de 4,8. La thèse centrale de la théorie du multiplicateur est que la hausse des crédits dépend de la hausse de la monnaie de base (donc pour l’essentiel des réserves). Mais elle pose également que ce coefficient est relativement stable. Quelle est alors la raison de telles différences dans les chiffres ? Qu’expriment-elles ? Ont-elles même un sens ?
La théorie du multiplicateur monétaire est en fait loin de faire l’unanimité chez les économistes. Elle est contestée par une autre école de pensée à la tête de laquelle se trouve la vénérable Banque d’Angleterre. Dans une célèbre étude publiée en 2014, celle-ci renverse le sens de la causalité entre monnaie de base et masse monétaire.
Non, expliquent ses auteurs, l’augmentation du crédit bancaire ne provient pas de la hausse de la base monétaire. C’est l’inverse. C’est la croissance des prêts qui induit la hausse de la monnaie de base, chaque fois que les banques créent de la monnaie ex-nihilo, c’est à dire continûment.
L’effet premier de chaque nouvelle opération commerciale créatrice de monnaie bancaire est d’entraîner la constitution de réserves obligatoires qui sont immédiatement virées à la banque centrale ; puis la transformation d’une fraction de cette monnaie scripturale en monnaie fiduciaire (billets) pour répondre aux attentes des agents économiques dans un rapport mathématique constant dû à leurs habitudes et aux contraintes de la loi bancaire.
Le solde non placé en réserves obligatoires ou non converti en monnaie fiduciaire détermine alors le volume des fonds prêtables, et donc les crédits. Les mêmes opérations sont répétées à chaque fois que l’argent dépensé par les clients revient par le circuit bancaire. Ce qui détermine, en fin de course, un coefficient effectif qui n’est pas une contrainte préalable, mais un résultat ex post.
L’étude de la Banque d’Angleterre reproche à la théorie du multiplicateur exposée dans les manuels de représenter la manière dont les économistes des années 50/60 concevaient la création monétaire. Leur modèle se fonde sur une conception du rôle des banques réduit à une activité traditionnelle d’intermédiaires prêtant aux entreprises l’argent non dépensé que les épargnants déposent chez elles. Leur financement provient uniquement des dépôts. Les banques collectent les dépôts qu’elles redistribuent ensuite sous forme de prêts à l’économie.
Or, depuis plus d’un demi-siècle, avec les développements de l’innovation financière et le passage progressif du « dépôt au repo », cette représentation ne correspond plus à la réalité. La banque du XXIème siècle dépend de moins en moins de la collecte des dépôts auprès d’une clientèle domestique. C’est une banque qui, désormais, emprunte une part croissante de ses ressources, et se procure les liquidités dont elle a besoin sur un marché mondial accessible 24 heures sur 24 – le Global Money – qui transcende les frontières et échappe à l’emprise régulatrice de tout pouvoir politique national.
Dans ce nouvel environnement, le modèle le plus proche de la réalité est non pas celui où les dépôts font les crédits (et donc la monnaie), mais celui où les crédits font les dépôts (et donc la monnaie). Avec pour conséquence de rendre obsolète l’enchaînement conceptuel qui, sur la base de la théorie du multiplicateur, sert de fondement au scénario du tsunami monétaire inondant le monde. Ce n’est pas parce que ce scénario est le plus répandu qu’il correspond à la vérité.
Seconde hypothèse : La pénurie structurelle de réserves bancaires
Cette seconde condition est essentielle dans le raisonnement de ceux qui pronostiquent le retour d’une immense inflation. Cette tension du marché monétaire est en effet l’outil qui permet à la banque centrale de guider les taux courts du marché vers le niveau-cible de sa politique[2]. Si elle ne s’applique plus, le modèle cesse de fonctionner. La banque centrale perd en effet sa capacité de contrôle sur les taux, et donc sur l’offre de monnaie bancaire. Ce n’est plus l’accroissement de la monnaie de base (réserves bancaires + billets) qui conditionne la capacité potentielle d’accroissement de l’offre de prêts du système bancaire, mais l’état – et seulement l’état – du bilan des banques. L’offre de monnaie par les banques redevient strictement endogène (sous la contrainte de nouvelles réglementations comptables à caractère prudentiel)[3]. On n’est plus dans le même univers.
Or c’est précisément ce qui s’est passé au cours du quatrième trimestre de l’année 2008, au lendemain de la faillite de Lehman Brothers. Suite à l’introduction de l’IOER – le taux d’intérêt sur les réserves excédentaires (mi-octobre) – et à la mise en place par la Fed (en décembre) de son premier programme de rachats massifs d’actifs de long terme (LSAP, mieux connu sous les initiales « QE »), les États-Unis sont entrés dans une nouvelle ère d’accumulation explosive de réserves bancaires excédentaires[4].
Ce devait être temporaire. Mais après un second QE, un troisième, une interruption relayée par le lancement d’un QE européen, les États-Unis en sont aujourd’hui au quatrième, voire au cinquième, sinon le sixième selon les modes de comptage (le Japon, lui, en est à son vingt-troisième QE en trente ans). Les autorités monétaires américaines viennent de mettre en place un programme de retrait progressif (Taper) ; mais la probabilité n’est pas nulle de les voir revenir sur leur décision du fait du processus d’étouffement de la reprise qui se dessine de façon de plus en plus nette depuis la fin de l’été.
Le monde a subrepticement changé de régime monétaire. Et la prise en compte de ce changement conduit à nourrir de sérieux doutes quant à la réalité même de cette inondation de liquidités dont les commentateurs craignent qu’elle produise, par le jeu du multiplicateur monétaire de la théorie, le retour d’une grande inflation.
Des contraintes quantitatives dites « prudentielles » ont certes été mises en place au titre des Accords de Bâle pour obliger les banques à limiter leurs risques. Mais la conséquence est que la manière dont le système bancaire détermine son offre effective de monnaie de banque a profondément changé. Le bilan de la Banque centrale peut gonfler à l’excès sans qu’on en tire nécessairement la conclusion que toutes les vannes de la création de monnaie sont ouvertes, ainsi que le répètent à gogo les médias. Pour faire des pronostics sur l’inflation il faut regarder ailleurs. Il faut scruter dans leurs profondeurs ce que nous disent les marchés.
Le mythe des réserves
Les opérations de QE n’ont en fait rien d’exotique. Ce ne sont que l’extension des interventions d’open-market déjà pratiquées depuis longtemps, de manière routinière, sur le marché interbancaire. Ces opérations portent désormais sur des sommes infiniment plus massives. La banque centrale rachète aux banques commerciales des titres de la dette publique et parapublique (comme les obligations des agences fédérales américaines Fannie Mae et Freddy Mac, assises sur des paniers titrisés d’hypothèques bancaires) avec, en contrepartie, l’écriture d’un crédit à leurs comptes de réserve.
Cependant cette transaction n’est pas réglée en monnaie ordinaire, la monnaie commerciale de tous les jours, mais en « monnaie banque centrale », un système de paiements particulier réservé à un petit nombre de titulaires de comptes à la banque centrale, qui ne fonctionne qu’entre ces titulaires ou avec la banque centrale elle-même. Bien que libellée en dollar, cette monnaie particulière ne peut servir qu’au sein du monde bancaire. C’est l’équivalent des « jetons » de crypto-monnaies qui ne s’échangent, par principe, qu’entre un nombre fermé de participants.
Cette monnaie n’est pas conçue pour circuler, elle ne peut pas se passer de main en main, sauf à être d’abord convertie en espèces telles que des billets ou des pièces. C’est une monnaie sans lien direct avec l’économie réelle. Donc une monnaie inactive.
Dans les opérations d’open-market, la banque centrale inscrit au passif de son bilan une dette nouvelle (crédit qui augmente la réserve de la banque venderesse). Elle porte à son actif le montant des valeurs rachetées. Par ce jeu d’écriture, la banque centrale crée de la monnaie « à partir de rien ». Son actif augmente du montant de la transaction.
Au contraire le bilan de la banque privée reste inchangé. Elle se sépare d’un paquet de créances sur le Trésor compensé, à l’actif, par l’acquisition d’une nouvelle créance sur la banque centrale (l’augmentation de sa réserve). Elle n’est ni plus riche, ni plus pauvre. Elle a simplement troqué (swap) un titre de dette qu’elle pouvait négocier sur le marché financier, au sens le plus large, contre une créance de banque centrale qu’elle ne peut échanger qu’avec un nombre restreint d’autres banques.
Autrefois, l’avantage de telles opérations était au moins de permettre au système bancaire de récupérer une capacité complémentaire de démultiplier ses crédits commerciaux et de créer de la monnaie dont les banques étaient, de fait, dépossédées par le régime des réserves obligatoires. Mais, depuis les QE, le passage à un état de surabondance de réserves fait que la création de réserves supplémentaires par la Banque centrale n’enclenche plus aucun de ces effets multiplicateurs d’offre. L’offre bancaire redevient indépendante de ses interventions. Il n’y a plus de multiplicateur, ni d’automaticité[5].
Le seul agrégat monétaire dont on peut être sûr qu’il augmente est la « monnaie de base » – c’est à dire l’argent-réserve qui se retrouve de fait confiné à la Banque centrale. S’il y a un tsunami, c’est essentiellement une inondation de réserves bancaires et de monnaie de base ; une monnaie qui, en réalité, n’est pas une monnaie ordinaire au sens commun du terme, mais est une monnaie confinée sans véritable rôle d’induction économique[6].
L’illusion bancaire
Dans un rachat d’actifs, la banque centrale paie les banques qui servent d’intermédiaires avec les porteurs de titres (dealer banks, primary dealers) en créditant leur compte-réserve avec de la monnaie de banque centrale. De leur côté les banques règlent le vendeur de titres en créditant directement son compte courant du montant de la transaction. Cette double opération donne le sentiment que la banque agit comme un caissier qui échange des espèces (billets + pièces de monnaie) contre un chèque, ou comme un bureau de change qui échange des billets libellés en une certaine devise contre d’autres billets libellés en une autre devise. Elle transformerait ce qui lui est réglé en argent-réserve (monnaie banque centrale) en un crédit d’argent-dépôt (monnaie de banque).
Mais c’est une illusion car, comme nous l’avons déjà spécifié, le compte spécial ouvert par la banque intermédiaire auprès de la banque centrale est réservé aux transactions entre banques. Ce compte ne peut être utilisé pour des transactions commerciales ordinaires. Il ne permet aucune opération dans l’économie réelle. L’argent qui y est bloqué ne peut sortir de la banque centrale que pour lui acheter du numéraire (des billets).
Le montant crédité au compte du vendeur de titres par la banque intermédiaire ne s’accompagne ainsi d’aucun débit sur le compte-réserve de cette dernière. Il n’y a donc pas de transfert d’un compte à l’autre. Mais, malgré cette absence de transfert, il y a bel et bien inscription d’un nouveau dépôt par la banque – c’est à dire, de fait, création de monnaie scripturale par un jeu d’écriture comptable qui donne lieu, semble-t-il, comme pour la banque centrale, à une création de monnaie dite « à partir de rien ».
La question essentielle est alors de savoir quelle sera l’incidence de la mise en circulation de ce nouvel argent sur l’offre globale de crédits (et donc de monnaie) de l’ensemble du système bancaire. Nous ne devons en effet pas perdre de vue que la création de monnaie est fondamentalement une œuvre collective de l’ensemble des banques interagissant les unes avec les autres, même si, initialement, cela résulte d’actes comptables individuels.
Les analystes et commentateurs raisonnent comme s’il devait nécessairement y avoir au moins équivalence un à un entre le volume de nouvelles réserves créé par la banque centrale et l’émission supplémentaire de monnaie par les banques. Nombreux sont les articles qui, par exemple, insistent sur la correspondance qui existerait, depuis les événements du printemps 2020, entre le volume de dettes publiques (anciennes ou récemment écoulées sur le marché) rachetées par la banque centrale et le montant des émissions nouvelles de dettes lancées pour financer le déficit. Le sous-entendu implicite est que, faute de monétiser le déficit public par la voie d’achats directs d’obligations du Trésor par la banque centrale (opération aujourd’hui légalement interdite dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis et dans les pays de l’Union européenne), on arriverait au même résultat par le détour de la capacité de création monétaire des banques privées. Le QE ne serait ainsi qu’une monétisation indirecte de la dette publique.
En réalité, dans le régime monétaire hérité de la crise de 2008, le résultat de ce détour est totalement indéterminé. Rien ne permet d’anticiper si le montant de monnaie bancaire globalement créé par les banques dans le cadre des opérations de Quantitative easing sera égal, supérieur ou même inférieur au montant supplémentaire ajouté par la Banque centrale aux réserves des banques commerciales.
La contrainte de capacité bilancielle
L’idée que la monnaie de banque représenterait une sorte de monnaie gratuite, créée «à partir de rien », est le fruit d’un sophisme idéologique. Pas plus qu’hier il n’existe de monnaie gratuite que le banquier multiplierait librement à l’instar de n’importe quel faux-monnayeur (comme l’a abusivement écrit Maurice Allais).
Le banquier est un fabricant comme un autre. Il fabrique du crédit soit à partir de nouveaux apports en capital, soit à partir de nouveaux dépôts préalablement collectés, soit en empruntant à d’autres banques, via le marché monétaire. De plus en plus souvent les banques trouvent leurs ressources via le marché des repos, auprès d’institutions financières spécialisées dans la collecte et la transformation des excédents mondiaux de trésorerie, ceux que détiennent les multinationales, les assurances, les plates-formes internet ou les fonds de retraite.
Cette fabrication de crédits n’est pas gratuite. Son coût dépend des taux et du marché financier mondial. Chaque établissement procède à des calculs de rentabilité endogènes où interviennent de multiples facteurs liés au bilan de chaque banque et à la conjoncture financière : évolution et prospective des taux d’intérêt, comportements d’encaisse, appréciation des risques, structure et composition du portefeuille d’actifs, rentabilité comparée des diverses activités bancaires et – ne l’oublions surtout pas – impact des réglementations et des ratios prudentiels imposés.
Toutefois, ces calculs sont soumis à deux contraintes :
- Une limite externe déterminée par la disponibilité de titres collatéralisables (l’offre de collatéral). Du fait des nouveaux modes de refinancement bancaire (du dépôt au repo), la demande de collatéral a explosé. Les QE se traduisant par une razzia de la banque centrale sur les emprunts d’Etat (la classe de collatéral la plus sûre et la plus recherchée), c’est désormais le véritable goulet d’étranglement qui commande la création monétaire en lieu et place des banques centrales.
- Une limite interne propre à chaque banque, fonction de sa « capacité bilancielle ».
On ne trouve nulle part (ni sur Google, ni dans Wikipedia, ou même sur Investopedia.com) de définition satisfaisante de la notion de capacité bilancielle ( balance sheet capacity ). Il s’agit d’un outil pour apprécier la limite du risque au-delà duquel il serait aventureux qu’une banque s’engage.
Cette estimation repose sur une formule de « value at risk » (VaR), diffusée par JP Morgan au début des années 1990, qui détermine ce qu’une banque pourrait éventuellement perdre sur son portefeuille d’activités et de placements, dans des conditions normales d’exploitation.
Cette formule pose aux banquiers une sorte de « frontière » analogue à celle que les économistes estiment pour choisir des investissements industriels : le portefeuille de la banque et ses activités sont classés en fonction du rendement de chaque placement et de chacune des activités ; des modèles mathématiques aident à déterminer la part de bilan (et donc le supplément d’affaires) qui optimiserait le risque et la rentabilité globale d’une organisation en croissance.
Ce mécanisme interne, et donc endogène, détermine (en principe) les capacités de production théoriques disponibles pour chaque département (crédits et prêts, trésorerie, sources de financement, fonctions de courtage, « money trading », tenue de marchés…), en tenant compte des contraintes de bilan qui découlent de multiples normes réglementaires : ratios de bilan, ratios de liquidité, tests de simulation de crise, etc. Ainsi, un département de la banque – par exemple la gestion des crédits – ne peut développer ses activités que si l’estimation périodique du portefeuille et des risques lui accorde un « espace de bilan » disponible.
Revenons maintenant à la somme d’argent que le banquier crédite au compte d’un client en paiement des titres que celui-ci lui apporte afin de les faire racheter par la Banque centrale.
Ce financement est assimilable à un crédit gratuit qui ne peut pas être remboursé et qui ne pourra en aucun cas être annulé. C’est un engagement contraint pour la banque du seul fait de son insertion dans un programme de Quantitative Easing, rémunéré par le taux d’intérêt (IOER) versé au banquier par la Banque centrale sur le supplément de réserves excédentaires qu’il reçoit en contrepartie [7].
Comme tout manager industriel, le manager de banque est personnellement contraint par les quotas de production liés à l’espace de bilan qui lui est réservé. Si son quota n’est pas rempli au moment où se présente une offre de rachat d’actif, pas de problème. Si au contraire son quota est plein, s’il se situe en quelque sorte « au taquet » de ses opportunités d’affaire, il devra soit refuser d’engager un nouveau crédit, soit résilier un engagement antérieur (un Roll over indéfini par exemple, ou une ligne de trésorerie accordée à un autre client).
Il est dès lors rationnel d’en déduire que les opérations de QE conduisent structurellement le système bancaire à donner la priorité aux demandes et besoins de la clientèle financière, bien informée, déjà fidélisée, disposant d’un patrimoine important, dotée d’une grande capacité d’influence, etc., plutôt qu’à des clients lambda, industrieux, mais aussi moins informés sur les marchés financiers et moins solvables. Ce que confirment les travaux de chercheurs de l’American Enterprise Institute qui, il y a quelques années, mirent en évidence que les petites et moyennes entreprises américaines (c’est-à-dire celles de l’économie réelle, par opposition à celles de la finance) ont été les grandes victimes des premiers programmes de Quantitative Easing). Actuellement, cet « effet d’éviction » se trouve confirmé par la stagnation des prêts industriels et commerciaux accordés par les banques américaines, malgré tout ce que l’on a entendu sur le caractère soi-disant « exceptionnel » de la reprise post-covid (idem en Europe).
Sans doute trouve-t-on là l’explication du grand écart entre les piètres performances globales de la croissance économique au cours des douze dernières années et, au contraire, l’incroyable résilience des cours de la bourse (la « bulle des bulles », comme aiment l’écrire les commentateurs boursiers : certains calculs suggèrent que les cours de Wall Street – S&P, Dow, Nasdaq – sont actuellement à peu près au double de ce qu’aurait vraisemblablement été leur niveau en l’absence de QEs). A quoi s’ajoute que si les banques n’ont pas la capacité de transformer directement leurs excédents de réserves en prêts à l’économie, du moins peuvent-elles continuer de librement les échanger et spéculer entre elles pour rentabiliser au mieux le rendement de leurs propres portefeuilles de valeurs (comportement encouragé par la doctrine du « Too Big To Fail » qui, depuis Greenspan et son « put », protège abusivement ces mastodontes).
Compte tenu de ces effets de transfert et d’éviction, les QE ressemblent ainsi plus à une gigantesque opération de redistribution monétaire à rebours – de Main Street vers Wall Street et non l’inverse –qu’à un authentique dispositif de production quasiment illimité de nouvelle monnaie « utile »[8].
L’État n’a pas besoin de la planche à billets
Tournons-nous maintenant vers les déficits publics. Là encore les médias n’hésitent pas à invoquer l’image d’un déferlement d’argent qui ne pourrait qu’augurer de sombres perspectives inflationnistes. Dans les grandes démocraties, l’annonce d’une politique de « quoi qu’il en coûte » a conduit à une accumulation tellement vertigineuse de déficits que, compte tenu des expériences passées, il est difficile de ne pas y soupçonner la complicité d’une planche à billets fonctionnant à plein régime.
Comment les États pourraient-ils additionner de telles dépenses – indemnisations des travailleurs mis au chômage ou au temps partiel, prêts ou subventions aux entreprises affectées par les décisions de fermeture autoritaire, soutiens directs au revenu des ménages (Helicopter money), dégrèvement d’impôts, programmes d’investissements dans l’énergie, les transports ou la lutte contre le réchauffements climatique – sans bénéficier d’une création massive de monnaie ?
En fait il n’en est rien, et il n’en est pas besoin. Ces montagnes de dépenses budgétaires sont tout simplement financées par l’emprunt et l’endettement des États. Il n’y aura création monétaire que si, finalement, ces emprunts ne sont jamais remboursés[9]. Le plus étonnant est d’ailleurs l’aisance relative avec laquelle tous ces emprunts sont ou ont été couverts.
Les épisodes de confinement, la fermeture autoritaire des entreprises et des commerces, les mesures de couvre-feu, les restrictions de déplacement, les fermetures de frontières, l’arrêt des transports aériens et l’effondrement du tourisme ont considérablement restreint les dépenses des ménages.
L’argent qui ainsi n’a pu être dépensé s’est accumulé sur les comptes en banque. Il constitue une épargne liquide dont le montant global a été d’un ordre de grandeur sans doute tout aussi considérable que les besoins immédiats exprimés par les États, aussi immenses soient-ils. C’est ainsi, par exemple, qu’au mois de juin dernier (2021) une étude de la Bank of America chiffrait à 3500 milliards l’excès d’épargne des ménages américains[10]. Les premières difficultés, quoiqu’encore limitées, du Trésor américain à couvrir ses appels au marché ne sont apparues qu’à la fin février 2021, à l’occasion d’une émission d’obligations à 7 ans. Mais l’incident ne s’est pas reproduit.
Pendant la crise Covid les marchés, épaulés par les canaux du Global Money [11] (via le marché mondial du repo), ont sans grande difficulté apporté aux États les ressources monétaires nécessaires pour en atténuer les conséquences sur le pouvoir d’achat. Ces emprunts ont drainé les ressources liquides des réseaux bancaires, sans problèmes particuliers en raison de l’abondance d’épargne ainsi captée sous forme de dépôts supplémentaires. Jusqu’à présent, contrairement à ce que la plupart des gens croient, le Trésor US n’a pas eu besoin du concours de la planche à billets.
Pas de monétisation virtuelle
Malgré cela, n’y aurait-il pas néanmoins, en coulisse, un phénomène de monétisation indirecte qui, bien qu’indépendant des politiques de QE, serait branché sur leur mécanisme ? Suggérée par les partisans de la MMT (Théorie Monétaire Moderne), l’hypothèse vaut la peine d’être décrite.
L’idée est qu’il faut suivre le circuit de l’argent levé par les emprunts du Trésor. Cet argent, sert aux pouvoirs publics pour payer des salaires, verser des subventions et des indemnités, acheter des ordinateurs, des machines, etc. Il retourne à l’économie réelle en irriguant de multiples circuits. C’est là la grande différence avec la pseudo-monnaie créée par les banques centrales (l’argent-réserve).
Les ménages, les entreprises qui reçoivent leurs chèques du Trésor ou du Budget les remettent à leurs banques pour encaissement. Les liquidités initialement drainées dans la trésorerie des banques, et transférées sur le compte dont le Trésor dispose à la Banque centrale, reviennent au fur et à mesure des dépenses de l’État dans le circuit des banques commerciales dont elles reconstituent la trésorerie globale sous forme de nouveaux dépôts. A leur tour, dans un régime de monnaie fractionnaire, ceux-ci génèrent une nouvelle expansion des activités de prêts et crédits.
C’est ainsi que le système bancaire récupère les ressources de trésorerie nécessaires pour assurer la contrepartie, sous forme d’émission de monnaie de banque « utile » aux marchés, de l’augmentation des réserves qui résultent pendant tout ce temps de la continuation des opérations de QEs. Et ceci d’autant mieux que l’accroissement de la dette publique apporte une capacité complémentaire d’actifs collatéralisables – et rehypothécables –- de toute première qualité (bills et bonds OTR) qui prennent la place du collatéral de moindre qualité razzié sur le marché secondaire par les rachats de la banque centrale. En swappant les anciens titres contre de nouvelles obligations d’État bénéficiant d’une négociabilité et d’une liquidité supérieures (en raison de leur plus grande facilité de réhypothécation) le système bancaire privé trouve ainsi le moyen d’élargir la contrainte bilancielle qui limite l’ampleur des chaînes de levier génératrices de monnaie de banque.
La boucle est fermée. La monétisation du déficit public se ferait indirectement, de manière virtuelle, par la participation du système bancaire privé aux QEs de la banque centrale. Elle enclencherait un cercle vertueux qui, dans l’esprit des partisans de la MMT, permettrait de retrouver une trajectoire de croissance stable.
Quelle pourrait-être l’ampleur de cette possible monétisation ? Il n’y a malheureusement aucun moyen de le savoir en raison de la non-commensurabilité directe des formes modernes de la création de monnaie.
Autrefois l’épargne des ménages prenait encore le plus souvent la forme d’espèces qu’on cachait sous son matelas ou dans un tiroir d’armoire. Les placements financiers, titres d’obligations et d’actions, étaient conservés dans des coffres personnels ou loués à la banque. Il en résultait que la souscription d’emprunts publics, via le réseau bancaire, avait pour conséquence majeure de réintégrer les épargnes personnelles ainsi détenues hors circuit bancaire dans la comptabilité de banques qui en tiraient de nouvelles ressources pour soutenir leur offre de prêts (avec coefficient multiplicateur au niveau du système bancaire). L’un des sous-produits de l’endettement public, dans un régime de monnaie fractionnaire, était ainsi de contribuer positivement à l’accroissement de l’offre de monnaie de banque. Il existait une forme de synergie inflationniste entre les déficits publics et l’activité monétaire des banques.
Ces temps sont depuis longtemps révolus. Avec la multiplication des produits offerts par l’accélération de l’innovation technologique et comptable, il n’existe plus d’épargne ou de liquidité qui reste inactive, ne serait-ce que l’espace d’une nuit. Même l’argent que vous laissez dormir sur votre compte en banque – ou sur votre livret A – se retrouve immédiatement mobilisé et intégré à des chaînes complexes de transformation bancaire créatrices de monnaie, dont vous n’avez pas conscience.
Résultat : lorsque, par sa politique d’emprunts, l’État draine les liquidités des banques, ce sont des ressources que, de facto, il retranche des circuits de création de monnaie de banque (multiplicateur négatif). Plus tard, ces liquidités reviennent dans le circuit bancaire sous forme de dépôts qui réalimentent les chaînes de création de monnaie. Mais il n’est pas nécessairement dit que le multiplicateur positif que les banques en tirent compense, au sous près, le multiplicateur négatif précédemment déclenché. Rien ne l’impose.
Le jugement des marchés
Le seul moyen dont nous disposions pour en juger consiste à observer, de l’extérieur, ce qu’en disent les indicateurs de marché, et tout spécifiquement les marchés obligataires. Des études portant de l’après-guerre à aujourd’hui révèlent en effet clairement que le mouvement des taux obligataires, non seulement en valeur absolue (ou déflatée, comme pour les TIPS), mais surtout les mouvements relatifs des taux entre eux, selon les échéances et les maturités, se révèlent sur la longue période être le plus efficace de tous les indicateurs avancés de conjoncture.
Depuis la fin de la Grande Récession, ces marchés n’ont constamment cessé d’afficher des anticipations aux antipodes de la tonalité des informations diffusées par les économistes considérés comme les plus réputés et les plus fiables de leur profession. On ne compte plus les déclarations de Bernanke, Yellen ou Powell où ils s’en prennent violemment aux marchés qu’ils accusent de se tromper. Pourtant, quand on fait l’analyse rétrospective de ces débats, on découvre que, à chaque fois, en 2018, en 2014, en 2011 ou en 2008 (l’été avant Lehman), ce sont les marchés qui, finalement, avaient raison. Encore faut-il savoir les lire et déchiffrer leurs messages.
Il s’agit d’un sujet qui dépasse ce qu’il est possible de traiter dans une chute d’article. Nous y consacrerons un prochain article. Nous nous limiterons ici à faire observer que la continuation du mouvement d’aplatissement de la courbe des taux enregistrée au cours des dernières semaines est totalement contradictoire avec l’idée d’un puissant mouvement d’inflation. On ne peut pas avoir les deux. Il en va de même pour ce qui concerne l’écart de taux des contrats de swap par rapport aux emprunts du Trésor (Swap spread). A une exception près (2013), ce spread est négatif depuis 2008, alors que selon la théorie financière enseignée dans les livres un tel écart négatif est non seulement improbable mais carrément impossible.
Les mouvements de cet écart forment l’un des meilleurs indicateurs de l’état de la liquidité mondiale. Un tel écart négatif est incompatible avec le développement d’une situation inflationniste. C’est au contraire l’un des révélateurs les plus solides de la persistance d’un trend de fond déflationniste. Or si cet écart s’est réduit par rapport au record enregistré au printemps 2020, il n’en demeure pas moins que, depuis début 2021, il reste encore solidement ancré en zone négative. Une telle négativité est incompatible avec l’inflation.
On pourrait multiplier les références. Le comportement des Eurodollar Futures, par exemple – sans aucun doute l’un des indicateurs de marché les plus performants – pointe dans la même direction. Tout comme, sur un tout autre plan, l’évolution du crédit. Depuis le début de l’année, les bilans bancaires ont repris leur progression. C’est une excellente nouvelle. C’est un signe de reflation. Cependant si l’on regarde d’un peu plus près comment évolue la répartition des placements des banques américaines, on constate qu’au sein de cette progression l’accroissement de leurs activités de prêts ne représente qu’une très faible fraction de ce qu’elles ont consacré, pendant la même période, à l’achat et au stockage de nouveaux bons et titres du Trésor considérés comme sûrs et liquides (safe assets). Au point qu’au cours des deux premiers trimestres de 2021 la part des prêts bancaires par rapport au total du bilan est descendue au-dessous du seuil des 50% – le chiffre le plus bas jamais enregistré depuis… 1955.
Ce chiffre signifie certes que les bilans bancaires sont aujourd’hui plus solides qu’ils ne l’avaient été depuis longtemps (depuis 1962, très précisément). Mais cette préférence massive pour la liquidité n’est pas du tout ce que l’on s’attendrait à observer si la situation économique correspondait à ce qu’en disent alors les médias, sur la foi des rodomontades des autorités (une économie « on fire » comme titrait au début de l’été The Economist). Un tel comportement n’est certainement pas porteur d’inflation. Pire même : si l’on pousse l’analyse encore plus loin, on découvre que de telles structures de portefeuille sont fortement reminiscentes de ce qu’était la situation des banques américaines entre les deux guerres, à l’approche de la récession dite secondaire des années 1936/37 (alors même que, comme aujourd’hui, l’Administration Roosevelt s’alarmait du retour de supposées tensions inflationnistes qui n’étaient que de l’affabulation).
Ces informations concernent les États-Unis. Mais on peut faire un constat très similaire tant pour le Japon (où le total des prêts bancaires à l’économie est encore aujourd’hui inférieur à ce qu’il était à la fin des années 1990) que pour l’Europe (où la reprise de la progression reste faiblarde).
Tous ces indicateurs indirects expriment un point de vue radicalement contraire aux opinions pro-inflationnistes que les médias rasassent. Ils renforcent la conviction que l’effet monétaire des QE est globalement négatif, et infirment l’hypothèse d’une gigantesque monétisation virtuelle.
La vérité du monde dans lequel nous vivons depuis plus d’une décennie n’est pas celle d’un trop-plein de liquidité, mais au contraire d’une création monétaire globale qui reste obstinément insuffisante pour autoriser le retour à des taux de croissance plus élevés.
L’épidémie des taux zéro est le symptôme d’une situation anormale où la surabondance d’une monnaie qui ne tourne pas (la monnaie gelée dans les banques centrales sous la forme de réserves improductives) va de pair avec une pénurie persistante (malheureusement difficilement mesurable) de véritable monnaie « utile « : la monnaie de marché que réclame l’activité des ateliers mondiaux et dont ceux-ci manquent cruellement, le dollar offshore. Sans elle il paraît improbable que la croissance économique revienne vite !
* * *
* *
Note : Ce que nous apprennent les chiffres sur les effets des QEs
Que disent les chiffres ? FRED est la grande banque de données économiques américaines administrée par la Federal Reserve Bank of Saint-Louis. Elle offre un service online très efficace qui permet de visualiser en quelques secondes les courbes graphiques recherchées. Nous l’avons utilisé pour vérifier si, sur l’ensemble de la période 2000-2021, il existait une quelconque corrélation visible entre les variations du volume de réserves bancaires déposées à la Banque centrale, l’évolution de la production de monnaie de banque (telle que mesurée par le chiffre des dépôts en banque faisant partie de l’agrégat M2), et les phases successives d’application des programmes de Quantitative Easing.
Le graphique obtenu fait apparaître trois périodes :
- avant 2007. Le chiffre des réserves est représenté par une droite horizontale stable à un niveau très faible (moins de $ 20 milliards). Les dépôts, eux, progressent à un rythme relativement régulier sur un trend moyen de long terme de 4,4 % par an. L’écart linéairement croissant entre les deux courbes confirme l’existence d’une solide relation de multiplicateur pour cette période.
- de 2008 à 2019. Toute corrélation entre les deux courbes disparaît. Elles évoluent en totale indépendance l’une de l’autre, sans que l’on puisse établir un lien quelconque avec les différentes phases de rachats d’actifs. Comme décrit dans le corps de cet article, il n’y a plus de multiplicateur.
- 2020 – 20021. Surprise : les dépôts-banque-centrale (réserves) et les dépôts dans les banques commerciales retrouvent des trajectoires strictement parallèles et synchrones. Durant le sauve-qui-peut monétaire du printemps, avant même que se manifestent les premiers signes de la crise Covid, les deux courbes explosent à la verticale. Leurs profils se confondent. Tout se passe comme si, par une sorte de transformation magique – en principe impossible – l’intégralité des nouvelles réserves créées par la banque centrales’étaient déversées instantanément, et quasiment dollar pour dollar, dans les tuyaux et circuits du système bancaire.
Qu’on en juge : entre février et novembre 2020 le volume des réserves bancaires a été quasiment multiplié par deux, passant de $ 2 300 à 5 100 milliards – soit un accroissement de $ 2 720 milliards. Au cours de ces mêmes huit mois la composante purement électronique de M2 (les dépôts) est passée de $ 13 600 à 16 900 milliards, soit une augmentation de $ 3 300 milliards. Mais dans ce chiffre figure un accroissement qui aurait naturellement résulté des 4,4 % de croissance moyenne annuelle correspondant au trend de long terme. Si on soustrait celui-ci, reste une somme de $ 2 740 milliards qui représente le montant de dépôts supplémentaires attribuables au programme d’intervention de la banque centrale pendant la même période (QE 4). D’un côté, + 2 720 milliards, de l’autre + 2 740 milliards, la correspondance des chiffres est confondante !
A partir du mois de mars 2021 les deux courbes recommencent à diverger. Ce qui correspond au moment où décolle le mouvement des opérations de reverse-repo (RRP) qui consiste pour les banques à déposer du cash à la banque centrale contre l’emprunt temporaire d’actifs collatéralisables, et donc de détruire de la monnaie.
Ce graphique doit certainement réjouir les dirigeants de la Fed. Cette explosion inattendue de M2 depuis deux ans est en effet pour eux du pain béni. Ils peuvent l’interpréter comme la confirmation de ce que, après une dizaine d’années de cibles ratées et de résultats profondément décevants, leur stratégie monétaire non conventionnelle de rachats d’actifs serait enfin en train de payer. Ce n’aurait été, comme Paul Krugman n’a eu de cesse de le répéter d’un essai de QE à l’autre, qu’une affaire de « quantum » : le tout était d’arriver à la masse nécessaire pour obtenir l’effet recherché. En 2020 ils auraient enfin touché le Jackpot ! L’heure de la véritable reprise serait arrivée.
Une autre population heureuse est sans nul doute celle des économistes monétaristes classiques qui, tel Steve Hanke (dans le Wall Street Journal), ou même Patrick Artus (en France), tout en restant loin des délires hyper-inflationnistes des derniers mois, fondent leurs diagnostics de retour à des 5 ou 6% par an d’ici à 18 mois/2ans.sur l’extrapolation de corrélations monétaires d’avant 2008 intégrant M2 et monnaie de base. Encore faudrait-il qu’ils disent pourquoi et comment le mécanisme de transmission entre la monnaie de gros émise par la banque centrale et la monnaie de détail créée par le système bancaire a cessé de fonctionner pendant treize ans, pour soudainement reprendre du service à l’occasion de la dernière crise. Ne serait-ce qu’une question de « quantum » ?
En fait, les courbes suggèrent que la réapparition du synchronisme daterait de la « crise du repo » survenue en septembre 2019 (qui fut une sorte de répétition de ce qui allait se produire en encore plus grand au mois de mars 2020). La réponse se cacherait-elle de ce côté-là ?
Possible. Mais, quelle que soit la réponse, celle-ci n’a aucune importance puisque le changement de régime monétaire international a pour conséquence de priver l’agrégat M2 de toute capacité opérationnelle en matière de planification monétaire (domestique). Dans un univers désormais chapeauté par le pouvoir dominant du « Global Money », où il n’y a quasiment plus de frontières monétaires, et où la création monétaire off-shore prend des formes toujours plus inédites, savoir comment se comporte l’agrégat M2 ne présente plus aucun intérêt, ni n’apporte aucune aide informationnelle.
L’égalité théorique à la base des modèles monétaristes n’est pas en cause. Elle reste parfaitement valable. Le problème, ce sont les chiffres que les opérateurs des systèmes mathématiques entrent dans leurs modèles pour en tirer des règles de fonctionnement macro-économiques. Pas seulement l’origine de ces chiffres, leur fiabilité, comment ils sont recueillis, etc… Mais plus fondamentalement le choix, la disponibilité, la nature même des chiffres qu’il faut introduire dans les ordinateurs pour que leurs puissances de calcul servent à quelque chose. Autrement dit, qu’est-ce qui entre dans le calcul de M2 : qu’est-ce qui est de la monnaie et qui n’en est pas !
Il se reproduit pour M2 (pour M3, voire M4 et tout autre M) le même genre de difficultés rencontrées avec M1, dans les années 1970, lorsque l’envol de la Grande inflation a révélé des distorsions impossibles à éliminer dans les résultats des équations monétaires utilisées par les autorités monétaires. Enquête faite, certains économistes de cette époque ont émis l’hypothèse que s’il en était ainsi c’était parce que de plus en plus d’échanges se faisaient discrètement via le recours à des instruments de transaction ne figurant pas dans la nomenclature reconnue des outils monétaires concourant en principe à l’émission de monnaie. Autrement dit parce que, dans les faits, l’innovation bancaire et financière avait atteint le stade où elle apportait désormais aux agents économiques les moyens de fonctionner plus efficacement en utilisant de nouvelles formes de monnaies (ou quasi-monnaies) produites par certaines banques et établissements financiers en dehors des réseaux de communication officiellement reconnus et du cadre traditionnel de leurs activités encadrées par la puissance publique. La statistique n’était plus en phase avec la réalité monétaire du moment.
C’est ce qui a amené les banques centrales à délaisser M1 pour se recentrer sur un nouvel agrégat M2 plus large incluant une partie de ces innovations (par exemple l’usage élargi des techniques de repo, la reconnaissance du caractère « monétaire » des parts de fonds mutuels, l’inclusion des comptes à terme, etc…). Mais l’innovation financière (monétaire) ne s’est pas arrêtée pour autant. Bien au contraire. L’essor de la mondialisation a fait sans cesse apparaître de nouveaux besoins auxquels l’industrie financière a répondu par l’offre de nouvelles techniques et l’apport de nouveaux réseaux de transaction permettant notamment de desservir de plus en plus rapidement des clientèles de plus en plus diverses et lointaines (exemple de l’essor des chaînes complexes de re-hypothécation dans le monde de la monnaie offshore).
Pour qu’il y ait politique monétaire, encore faut-il être en mesure de bien définir ce qu’est la monnaie, et de la mesurer. Or c’est ce que l’innovation et la multiplication des nouveaux produits quasi-monétaires ont rendu impossible. M2 a donc subi le même sort que M1. A la fin des années 1990, Alan Greenspan a publiquement reconnu qu’il n’était plus en mesure de dire où commençait et où finissait l’univers conceptuel de ce qu’on appelle « la monnaie ». Sans en faire la publicité, les banques centrales ont abandonné l’usage des agrégats comme instrument de pilotage de leurs politiques monétaires. Elles font désormais de la-politique-monétaire-sans-monnaie !
Résultat : les traditionnels agrégats monétaires sont des outils d’action économique obsolètes, inadaptés aux réalités d’une économie mondiale ouverte, incapables de nous apporter les informations dont nous aurions besoin pour juger l’état de la situation monétaire à un moment donné. Peut-être pourrait-on rêver d’un M2 ou d’un M3 mondial. Mais c’est un rêve de technocrate impossible à réaliser avec une innovation financière qui se poursuit de plus belle, entraînant désormais une course poursuite entre la réglementation et la prolifération sans fin de nouveaux produits et services susceptibles de remplir des fonctions quasi-monétaires (parallèle avec l’histoire de la réglementation des nouvelles technologies téléphoniques). Concrètement, ce bouillonnement technologique rend les frontières conceptuelles entre vraies-monnaies et monnaies-alternatives de plus en plus floues et difficiles à définir. Avec pour conséquence que la construction même d’agrégats monétaires, au sens de la statistique traditionnelle, y perd toute pertinence.
Il nous faut donc penser la monnaie autrement. Et revoir également la vision des phénomènes d’inflation qui y est liée. L’approche essentiellement quantitative a vécu, rendue inopérante par la globalisation de la monnaie via l’émergence du « Global Wholesale Money Market ». Seule l’observation de la dynamique des taux permet désormais de déchiffrer les signaux d’information économique en provenance du nouvel ordre global de marché. Nous avons changé non seulement de régime monétaire, mais, plus fondamentalement encore, de paradigme.
[1] L’exigence est qu’il y ait toujours en permanence présent sur le marché interbancaire un volant de fonds empruntés (Borrowed Reserves). Aux États-Unis ce marché porte sur l’échange de Fed Funds, valeurs du Trésor à très court terme (overnight).
[2] La banque centrale ne contrôle les taux des Fed Funds que de manière indirecte. Elle fixe une cible, le niveau de taux qu’elle aimerait voir prévaloir compte tenu de son analyse de la situation économique. Elle utilise ensuite les opérations d’open-market pour peser sur ce marché et faire en sorte que le taux qui s’y affiche tombe dans la fourchette cible qu’elle a préalablement définie. Si elle désire que les taux montent, elle augmente son offre de vente de titres publics sur le marché interbancaire, faisant ainsi baisser le prix et monter le rendement. Le contraire si son objectif est d’obtenir des taux qui baissent.
[3] Ces nouvelles contraintes contrôlent l’activité des banques non plus en agissant directement sur leur capacité à accorder spécifiquement des prêts (le multiplicateur basé sur les réserves), mais par des ratios financiers qui limitent l’extension de leurs activités (balance sheet capacity) par une augmentation globale de leurs coûts en capital.
[4] Fin 2007, juste avant la première grande crise financière (GFC1) les réserves bancaires déposées à la Fed ne dépassaient pas les 10 milliards de dollars. Au cours des dix années précédentes elles n’avaient jamais été au-delà de 30 milliards. En mai 2009 – fin de la grande récession – le chiffre était près de 800 milliards. Il est passé à 2 800 milliards en septembre 2014, juste avant la fin du troisième QE. Au mois de mars 2020, date de déclenchement de la dernière crise (GFC2), le volume total des réserves était redescendu à 3 250 milliards, pour remonter aujourd’hui (septembre 2021) autour de 4 200 milliards (figurant au passif, pour un bilan total désormais de plus de 8 trillions). 4 200 milliards de monnaie inactive, confinés dans le bilan de la Fed, et qui n’irriguent pas l’économie réelle. Autrement dit une vraie fausse monnaie.
[5] Autrefois, le supplément de réserves créé par la Banque centrale dans le cadre de ses opérations d’open market permettait potentiellement de libérer chez les banques un montant équivalent de ressources liquides dont le blocage antérieur au titre des réserves obligatoires avait pour effet de restreindre leur offre de crédits. L’application de la théorie du multiplicateur au supplément de dépôts ainsi ressuscités permettait alors aux banques d’accroître leur production de monnaie d’un multiple du supplément d’argent-réserve créé par la banque centrale. Une opportunité que les banques commerciales ne pouvaient se permettre de laisser passer. D’où une sorte de déclic automatique. C’est ce schéma de levier multiplicateur qui inspire fondamentalement ceux qui croient que les QE sont la source d’un gigantesque tsunami monétaire.
Dans le nouveau contexte, l’apport par la Banque centrale de crédits supplémentaires venant compléter le compte de réserve des banques n’a plus les mêmes propriétés de déclic. L’énormité des sommes aujourd’hui accumulées au titre de réserve bancaire (par rapport à l’accroissement ordinaire de la demande de crédits) signifie en effet qu’elles dépassent de loin ce qui correspondrait au seuil normal de prudence d’une bonne gestion du risque bancaire. Comme par ailleurs l’argent-réserve ne peut être transformé à l’initiative des banques en prêts directs au public, il en découle que la seule addition d’un nouvel apport de réserve correspondant à un règlement d’achat de titres financiers publics (ou privés) par la Banque centrale ne déclenche plus de réaction d’offre supplémentaire dans la politique de crédit des banques. Il s’agit pour elles d’un non-événement. Il n’y a plus de multiplicateur.
L’effet levier ne peut exister que lorsque les réserves sont rares par rapport à la demande de crédits et que les banques se livrent concurrence pour se les répartir. Les réserves sont devenues une forme de liquidité qui, dans le contexte actuel, perd son principal attrait par rapport au nombre croissant d’autres instrument d’accès au cash qu’offre aujourd’hui aux banques la finance monétaire de marché. C’est vers ces marchés, qui se confondent avec le Global Money, qu’elles se tournent désormais pour trouver des sources de levier et de multiplication. Elles remplacent un multiplicateur (qui ne fonctionne plus) par un autre (lié à la réhypothécation d’actifs utilisés comme collatéral).
[6] L’image de l’État faisant fonctionner à plein la planche à billets reste toujours présente dans nos représentations mentales de la monnaie. Ce n’est pourtant qu’un cliché, une image d’Épinal qui ne correspond plus à aucune réalité matérielle. Il y a bien longtemps déjà que l’État ne fabrique plus de monnaie. De nos jours, c’est par les banques que se fait exclusivement la création de monnaie. C’est le crédit bancaire qui est la source de toute création monétaire. Chaque année l’impression de billets et la fonte de pièces de monnaie représentent moins de 10% des additions au stock de monnaie. Tout fonctionne comme si, après la guerre, les banques centrales avaient affermé aux banques d’abord, puis également aux institutions financières non bancaires qui pratiquent de facto des activités de banquiers (shadow banking), le privilège de créer monnaie.
[7] Soit 5 points de base au-dessus du taux du marché monétaire pour les Fed Funds, lorsque tout fonctionne bien.
[8] Une note ajoutée en annexe précise les données empiriques qui viennent confirmer cette lecture de l’impact des QEs. La note présente également les controverses autour de la mesure de la « masse monétaire » qui ne sont pas sans liens avec les divergences d’opinion quant à l’apparition imminente d’un inflation forte et soutenue.
[9] Pour renforcer la thèse de la monétisation, il est fortement soupçonné qu’il existerait un accord tacite entre, d’un côté le Trésor, de l’autre la Banque centrale, pour que cette dernière diffère aux calendes grecques le remboursement des échéances des emprunts publics figurant sur son bilan. Peut-être, mais cela ne change rien au fait qu’on ne peut parler de financement par la planche à billets, qu’elle soit privée ou publique (puisque la monnaie de banque centrale ne circule pas). Il n’y a pas monétisation, mais espérance de monétisation future fondée sur un double pari, d’une part que le pacte tacite entre le Trésor et la Banque centrale sera exécuté, d’autre part que l’inflation d’ici là aura rogné à peu de chose la valeur réelle du nominal alors remboursé.
Reste cependant une part de monétisation réelle qui correspond aux économies d’intérêts sur lesquelles le Trésor peut compter du fait de l’incidence des programmes de QE sur le niveau des taux. Une étude très approfondie des services économiques de la Royal Bank of New Zealand (la banque centrale du pays) – confirmée par d’autres travaux de la banque centrale suédoise – montre cependant que cette baisse reste en réalité très marginale : 50 points de base tout au plus par tranche de QE portant sur 10% du PNB d’un pays. C’est peu par rapport à l’ampleur du trend baissier enregistré sur les treize dernières années, symptôme du biais déflationniste qui, depuis la GFC1, afflige le fonctionnement du Global Money.
[10] Le taux d’épargne mesuré ce mois-là étant de 12,4%, comparé à un taux moyen de longue période de 8%. Voir l’article signé Tyler Durden sur le site ZeroHedge.com en date du 29 juin 2021: « Why The Fed Is Dead Wrong On Inflation: Americans Have $ 3.5 Trillion in Savings for a Sunny Day ».
[11] Pour une présentation du concept de Global Money, voir l’article « L’ère du Global Money», Henri Lepage, dans le Journal des libertés, Hiver 2019.