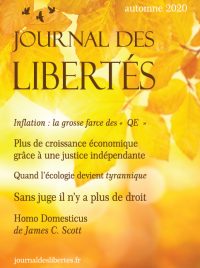Tout au début de son article Pascal Salin évoque avec discrétion l’existence d’un keynésianisme « extrême », et il décide de ne pas s’y attarder. Il a tout à fait raison puisqu’il veut démontrer – avec le talent qu’on lui connaît – qu’une vue autrichienne de la science économique rend le concept de demande globale dénué de sens, puisqu’une demande correspond à une offre, et qu’elle ne saurait être globale puisque seuls les individus demandent (et offrent).
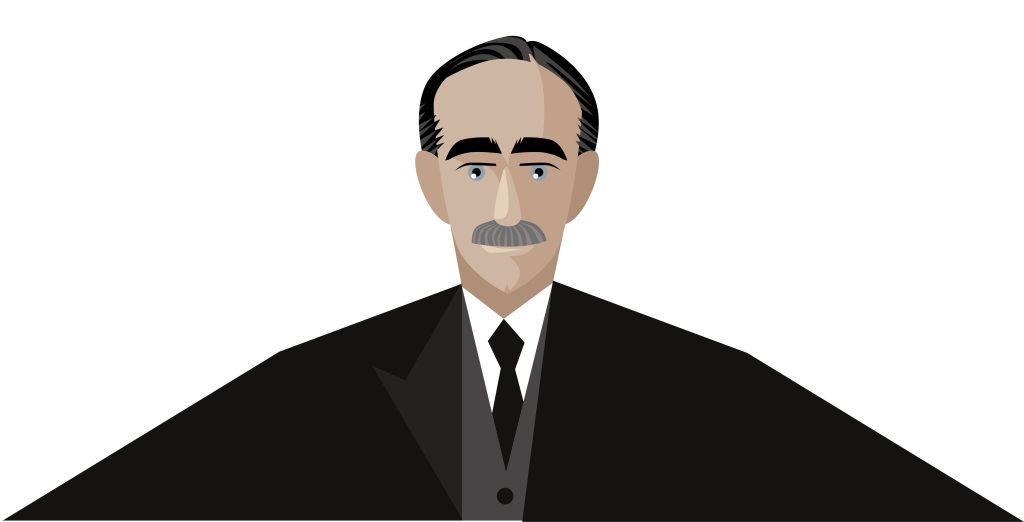
Je n’ai pas la discrétion de Pascal Salin et je n’hésite pas à rappeler à l’occasion que la demande globale joue un rôle décisif dans la construction de la Théorie Générale. Et si la demande, globale ou non, n’a pas les vertus que lui prête Keynes, toute politique keynésienne est elle-même dépourvue de sens.
Je vais m’efforcer de faire le plus simple possible. Chez Keynes la demande joue un rôle moteur parce que l’offre ne peut varier à court terme. C’est la base même de la démonstration proposée par Keynes : il ne s’intéresse qu’au court terme, une période assez courte pour que les producteurs n’aient pas le temps de faire varier ou d’adapter les moyens de production dont ils disposent. Cette première hérésie traduit bien l’erreur soulignée par Pascal Salin ; erreur qui consiste à concevoir offre et demande comme des concepts nettement distincts : on ne peut pas jouer sur l’un (offre), donc on va jouer sur l’autre (demande). L’offre est tétanisée parce que l’objet de la politique économique est de rétablir une bonne conjoncture : « dans le long terme nous serons tous morts » disait Keynes. Il y a urgence, et on n’a pas à se soucier des considérations structurelles, institutionnelles, l’important c’est de retrouver rapidement le plein emploi. Ce qui importe, c’est la relance !
Donc, à court terme, toute variation de la production et donc de l’emploi (considéré par Keynes comme la seule variable d’ajustement conjoncturel) va dépendre de la demande. Cette demande a deux composantes : la consommation, C, et l’investissement, I.
Les ménages consomment-ils assez pour assurer le plein emploi ? Non, à cause de ce que Keynes appelle pompeusement « la loi psychologique fondamentale ». Une loi qui condamne nécessairement les sociétés opulentes : les gens enrichis ont la fâcheuse habitude d’épargner, voilà donc de l’argent qui n’est pas réinjecté dans le circuit économique. On dira que la « propension marginale à consommer » diminue avec le niveau de revenu, la part épargnée est d’autant plus grande que le revenu est élevé. Keynes, comme Malthus, pense que l’épargne freine la production, et il évoque sans amertume « l’euthanasie fatale du rentier ». Bien évidemment la loi psychologique est inexistante, elle a été démentie par de multiples travaux, et si les gens épargnent c’est en principe pour garder la possibilité d’une dépense future : il y a arbitrage entre consommation immédiate et future. L’épargne au temps t se retrouvera nécessairement sous forme de désépargne au temps t+n (sauf pour Harpagon bien sûr).
Les perspectives de relance étant bloquées du côté de la consommation (comme s’en est désolé Monsieur Le Maire) on doit maintenant se tourner du côté de l’investissement. Son volume global (évidemment global !) dépend de deux facteurs : l’un est « l’Efficacité Marginale du Capital » (EMC), c’est ce que va rapporter l’investissement nouveau. Or, dans une société opulente, il y a déjà une telle accumulation de capital que le rapport ne cesse de diminuer. Il y a là une croyance qui évidemment n’a rien de réaliste mais qui était courante dans les années 1930, et qui n’est pas sans évoquer la « loi » marxiste de la décroissance du profit en longue période – à en croire Marx, le capitalisme ne manquera pas de s’effondrer victime de ses contradictions internes. Cette baisse de l’EMC ne présage donc rien de bon, à moins qu’elle soit compensée par une baisse du taux d’intérêt, c’est-à-dire du coût de l’investissement. Le niveau du taux d’intérêt va dépendre du comportement de celui qui peut louer son capital disponible. Il a le choix entre placer son argent ou le conserver sous forme liquide. Et voici un nouveau blocage, une autre loi : c’est la préférence pour la liquidité, de sorte qu’il faudrait des taux d’intérêt très élevés pour que le détenteur de fonds prêtables renonce à la liquidité. Il y a donc conflit total entre ce que désirent l’investisseur potentiel et le financier possible. Le conflit se termine mal : « John Bull peut tout supporter sauf un taux d’intérêt à 2 % » estime Keynes. Il ajoute au passage qu’une politique d’expansion monétaire ne servirait pas à grand-chose, car la masse monétaire nouvelle serait elle aussi conservée sous forme liquide. C’est « la trappe monétaire », pour laquelle Keynes propose un graphique, le seul de sa Théorie Générale.
La conclusion s’impose : il n’y a pas d’autre moyen de revenir au plein emploi que de compenser « l’insuffisance de la demande globale spontanée » par des dépenses publiques, qui auront un effet « multiplicateur » sur le revenu national.
Cette rapide incursion dans le keynésianisme « extrême » (mais originel) permet sans doute de mesurer la rigueur scientifique de la farce keynésienne. Keynes, d’ailleurs, n’avait que faire de la science. A juste titre l’un de ses vulgarisateurs français, Alain Barrère, avait mis en évidence le « finalisme keynésien » : ce qui intéressait Keynes c’était uniquement la fin de son analyse, la conclusion de son discours : justifier l’intervention de l’État et les dépenses publiques pour relancer une économie de marché malade de ses fluctuations conjoncturelles. Il n’est pas étonnant que la classe politique se soit ralliée au keynésianisme puisqu’il légitimait ses interventions et ses dépenses. Le bon peuple, de son côté, est persuadé que les riches ne font pas un bon usage de leur argent, qu’il faut sans cesse augmenter les salaires pour accroître le pouvoir d’achat, et qu’il est magique de s’enrichir en dépensant davantage.
A juste titre Pascal Salin rappelle que la science économique n’est que la science des comportements humains, et que l’échange est la meilleure façon de satisfaire les besoins personnels. C’est bien le cœur de la théorie dite « autrichienne ». Certains « autrichiens » (comme Israel Kirzner et ses disciples) insistent aussi sur l’importance que jouent le temps et l’incertitude dans les décisions individuelles : il n’y a réellement rien de « global » dans la réalité. Seule l’idéologie collectiviste ignore les choix personnels et la liberté humaine.
 Jacques Garello est professeur émérite de l’Université Aix-Marseille. Président de l’ALEPS de 1978 à 2015, il publie depuis 1981 La Nouvelle Lettre, hebdomadaire. Il a été l’un des créateurs du groupe des Nouveaux Économistes (1977) et a organisé 38 Universités d’Été de la Nouvelle Économie à Aix en Provence.
Jacques Garello est professeur émérite de l’Université Aix-Marseille. Président de l’ALEPS de 1978 à 2015, il publie depuis 1981 La Nouvelle Lettre, hebdomadaire. Il a été l’un des créateurs du groupe des Nouveaux Économistes (1977) et a organisé 38 Universités d’Été de la Nouvelle Économie à Aix en Provence.