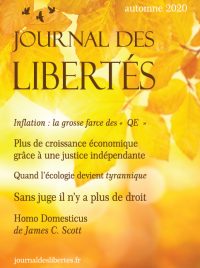L’objectif du présent texte n’est pas de faire de l’exégèse à propos de l’œuvre de Keynes, mais d’analyser la portée d’une proposition centrale de ce que l’on peut appeler le « keynésianisme courant ». En termes très simples, il s’agit de discuter l’idée selon laquelle il existerait des circonstances dans lesquelles on pourrait accroître l’activité économique et/ou l’emploi en augmentant la demande globale[1]. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de préciser quelles peuvent être ces circonstances puisque le but du présent texte est précisément de montrer qu’il ne peut logiquement pas exister de circonstances de ce genre. Le fondement du raisonnement sera constitué par la logique de l’action humaine, ce qui signifie évidemment que la critique du keynésianisme courant qui en résultera sera inspirée par la théorie « autrichienne ». Cette critique est logiquement valide.

Offres et demandes individuelles et concept de demande globale
Nous partirons d’une économie aussi simple que possible, composée de deux individus, A et B, qui sont en relation d’échange. Nous supposerons pour le moment qu’il n’y a pas de monnaie. Comme on le sait bien, A trouve un gain à l’échange en ce sens que la valeur pour lui de ce qu’il achète – c’est-à-dire la valeur subjective – est supérieure à la valeur subjective de ce qu’il vend. La demande qui s’adresse à A en provenance de B – et qui constitue l’offre de A – est inséparable de la demande exprimée par A pour le bien produit – offert – par B. Or, ce qui procure de l’utilité à A c’est ce qu’il reçoit – sa demande – et non son offre, c’est-à-dire la demande qui s’adresse à lui. La demande qui s’adresse à A représente au contraire un sacrifice pour lui et il est en un sens d’autant plus content que cette demande est plus faible pour chaque unité qu’il achète. C’est la traduction même du principe fondamental selon lequel un individu est d’autant plus satisfait que le prix du bien qu’il achète est plus faible. Supposons que A achète du vin et vende du blé. Dire que le prix de ce qu’il achète – le vin – diminue c’est dire qu’il offre moins de blé pour chaque unité de vin qu’il obtient. En d’autres termes, A gagne à ce que B diminue la demande qu’il lui adresse pour chaque unité de vin qu’il lui vend.
Cette proposition résulte de manière logique de l’idée fondamentale selon laquelle l’individu est rationnel et donc qu’il est capable de reconnaître ce qui va dans le sens de son propre intérêt. Elle est donc “vraie“ et on ne peut pas construire une science économique qui l’ignorerait. Or, elle est contradictoire avec l’idée keynésienne selon laquelle un individu ou un ensemble d’individus gagneraient à ce que la demande qui s’adresse à eux augmente. Certes, on dira peut-être que le raisonnement keynésien est un raisonnement macro-économique. Mais on doit précisément reprocher à la théorie keynésienne de construire de manière arbitraire des concepts dits macro-économiques dans l’ignorance la plus totale des lois du comportement humain. En effet, ce qui est vrai – et nécessairement vrai – pour un individu est vrai pour deux individus, pour trois, quatre, n individus… Ainsi deux individus n’ont pas intérêt à ce que la demande qui s’adresse à eux – si jamais cela était possible – puisse augmenter sans que la demande qu’ils adressent à autrui augmente. Cela signifierait que pour obtenir un même niveau de satisfaction – du fait de leurs achats – ils seraient obligés de remettre plus de biens, c’est-à-dire de faire un sacrifice plus important. N’oublions en effet jamais que l’effort productif est coûteux (en termes d’utilité) et qu’il n’est accepté que dans la mesure où il permet une création nette d’utilité. Le but d’un individu n’est pas de produire, mais de consommer. La théorie keynésienne, de ce point de vue, participe à l’erreur courante consistant à penser que le but d’une « économie » est de produire[2], comme si l’on pouvait parler des buts d’une économie et comme si ceux-ci pouvaient être distincts des buts de chacun de ses membres.
Autrement dit, ce qui intéresse un individu ce n’est pas la demande qui s’adresse à lui, mais le prix relatif des deux biens qui entrent de manière inséparable dans la transaction qu’il envisage de faire. Imaginons donc un certain état initial où A dispose de capacités productives et d’un certain niveau d’information. Pour le prix relatif qui prévaut sur le marché entre le blé et le vin, il est disposé à vendre une certaine quantité de blé contre l’achat d’une certaine quantité de vin. Dire que la demande de blé exprimée par B augmente n’a strictement aucune conséquence pour A si cela ne se traduit pas par une variation de prix relatif : A était satisfait pour les quantités échangées au prix relatif existant et il n’a aucune raison de produire plus de blé et d’en vendre plus à B. Ce qui peut inciter A à vendre davantage de blé ce n’est pas que la demande de blé augmente, mais que cela se traduise par une augmentation du prix du blé (c’est-à-dire une baisse du prix du vin). Si l’augmentation de la demande de blé se faisait à prix constant ou même à prix plus faible[3], A ne trouverait aucun avantage à vendre plus de blé.
Ce qui est vrai pour un individu est évidemment vrai pour un ensemble d’individus, ce qui signifie que – contrairement à ce que fait la théorie keynésienne – on ne peut pas développer directement des concepts macro-économiques dans l’ignorance du comportement individuel. Comme dans le cas de l’individu isolé, n individus n’ont pas intérêt à ce que la demande qui s’adresse à eux augmente (donc que leur offre augmente) sans que la demande qu’ils expriment eux-mêmes n’augmente (sinon cela signifierait qu’ils doivent supporter un sacrifice plus important pour obtenir la même quantité de biens). L’effort productif est toujours coûteux et des individus rationnels cherchent donc à le minimiser. Leur objectif n’est pas de produire le plus possible, mais de consommer (c’est-à-dire détruire) le plus possible, à créer des satisfactions en minimisant les sacrifices qui sont nécessaires pour cela. Ce qui intéresse les individus ce n’est donc pas la demande, mais le prix relatif entre deux biens qui sont inséparablement liés dans l’échange : on ne peut pas augmenter la « demande à » sans augmenter la « demande de » (on ne peut pas augmenter la demande qui s’adresse à A sans augmenter la demande de A) : il n’y a pas de demande sans offre et d’offre sans demande.
Dans l’économie simple où nous nous sommes placés pour le moment il n’y a donc jamais de problème de demande (ce qui restera vrai, comme nous le verrons, dans une économie plus complexe, par exemple une économie monétaire avec beaucoup d’individus et un État). On peut d’ailleurs ajouter qu’il n’y a pas non plus de problème d’offre, de telle sorte qu’au lieu de parler d’économie de l’offre (« supply-side economics »), il vaudrait mieux parler d’économie des incitations productives. Remarquons aussi que le concept de demande globale apparait dans ce cadre simplifié pour ce qu’il est, c’est-à-dire dénué de sens. En effet, peut-on définir la demande globale autrement que comme la somme de toutes les demandes exprimées dans la société considérée ? Dans notre exemple actuel, conformément à la théorie keynésienne, elle serait donc la somme de la demande de A (à B) et de la demande de B (à A). Mais cette demande globale est une demande de qui, adressée à qui ? C’est la demande de blé et de vin exprimée par A et B et destinée à A et B. Ce concept soulève deux difficultés majeures :
- Il y a d’abord une circularité du raisonnement. Imaginons en effet temporairement une situation encore plus simple que la précédente, c’est-à-dire celle de Robinson Crusoé seul sur son île. Cela n’a évidemment pas de sens de parler de la demande de biens adressée par Robinson à Robinson. Si Vendredi rejoint Robinson, on peut certes parler de demandes individuelles (ou demandes partielles) : la demande adressée par Robinson à Vendredi et la demande adressée par Vendredi à Robinson. Mais cela n’a pas plus de sens de parler de la demande globale adressée par Robinson et Vendredi à Robinson et Vendredi que cela n’en avait de parler de la demande adressée par Robinson à Robinson. Dans un ensemble clos le total des demandes est nécessairement égal au total des offres. La demande est nécessairement exprimée par une partie des membres d’une société – par exemple la société mondiale – à une autre partie des membres de cette société. Mais il ne peut pas y avoir de demande globale. La seule réalité c’est celle de l’action humaine[4]. Selon les circonstances les individus satisfont leurs besoins directement par leurs propres activités ou indirectement en passant par l’échange (ou ce qu’on appelle parfois le marché). Or, si l’on peut distinguer de manière comptable la partie « vente » et la partie « achat » dans une transaction, il est dangereux, du point de vue de la compréhension du fonctionnement des sociétés humaines (c’est-à-dire du point de vue de la science économique) de distinguer l’offre et la demande comme étant des fonctions humaines séparées l’une de l’autre. Comme nous venons de le voir, on ne peut pas augmenter la demande globale, mais seulement la demande d’un certain ensemble de biens par rapport aux autres biens. Or ceci peut prendre un aspect spécifique important : si, par exemple, on arrive à augmenter la demande de biens de consommation – comme cela est souvent recommandé – il se peut que cette demande supplémentaire de biens de consommation soit satisfaite du fait du changement d’affectation de certains facteurs de production ; mais cela implique donc une diminution de la production de biens d’investissement (et donc une diminution de la production future). Il n’y a pas augmentation de la demande globale, mais augmentation de la consommation actuelle de certains biens aux dépens de la consommation future.
- La deuxième difficulté que l’on rencontre lorsqu’on cherche à comprendre la signification du concept de demande globale, c’est qu’il conduit à additionner toutes les demandes exprimées par tous les membres d’une société humaine sans se préoccuper des variations de prix relatifs. Or, pour les raisons que nous avons vues ci-dessus, il ne peut pas y avoir de variation de la demande (donc de l’offre) sans variation des prix relatifs entre les biens qui font l’objet de ces demandes particulières dont la sommation est censée constituer la demande globale. Il en est ainsi parce que, pour un certain état des besoins et des connaissances, il ne peut y avoir de changement que si les individus sont incités à modifier leurs comportements. Ceci pose évidemment un problème qui n’a jamais pu être résolu autrement que de manière parfaitement arbitraire (et pour cause), à savoir le problème de la mesure d’un agrégat lorsque les prix relatifs des biens qui constituent cet agrégat varient. Mais plus fondamentalement, il est tout-à-fait clair que l’augmentation du prix relatif de certains biens correspond nécessairement à la diminution du prix relatif des autres biens, de telle sorte qu’une augmentation de la demande globale ne peut apparaître que de manière artificielle. Les producteurs des biens dont les prix augmentent sont incités à produire plus, mais les producteurs des biens dont les prix relatifs diminuent sont incités à produire moins. Il n’y a pas d’augmentation de l’offre globale et de la demande globale, mais une modification des structures productives et des structures de consommation (et d’investissement), en même temps qu’une variation des prix relatifs.
Ces remarques conduisent même à une critique plus radicale, à savoir à la mise en cause du concept même de revenu : on peut spécifier des demandes particulières exprimées par des individus particuliers, mais on ne peut pas additionner de manière non ambiguë des valeurs de marché pour créer des grandeurs macro-économiques mesurables (telles que le revenu national ou la demande globale ou même le revenu d’un individu[5]). Ces remarques ne doivent pas conduire au pessimisme. Elles signifient seulement qu’une partie importante de la science économique repose sur des bases contestables, mais elles ne signifient pas que la science de l’action humaine (la praxéologie selon Ludwig von Mises) soit impossible, à condition qu’elle repose sur des bases cohérentes.
Le problème de l’emploi
Supposons maintenant que A soit employeur d’un troisième individu, C. Il lui demandera des heures de travail jusqu’à ce que le gain marginal qu’il obtiendra de ce fait soit suffisant – de son point de vue subjectif – pour l’inciter à l’employer. Cette relation de salariat n’est qu’une application particulière du principe de l’échange d’après lequel chacun gagne à se spécialiser et à échanger le produit de son activité : C vend des services de travail spécifiques et A joue un rôle entrepreneurial.
Qu’est-ce qui peut alors conduire A à accroître son activité et à employer C pendant un plus grand nombre d’heures (ou à embaucher une personne supplémentaire, D) ?
- Il peut tout d’abord se produire des changements du côté de A lui-même : il introduit par exemple un progrès technique dans son activité, ce qui augmente le gain subjectif qu’il obtient de l’emploi de C. Éventuellement un changement dans l’appréciation du gain subjectif qu’il tire de son activité entrepreneuriale (changements de goûts) peut aussi le conduire à l’accroître. Ces différentes hypothèses n’ont évidemment rien à voir avec une augmentation de la demande (et l’échange entre A et B n’en est d’ailleurs pas forcément modifié). Il en va de même dans le cas où l’accroissement d’activité provient d’un changement de l’environnement. Si, par exemple, on taxait l’échange de services de travail contre salaire et qu’on ne le taxe plus, A est incité à diminuer ses activités autarciques et à accroître sa demande de services de travail, c’est-à-dire à accroitre ses échanges avec C (ou d’autres salariés). Il est d’autant plus vrai qu’il ne s’agit pas d’un problème de demande globale que l’État a précisément diminué sa demande, puisqu’il a diminué les impôts.
- Des changements du côté de B – du même type que les précédents – peuvent conduire à un élargissement du marché entre eux. Il se peut alors que A décide d’accroître un type d’activité, celle qui correspond aux possibilités d’échange avec B, mais ce changement se fait nécessairement aux dépens des autres activités, par exemple le loisir. Ce qui l’incite à faire ainsi c’est qu’il se trouve mieux dans la nouvelle position, c’est-à-dire que ce qui compte pour lui ce sont les incitations et pas la « demande » qui s’adresse à lui : si A change ses activités et augmente son activité marchande, ce n’est pas parce que la demande pour sa production augmente (c’est-à-dire que son offre augmente), mais parce qu’il reçoit plus pour une unité de ce qu’il offre (sinon il n’aurait pas accepté de changement). Ce qui l’incite ce n’est pas la demande pour ses produits, mais bien au contraire la possibilité de mieux satisfaire sa propre demande (obtenir plus de produits par unité vendue). L’application pratique immédiate que l’on peut faire à partir de cette remarque c’est qu’on n’accroit pas l’activité économique des producteurs d’un pays – et donc leurs incitations à embaucher – en exportant plus, en augmentant la demande publique ou, bien sûr, en augmentant la consommation globale. La seule question qu’un économiste doit en effet poser est la suivante : à quels prix ces différentes demandes s’expriment-elles ? Le problème ne serait en rien modifié si, au lieu d’avoir deux échangistes (et un salarié), on en avait trois, c’est-à-dire par exemple que A et D échangeraient avec B. Et bien évidemment il en va de même si on augmente le nombre d’échangistes jusqu’à n (par exemple le nombre de résidents d’un pays) : il ne peut pas y avoir de saut qualitatif dans l’analyse, à partir d’un certain nombre de participants à l’échange.
- Enfin il peut y avoir des changements dans l’environnement. C’est le cas, par exemple, si des obstacles à l’échange sont supprimés et que l’individu A est davantage incité à produire pour échanger (et donc éventuellement à embaucher). De ce point de vue on peut dire que toute baisse d’impôt est souhaitable puisque les impôts modernes sont tous perçus à l’occasion des opérations d’échange au cours desquelles une valeur de marché apparait, rendant ainsi possible la levée de l’impôt par l’administration fiscale[6]. Il est alors bien évident que cette baisse des impôts – et l’éventuelle baisse correspondante des dépenses publiques – ne correspond en rien à une quelconque augmentation de demande globale.
La demande globale dans une économie monétaire
Nous avons donc vu que, dans l’économie non-monétaire où nous nous étions placés jusqu’à présent, le concept de demande globale était dénué de sens : on peut seulement parler de la demande d’un certain ensemble de biens, exprimée par un certain ensemble d’individus, en contrepartie d’une demande d’autres biens exprimée par d’autres individus. Qu’en est-il maintenant si on considère une économie monétaire ? L’ensemble des biens étant maintenant composé des marchandises (biens et services) et de la monnaie, il serait impossible de parler d’une demande globale de marchandises et de monnaie. Mais on peut évidemment parler d’une demande de biens et services en contrepartie d’une offre de monnaie. Mais l’offre et la demande étant inséparables, on ne peut alors pas augmenter la demande de marchandises sans augmenter l’offre de monnaie. De ce point de vue il est faux de penser que la demande globale de marchandises augmente si, par exemple, le déficit public augmente ou s’il se produit une variation positive du solde commercial. Si l’offre de monnaie par les échangistes n’augmente pas, il ne peut pas y avoir d’augmentation nette de la demande globale.
Mais que se passe-t-il si l’offre de monnaie augmente ? Imaginons une situation initiale où tous les individus effectuent les activités qu’ils désirent pour les prix relatifs qui prévalent et où, par ailleurs, ils possèdent exactement la quantité de monnaie qu’ils désirent (compte tenu des prix monétaires existants). Supposons alors que la quantité de monnaie soit doublée. Pour les prix existants, tous les individus se trouvent donc avec des encaisses excédentaires. Ils vont devenir offreurs de monnaie et demandeurs de marchandises. On pourrait être tenté de dire dans ce cas qu’il y a une augmentation de la demande globale de marchandises. Mais cette augmentation de demande globale n’entraine en rien une augmentation correspondante de la production de marchandises (et de l’emploi) puisque ce que tous les individus désirent ce n’est pas d’offrir plus de marchandises contre une demande qui aurait augmenté, mais de se débarrasser de leurs encaisses excédentaires. Comme on le sait bien, la seule conséquence de cette pseudo-augmentation de la demande globale c’est d’entrainer un effet d’encaisse réelle : les prix des marchandises en termes de monnaie augmentent, diminuant la valeur réelle des encaisses jusqu’à ce que les individus se retrouvent exactement avec le niveau d’encaisses réelles qu’ils désirent (celui qu’ils avaient au début). L’augmentation de la quantité de monnaie n’a en rien modifié leurs incitations à produire. Mais on peut certes envisager que certains prix relatifs entre marchandises se modifiant temporairement et que les anticipations de prix des individus n’étant pas parfaites, certains producteurs aient l’impression que leurs activités sont devenues plus rentables et qu’ils soient donc incités à produire davantage. Mais il ne s’agit là que d’illusions qui, d’une part, affectent seulement une partie des producteurs et non la totalité, et qui par ailleurs se dissipent avec le temps. C’est dire qu’il n’y a pas de phénomène de demande globale, mais seulement des phénomènes de prix et de mauvaise information transitoire.
La demande publique et le déficit public
Imaginons maintenant qu’un autre individu arrive – appelons-le l’État – et qu’il fausse les prix relatifs induisant ainsi des comportements qui, sinon, n’auraient pas été désirés. En augmentant sa demande pour certains biens et services l’État ne fait que modifier les prix relatifs d’une manière qui ne correspond pas aux vrais désirs des individus ; il en résulte des gains pour certains et des pertes pour les autres, de manière totalement injustifiée. La conséquence n’en est pas une augmentation de la « demande globale » et donc de « l’offre globale », mais la création de distorsions.
Un exemple typique est celui qui correspond au cas keynésien traditionnel, c’est-à-dire celui d’un déficit public financé par l’emprunt. La tradition keynésienne a imposé l’idée que le passage d’un budget en équilibre comptable à un budget en déficit représentait une augmentation nette de la demande globale et qu’il était donc désirable pour relancer l’économie.
Imaginons donc une situation initiale où le déficit budgétaire est nul et où un individu représentatif, A, se trouve en équilibre, c’est-à-dire qu’il est satisfait compte tenu des prix existant sur le marché. On peut décrire son comportement en disant qu’il agit de manière à ce que l’utilité marginale qu’il retire du loisir soit égale à l’utilité marginale de sa consommation présente, elle-même égale à l’utilité marginale de la consommation future qu’il obtient en investissant son épargne, égale à l’utilité marginale de la consommation future qu’il obtient en prêtant des ressources actuelles afin d’obtenir un certain intérêt. Sa satisfaction diminuerait s’il était obligé, par exemple, d’épargner et de prêter davantage. Il ne sera incité à prêter davantage que dans le cas où le prix du temps sur le marché, c’est-à-dire le taux d’intérêt, augmenterait. Or c’est précisément ce qui se passe normalement si l’État augmente sa demande de biens et finance ses dépenses par l’emprunt car il ne peut inciter les individus à prêter davantage qu’en augmentant le taux d’intérêt.
Or, plaçons-nous dans l’hypothèse extrême où il n’existerait que deux « agents économiques » dans une société fermée, l’individu A et l’État. L’État désire tout d’un coup réaliser un projet et le financer par l’emprunt, celui-ci ne pouvant évidemment être souscrit que par A. Deux cas peuvent alors se présenter :
- Si le projet étatique était réalisable privativement, c’est-à-dire par l’individu A, et si celui-ci ne l’avait pas réalisé c’est parce qu’il obtenait un niveau de satisfaction plus élevé en utilisant ses ressources à autre chose (par exemple le loisir ou la consommation présente) qu’à la réalisation de ce projet. Si l’État lui propose un taux d’intérêt plus élevé pour l’inciter à modifier ses choix, A peut être tenté de réduire son niveau de loisir, sa consommation présente ou sa consommation future qu’il peut obtenir par ses investissements propres (placement de ses fonds propres). Mais dans l’hypothèse extrême [7] où nous nous sommes placés, il lui sera facile de faire le raisonnement suivant. Soit r0 le taux de rendement du projet qui, précisément, était considéré comme insuffisant par A pour qu’il le réalise. Pour l’inciter à prêter les ressources nécessaires au financement de ce projet, il faut donc bien que l’État propose à A un taux d’intérêt r+ supérieur à ro. Mais la différence entre r+ et ro ne peut évidemment provenir que de l’impôt. Or, A étant le seul contribuable, il sait pertinemment que l’État ne pourra lui payer un taux d’intérêt r+ que dans la mesure où il prélèvera par l’impôt la différence entre r+ et ro. Autrement dit, le rendement net après impôt du projet en question pour l’individu A ne peut guère être égal qu’à ro. Puisque, en l’absence du désir étatique, A ne désirait pas réaliser ce projet dont le rendement lui semblait trop faible pour justifier un sacrifice, il refusera évidemment de prêter ses ressources à l’État.
Mais le problème change totalement s’il existe un grand nombre de citoyens. En effet chacun sait qu’il risque de payer l’impôt nécessaire au paiement du taux d’intérêt promis, qu’il ait ou non prêté. Dans ces conditions il vaut donc mieux profiter néanmoins du taux d’intérêt élevé proposé par l’État, si l’on pense qu’il y aura de toutes façons des individus prêts à prêter (et donc des impôts futurs). Et il y en aura effectivement car chacun fait le même raisonnement : il est certain d’obtenir un taux d’intérêt élevé, mais il n’est pas certain que l’impôt correspondant pèsera sur lui et il sait en tout cas qu’il sera réparti sur un grand nombre de contribuables. Le déficit budgétaire, n’est donc qu’un jeu d’illusions. Il provoque des déplacements de ressources, mais pas une augmentation nette de la demande globale, ce qu’il ne peut pas faire.
- Envisageons maintenant le cas où l’investissement projeté par l’État ne pourrait pas être réalisé par une personne privée, c’est-à-dire qu’il s’agit typiquement de ce qu’on appelle un “bien public“. Certes il existe de fortes raisons de penser que les biens publics n’existent pas, mais tel n’est pas le problème qui nous retient pour le moment. Acceptons donc, en dépit de ces réserves, l’idée qu’il existe des biens publics et que tous les individus sont d’accord pour sacrifier des usages privés de leurs ressources afin de financer un bien public qui leur apporte une plus grande satisfaction. Mais il est alors bien clair que ce qui est en cause n’est pas l’existence même du déficit public et de la prétendue augmentation de la demande globale qu’il représenterait, mais la nature de la dépense publique. D’ailleurs si l’on prend l’hypothèse où la population désire unanimement à la fois un bien public et la charge de financement correspondante, ce financement peut être apporté aussi bien par l’impôt que par l’emprunt (c’est-à-dire un impôt futur). C’est dire que l’idée même selon laquelle l’augmentation du déficit public représente une augmentation de demande globale est une idée fausse.
Nous avons jusqu’à présent envisagé une société fermée. Mais nos conclusions ne sont absolument pas modifiées si l’on envisage une société ouverte, c’est-à-dire que la demande globale considérée est seulement une partie de la demande mondiale. Mais alors l’idée même d’une insuffisance de demande globale dans un pays – susceptible d’expliquer le chômage – n’est pas envisageable pour une nouvelle raison. En effet, pour un pays de dimension limitée, la demande mondiale est à peu près illimitée et la seule question que l’on puisse alors légitimement se poser est la suivante : comment se fait-il que les producteurs du pays ne produisent pas plus (et n’embauchent pas plus), alors qu’ils font face à une demande monétaire pratiquement illimitée ? Il ne peut y avoir qu’une réponse logique à cette question : s’ils ne produisent pas plus pour répondre à cette demande, alors qu’ils ont la liberté de le faire, c’est qu’ils n’ont pas intérêt à le faire. Autrement dit, la structure de leurs coûts de production est telle, compte tenu de la structure mondiale des prix, qu’ils ne pourraient vendre plus qu’en vendant à perte. Mais c’est bien dire que le problème en cause n’est pas un problème de demande globale, mais un problème de structure des prix et d’incitations productives.
Le mythe keynésien de la demande globale doit être considéré comme une absurdité et comme une conception totalement erronée de la réalité. Il est pourtant très généralement accepté, en particulier parce qu’il fournit aux politiciens un argument pour augmenter les dépenses publiques. Quant à l’opinion publique elle ne résulte pas tellement d’un effort de compréhension de la part des individus, mais plus simplement de l’acceptation des slogans lancés par les politiciens. Et ces derniers contribuent par ailleurs à renforcer cette fausse croyance, par exemple en en suscitant la présentation dans les enseignements délivrés dans les écoles et les Universités. Si l’on veut véritablement s’intéresser au bien-être des individus, il convient de faire l’effort de raisonnement nécessaire de ce point de vue et l’effort de diffuser la vérité. Nous nous permettons d’avoir l’espoir que le présent texte puisse y contribuer.
[1] Il existe peut-être un keynésianisme extrême consistant à dire que l’on peut toujours obtenir les effets désirés par une augmentation de la demande globale. Mais il n’est pas nécessaire de se référer à cette version.
[2] Ou encore de « créer des emplois », c’est-à-dire détruire du temps de loisir, quelle que soit l’utilité de cette destruction. Un entrepreneur cherche à détruire des emplois, c’est-à-dire à obtenir une production donnée avec le minimum de travail et il a raison. Ce qui est vrai au niveau d’in individu ne peut pas être faux au niveau d’un ensemble d’individus.
[3] C’est une situation de ce type que l’on essaie de créer lorsqu’on subventionne les exportations dans le but de stimuler la demande globale. L’exportateur refuserait de vendre à un prix plus faible, mais on lui paie la différence entre le prix effectif et le prix désiré. Or il se peut fort bien qu’il paie en fait cette différence en tant que contribuable. Mais dans la mesure où l’impôt est en majeure partie payé par les autres, il a tout de même intérêt à exporter.
[4] Nous reprenons ici le titre fondamental de l’ouvrage de Ludwig von Mises : Human Action, Yale University Press, 1949 ; traduction française par Raoul Audouin, L’action humaine, Paris, Presses Universitaires de France, 1985.
[5] Cf. notre article, “The income effect does not exist », The Review of Austrian Economics, IX, N°1, 1996, pp. 95-106
[6] Seul l’impôt de capitation ou impôt forfaitaire par tête échappe à cette caractéristique. Mais il est rarement utilisé à notre époque.
[7] Quelque peu irréaliste, puisqu’on voit mal comment un taux d’intérêt pourrait exister dans une société où il y aurait un seul individu (en-dehors de l’État)
 Pascal Salin est économiste, Professeur honoraire à l’Université Paris-Dauphine. Ancien Président de la Société du Mont Pèlerin, il préside aujourd’hui l’ALEPS (Association pour la liberté économique et le progrès social). Auteur de nombreux ouvrages dont Les systèmes monétaires – Des besoins individuels aux réalités internationales (Odile Jacob, 2016)
Pascal Salin est économiste, Professeur honoraire à l’Université Paris-Dauphine. Ancien Président de la Société du Mont Pèlerin, il préside aujourd’hui l’ALEPS (Association pour la liberté économique et le progrès social). Auteur de nombreux ouvrages dont Les systèmes monétaires – Des besoins individuels aux réalités internationales (Odile Jacob, 2016)