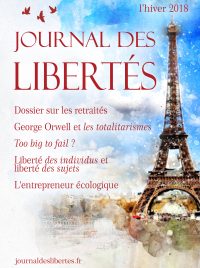Creative Images | Shutterstock.com
Un entrepreneur environnemental est une personne qui trouve des moyens pertinents et novateurs afin de transformer les problèmes environnementaux en atouts, en recourant aux droits de propriété et au marché.
Si la protection et la gestion de l’environnement sont des objectifs partagés par tous, les moyens à mettre en œuvre font, en revanche, l’objet de points de vue divergents. En France le rôle de la puissance publique est capital, via la réglementation et la fiscalité, aussi bien pour fixer les objectifs que pour assurer le financement. Ceci aboutit directement ou indirectement à contrôler de facto les individus, les associations et les entreprises désireuses de combiner entreprenariat et gestion environnementale. Cette situation n’est pas satisfaisante, pour plusieurs raisons : elle décourage l’innovation, favorise la politisation et les dérives idéologiques. Elle s’avère aussi très coûteuse en raison de la bureaucratisation qui en découle naturellement.

|
Jean-Pierre Chamoux. Professeur émérite à l’université Paris-Descartes, il a publié une douzaine d’ouvrages sur l’économie de l’information et la communication. Membre actif de l’ICREI, il a contribué aux conférences internationales de cet institut depuis 1996. Il préside le Comité Jean Fourastié depuis 2007. |

|
Max Falque est juriste et économiste. Diplômé de Science Po Paris il a séjourné deux années à l’Université de Pennsylvanie. Il est Délégué générale de l’ICREI (International Center for Research on Environmental Issues). |
Début juillet 2016, à l’heure où se rassemblaient à Aix-en-Provence les délégués invités à la dixième conférence internationale de l’ICREI (organisée en collaboration avec IES-Europe), aucune initiative, académique ni politique, n’avait encore vraiment mis l’accent, en Europe, sur le rôle que des personnes peuvent prendre pour gérer les ressources environnementales dans le cadre d’une écologie responsable et partagée. Bien au-delà des impératifs régaliens, les retombées bénéfiques que l’action économique du secteur concurrentiel pourrait avoir sur le milieu naturel, en matière agricole, touristique, industrielle ou urbaine étaient simplement ignorées. Le thème choisi pour cette dixième conférence internationale – Environnement : le temps de l’entrepreneur – avait donc de quoi surprendre plus d’un écologue.
Afin de permettre à un large public de prendre connaissance de l’essentiel des débats nous publions cet ouvrage largement bilingue basé sur les interventions très diverses qui ont fait de cette conférence un moment particulièrement intéressant[1].
Le concept d’enviropreneur
Ce terme qui conjugue « environnement » et « entrepreneur » est séduisant ; mais d’autres termes sont aussi utilisés, recouvrant des réalités du même ordre tels : éco-preneur, entrepreneur environnemental, entrepreneur vert, entrepreneur écologique, entrepreneur en développement durable… Toutes qualifient des individus, des entreprises ou des institutions qui, comme tous les entrepreneurs, s’appuient sur le contrat, les droits de propriété et sur le marché pour protéger et pour gérer les ressources environnementales tout en ayant un intérêt financier dans cette exploitation. Dans le meilleur des cas, ces entreprises génèrent des profits tout en favorisant le bien-être social et le respect de l’environnement.
Ces entreprises doivent en effet concilier leur ambition environnementale et la profitabilité qui permet leur développement à moyen terme. Même en l’absence de financement public, des dispositions fiscales (pour autant qu’elles n’entraînent pas trop de contraintes réglementaires) et des campagnes publiques d’information peuvent accompagner utilement les initiatives privées. Les intervenants en apportent de nombreux exemples qui méritent d’être connus, appréciés et imités.
Ainsi que l’explique Peter Thiel, l’enviropreneur devra surmonter les obstacles que tout entrepreneur trouve sur sa route. Son ouvrage, Zéro à un : comment construire le futur [2], connaît un succès considérable (d’autant plus que son auteur est un exemple de réussite exceptionnelle) et détaille les ingrédients nécessaires à la réussite entrepreneuriale. Il se démarque des manuels de management des Business Schools du monde entier. Thiel, dans la lignée des grands classiques et d’Ayn Rand ou encore René Girard, réfute l’idée d’une planification centralisée top-down et avance des propositions originales.
Concernant l’entreprenariat environnemental, Thiel affirme que la vraie raison des échecs en ce domaine est que ces entreprises n’ont pas répondu à une ou plusieurs des sept questions que doit se poser tout entrepreneur environnemental :
- recourir à une technologie radicalement nouvelle au lieu d’améliorer marginalement,
- choisir le bon moment pour démarrer l’entreprise,
- disposer d’une fraction de marché importante,
- disposer d’une équipe adéquate,
- viser une position de marché valable dans 10 ou 20 ans,
- créer, mais aussi distribuer son produit ou service,
- identifier un créneau qui n’a pas été repéré par d’autres.
Thiel met aussi en garde contre ce qu’il appelle le « mythe de l’entreprenariat social »[3] : c’est une approche philanthropique selon laquelle entreprises et secteur philanthropique poursuivent des objectifs radicalement opposés. A vouloir « faire à la fois bien et bon » l’entrepreneuriat social « échoue généralement dans les deux » !
L’éco-entrepreneur : une longue histoire
L’histoire tricentenaire du développement industriel, depuis la révolution industrielle anglaise jusqu’à nos jours, a prouvé amplement que, sous réserve que l’initiative des acteurs privés soit reconnue, appréciée et encouragée, forestiers, chasseurs, pêcheurs, entrepreneurs de collecte des déchets ménagers ou paysans peuvent assurer non seulement l’entretien du milieu naturel, mais aussi maintenir les écosystèmes au sein desquels ils vivent en bon équilibre, biologique et minéral, sans qu’il en coûte grand-chose à la collectivité ni que le citoyen ait quelque chose à redire. De nombreuses études empiriques, appuyées sur une longue histoire sociale, ont souligné l’existence et l’efficacité d’organisations pragmatiques, diverses et variées, dont le propos fut, à travers les siècles, d’assurer le maintien des ressources au fil du temps historique et d’organiser leur répartition équitable au sein de sociétés aussi diverses que réparties à travers la Planète [4].
De nombreux travaux ont également prouvé que le souci écologique n’est un monopole ni de l’action publique, ni des gouvernements, ni des collectivités territoriales ; mais que, sous réserve que les institutions et que les conditions politiques le permettent, une sensibilité naturelle s’exprime en faveur de l’écologie au sein de la société humaine, sous des formes multiples : des organisations privées altruistes peuvent avoir un rôle important dans la conservation des milieux naturels ; l’émulation sociale peut en multiplier l’impact sur le milieu autrement que par la contrainte et par la loi.
Les préoccupations précédentes constituent l’essentiel de ce qui s’apprend depuis plus de deux cents ans dans les écoles d’ingénieurs : toutes ces dispositions grâce auxquelles la productivité, celle des machines, celle des hommes et celle des capitaux, ne cesse de progresser depuis l’aube du XIXème siècle, pour le plus grand bien des conditions de vie et d’existence. Des exemples nombreux démontrent que cet effet n’est pas seulement vertueux mais consubstantiel à l’organisation industrielle : c’est à de telles conditions pratiques — et non à une quelconque politique publique — que l’on doit l’augmentation spectaculaire des productions industrielles et agricoles qui ont permis le mieux-être de toutes les générations qui ont vécu depuis la naissance de la grande industrie. Cette aventure extraordinaire, mise en évidence par de très nombreux travaux économétriques depuis le milieu du XXème siècle, s’appuie sur l’analyse des faits, des procédés de fabrication et des conditions de marché. Elle prouve que, dans un cadre compétitif, faire mieux que ses concurrents est une condition du succès ; qu’améliorer sa marge bénéficiaire n’est pas seulement une démarche égoïste mais qu’elle est aussi altruiste puisqu’elle contribue à baisser les prix et, donc, à partager les dividendes du progrès avec les consommateurs qui sont ainsi les premiers bénéficiaires des gains que dégage la productivité industrielle[5].
L’éco-entrepreneur : le héros oublié
Et pourtant ! Depuis que la préoccupation environnementale s’est imposée au monde politique, vers la fin des années 1960, aucun programme de gouvernement n’a jamais sérieusement considéré, en Europe ni ailleurs, que l’action humaine puisse, en quelque manière et spontanément, épurer les eaux polluées ou les fumées d’usines, sinon sous l’effet de contraintes légales sévères qui ne peuvent être édictées que par la puissance publique. Partout dans notre monde l’impératif écologique s’est donc traduit par des politiques publiques qui prétendent aligner le comportement des hommes et des entreprises sur des normes, techniques et juridiques, que les inventeurs de ces règles considèrent comme d’impérieuse nécessité car ils n’imaginent aucun moyen autre que la contrainte pour arriver à leurs fins : il faut, pensent-ils, imposer à tous ces normes impératives par la loi car seule une action conçue d’en haut, par un pouvoir politique inspiré, pourrait modifier les comportements et rectifier les dégâts environnementaux[6].
Une telle certitude est rarement contestée de nos jours : elle est en parfait accord avec une conception messianique de l’action publique qui imprègne en profondeur la vie politique et les démocraties modernes depuis plus d’un siècle. Elle contribue à donner de l’importance aux bureaucraties nationales et internationales, très actives en matière d’environnement ; elle traduit une conception du bien commun qu’impose l’État-Providence omniscient dont l’influence n’a cessé de croître au cours du XXème siècle. Popularisée à l’échelle mondiale par le Président Roosevelt, la délégation qu’accorde le pouvoir politique à son brain trust installa un pouvoir technocratique qui est devenu la référence de tous les régimes politiques modernes, de Tchang Kai Chek à Peron et de la Suède jusqu’à Singapour.
Dans le domaine qui nous intéresse ici, l’entourage des hommes politiques, les organisations non-gouvernementales comme Green Peace et les fonctionnaires internationaux ont progressivement pris largement le dessus sur le suffrage populaire et sur l’expression parlementaire ; quant à l’initiative décentralisée des entrepreneurs et des individus ordinaires, elle a été exclue du débat, pour l’essentiel.
Après avoir trahi leurs mandants, seuls des clercs mènent désormais l’environnement dans le monde ; et ils produisent ce qu’ils savent faire et ce qui maintient leur prépondérance : des lois et des règles impératives[7]. Sûrs de leur rôle, nos États tutélaires les suivent : ils édictent ainsi des lois dont ils sont persuadés qu’elles sont bonnes car eux les jugent nécessaires ; ils les imposent à tous par la force publique, avec l’espoir qu’elles contribuent à reconstituer l’harmonie mythique d’un Eden originel que l’on promet de reconstituer au présent, par une démarche volontaire… et par la contrainte. Inspirée par cette vision messianique, l’écologie militante ressemble en définitive aux doctrines redistributives comme le keynésianisme : c’est un stéréotype constructiviste qui plonge ses racines autant dans l’histoire ancienne (celle des platoniciens, notamment) que dans le mythe du « bon sauvage », cet idéal-type qui serait, par essence, respectueux de l’état de Nature.
Dix ans avant la Révolution française, Rousseau, ce « Promeneur solitaire », se considérait, à la fin de sa vie, comme : « un être isolé qui ne désire ni ne craint rien de personne, qui parle aux autres pour eux et non pour lui (…) qui chérit trop ses frères pour ne pas haïr leurs vices ». Persuadé de sa mission révélée, notre philosophe des Lumières rêvait d’éradiquer les tares d’une société qu’il croyait pervertie par la déviance fondamentale des hommes civilisés : innocents et vertueux aux premiers temps du monde, il les voyait « pervertis par la science et les arts », par les conventions sociales, par la politesse et par son corollaire : l’hypocrisie [8].
De même, l’écologiste militant d’aujourd’hui accuse la société industrielle de dévoyer ses semblables, de leur inspirer des comportements agressifs tant envers les autres hommes qu’envers le milieu naturel. Il estime subir des dommages du fait de l’industrie, alors que notre inspiration profonde nous porterait à vivre paisiblement au sein d’une Nature vertueuse, bienveillante et généreuse, ce que Jean-Jacques Rousseau résumait ainsi : « ce sont le fer et le blé qui ont civilisé les hommes et perdu le genre humain »[9]. Déniant aussi bien le « péché originel » chrétien que l’hypothétique être sauvage, Rousseau dénonçait la propriété comme la mère des vices que sont le mensonge, la cupidité et la jalousie qu’il condamnait vertement. C’est au gouvernement, disait-il, qu’il revient de redresser la barre. L’État-providence avait ainsi trouvé par avance son prophète qui annonçait l’écologie militante.
L’erreur perdure mais il est encore temps
Revenons aux temps présents : la pauvreté, l’inflation, les troubles économiques et monétaires, tous ces « maux qui affligent la problématique mondiale » ne découleraient-ils pas aussi du comportement malin des hommes et de leurs institutions[10] ? Pour les suiveurs de Rousseau et Platon, aucun doute possible ! C’est pourquoi ils transposent à nos jours les leçons du penseur genevois ; l’écologie politique, vise, comme le faisait Jean-Jacques Rousseau lui-même, non seulement à changer les hommes et à leur faire redécouvrir l’état originel de nature ; mais à redresser aussi leurs institutions afin d’en éradiquer les vices accumulés par des siècles de civilisation maligne. Pour parvenir à une telle fin, il a d’abord fallu que les hommes de notre temps prennent conscience du mal, tâche que s’était donné, avant bien d’autres, le Club de Rome sous la houlette de son fondateur Aurelio Peccei, afin d’exhorter dirigeants, gouvernements et organismes internationaux à unir leurs forces pour faire cesser, par l’indignation d’abord et, au besoin, par un diktat politique, le péché environnemental qu’ils dénonçaient, en Amérique et ailleurs ; un péché menaçant notre bien-être et même la survie de la planète Terre, affirmaient-ils, deux siècles après les diatribes de Rousseau.
Ce messianisme n’a cessé d’élargir son influence depuis les années soixante. Après s’être appuyé sur une partie de la gauche libertaire (les liberals Etats-Uniens,) son influence a gagné les organisations internationales comme les Nations-unies. C’est donc dans les forums internationaux que se retrouvent les porte-paroles de nombreux groupes d’intérêt, tous inspirés par l’écologie militante qui a ainsi obtenu des lettres de créance qui lui permettent de faire endosser par l’Europe communautaire un très grand nombre de normes contraignantes que la France rassemble dans son « Code de l’environnement ».
Il convient de souligner que, dès l’apparition du ministère de l’écologie qui remonte au mandat quadriennal du ministre Poujade, au temps du Président Pompidou, les dispositions proposées, débattues et mises en œuvre par la République française furent toutes de nature régalienne ; et que, depuis cette époque, l’écologie gouvernementale n’a consisté, en France comme dans trop d’autres pays, qu’à concevoir et à édicter des normes réglementaires ; qu’à créer et à spécialiser des institutions publiques qui dictent les règles, qui les détaillent et qui les imposent au public ou à l’industrie ; ainsi qu’à prélever toutes sortes de taxes pour financer les dispositifs qui appliquent ces normes et ainsi de suite[11].
Tous les pays sont confrontés à un immense défi : accroître leurs possibilités économiques tout en tenant compte des pressions croissantes que la croissance fait peser sur l’environnement. Les entrepreneurs sont au cœur de solutions « bottom up » pour relever ce défi. Cependant, l’incertitude du marché et de la technologie concernant leurs activités implique que « l’entrepreneur vert » doive, en règle générale, faire face à bien plus d’obstacles que l’entrepreneur classique, y compris pour défricher le marché, surmonter les contraintes financières, le manque de collaborateurs qualifiés et les barrières réglementaires.
Le rôle des pouvoirs publics est d’assurer un environnement permettant à l’entrepreneur vert de développer de nouvelles idées, de croître et de maintenir un lien étroit avec les consommateurs, les concurrents et autres acteurs impliqués. Cet ouvrage collectif cherche à approfondir ce concept d’entrepreneur vert ; il commente le rôle des politiques qui encouragent l’entrepreneuriat, qui prennent en compte l’encouragement et les barrières à l’éco-innovation et aux business models écologiques.
L’activisme entrepreneurial aiguillonne l’innovation, ce qui explique l’amélioration des conditions d’existence grâce à laquelle le genre humain a échappé à la fatalité malthusienne. Nous devrions donc favoriser l’activisme entrepreneurial. Parallèlement, nous devrions accueillir avec réserves les politiques qui inhibent l’innovation. Curieusement, innovation environnementale et innovation entrepreneuriale sont souvent perçues comme antagoniques, comme si l’une jouait au détriment de l’autre. Cette erreur en colporte une autre : la gestion publique des biens environnementaux en serait le seul mode de production. Or le management public échoue fréquemment ; de surcroît, il tue dans l’œuf le désir d’innover en la matière.
Les droits de propriété, physiques et/ou immatériels sont au cœur de l’activisme entrepreneurial et de l’innovation. C’est cela que nous avons voulu explorer au cours de cette conférence et ce sont les fruits de cette réflexion, dont l’urgence nous paraît évident, qui vous sont offertes à travers les pages de cet ouvrage dont vous trouverez ci-dessous la liste des contributions ; liste qui, à défaut de vous donner une idée précise des conclusions, vous permettra de mieux saisir la diversité et la richesse des interventions parfois divergentes. Mais pour avancer n’est-il pas important de croiser les points de vue et d’essayer de dégager un consensus sur quelques points fondamentaux ?
Au sommaire de l’ouvrage
Partie 1 : Témoignages et études de cas
- Environmental entrepreneurship: case studies of common pools with the Ostroms, John Baden (Free Foundation, Montana)
- Opportunities for the Environmental Entrepreneur, Iain Murray (Competitive Enterprise Institute, Washington D.C.)
- Entrepreneurship and the Environmental Discovery Process, Paul Schwennesen (Agrarian Freedom Project)
- Agricultural Land: Management in common from ideas to implementation, Sjoerd Wartena (Terre de Liens)
- The underwater enviropreneur, Reed Watson (PERC Institute, Montana)
Partie 2 : Questions de droits
- Protection des actifs immatériels de l’entrepreneur environnemental, Pierre-Dominique Cervetti (Avocat et Professeur de Droit, Aix Marseille Université)
- Stimulating Private Land Conservation Entrepreneurship, Thierry de l’Escaille (European Landowners’ Organisation)
- Droits de propriété et entrepreneuriat environnemental en Afrique, Robinson Tchapmegni (Professeur de droit, Québec)
Partie 3 : Économie et sciences politiques
- Afrique du Nord et Moyen-Orient : environnement, croissance et entreprises vertes, Antoine-Tristan Mocilnikar (Ministère de l’Environnement, France)
- Incentives or market failure : diverging policies on waste management, Pierre Desrochers et Erwan Queinnec (Universités Paris et Toronto)
- Green entrepreneurship for innovation and growth: what can governments do? Lucia Cusmano(OCDE)
- Cleantech start-up development, David Dornbusch (CleanTusday)
- Verdissement : par l’entrepreneuriat ou par une action politique ? François Facchini et Benjamin Michallet (Université Paris 1- Panthéon Sorbonne)
- Institutions et entreprenariat environnemental, Max Falque (ICREI) avec une annexe : Droits de propriété et la performance environnementale
- Les eco-entreprises : des entreprises comme les autres ? Michel Debruyne (Université de Lille)
Partie 4 : Réflexions doctrinales
- Entreprise et développement durable : au-delà des apparences, Dominique Bidou (Consultant)
- Économie circulaire, entreprises, territoires : freins et leviers, Yvette Lazzeri (Aix Marseille Université – CERIC)
- Ecologie & entreprenariat : une comparaison entre la France et les Etats-Unis, Michel Marchesnay (Université de Montpellier)
Réflexions conclusives
Environnement : le temps de l’entrepreneur ? Jean-Pierre Chamoux (ICREI)
[1] Environnement : le temps de l’entrepreneur/ Environment and Entrepreneurship, sous la direction de M. Falque, J.P. Chamoux et E. Queinnec, Nice, Editions Libre Echange, 250 p. 1er trimestre 2019. Cet ouvrage comprend une vingtaine de chapitres rédigés en français ou en anglais précédés de résumés bilingues.
[2] Éditions Jean-Claude Lattès, 2016.
[3] Analogue au concept de Responsabilité Sociale des Entreprises.
[4] C’est évidemment à Elinor Ostrom, aujourd’hui disparue, qu’il est fait référence ici, et particulièrement : Governing the Commons : The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge U.P. (1990) traduit en français sous le titre La gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des ressources naturelles, de Boeck, 2010.
[5] Deux sources classiques sont très éclairantes à ce propos : Simon Kuznets, Modern Economic Growth, Yale U. P. (1966) ; et Jean Fourastié : Le grand espoir du XX° siècle : progrès technique, progrès économique, progrès social, PUF (1949) -nombreuses rééditions ultérieures.
[6] La formulation de Barun Mitra, Directeur du Centre for Civil Society à New Dehli, était limpide : « the environmental awareness and concerns have made governments across the world expand their scope, and gone on a spree to bring in a huge array of regulations to protect the environment… this approach has greatly restricted the creative and entrepreneurial spirits to deal with environmental challenges… regulations and subsidies have attracted a number of cronies to corner a large share of this (public) pie » (courriel de soutien à la conférence d’Aix en Provence adressé à Max Falque, 26 Décembre 2014).
[7] Nous faisons évidemment allusion à la thèse prophétique de Julien Benda : La trahison des clercs, réédition Pluriel Livre de poche, n°8309, Grasset (1927).
[8] Discours sur les sciences et les arts, Éditions GF-Flammarion pp. 40-46. Dans ce texte, conformément à l’usage du 18ème siècle, le terme « les arts » (au sens des « arts & manufactures » ou des « arts et métiers ») équivaut à ce que nous nommons aujourd’hui : « la technique ».
[9] Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité entre les hommes, op.cit. p.232.
[10] cf. le premier rapport Meadows paru en 1972 avec le soutien du Club de Rome : The limits to Growth, Earth Island, London (ed. Européenne, 1972), « Foreword », pp.10-11.
[11] « La France n’est pas seule, elle n’est pas seule ! » proclama le général de Gaulle à un tout autre propos : il en fut de même pour l’écologie, aux quatre coins du monde, du Cap nord au Cap de Bonne Espérance et de Tokyo jusqu’à New York ; jusqu’à la trop fameuse « Conférence de Paris », la COP 21 dont les retombées sont encore à écrire…