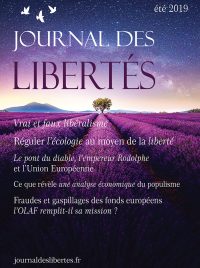Quelle ambition que cette vaste enquête intellectuelle à travers les arcanes de la démocratie et du populisme ! Les deux directeurs de ces travaux titanesques ont réuni les contributions, inévitablement inégales, de près de 70 auteurs de diverses nationalités et sensibilités. La trame générale consiste à défendre une certaine idée de la démocratie qui n’exclue pas nécessairement des formes de populisme et d’en poser les limites ; les points de vue sont parfois tranchés et opposés, ce qui fait d’ailleurs en partie l’intérêt de l’ouvrage. Il n’est donc pas possible d’en livrer en quelques lignes une analyse exhaustive, mais plutôt d’en brosser une image, d’essayer d’en extraire l’esprit, ce qui est sans doute bien téméraire aussi.
Chantal Delsol fixe bien d’emblée le cadre de l’étude qui ne se veut pas un panégyrique démocrate car « aucun régime n’est immortel » et nous savons aujourd’hui que ceux qui ont cru que la chute du Mur annonçait la « fin de l’histoire » se sont trompés. La mort de l’empire soviétique qui s’était approprié indument la démocratie dite populaire n’a pas mis fin à la dénaturation des mots par ceux qui voudraient imposer partout la démocratie sociale, de l’école à l’entreprise et aux institutions sociales ou militaires alors que « la démocratie est faite pour la société civile, société ouverte, mais ne s’applique ni à l’armée, ni à l’Université, par exemple, qui sont des sociétés fermées. Contrairement à ce que pensent certains, on ne résoudra pas les problèmes de la démocratie par « toujours plus de démocratie », de même qu’on ne résoudra pas les problèmes de l’Europe par « toujours plus d’Europe » » (p.10). Elle note d’ailleurs que, selon les mots même de Vaclav Havel, l’idée que la démocratie puisse advenir de manière finie a quelque chose de communiste, de chosifié, « comme si les structures idéologiques du XXème siècle, en s’en allant, avaient laissé à la démocratie leur forme propre : une rationalité excessive, un statut idéologique qui ne lui convient pas. Cette rationalisation nous entraîne dans des tentatives folles et infructueuses qui consistent à vouloir implanter artificiellement la démocratie dans n’importe quel pays, comme si elle était un simple outil mécanique, que tout le monde pourrait utiliser également » (p. 11). L’ouvrage s’inscrit lui-même dans cette idée que toutes les conceptions de la démocratie ne sont pas possibles mais qu’aucune n’est définitive et parfaite et il laisse donc la place à la critique et à l’apport de chacun. Il fait avancer la réflexion en essayant de fixer néanmoins un cadre.
Il est vrai que la lecture désoriente parfois. Celle de l’universitaire Daniel A. Bell, qui enseigne à l’université de Shandong en Chine (à ne pas confondre avec le sociologue Daniel Bell mort en 2011), par exemple, qui semble avoir subi un lavage de cerveau pour récuser le système démocratique lui-même et vanter le système chinois « méritocratique » et, dit-il, « probablement le plus compétitif du monde » qui a si bien réussi qu’il « a semé le doute quant à la dichotomie du « bon » démocratique versus le « mauvais » autoritaire » (p.298). Certes, il est vrai que ce débat peut s’inscrire dans celui qui a existé entre Platon qui voulait confier le pouvoir à celui qui sait et Aristote qui croyait que la pouvoir est une question de jugement droit que tout un chacun peut avoir (p. 22). Mais on sait comment finissent les régimes qui ont la prétention de savoir pour les autres, car « le problème est qu’une décision politique objective et scientifique n’existe pas. La politique ressort au problème de l’humain, toujours complexe et contingent » (p.24). Le populisme n’est d’ailleurs sans doute qu’une mauvaise réponse à des technocraties qui se sont emparées du pouvoir au prétexte de tout savoir. Mais la tentation platonicienne est toujours présente, ce dont témoigne à sa façon le premier texte présenté, de Daniel et Martin Andler, qui attendent « le jour où s’ouvrira la frontière entre le monde politique et économique et le monde scientifique » (p.58).
Qu’est la démocratie ?
Marek Cicocki (p. 367) rappelle que selon Fareed Zakaria, le modèle libéral de la démocratie peut être défini comme un système caractérisé par des élections libres et équitables, le règne de la loi, la séparation des pouvoirs et la protection des libertés fondamentales d’expression, de réunion, de religion et de propriété.
Mais la démocratie est peut-être plus facile à définir par ce qu’elle n’est pas. Et il faut affirmer d’abord que, contrairement à ce que, sous l’emprise de l’héritage stalinien, beaucoup suggèrent encore, le goulag ou les camps chinois ne peuvent pas être la démocratie, fût-elle populaire, comme le rappelait Raymond Aron. Avec celui-ci, il est possible de considérer que la démocratie est une autre forme de radicalité qui « engage une pratique du doute et de la liberté, elle prend à bras le corps l’incertitude qui fait le cœur battant des démocraties, leur force vulnérable » (Jean Birnbaum, pp.70-71). Dire encore ce qu’elle n’est pas, c’est souligner avec Blandine Kriegel que la démocratie est intimement liée à l’Etat de droit qui « ne vient donc pas de l’Empire et ne prend pas la place du Sacerdoce. Il n’est pas divin comme la royauté de droit divin, il n’est pas un corps mystique. Les droits de l’homme qui sont attribués à des individus ne dépendent nullement de l’autonomie et de la volonté » (p.165). Le texte de Blandine Kriegel est pourtant ambigu car les droits de l’homme sont plutôt – me semble-t-il – des droits naturels qui ne sauraient être « attribués » par l’Etat, mais plutôt reconnus et protégés par lui. D’ailleurs Blandine Kriegel semble méconnaître les limites entre la charité, à la discrétion de chacun, et la loi, qui oblige la communauté, en considérant que le message christique « Aime ton prochain comme toi-même » constitue « la loi naturelle et le droit naturel, au fondement de la cité républicaine » (p.165) quand il m’apparaît que l’intégration de cet enseignement judéo-chrétien au domaine du droit est au fondement de l’Etat providence dans une sorte de débordement de l’Etat de droit qui repose, lui, sur l’enseignement biblique originel, négatif, de ne pas faire à autrui ce qu’il ne voudrait pas qu’il nous fasse.
La démocratie n’est pas non plus ou ne pourra pas être refondée dans une espèce de participation radicale et permanente appelée par une forme de populisme : « cette démocratie-fin, programme politique d’une participation intégrale, d’un consensus plus large, d’une transparence transparente et d’une représentation plus parfaite n’est pas la solution : plutôt le chemin sûr vers son effondrement » (Jeronimo Molina, p.187). « L’idée démocratique ne se limite pas à des principes institutionnels, comme la séparation des pouvoirs et l’élection, elle repose aussi sur un corpus de valeurs » note Thierry de Montbrial (p.194). Mais s’il a raison de citer la Magna Carta anglaise de 1215 comme un fondement, faut-il y joindre, comme il le fait, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 qui institutionnalise les droits créances comme un poison corrosif des libertés ? Car c’est bien l’accumulation de ces droits créances qui conduit inéluctablement à faire croître l’Etat jusqu’à « la démoralisation des classes moyennes qui résulte du terrorisme fiscal, l’équivalent « libéral » du KGB soviétique » note Dalmacio Negro Pavon (p.207).
La démocratie n’est pas une solution définitive. « Prétendre fixer les problèmes en décidant une fois pur toutes de ce qui est bon ou mauvais est une œuvre messianique sécularisée. Les prophètes en politique, ceux qui se mettent dans la posture christologique du porteur de la bonne nouvelle, commettent une démesure – le plus grand vice pour les pères de la démocratie que furent les Grecs » observe à juste titre Stéphane Bauzon (p.289) qui ajoute : « Comme la justice, la démocratie est précaire, vacillante et approximative » (p. 291).
Qu’est le populisme ?
Le populisme se nourrit sans doute du refus de l’inquiétude naturelle que toute démocratie entretient à l’égard de l’Homme autant que d’elle-même. Mais il prospère aussi bien quand la démocratie perd confiance en elle-même que quand elle devient arrogante. Pour Myriam Revault d’Allones, quand la démocratie classique a perdu toute son énergie pour ressembler à une coquille vide, fleurissent les démocraties dites « illibérales », « ces régimes qui réduisent le système démocratique à la légitimation des gouvernants par l’élection et qui, une fois le vote passé entreprennent d’affaiblir ou de détruire les contre-pouvoirs liés à l’état de droit » (p.719). Mais quand les experts en démocratie s’arrogent l’exclusivité technocrate de ceux qui savent, le populisme finit aussi par surgir en réaction. Mathieu Bock-Coté dénonce à cet égard la démocratie qui « ne se pense plus sous le signe de la délibération mais de la révélation » (p.319). Les populistes cherchent alors à s’emparer directement de la décision en faisant fi du gouvernement des experts. Ils naissent du sentiment d’être exclu d’un consensus réservé aux élites. Le populisme dit Vincent Coussedière « est la situation dans laquelle se trouvent les peuples européens, il est la lutte des peuples malades qui voudraient retrouver la santé, c’est-à-dire qui voudraient redevenir des « peuples politiques » » (p.383). En même temps, et paradoxalement, le populisme s’exprime souvent dans « une relation directe entre la masse et le leader ; une nation conçue comme ‘une seule volonté’ incarnée par le Président, qui implique la négation même de la politique » (p.902) comme la soi-disant « démocratie participative » ou « démocratie patriotique » vénézuélienne de Chavez décrites respectivement par Stephen Launay et Michaël Rabier d’une part et par Carole Leal Curiel d’autre part.
Le populisme est en partie le fruit du dévoiement de la démocratie qui s’assimile désormais à l’Etat providence. En promettant tout, celui-ci est sûr de décevoir, et en infantilisant tous les citoyens, il les conduit à l’incapacité et à la révolte. L’Etat est devenu un grand ordonnateur économique et social qui gagne en impuissance à la mesure qu’il étend ses pouvoirs. Tous attendent tout de lui et il n’est plus capable d’y pourvoir. Mais son impuissance est aussi parfois, et légitimement, liée à ses propres principes qui lui interdisent d’utiliser les mêmes moyens que ses ennemis, les djihadistes ou les casseurs (Jenny Rafik), ce qui suscite l’incompréhension des populistes réfugiés dans un « repli xénophobe et… la nostalgie d’un monde qui n’est plus » (Philippe d’Iribarne, p.425) alors même qu’il n’a en fait jamais été. Finalement le populisme existe sans doute parce qu’il y a un mauvais exercice de la démocratie. Le populisme est « une mauvaise réponse à de vrais problèmes » dit Alessandro Ferrara (p.443). Le populisme ne serait-il alors que la part maudite de la démocratie, l’ombre portée de la démocratie » (Stéphane Vibert, p.576) ?
Des solutions ?
La subsidiarité (Jean-Thomas Lesueur) et la démocratie directe (Olivier Meuwly) sont présentées comme des remparts contre le populisme. Beaucoup de contributions se tournent vers la Suisse et le miracle de ses votations qui refusent les minarets, la cinquième semaine de congés payés, la réduction des 42 heures hebdomadaires de travail pour les salariés, la suppression du forfait pour les étrangers… Ces initiatives populaires permettent, note Jean-François Mayer, « une culture de débat public dans lequel le débat se poursuit ensuite même entre tenants de positions antagonistes » (p.681). Mais le miracle suisse n’est-il pas une exception ? Georges-Henri Soutou fait part de ses réserves à l’égard du référendum après le souvenir négatif des plébiscites de Napoléon III et l’utilisation qu’en a faite Hitler. Le tirage au sort est présenté (Gil Delannoi) comme une solution, mais est-il utilisable autrement que dans de petites circonscriptions ? Et il faut dire aussi que dans les anciennes cités grecques où il existait, il n’empêchait pas que certaines fonctions soient réservées aux plus compétents.
Analysant la démocratie allemande dont il constate qu’elle a toujours vécu des soubresauts, Horst Möller, se demande à juste titre si le débat sur la crise n’entretient pas lui-même la crise (p.962) en exagérant les problèmes. « Dans ce contexte, écrit-il, il faut aussi mettre en garde de ne pas adopter un climat d’alerte qui ne sert pas la démocratie mais les partis populistes de droite : ce sont justement eux qui vivent de l’atmosphère de crise » (p.967). Et il conclue que « Ce ne sont pas les populistes qui représentent le vrai danger, mais ces démocrates qui laissent irrésolus les problèmes, dont les populistes sont l’expression » (p.969). Au demeurant, l’ordre libéral progressif de l’après-guerre froide n’a-t-il pas été trop loin, évoque Marek Cicocki, dans « la levée radicale des frontières, le rejet de l’identité nationale et collective, sa déconstruction de la religion et de la culture, sa dénonciation du rôle de l’Etat » (p.376) ?
Dans sa conclusion Giulio De Ligio observe que les crises de la démocratie « ne manifesteraient au fond que la modalité ordinaire – ou la logique bien comprise – d’un genre de société qui accepte l’incertitude de ses croyances, l’absence de critères naturels des lois ou l’autonomie de ses sujets » (p.1008). Mais la démocratie doit rester forte de ses convictions. La démocratie ne peut revivre qu’en s’inscrivant « dans une société ouverte qui, certes avoue son incomplétude, assume son inachèvement ou sa fragilité, mais affirme la vitalité de ses relations sociales et de ses perspectives d’avenir » (Myriam Revault d’Allones, p.726). La démocratie doit aussi faire confiance au jugement commun. « La vie démocratique oblige à l’abandon de la posture d’autorité coupant court à toute discussion » note Gaëlle Demelemestre (p.408) qui rappelle la remarque d’Aristote selon laquelle « les convives d’un banquet sont mieux placés que les chefs cuisiniers pour apprécier leur art culinaire » (p.416).
Sylvain Fort cite (p.860) opportunément Tite Live qui constate que toutes les choses de ce monde s’altèrent, mais que « pour les religions et les républiques, …ces altérations salutaires sont celles qui les ramènent à leurs principes ». C’est sans doute ce retour à ses principes que devrait faire la démocratie qui a été conçue et s’est construite pour permettre aux hommes de vivre libres et égaux en droit plutôt que pour être assistés du berceau au tombeau. La démocratie a besoin d’idéal autant que de réalisme. Elle a besoin d’être forte dans ses fondements et de rester prudente dans ses affirmations autant que dans son exécution. Elle ne saurait dire le Bien, mais pas non plus ignorer « les contenus matériels et spirituels qui ‘intègrent’ les hommes » note Giulio de Ligio qui termine l’ouvrage en soulignant que « l’intelligence de la démocratie doit à la réflexion de ceux qui continuent à considérer ses conditions politiques et à chercher la forme de vie que la démocratie cherche à actualiser » (p. 1023). La démocratie ne saurait être un régime parfait, mais elle est toujours perfectible. Quand elle l’oublie elle nourrit les populismes, comme elle le fait aussi quand elle s’affadit.