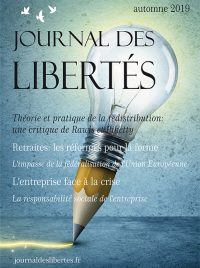La justice recherche le bien commun quand la morale veille au bien des personnes. Le juste attribue à chacun ce qui lui revient légitimement, il partage et départage. Le Bien donne sans compter, sans retour, librement. Le Bien est ce vers quoi chacun tend pour réaliser sa propre nature et en ce sens il est presque comme le but ultime de la justice qui a vocation de permettre aux hommes d’être libres de réaliser leurs fins. Mais quand le droit tend à confier à la collectivité le soin de dicter aux individus le Bien qu’ils doivent faire, la justice s’égare au risque de réduire la liberté des hommes qu’elle a mission de laisser prospérer.

La morale a pris le pouvoir
Progressivement la morale prend le pouvoir sur la justice comme dans la loi et son exécution. Et en prétendant faire le Bien, le droit usurpe ses droits. L’Institution de la justice a elle-même du mal à résister aujourd’hui à une fausse bienveillance qui confond le Bien et le Juste et elle prend ainsi le risque de se perdre. Désormais, le règne de l’opinion, et parfois simplement de la foule rassemblée sur le nouveau forum des réseaux sociaux cherche, au nom d’un Bien illusoire, à instruire le procès avant les magistrats et à leur place dans un mouvement que la force du nombre amplifie à mesure que son intelligence s’estompe comme déjà Gustave Le Bon l’avait exposé au XIXème siècle. Divers exemples en témoignent dont, cette année, le jugement de première instance du 7 mars 2019 prononçant à l’encontre du Cardinal Barbarin une peine de six mois de prison avec sursis pour non dénonciation d’un délit de pédophilie qui n’a pas été jugé alors que le présumé coupable est vivant et fait l’objet de poursuites. Il est curieux de condamner un seul des prévenus pour ne pas avoir porté à la connaissance de la justice des faits que plusieurs d’entre eux ont connus et qui ont été commis près de vingt ans avant que l’accusé en ait entendu parler et que la victime, majeure depuis longtemps et capable, pouvait dénoncer elle-même ; curieux encore de le condamner pour des faits prescrits depuis longtemps. Les juges ont sans doute voulu satisfaire l’opinion qui demandait un coupable alors que le vrai coupable lui-même est en attente de son propre jugement. Ils auraient opéré une sorte de justice sacrificielle, élevant l’autel d’un bouc émissaire pour contenter la foule ou même seulement pour arrêter le cri des victimes. Mais la justice qui sacrifie un innocent au nom de la morale, se conduit de manière barbare, tout à la fois injuste et immorale. En libérant Barabbas, Pilate répond aux vœux du peuple mais sa décision n’est ni bonne ni juste.
Et quand la justice discerne encore le Bien du Juste, ce qui reste heureusement sa règle usuelle, c’est le pouvoir politique qui vient la remettre en cause. C’est ce qui est arrivé avec l’affaire Sauvage : « C’est une sorte de désastre parfait, observe Olivia Dufour. La justice conspuée par les médias a fini par être désavouée par le politique alors qu’elle n’avait en rien dysfonctionné »[1]. Le 10 septembre 2012, Jacqueline Sauvage, 65 ans, avait elle-même appelé les pompiers pour leur dire qu’elle avait tué son mari. Elle lui avait tiré en fin d’après-midi trois coups de carabine dans le dos après avoir fait l’objet de violence de sa part dans la matinée. Elle se défendait en arguant de la brutalité habituelle de son mari depuis des années. Ses filles vinrent à son secours en dénonçant les viols de leur père dont, jeunes, elles avaient été les victimes. L’affaire fût jugée et rejugée puisqu’elle vint deux fois en cassation. Chaque fois la prévenue fut condamnée à défaut de justifier de ce qu’elle alléguait. Une femme battue qui n’a jamais dénoncé son mari ne peut pas le tuer froidement plusieurs heures après des faits de violence alléguée en revendiquant une légitime défense proportionnée, sauf à ouvrir la porte à une sorte de droit de tuer à toute femme battue ! Condamnée à la prison ferme, cette femme de tête en appela à l’opinion publique qui se déchaîna en sa faveur, avec d’innombrables soutiens d’élus démagogues, jusqu’à obtenir la grâce de François Hollande bafouant l’avis unanime des juridictions et le droit constant, au nom de l’émotion caractéristique d’un détournement du Bien et du Juste à la fois.
Les dérives de la justice ne sont pourtant que le reflet de la politique qui lève de plus en plus souvent la bannière du Bien pour s’insérer dans la vie de tous en gommant les limites privé/public. La loi commence par nous dire ce qu’il faut manger et boire, comment il faut construire nos maisons, les règles qui doivent régir les relations entre employeur et employé… Puis, elle taxe, interdit, pénalise…. L’Etat s’érige en seul dispensateur du Bien. Il ne paye les écoles de nos enfants que s’ils vont dans les siennes. Seuls les diplômes qu’il délivre permettent de devenir avocat, pharmacien ou médecin. Il fait voter des lois spéciales pour museler la liberté de la presse durant les campagnes électorales. Il assomme les contribuables de charges fiscales et sociales qui les engourdissent et les conduisent à faire eux-mêmes toujours plus appel à lui dans un mouvement de servitude volontaire. Il habitue les citoyens à subir son intrusion toujours plus loin pour « sa » bonne cause.… Il peut y avoir un long chemin, mais il n’y a plus de frontières entre les aviseurs fiscaux rémunérés et « La vie des autres » sous le regard de la Stasi[2]. Cette confusion du Bien et du Juste, de la morale et de la justice satisfait à la tentation de tout pouvoir totalitaire d’avoir prise sur les cœurs à défaut de pouvoir l’avoir sur les âmes. C’est la déviance que toute société qui veut rester libre doit écarter, notamment en distinguant mieux le Juste du Bien.
Le Juste n’est pas le Bien
La morale se réfère au Bien qui reste soumis au jugement personnel et relève de la discrétion de chacun. La justice intervient au nom de la collectivité et avec son pouvoir d’exécution, pour punir les déviances et pour assurer, dans les relations entre les personnes, l’égalité géométrique, à chacun selon ses capacités et ses mérites, ou arithmétique, dans l’égalité des échanges. Alors que la morale confine à l’intimité humaine, la justice se situe toujours dans le jeu social. La bonté est unilatérale quand le droit est fait pour gérer la réciprocité. Le but du législateur n’est pas de rendre les hommes bons, mais plutôt de permettre la coexistence pacifique entre les hommes. Le juste peut tendre au Bien, mais ne saurait s’y substituer. La bonté est privée et adaptée à chaque situation ; elle concerne autrui, mais elle relève de la bonne volonté.
Le droit est le juste. Le mot latin jus les assimilait. Le droit détermine de façon aussi consensuelle que possible les règles communes qui permettent la vie en société, le respect mutuel. La morale a au contraire vocation à faire le Bien. « La justice pose les limites, écrit John Rawls, le bien indique la finalité.[3] » La morale relève d’une vérité à la recherche de laquelle tout honnête homme se doit de concourir mais que personne n’est jamais certain de connaître. Elle s’élève au-dessus du droit, son exigence est d’un autre ordre et elle ne peut pas être contraignante.
A l’origine la loi inscrite dans les premiers codes et dans les préceptes des grandes religions du monde a été édictée pour enjoindre aux hommes de ne pas faire aux autres ce qu’ils ne voudraient pas qu’ils leurs fissent. Zoroastre a énoncé cette règle négative : « Tout ce qui te répugne, ne le fais pas non plus aux autres [4]». Confucius[5] et le Bouddha[6] ont également tenu des propos similaires et l’épopée du Mahâbharata le formule autrement[7]. Mais ce n’est pas de la morale, seulement de la précaution, de la politique en ce sens qu’il s’agit d’un principe de sagesse sociale. La règle est là toujours négative, « Ne fais pas à autrui », et toujours dans l’intérêt bien compris de celui qui l’applique, pour se prémunir du mal des autres, une éthique intelligente de réciprocité en quelque sorte qui est aussi celle de la Bible. Le Rabin Hillel résumait ainsi la loi juive à l’époque de Jésus: « Ce que tu ne voudrais pas que l’on te fît, ne l’inflige pas à autrui. C’est là toute la Torah, le reste n’est que commentaire.[8]»
Puis a été enseignée une autre règle, plus exigeante, qui dépasse le droit pour relever du domaine de la charité. Elle est introduite par l’Ancien Testament dans le Lévitique et le Deutéronome : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ; je suis l’Eternel [9]». Le Christ l’a enseigné à son tour[10] mais a été plus loin : « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le vous-même pour eux [11]». Il ne s’agit plus d’une règle négative, mais positive, sauf que cette règle ne représente qu’un devoir moral, elle est proposée à ceux qui voudront la pratiquer, elle est librement pratiquée par eux. D’ailleurs à l’homme qui demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage », Jésus répondit : « Qui m’a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? [12]». Le droit conserve son domaine propre et Saint Augustin rappelle que dans tous les contrats de droit, il faut respecter la maxime commune : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse »[13].
Mais peu à peu le pouvoir politique a transformé la charité, vertu personnelle, en une forme de justice morale. Tandis que Charles Quint, ce grand prince qui finit sa vie au couvent, exhortait avec force les privilégiés du monde à donner aux pauvres sans les y obliger par la loi, dans le même siècle, le roi Henri VIII devint chef de l’église d’Angleterre et afin de suppléer les ordres religieux abolis, son fils Edouard VI dut légiférer pour que les municipalités entretiennent leurs pauvres. On en vint ainsi à créer des « droits créances » des pauvres sur la société, ce que le préambule de la Constitution française de 1793 a caractérisé dans son article 21 : « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler ». L’aboutissement actuel en est l’Etat-providence dont la France est le meilleur représentant, fidèle à 93[14]. Il a institué une justice redistributrice (et non distributive au sens ancien) qui consiste à prendre aux uns par la coercition pour donner aux autres. Depuis lors, cet Etat-providence a enflé sans cesse entre les mains de dirigeants politiques aisément prodigues de l’argent des autres pour entretenir leur électorat ou parfois plus simplement abandonnés à la vaine et dangereuse croyance qu’ils savent mieux que leurs administrés le bien qu’il faut pour eux.
Retour aux sources du droit
Pour se garder de telles dérives, il n’est pas inutile de se ressourcer aux origines du droit occidental qui sût établir quelques règles simples comme un garde-fou contre l’hubris du pouvoir et la folie des Hommes.
L’objectivité du droit
Le droit à une vocation universelle et objective, indépendamment de la qualité des parties. Vitoria, qui a repris et commenté à Salamanque, au XVIème siècle, l’enseignement de Thomas d’Aquin, souligne l’objectivité de la justice commutative :
« Dans l’objet de la justice, c’est-à-dire dans ce qui est juste, il ne faut pas prendre en considération la condition de l’agent, à savoir si celui qui achète est riche ou pauvre pourvu qu’il donne l’équivalent. […] C’est pourquoi ce qui est juste exprime de soi ce qu’il faut faire, par exemple restituer les cent ducats que je dois sans prendre en compte si je suis riche ou pauvre, bon ou mauvais, mais seulement le fait que je les doive à autrui, sans considérer la condition de la personne elle-même, mais si ce sont cent ducats que tu dois, tu dois en donner cent. Et si l’on demande à un expert dans les affaires humaines combien vaut un cheval, on dira : combien est-il juste de donner pour un cheval ? On répondra : il est juste de donner cent ducats sans prendre en considération si l’on est pauvre ou riche.[15] »
Indépendamment de la qualité des personnes, le droit dit quoi est à qui, ce qui doit revenir à chacun. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu’il revient à la loi de fixer le prix du cheval dont la valeur est, elle, subjective en fonction du souhait du vendeur de le vendre et de l’envie de l’acquéreur de l’acheter comme le rappelait Luis de Molina (1535-1600), un autre représentant de l’école de Salamanque, exposant que :
« Le prix est dit « naturel » parce qu’il résulte de la chose même sans égard aux lois et décrets, et qu’il dépend de maintes circonstances qui le modifient, telles que les sentiments des gens, leur estimation des différents usages, souvent même selon les humeurs et plaisirs.[16]»
Le prix ne relève de la justice que lorsqu’il y a désaccord à son propos entre les parties et elle doit alors trancher indépendamment de leurs qualités respectives.
A chacun le sien
C’était une vocation essentielle du droit romain de rendre à chacun le sien (suum quique tribuere). L’histoire du jeune Cyrus (roi des perses au VIème siècle avant JC) racontée par Xénophon (IVème siècle avant JC) l’illustre et inscrit dans le temps la distinction du Bien et du Juste. Pour apprendre son métier de roi, Cyrus, fils de roi, devait aussi apprendre à juger, ce à quoi s’employait son précepteur. A la cour, un matin où des cas simples se présentaient, le précepteur dit à Cyrus de juger. Deux enfants, un grand et un petit, vinrent devant lui. Le petit réclamait au grand de lui rendre sa longue robe que le grand avait prise de force en lui donnant en échange la courte robe qui lui appartenait. Le jeune Cyrus constata que la courte robe seyait bien au petit et la longue robe au grand et jugea donc que le grand avait bien fait de s’emparer de la robe de l’autre en échange de la sienne. Son précepteur réprimanda Cyrus en lui rappelant que le rôle du juge était de décider « auquel des deux était la robe » pas de dire auquel elle convenait le mieux. Le petit avait sans doute ses propres raisons de vouloir cette longue robe. Et peu importe, c’était la sienne. « Ainsi, concluait Cyrus… je sais parfaitement ce qui est juste.[17] »
Les parents des enfants, soucieux du bien autant que du juste dans leur devoir d’éducation, auraient pu leur recommander d’échanger leurs robes en leur expliquant que cela leur convenait mieux. Les enfants auraient pu le faire d’eux-mêmes en considérant que cet échange répondait mieux au bien de chacun. Mais la justice, la collectivité, n’avait pas à leur imposer.
La loi pénale
La justice pénale a pour sa part la tâche de gérer les interdits. Elle est négative comme l’était pour l’essentiel les premières prescriptions juridiques de l’humanité. Mais elle n’a pas mission de tout interdire selon le sentiment du moment. Et dans le respect de ce qui revient à chacun, elle ne doit pas se mêler de ce qui ne la regarde pas sinon au risque de faire le mal au nom d’un Bien dont d’autres ont la responsabilité. Quand elle interdit la fessée[18], elle s’ingère dans les familles où un juste châtiment n’a, sauf accident, jamais tué un enfant et a pu contribuer à l’éducation de beaucoup pour autant qu’il ne se soit pas agi de sévices inappropriés et/ou cruels. Elle n’avait pas besoin d’ajouter ce délit à un arsenal légal qui punissait déjà les violences et particulièrement les mauvais traitements des enfants.
Il est vrai que de plus en plus de citoyens en appellent au législateur pour trancher entre leurs visions dissonantes du Bien. Il y a consensus autour de l’ancien précepte : « Tu ne tueras point_». Mais l’autorisation de l’avortement étend-t-elle le champ des libertés individuelles ou légalise-t-elle le meurtre d’enfants à naître ? Chacun peut avoir sa réponse, mais il est certain que la loi attente à la liberté lorsqu’elle interdit aux sites pro-vie d’exprimer leurs convictions en proposant aux femmes qui les consultent de ne pas avorter. Elle empêche alors de faire le Bien à ceux qui pensent que leur devoir moral est de convaincre les femmes de ne pas avorter. Les querelles éthiques soulèvent toutes des difficultés semblables, de l’euthanasie à la PMA et la GPA. L’autorisation ou non de la production et de la commercialisation de certaines drogues pose le même type d’interrogations. Le droit est en incessante recherche des règles les mieux adaptées à l’équilibre de la Cité. Mais il se fourvoie quand il édicte in abstracto des règles d’ordre idéologique. Un retour à l’équilibre ancien entre pragmatisme et reconnaissance d’une loi naturelle pourrait y suppléer.
La jurisprudence ou la prudence du droit
Le droit romain a été bâti sur l’expérience des jurisconsultes, retenant le meilleur des décisions jurisprudentielles accumulées dans le temps, dans une progression par essais et erreurs dont Karl Popper a fait une méthode scientifique. Loin d’une démarche trop théorique, il était empreint de pragmatisme, selon un processus qu’a conservé longtemps et aujourd’hui encore partiellement le common law anglais. Cette prudence du droit face à la diversité des situations ne l’a pas empêché de constater des régularités dans la pratique des justiciables et dans leurs comportements autant que d’en tirer des règles de sagesse commune nécessaires à la vie sociale. Il a pu aussi reconnaître l’existence d’une certaine nature humaine qu’il fallait à la fois satisfaire et contenir. En tâtonnant dans l’écheveau des grandeurs et turpitudes humaines, le droit romain a déterminé les principes de base utiles à l’épanouissement des hommes autant qu’à leur coexistence. Il a érigé en grammaire sociale le respect de la vie, de la famille, de l’intégrité des personnes, de la spécificité des genres, de la parole donnée et des contrats souscrits, de la propriété… Il déraillait parfois d’ailleurs, par exemple en considérant que le bien de la cité était préférable à celui des citoyens. L’idée était qu’il existe une loi naturelle commune à l’humanité, même si elle est changeante selon les temps et les territoires.
« La loi vraie, écrivait Cicéron, est la raison juste en accord avec la Nature ; elle est d’application universelle, invariable et éternelle ; elle invite au devoir par ses commandements et détourne du mauvais chemin par ses interdictions […]. Les lois ne seront pas différentes à Rome ou à Athènes, et elles ne différeront pas d’un jour à l’autre : une seule loi éternelle et invariable sera valide pour toutes les nations et en tout temps.[19] »
Malgré ses imperfections, cette référence à un droit fondé sur la connaissance de la nature humaine et sa quête éternellement insatisfaite du bien a longtemps permis d’éviter les dérives des systèmes légaux qui ont ensuite rompu leurs amarres en reconstruisant un nouveau droit dit encore « naturel » et qu’il eut mieux valu appeler le droit rationnel tant il voulait tout tirer de la volonté et la raison pure, des nominalistes à Kelsen.
Les convergences du bien et du juste
Ainsi, le Bien et le Juste ne s’excluent pas totalement. L’état de droit, dans lequel le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire concourent pour assurer la sécurité extérieure et intérieure des citoyens et l’exécution des lois et des contrats, favorise l’exercice de la liberté nécessaire à chacun pour poursuivre ses fins et, le cas échéant, pratiquer la bienfaisance. Le Bien les rassemble ainsi. Dans sa fonction, la justice a aussi chargé d’établir ou rétablir les relations les plus justes possibles entre les hommes pour que soient respectées la dignité, la liberté et la propriété des individus, ce qui relève du Bien de chacun.
Le Bien et le Juste convergent parfois sur des chemins parallèles. Ils ont par exemple tous deux besoin de savoir oublier le mal. La justice le fait par la prescription pour favoriser la paix sociale, savoir tourner la page, éviter de déterrer des mémoires altérées et susceptibles de déformer la vérité dans la fouille de faits et preuves trop anciens. Au plan moral il reste le pardon et la miséricorde, à la bonne volonté des parties mais souvent autrement efficace que les tribunaux.
Cicéron parlait du « bonum et aequum » comme des principes de base de toute législation. Et Saint Paul se montrait à cet égard proche des stoïciens en se référant à une loi naturelle inscrite dans le cœur de chacun[20]. Cette idée était alors très moderne d’imaginer que le droit puisse se déterminer indépendamment des préceptes religieux, qu’il puisse se nourrir du fond du cœur des hommes autant que de leur raison. Le Bien et le Juste ne peuvent ignorer les liens qui les attachent et sans lesquels ils se dessècheraient. Ils se nourrissent de la même inquiétude des hommes, de leur même conscience d’une solidarité humaine et d’une commune destinée. Il y a un bien commun qui intègre l’état de droit et le dépasse en y ajoutant les ingrédients nécessaires, parfois presque une dose de mystique, avec ses dangers, pour qu’une communauté soit plus qu’une collection d’individus, pour que les êtres humains disposent d’un environnement, notamment institutionnel, propice à la poursuite de leurs fins. S’y fondent des croyances communes et une vision partagée du bien et du mal, une forme de plaisir de vivre ensemble et le souhait de sauvegarder une unité dans les dépendances informelles qui constituent une patrie. Il existe d’une certaine manière une morale commune qui est la reconnaissance consensuelle de ce que nous réprouvons. Et parce que l’individu ne vit pas solitaire et a besoin de la société pour s’épanouir, cet ensemble fait aussi partie du Bien des hommes pour autant que chacun soit garanti de sa liberté de pouvoir vivre à l’écart et de s’exprimer différemment s’il le souhaite. C’est en ce sens sans doute qu’Aristote disait que l’amitié était nécessaire pour constituer une cité car le lien d’amitié authentique était pour lui une allégeance partagée au Bien. La vie commune serait sans doute moins supportable sans pouvoir parfois bénéficier de la bonté des autres. La nature humaine a sans doute profondément besoin du Juste et du Bien qu’elle est pourtant incapable de toujours satisfaire. Le Juste est en quelque sorte le négatif du Bien. Nous avons besoin de justice parce que le Bien n’est pas plus naturel que le mal, parce que l’homme est imparfait et bafoue volontiers les droits des autres pour satisfaire ses envies.
Conclusion
Les
limites sont aussi ténues que nécessaires entre le Bien et le Juste. Le danger
vient généralement du trop ou du trop peu de distance entre l’un et l’autre. La
confusion entre eux alimente les idéologies dont elle est en même temps le
fruit et mène à la tyrannie du Bien qui peut se muer en totalitarisme.
L’ignorance l’un de l’autre peut gommer la frontière entre vérité et mensonge
dans un abandon de la loi naturelle[21]. Le mystère du mal,
coexistant à l’humanité, reste toujours d’actualité et la question du Bien ne
saurait être ignorée par quiconque. Mais la loi et la justice font la bête
quand elles veulent faire l’ange. La morale aussi sans doute. Entre le Bien et
le Juste, le fait que chacun ait sa place ne veut pas dire qu’ils se
méconnaissent. Et quand ils se côtoient et s’entretiennent harmonieusement,
c’est toujours dans un équilibre précaire.
[1] Olivia Dufour, Justice et médias, la tentation du populisme, LGDJ, 2019, p.16.
[2] Cf. La vie des autres, film de Florian Henckel von Donnersmarck, 2007.
[3] John Rawls, 1993, Justice et démocratie, Paris, Le Seuil, p.288.
[4] Shayast-na-Shayast 13, 29.
[5] Analects, XV.23 : « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse à vous-même ».
[6] Udana-Varga, 5, 18 : « Ne blesse pas les autres par des moyens que tu trouverais toi-même blessants ».
[7] Epopée du Mahâbharata, 5,1517, « Ne fais rien à ton voisin que tu ne voudrais pas le voir faire à ton égard par la suite ».
[8] Talmud de Babylone, traité Shabbat 31 a, cité par Armand Laferrère, La liberté des hommes, Odile Jacob, 2013, p.221. Voir par exemple Livre de Tobie, Chapitre 4, 16.
[9] Deutéronome 19,18 ; Lévitique, 19,18.
[10] Matthieu 22,39.
[11] Matthieu 7,12.
[12] Luc 12, 13-21.
[13] De Ordine 2, 8, 25. PL 32, 1006 ; cité par Elisabeth Dufourcq, L’invention de la loi naturelle, Bayard, 2012, p. 227.
[14] Voir sur ce sujet mon ouvrage : Jean-Philippe Delsol, L’injustice fiscale ou l’abus de bien commun, Desclée de Brouwer, 2016, chapitres VI, VII et VIII.
[15] Francisco de Vitoria, La Justice, Q 57, article 1er, 4, Etude et traduction de Jean-Paul Coujou, Editons Dalloz, 2014, p.5.
[16] Luis de Molina, De justitia et de jure, Cologne 1596-1600 ; disp. 347, n°3.
[17] Xénophon, De la Cyropédie, Livre I, Chapitre III, 16,17.
[18] Loi adoptée définitivement le 2 juillet 2019 par la France, 56ème pays à interdire la fessée.
[19] De Republica, III, 22.
[20] Epitre aux Romains, 2, 14 et 15 : « Or quand les Gentils, qui n’ont point la Loi, font naturellement les choses qui sont de la Loi, n’ayant point la Loi, ils sont Loi à eux-mêmes. Et ils montrent par-là que l’œuvre de la Loi est écrite dans leurs cœurs ; leur conscience leur rendant témoignage, et leurs pensées s’accusant entre elles, ou aussi s’excusant. »
[21] Cf. le pape Benoît XVI dans un article publié ce 11 avril 2019 par la revue allemande Klerusblatt et diffusé par l’Agence CNA.