En janvier 2018 le gouvernement écrit à Jean-Dominique Sénard, alors président de Michelin, et Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT, pour leur demander un rapport sur leur « réflexion sur la relation entre entreprise et intérêt général ». La lettre de mission est de nature « fermée ». En effet, on peut y lire les propos suivants :
« Il est aujourd’hui demandé à l’entreprise d’assumer une responsabilité à l’égard de la société… répondre aux défis environnementaux… favoriser l’amélioration du bien-être des salariés sont des buts légitimes que l’entreprise se voit désormais assigner… permettre aux entreprises de poursuivre des buts plus larges que la réalisation du profit… promouvoir une vision du capitalisme plus respectueuse de l’intérêt général et de celui des générations futures. »
Avec une telle colonne vertébrale on peut aisément se douter du contenu attendu de la part des rédacteurs. La manœuvre était habile, un patron unanimement respecté venant d’une entreprise particulièrement innovante et adepte de l’économie de marché, flanqué d’une syndicaliste ayant effectuée son chemin de Damas : voilà de quoi rassurer la fausse droite et contenter la fausse gauche.
Le 9 mars, le rapport est remis aux autorités publiques sous le titre « L’entreprise, objet d’intérêt collectif ». Les figures imposées sont bien à la place attendue :
« Le court-termisme et la financiarisation pèsent sur la vie de l’entreprise… les décisions de l’entreprise devraient ne pas être guidées par une seule raison d’avoir… le critère financier de court-terme ne peut servir de boussole… les comportements de maximisation du profit sont des conduites dommageables…»
Les « mythiques » articles 1832 et 1833 du Code Civil sont mis en cause. Ils postulent on le sait : « la société est instituée… en vue de partager le bénéfice… » (a. 1832) et « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » (a. 1833). Mais les rédacteurs du rapport concluent sans hésiter : « une clarification juridique sur l’entreprise serait rassurante et de nature à contribuer à réconcilier les citoyens avec l’entreprise ». La référence au « citoyen » est révélatrice : l’entreprise ne concerne pas des associés, mais des citoyens.
Toujours est-il que le rapport va inspirer la loi PACTE du 22 mai 2019. Désormais un second alinéa a été ajouté à l’article 1833 qui postule « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Il est prévu en mai 2020 comme limite maximum que le Parlement vote « la mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels de RSE. »
Émergence de la RSE
Aujourd’hui la RSE reçoit une définition simple, que l’on peut trouver par exemple en consultant Wikipedia :
« La responsabilité sociétale des entreprises, aussi appelée responsabilité sociale des entreprises, est un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire. »
Encore plus simplement, c’est « la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable ». À noter qu’en 2010 le Ministère français de l’Écologie, de l’Énergie et du Développement Durable emploie le terme de responsabilité « sociétale », jugé plus large et plus pertinent que « responsabilité sociale ».
Historiquement le concept de RSE n’apparaît qu’à partir des années 1960 dans la littérature consacrée aux entreprises (avec, en 1953, Social Responsabilities of the Businessman de H. Bowen, et en 1961, The Responsible Corporation par G. Goyder). Il a depuis fait l’objet d’une élaboration théorique chez plusieurs chercheurs anglophones et francophones (voir notamment les travaux de l’école de Montréal et ceux qui se réfèrent à la Théorie de la régulation). Dans la littérature économique anglo-saxonne, on va désormais distinguer deux types de personnages liés à l’entreprise : les shareholders, et les stakeholders ; ceux qui ont des actions de l’entreprise, et ceux qui ont des intérêts dans le fonctionnement des entreprises. Pour les économistes, il ne fait pas de doute que les actionnaires veillent à la gouvernance de l’entreprise et privilégient le profit, signe non seulement de la bonne gestion mais aussi du meilleur service de la clientèle. On peut citer ici l’article canonique de Milton Friedman du 13 Septembre 1970 paru dans le New-York Times Magazine sous le titre « The social responsibility of business is to increase its profits ».
Mais c’est avec le succès du nouveau concept de « développement durable » que le la RSE prendra réellement son essor. Faut-il rappeler que ce « développement durable » est la nouvelle arme idéologique découverte par les adversaires du capitalisme qui se trouvent très dépourvus après la chute du mur de Berlin ? La couleur rouge et la planification ne pouvant plus être revendiquées sérieusement après l’explosion du communisme soviétique, les substituts en seront désormais d’une part la couleur verte, d’autre part la RSE. L’une et l’autre développent une hostilité radicale à l’ordre libre et au fonctionnement du marché avec une virulence bien supérieure à la période d’avant la chute du mur. Le professeur Alain Wolfelsperger dans plusieurs articles d’une très grande finesse a pu démontrer que sans doute jamais le marché des idées n’a été aussi hostile à la dimension économique du libéralisme.
Élargissement de la RSE
De « responsabilité sociale » de l’entreprise — concept déjà ambigu — on en est donc venu à sa « responsabilité sociétale ». Le « piège » entrevu par Friedman se referme sur l’entreprise, qui sera désormais tenue pour responsable de tous les désordres qui traversent naturellement et évidemment tout ordre social à toutes époques de l’histoire. Il s’agit bien d’une « dérive-extension ».
Voici par exemple le titre significatif donné à son ouvrage par Fabienne De La Chauvinière : « La responsabilité sociétale ; osez la vertu»[1]. Et cette vertu consiste à engager la responsabilité des entreprises en matière de droits de l’homme. Dans la même veine on trouve à la Documentation Française deux tomes totalisant à eux deux 726 pages intitulés : « La responsabilité des entreprises en matière de droits de l’homme ». Le tome 1 a pour titre « Nouveaux enjeux, nouveaux rôles » (418 pages). Le tome 2 s’intitule « Etat des lieux et perspectives d’action publique » (308 pages).
On note aussi, entre autres documents de base, le rapport de juin 2013 publié aux Éditions des Journaux Officiels, et revêtu sur la couverture du timbre de la République Française, dans lequel le rapporteur Alain Delmas produit un texte du plus haut intérêt intitulé « La RSE : une voie pour la transition économique, sociale et environnementale »[2]. De ce texte dense, riche et intéressant, fort de 51 pages, nous avons retenu deux passages dans lesquels le rapporteur fixe les véritables enjeux de la RSE. Il va développer l’idée, traditionnelle désormais chez les régulationnistes néo-marxistes, selon laquelle les États-Nations sont aujourd’hui un cadre inapproprié à l’analyse[3]. Ayant constaté ce premier trait le rapporteur explique (page 7) la multiplication des crises de toutes natures obligeant à une urgence d’action :
« Sous l’effet de la mondialisation, de la financiarisation de l’économie et l’accélération des échanges commerciaux, les Etats Nations ne sont plus les seuls protagonistes sur la scène internationale. De nouveaux acteurs – en particulier… les entreprises multinationales – se sont, au fil des années, imposées et affirmées modifiant les rapports de forces.
Dans le même temps, la multiplication des crises économiques sociales et des catastrophes environnementales qui fragilise l’avenir de la planète suscite une prise de conscience de plus en plus forte en faveur de nouveaux modes de production, de consommation, de transports…
L’inscription, … des questions de développement durable, de régulation financière et de protection de l’environnement témoignent de cette préoccupation majeure de l’urgence d’agir. »
La mondialisation se doit d’être plus équitable. Il faut donc combattre les inégalités. Ces dernières sont évidemment et sans discussion perçues comme des injustices. Le rapporteur en vient alors à la conclusion évidente (page 25) :
« Une mondialisation plus équitable […] exige des modes de développement fondés sur un juste équilibre entre les dimensions économiques, sociales et environnementales. […] Parce que la RSE se situe à la confluence des différents enjeux elle peut être porteuse de progrès en faveur de nouvelles formes de gouvernance et de régulation au service d’un plus grand bien-être de l’humanité. Les conventions et instruments adoptés par les institutions internationales autour de la RSE s’inscrivent dans le sens de l’Histoire[4] : ils dessinent les contours d’un droit international plus efficace dans la lutte pour le respect des droits de l’homme et contre le moins-disant social et environnemental. »
A cette idée si ancrée (qu’elle ne se discute même plus) selon laquelle la mondialisation non régulée se traduirait par le moins-disant social et environnemental, on opposera le constat que le revenu par tête ne cesse de progresser de par le monde, comme l’attestent tant les statistiques du FMI, de l’OCDE, d’Eurostat, et de l’OIT elle-même ou encore les travaux de François Bourguignon ou de Christian Morisson. Le « moins-disant » économique se traduit en fait par un meilleur niveau de vie…
Environnement et propriété privée
Quant au moins-disant environnemental qui naîtrait du productivisme et de la croissance faite pour maximiser le profit des capitalistes, il est d’évidence contraire à la réalité observée. Pour s’en tenir à quelques exemples, la forêt et les arbres sont en progression constante à peu près dans toutes les zones de la planète (et la déforestation en Amazonie n’est pas le drame scandaleux qu’on en a fait). L’eau est sans conteste possible plus propre presque partout qu’il y a un demi-siècle et même au-delà — c ’est à la fin du XIXème siècle que l’on interdit de pêcher dans la Tamise, du moins dans sa partie qui traverse Londres ; c’est de nouveau possible aujourd’hui. Quant à nos voitures chaque jour elles polluent moins, non parce que les réglementations ont fleuri, mais parce que le progrès technique les rend chaque jour plus « propres ». On rapporte que la faune ici ou là serait gravement menacée, et les reportages abondent sur les massacres d’animaux rares et commercialisables dans les parcs nationaux en Afrique. Mais que l’on sache il n’y a pas une espèce faisant l’objet d’une appropriation privée qui soit menacée aujourd’hui de disparition. Quel est le sort le plus enviable : celui des chiens errants ou celui des chiens ayant un propriétaire, qui ont chaque jour gîte et couvert assurés ? La pêche intensive au milieu des océans d’espèces qui n’ont pas de propriétaires rend-elle leur sort plus enviable que celui des innombrables poissons, y compris tropicaux, qui sont l’objet de toute l’attention, la science et la patience des aquariophiles ? Les fleurs sont-elles mieux traitées et avec plus d’attention quand elles poussent de façon sauvage dans la nature, et sont vite cueillies par ceux qui voient la gratuité, que les fleurs qui sont cultivées avec amour dans les jardins de propriétaires privés qui les nourrissent et les arrosent avec précaution et assiduité.
Ce que ne savent pas ou ne veulent pas savoir ceux pour qui le processus de marché serait le responsable des problèmes environnementaux c’est qu’il existe une technique éprouvée depuis des millénaires afin de correctement gérer la nature et qui a pour nom la propriété privée. Les terrains sans propriétaires dans nos villes sont-ils vite transformés en décharge ? Les mêmes individus qui depuis leur voiture se débarrassent d’ordures sur les terrains « publics », jetteraient-ils les mêmes sacs dans le bout de jardin devant leur maison dont ils taillent amoureusement le gazon dont ils sont fiers ?
Lorsque le droit public devient dominant et le droit privé évincé, les effets pervers s’accumulent. L’ingénierie juridique de la propriété privée est le meilleur moyen de sauver la faune et la flore. Quand l’idéologie sera-t-elle enfin bannie, quand va-t-on reconnaître les évidences ?
Il est vrai que les vertus de la propriété n’existent que lorsque les droits de propriété sont définis avec précision. C’est la raison pour laquelle même quand la propriété publique est présente, forme pourtant altérée de la propriété, les effets positifs se font sentir. Autour des côtes de tous les pays du monde existe le domaine public maritime. Certes c’est une forme dégradée et altérée de propriété, mais c’est cependant une forme de propriété. Les pétroliers, les gaziers et les autres navires ont-ils pris l’habitude de dégazer dans les eaux du domaine public maritime ou lorsqu’ils sont au milieu de l’océan ? Le drame des océans c’est qu’ils ne font l’objet d’appropriation privée.
De nouveau, ici et encore, le lecteur sera sceptique se demandant comment la mer peut faire l’objet d’une appropriation privée ? Qu’il sache que c’était la même interrogation il y a 3000 ans concernant la terre. Le droit spontané[5], issu de l’expérimentation juridique, y a pourvu. De toute façon des plages privées aux bancs de poissons privatisés suivies par isotopes par les satellites, la propriété privée sur des morceaux de mers existe déjà. Si je suis propriétaire d’une petite parcelle d’eau qui m’appartient, vais-je la polluer à loisir, ou la traiter comme on traite son morceau de gazon et ses rosiers devant sa maison ? La technique de la propriété privée est la meilleure pour tous ceux qui réellement souhaitent résoudre les problèmes de pollution.
Mais évidemment, tel n’est pas l’objectif de la propagande autour de la RSE. Pour les tenants idéologues de la RSE cette notion est le cheval de Troie qui permettra de détruire l’odieux système capitaliste. Et actuellement l’unanimité se fait autour de cet objectif. Unanimité au Conseil Economique Social, devenu Environnemental en 2008, quand il s’est agi de voter un rapport sur la RSE : 163 inscrits, et 153 « Pour », les artisans, les patrons, les professions libérales et des personnalités réputées pour leurs opinions « à droite », voire même libérales ont suivi les conclusions du rapporteur (membre de la CGT). Unanimité aussi dans le patronat chrétien[6] :
« [N]ous sommes attentifs au développement durable, à la préservation des ressources naturelles et aux atteintes à l’environnement car nous nous sentons responsables… »
A la recherche de la troisième voie
Tous ceux qui comptent dans l’élaboration des concepts et contenus de la RSE se sont réunis dans un ouvrage fondamental, fruit des réflexions du colloque tenu à Paris V les 24 et 25 mars 2011 intitulé « Responsabilité sociale de l’entreprise et gouvernance mondiale ». Il s’agissait du 8ème Congrès de l’ADERSE (Association pour le Développement de l’Enseignement et de la Recherche en Responsabilité Sociale de l’Entreprise) à l’occasion de ses 10 ans.
Le rapport introductif était dû à la plume de celui qui peut revendiquer légitimement la qualité de théoricien majeur de la RSE, Henri Savall. Dans le chapitre 1 de l’ouvrage il lève totalement le voile sur les fondements philosophiques des concepteurs et partisans de la RSE.
Le projet idéologique est remarquablement présenté, sans faux-semblant ni fard :
« La RSE a une dimension politique fondamentale. La genèse de cette problématique repose… sur une double réfutation celle de l’autorégulation libérale et celle de la régulation étatique ou inter-étatique. »
On ne saurait être plus clair. La régulation étatique telle qu’elle fut pratiquée de l’URSS à la Chine, de l’est de l’Europe au Cambodge etc., est rejetée, mais tout autant l’autorégulation libérale. Le procédé est séduisant : rejet de solutions considérées comme extrêmes et sagesse d’une position centriste.
Il est évident qu’une telle approche ne résiste pas à l’analyse économique, ni même au sens commun. Comme Daniel Villey l’avait souligné[7], après Walter Eücken, le tiers système est une impossibilité théorique et pratique.
Théorique parce que ce ne peut être une chose et son contraire qui soient simultanément vraies. Une économie ne peut pas être en même temps régulée et non régulée. Pour répondre aux trois questions de Samuelson : « que produire, comment et pour qui », on ne peut mêler ou rapprocher les deux systèmes : l’économie centralisée (le plan) et l’économie décentralisée (le marché). Le tiers système est une impasse. La révélation des préférences (que produire), la gestion des facteurs de production (comment produire) ne peuvent s’assortir avec une répartition des richesses et des revenus (pour qui produire), car le dirigisme traduit les préférences des planificateurs et non des consommateurs, tandis que la redistribution rompt le lien entre production et rémunération.
Il est donc aisé de montrer l’impossibilité pratique d’un système qui emprunterait aux deux logiques systémiques.
Bien sûr il est à la mode de prôner la dialectique des contraires. Mais il s’agit d’une mode intellectuelle. C’est de la logique que nous vient le secours. Une chose dans l’ordre de la nature, comme dans l’ordre social, ne peut pas être et ne pas être. La dichotomie des systèmes est irréductible. Toute solution intermédiaire cumule des inconvénients au lieu d’additionner des avantages. Quand le mécanisme des prix est neutralisé, sa fonction et mission d’orientation des efforts productifs et de signaux aidant à découvrir ce que nous voulons ou rejetons ne peut plus fonctionner correctement. Elle est paralysée par l’incessante intervention de l’Etat. L’expression « le contrôle des prix » est un oxymore parfait. Si en effet un prix est contrôlé ce n’est plus un prix puisqu’il ne reflète plus l’intensité ou/et la rareté respective des offres et des demandes. Mais inversement la logique du plan, fût-elle critiquable, s’altère au fur et à mesure que j’introduis des mécanismes incitatifs, relevant de la logique de la liberté dans l’ordre de l’économique. Si bien que plus les régimes réels s’éloignent des systèmes purs et plus les résultats déçoivent les espérances.
La RSE est un prototype parfait de l’idée selon laquelle l’entreprise doit être gérée pour l’essentiel comme en économie de marché si elle veut survivre, mais pourvu qu’elle obéisse à des objectifs qui sont justement incompatibles avec les règles habituelles de gestion. Non pas que l’entreprise gaspille inutilement, ni qu’elle pollue par plaisir, ni que pour être efficace elle ait un intérêt rationnel à tyranniser ses salariés, ou encore et enfin qu’elle trouve une quelconque fécondité à empoisonner, dans tous les sens du terme, le consommateur.
LA RSE : mission impossible
L’article d’Henri Savall transforme aussi la nature de l’entreprise au point de rendre la RSE accablante, impossible.
Demander par principe, voire obliger par des textes, une entreprise à faire ce pourquoi elle n’a pas vocation, c’est l’affaiblir et l’écarter de ce qu’elle sait faire : produire au prix le plus compétitif les biens et les services qui nous permettent de survivre et de vivre. La vocation du producteur n’est pas de défendre les droits de l’homme. Le but final de l’entreprise n’est pas de rendre les gens heureux. C’est une confusion d’une extrême gravité dont la conséquence est la suivante : si l’entreprise est citoyenne (terme qui ne veut rien dire), si elle a pour fonction d’épanouir les hommes, de sauver la nature, de rectifier les inégalités de la distribution initiale des dons, de lutter contre le racisme, et d’organiser des lieux de prière… chaque fois qu’un individu sera malheureux il en tiendra l’entreprise pour responsable. A force de demander tout et n’importe quoi au cadre de travail, à force d’élargir les limites de son territoire, on fait du lieu de travail le creuset de toutes les frustrations.
Une preuve dramatique est la multiplication des suicides sur le lieu de travail. Les cadences de travail ou l’inhumanité supposée de la hiérarchie seraient-elles les causes les plus fréquentes du suicide[8] ? C’est évidemment d’abord pour des raisons privées que l’on met fin à ses jours, mais c’est désormais le lieu de travail qui est le déversoir des malheurs des individus puisque l’entreprise est considérée comme un substitut à une institution ou à une pratique qui la remplissait[9]. Quand on fait sa prière en entreprise, on ne la fait pas dans une église. Quand le CE organise les vacances du salarié ce n’est donc plus en famille que se discute cette décision. Quand la hiérarchie accepte de jouer aux « psys » elle frustre de sa fonction naturelle le psychologue, le psychiatre ou l’homme d’église. Et quand l’entreprise se sent obligée de tenir bibliothèque et de faire de la formation à la culture générale, elle enlève à l’Université sa mission naturelle. Autrement dit dans bien des cas ce sont les hommes d’entreprise eux-mêmes qui font, tel M. Jourdain, de la RSE sans le savoir.
La RSE : une erreur bien ciblée
Henri Savall conclut ainsi à une sorte d’entreprise-providence, base de la fameuse troisième voie, celle que prônait François Perroux, qu’il cite comme l’un de ses inspirateurs, puisqu’il a introduit le concept de « l’énergie endogène des unités actives ». La RSE n’est donc qu’une forme inéluctable du « nouveau développement » jadis prédit par François Perroux.
« Le concept de RSE est de nature normative. Le message subliminal qu’il véhicule est que le développement de la RSE est souhaitable. La cohérence de ce concept s’appuie sur son option structurale, à savoir la préférence pour un système économique et social décentralisé et régulé, synchronisé ou orchestré. La remise en cause d’un capitalisme débridé par la mondialisation est une résurgence dans l’histoire de la pensée économique qui fait suite à l’échec historique des régimes économiques d’inspiration marxiste. »
Ni capitalisme débridé, ni régime d’inspiration marxiste : ce neutralisme fait la séduction de la RSE, mais n’a aucune cohérence économique. Il porte cependant un message subliminal pour les personnes ignorantes de la réalité des entreprises : le capitalisme et l’économie de marché ne peuvent continuer à régner dans le monde entier.
La RSE : une erreur qui n’est pas innocente.
La RSE constitue en fait une mécanique diabolique pour les entreprises et au-delà pour le marché, et au-delà encore pour la société libre. Si l’ensemble impressionnant d’un Everest de textes déjà votés était appliqué, l’efficacité des entreprises s’en trouverait largement altéré. Dans ce cas, le cercle vicieux du dirigisme fonctionne à plein. Constatant, et nous y sommes, que les résultats des économies occidentales sont insuffisants voire décevants, les gouvernants, les organisations internationales, les ONG, ont beau jeu d’imputer l’insuffisance des résultats et les dégâts causés à l’environnement au résultat du jeu des forces spontanées du marché. Alors qu’en vérité le fait générateur est que, la fiscalité, le Code du travail, les monstres juridiques sont destructeurs des incitations productives.
Comme il est honnête de reconnaître que la plupart des partisans de la RSE sont des gens de bonne foi, dotés largement de bonnes intentions, la RSE permet de vérifier une fois encore que l’enfer est pavé de bonnes intentions, le mieux est l’ennemi du bien, et qui veut faire l’ange fait la bête.
Loin d’être
neutre la RSE est clairement une nouvelle machine de guerre lancée contre
l’économie de marché. Notre espoir est d’avoir convaincu que, loin d’être un
ensemble intellectuel sans visée idéologique, la typologie de la RSE est à
prendre très au sérieux et à combattre. Il s’agit d’une de ces idées fausses
dont Raymond Boudon a si bien montré qu’elles s’emparent du corps social le
temps d’une période avant que les principes de réalité et de vérité, qui
finalement ne sont qu’un, fassent éclater la supercherie[10].
[1] Souligné par nous. Editec, collection « D’autres regards sur le management », 2013.
[2] JORF, Juillet 2013, collection des Avis du Conseil.
[3] C-A. Michalet (2004), Qu’est-ce que la mondialisation ? La Découverte/ Poche, chapitre 2, pp. 31 et s.
[4] Tous les mots sont importants sauf à lire de façon hâtive. Ainsi, pour ne prendre que cet exemple, considérer qu’il y a un sens à l’Histoire, et donc que celle-ci a un début et une fin, est un langage adopté par le seul Karl Marx.
[5] Sur ce sujet on consultera Serge Schweitzer : « L’analyse économique de la production du droit », in Légitimité du pouvoir politique et représentation, Travaux du Centre de Recherches Hannah Arendt, Cujas, 2008.
[6] Voir, « La RSE : un regard d’entrepreneurs et dirigeants chrétiens sur la mise en œuvre du développement durable, » Cahiers des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, novembre 2013. http://bit.ly/2lZP2iy .
[7] Voir Daniel Villey (1967), A la recherche d’une doctrine économique, M.T. Genin, Paris, pp. 36-43. Au-delà du fond, ces pages, comme d’autres, révèlent l’admirable styliste qu’était Daniel Villey. Il y a réellement des passages sur l’adoxalisme ou la dichotomie des systèmes qui atteignent une perfection inégalée.
[8] Sur ce sujet Serge Schweitzer, « Un point de vue dissident sous l’angle de l’analyse économique : le stress au travail, faux concept et mode passagère », pp. 29 et s., in Le stress au travail – Regards pluridisciplinaires, PUAM, 2013, Collection Droits, pouvoirs et sociétés.
[9] C’est une idée similaire que défend Pascal Salin dans Libéralisme, Odile Jacob, Paris, 2000, pp. 149-166 quand il explique que mettre ses économies et son épargne de façon artificiellement stimulée par des mécanismes fiscalement incitatifs dans la même entreprise où déjà on travaille est une grave erreur. En effet si l’entreprise fermait on perd simultanément son salaire, son emploi et ses économies.
[10] Le présent texte est une version remaniée, actualisée, et très allégée d’une communication effectuée le 4 juin 2019 dans le cadre d’un colloque consacré à l’entreprise. Pour ceux des lecteurs du Journal des Libertés souhaitant approfondir le sujet, et en particulier comprendre la portée de l’article de Milton Friedman, ils pourront se reporter à notre article « La responsabilité sociale de l’entreprise est-elle d’augmenter ses profits ? » paru dans J.Y. Naudet (ed.), L’éthique de l’entrepreneur, 2015. P.U.A.M. 251-288.



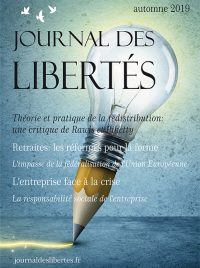
2 Commentaires
Excellent article. Moi-même maître de conférences en sciences de gestion et ayant eu comme mentor le Pr Jacques Igalens (lequel a d’ailleurs peut-être théorisé la RSE avant Henri Savall, en France), j’avais fait une communication intitulée « une critique libertarienne de la RSE » en 2004, au congrès de l’ADERSE, association que vous mentionnez. Et en 2012, dans l’encyclopédie de gestion des ressources humaines, un chapitre intitulé « la RSE : du mirage conceptuel à la désillusion normative ? ». Mais pas plus que dans d’autres disciplines la recherche en gestion n’est particulièrement ouverte au discours critique (le relativisme scientifique ayant depuis belle lurette pris le relais du relativisme éthique. Aujourd’hui et pour paraphraser le mot célèbre du député Laignel, on a scientifiquement tort quand on est académiquement minoritaire). Votre article me donne envie de proposer mon chapitre de 2012 au JDL, pour re-publication. Je ne suis pas sûr que ne puisse exister un espace de dialogue entre (certains) spécialistes de la RSE et économistes de marché mais la voie est ténue…
N’hésitez pas à nous soumettre votre article.