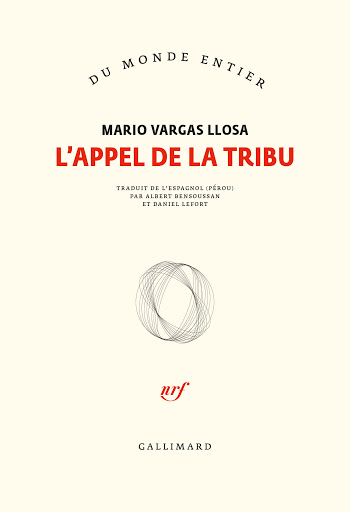 La belle profession de foi libérale de Vargas Llosa
La belle profession de foi libérale de Vargas Llosa
Il faut d’abord saluer le courage moral actuellement nécessaire à un auteur d’audience mondiale et qui plus est Prix Nobel de Littérature pour oser non seulement proclamer urbi et orbi son profond attachement à la cause libérale, mais aussi d’entrée de jeu exprimer son admiration pour Margaret Thatcher, la bête noire de tout ce que le monde entier compte de stupides et délétères dévots du « politiquement correct ». C’est ce que vient de faire Mario Vargas Llosa dans son nouvel opus, L’Appel de la tribu (Gallimard) où, ayant confié avoir « eu la chance de connaître Madame Margaret Thatcher en personne », il l’élit comme l’un de ses grands mentors personnels (l’autre étant son ami Jean-François Revel, on y reviendra plus avant) en initiation à la philosophie libérale. « Opter pour le libéralisme, expose-t-il d’abord, a surtout représenté un processus intellectuel de plusieurs années, auquel a beaucoup contribué le fait de résider alors en Angleterre, depuis la fin des années 60, comme enseignant à l’université de Londres, et d’avoir vécu de près les onze années du gouvernement de Margaret Thatcher. Cette dernière appartenait au parti conservateur mais était guidée comme chef d’État par des convictions et, surtout, par une fibre profondément libérale… ». Suit alors l’explication de l’influence doctrinale précise de la Dame de fer sur sa conversion au libéralisme classique : « Elle n’avait aucun scrupule à dire qu’elle consultait Friedrich von Hayek et qu’elle lisait Karl Popper, qu’elle tenait pour le plus grand philosophe contemporain de la liberté. Je les ai lus tous les deux dans ces années-là, et depuis lors, La route de la servitude et La société ouverte et ses ennemis sont devenus pour moi des livres de chevet. »
Figures et moments d’une invitation au libéralisme
Dans la foulée de cette flamboyante entrée en matière, Vargas Llosa propose les portraits bio-bibliographiques des sept penseurs libéraux qui l’ont le plus influencé, présentés par ordre chronologique et agrémentés d’impressions ou souvenirs personnels qui ne sont pas les moins enrichissants de ce parcours. Inaugurée par Adam Smith, cette saga enjambe étrangement tout le XIXème siècle pour se poursuivre avec Ortega y Gasset, Friedrich Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin et se clôt donc avec Jean-François Revel : essentiellement des presque contemporains. On aurait pu imaginer un itinéraire fort différent, successivement ponctué par Locke, Turgot, Constant, Bastiat, Tocqueville, Mises et Rand – mais le propos de l’auteur n’est pas d’ordre historiographique et ne renvoie qu’à des choix subjectifs à prendre comme tels. Ceux-ci se révèlent d’autant plus intéressants qu’ils prennent souvent appui sur les ouvrages des penseurs retenus et sont servis par un superbe talent d’écriture. Car c’est un autre grand intérêt de cet opus, qui est non pas l’œuvre d’un économiste, d’un juriste, d’un historien ou d’un philosophe, mais d’un pur écrivain. Ce qui lui permet de jouer le rôle du meilleur passeur (influenceur ?) qui soit des idées libérales auprès d’un grand public et de … grands débutants prévenus contre le libéralisme par la propagande étatiste/collectiviste (ennemie personnelle de Vargas Llosa !) qui inonde les médias et l’enseignement en France.
Qui connaît déjà bien les figures libérales élues dans cet Appel de la tribu n’apprendra pas grand-chose de neuf à leur sujet. En revanche, il pourra au passage apprécier la pertinente connaissance dont témoignent les commentaires qu’en fait volontiers son auteur. Célébré pour sa théorisation séminale du libre marché et de la propriété privée, Adam Smith l’est ainsi un peu moins pour avoir cru que « le prix des marchandises se mesure au travail investi dans leur fabrication » (p. 57) : dans une utile note au bas de cette page, Vargas Llosa relève que « Cette idée, que Marx adopta, est l’objet de critiques de la part des économistes libéraux de ce que l’on appelle l’École autrichienne comme Mises et Hayek. Ces derniers soutiennent que la ʺvaleurʺ n’est pas quelque chose d’objectif… mais quelque chose de subjectif, créé par les préférences des gens sur le marché. » – notre homme connaît bien son affaire. Et c’est pourquoi il se montre heureusement inspiré en faisant ensuite figurer Ortega y Gasset au nombre des penseurs libéraux de premier plan, alors que ce grand philosophe espagnol n’est trop souvent pas reconnu comme tel. Éminent connaisseur et admirateur d’Ortega, Vargas Llosa indique en quoi l’immortel auteur de La Révolte des masses a par son anti-collectivisme et son esprit de tolérance effectivement contribué à enrichir la vivante tradition libérale sur le plan anthropologique, moral et politique. Mais c’est pour mieux souligner que « le libéralisme d’Ortega y Gasset, bien qu’authentique, est partial. La défense de l’individu et de ses droits souverains, d’un État petit et laïque qui stimule la liberté individuelle au lieu de l’étouffer, de la pluralité d’opinions et de critiques, ne s’accompagne pas de la défense de la liberté économique, du marché libre… » (p. 86) : il fut donc « un libéral limité par sa méconnaissance de l’économie » (p. 96).
Viennent ensuite les deux penseurs de référence de Thatcher, à savoir Hayek et Popper, auxquels Vargas Llosa accorde une égale prééminence. Passant en revue l’abondante bibliographie de Hayek, c’est moins la pourtant si renommée et influente Route de la servitude que la postérieure Constitution de la liberté qu’il considère comme son « livre le plus important » – c’est « son chef d’œuvre » affirme-t-il. En effet, Hayek est loué pour avoir su y repérer, nommer et dénoncer avec les dernières rigueur et vigueur intellectuelles ce qui est au principe du drame occidental du XXème siècle : « comment les responsabilités de l’individu ont été progressivement expulsées par l’étatisme et le collectivisme croissants en réduisant sa marge de liberté et augmentant la capacité de l’État à prendre des décisions dans des affaires qui concernent essentiellement la vie privée. » (p. 138). Et Vargas Llosa de faire finalement grand cas du célèbre appendice qui clôt l’ouvrage : « Pourquoi je ne suis pas conservateur »… Assez curieusement, s’il n’élève aucune critique envers les thèses soutenues par Hayek (sauf sur la nature du socialisme : là aussi, on y reviendra), il n’en va pas de même pour Karl Popper alors que Vargas Llosa le tient pour « le penseur le plus important de notre époque », le fait et de loin bénéficier de la plus longue pagination (70 pages contre 42 pour Hayek) des penseurs recensés dans le livre. Bien entendu, c’est La société ouverte et ses ennemis et sa matricielle opposition paradigmatique entre ladite société ouverte et la « société close » qui se trouvent au centre de l’apologie de la pensée poppérienne, dont la substantifique moelle est ainsi cursivement résumée :
« L’individu, à l’intérieur de cette ruche [la société close] est irresponsable et esclave, c’est une pièce qui se sait irrémédiablement unie aux autres dans la machine sociale qui préserve son existence et le défend contre ses ennemis, contre les dangers qui le guettent hors de cette citadelle hérissée de prescriptions régulatrices de tous de tous ses actes et de tous ses rêves : la vie tribale. La naissance de l’esprit critique lézarde les murs de la société close et expose l’homme à une expérience inconnue : la responsabilité individuelle. » (pp. 176/177).
Mais ce n’est pas tout car voici à nouveau diagnostiquée la cause du drame de l’époque : l’ « appel de la tribu » (on notera que c’est à K. Popper que Vargas Llosa emprunte le titre de son livre) resurgit, séduisant « dans les sociétés ouvertes des individus et des collectivités qui luttent inlassablement pour en faire des sociétés closes et abolir la culture de la liberté. » (p. 179). Pour autant, Vargas Llosa ne s’en montre pas moins, et c’est justifié, sévère envers deux inadvertances de K. Popper : son indifférence sinon son dédain pour les problèmes sémantiques (le choix des mots importe peu), et par suite sa préconisation d’une « ingénierie sociale » (une expression à faire frémir d’horreur tout individu épris de liberté !) afin de réformer les sociétés ouvertes (pp. 202/203) …
Avec les pages consacrées à Raymond Aron puis Isaiah Berlin peuvent toutefois commencer à se poser quelques problèmes au sujet de la conception que Vargas Llosa se fait de ce qu’il faut entendre par « libéralisme ». Concernant Aron, si l’on ne peut qu’adhérer à l’éloge de ce si courageux chef-d’œuvre de la pensée anti-totalitaire que fut L’Opium des intellectuels, va-t-il autant de soi que, bien qu’il se soit lui-même qualifié d’ « incorrigible libéral », il ait intégralement été un « authentique libéral » (p. 225) en tout ? Que Raymond Aron incarne le libéralisme en politique ou sur le plan moral est indiscutable. Mais son libéralisme en économie a de quoi interroger. Dans l’excessive diatribe contre Hayek figurant dans L’Essai sur les libertés (1965, ch. 2) en particulier au sujet de l’impôt progressif, ne confie-t-il pas que « l’économie mixte, … le Welfare State… me paraissent à l’heure présente le compromis le meilleur entre les diverses libertés que la société moderne a l’ambition de donner aux hommes » ? N’est-ce pas plutôt là un étatiste programme social-démocrate vilipendé par… Thatcher ? Ces flottements sur la liberté en économie sont encore bien plus sensibles dans le chapitre suivant sur Isaiah Berlin, le plus méconnu en France des penseurs sélectionnés par Vargas Llosa. Celui-ci le reconnaît d’ailleurs, « le libéralisme d’Isaiah Berlin consista surtout en l’exercice de la tolérance, dans un effort permanent de compréhension de l’adversaire idéologique » (p. 283) : cela suffit-il pour faire de lui « un grand libéral » (idem) ? Et le libéralisme impose-t-il vraiment de vouloir « comprendre » les apôtres du nazisme, du bolchevisme ou maintenant de l’islamisme ? Qui plus est, non seulement Berlin n’accorde presque aucune place à l’économie dans sa pensée, mais quand il le fait, c’est pour réprouver la liberté économique (idem). Alors pourquoi reprocher à Ortega y Gasset son indifférence pour l’économie (au moins ne dit-il rien contre la liberté économique !) si c’est pour la tolérer chez Berlin ?
Libéralisme, socialisme et individualisme
Le parcours s’achève sur Jean-François Revel, grand ami personnel de Vargas Llosa mais qui est à certains égards et paradoxalement le moins bien servi pour ce qui est du rapport au libéralisme. « Socialiste et libéral » (p. 295), « En même temps qu’il était social-démocrate et libéral » (p. 297) : parmi quelques autres appréciations de semblable inspiration, ces caractérisations de la position idéologico-politique de Revel ont de quoi interpeller ! Sur le fond, peut-on en effet être à la fois socialiste ou social-démocrate et libéral, sauf à tordre le sens des mots ? Si une partie des socialistes sont effectivement des démocrates dans la mesure où ils respectent le pluralisme politique, il est impossible de les qualifier de libéraux alors que leur propension congénitale à l’oppression fiscale et l’interventionnisme bureaucratique en fait de fieffés adversaires des libertés individuelles élémentaires. S’agissant de Revel, est-il si certain qu’il aurait été « socialiste une grande partie de sa vie » (p. 288), alors qu’il a définitivement cessé de l’être avant 1980, lors de la signature du « programme commun » socialo-communiste ? Dès 1981 avec l’arrivée au pouvoir de Mitterrand, il signe avec La grâce de l’État une véritable déclaration de guerre au socialisme (« La liberté selon les socialistes se définit comme la participation au pouvoir collectif et non plus comme l’extension du choix et de la responsabilité individuelle », p.144), et récidive en 1984 dans Le rejet de l’État – deux titres que Vargas Llosa ne cite pas alors qu’ils consacrent l’aboutissement d’une spectaculaire rupture avec le socialisme et une pleine adhésion au libéralisme – y compris sur le plan économique. Revel n’aura donc été proche du socialisme que pendant 35 ans (de 1940 à environ 1975), ce qui ne représente pas « une grande partie de sa vie » puisque les trente dernières années le verront devenu intégralement libéral, couronnées par l’apothéose de La grande parade (2000) significativement sous-titré « Essai sur la survie de l’utopie socialiste »[1] et L’obsession anti-américaine (2002), dont étrangement Vargas Llosa ne dit non plus mot. On préférera donc retenir sa belle conclusion sur la mort de son ami qui « a privé la culture libérale d’un de ses combattants les plus talentueux et les plus aguerris et nous a laissés, nous ses admirateurs et amis, avec la déchirante impression d’être orphelins ».
Ce déconcertant flottement au sujet de ce qui sépare et même oppose foncièrement socialisme et libéralisme se retrouve dans quelques autres passages du livre, par exemple lorsqu’à propos des rapports entre Hayek et Keynes il est avancé que « tous deux étaient des libéraux » (Keynes libéral ? Une « fake news » !) ou encore quand Vargas Llosa croit pouvoir reprocher à Hayek de ne pas avoir fait de « distinction entre socialisme démocratique et socialisme totalitaire » (p. 128) et estime au contraire que le « socialisme démocratique n’est plus un socialisme au sens traditionnel du mot et se trouve plus proche du libéralisme que du marxisme » (p. 129). Comme si la redistribution spoliatrice forcenée, la mise sous assistance par l’État-providence et l’hyper-réglementation intrusive chers à la social-démocratie avaient quoi que ce soit à voir avec le projet libéral…
Reste qu’à s’en tenir à ce qu’apportent de neuf (et parfois donc de discutable) les considérations de Vargas Llosa sur les sept penseurs revisités, on risquerait de passer à côté de ce en quoi réside peut-être l’intérêt majeur de son ouvrage : l’expression sous-jacente, aussi profondément cohérente qu’originale, de ses propres convictions, qui font de lui un huitième penseur de poids à ajouter aux autres. Car dans la droite ligne de son engagement anti-collectiviste, c’est une vigoureuse insistance sur le lien consubstantiel entre libéralisme et individualisme comme on n’en fait plus qui s’exprime tout au long de ces pages. D’une lecture transversale de L’appel de la tribu, il ressort en effet que pour Vargas Llosa, la souveraineté de l’individu apparaît comme le critère suprême de l’accomplissement humain. Ce qui ainsi selon lui rend haïssable nationalisme et communisme, c’est « la négation de l’individu comme être souverain et responsable » (p.24) ; aux côtés d’Ortega, il appelle à sauver « cette civilisation [occidentale] qui a rendu possible l’individu souverain avec son indépendance, ses droits et ses devoirs en permanent équilibre avec les autres… » (p. 102) et dans le sillage de Karl Popper, rappelle que « l’individu souverain, émancipé de ce tout grégaire jalousement fermé sur lui-même … est une création tardive de l’humanité » (p. 174) ; enfin, si le concept de « liberté négative » analysé par I. Berlin a tant de valeur, c’est qu’il « part du principe que la souveraineté de l’individu doit être respectée parce qu’elle est, en dernière instance, à l’origine de la créativité humaine, du développement intellectuel et artistique, du progrès scientifique » (p. 263). Or l’institution de la souveraineté civilisée de l’individu en norme morale et fin politique suprêmes qu’est l’individualisme pour une fois bien compris est, pour Vargas Llosa, au fondement du libéralisme qu’il défend.
Á plusieurs reprises souligne-t-il ainsi ce lien consubstantiel avec force : « Ce spectateur impartial possède, de plus, une raison d’être qui apparaîtra plus tard comme l’un des piliers de la doctrine libérale : l’individualisme » (p. 45), « L’individualisme est un facteur central de la philosophie libérale » (p. 116). Et il reprend à son compte le propos de Hayek, « ce défenseur de l’individualisme, de la propriété privée et du marché » (p. 105) : « il existe entre le nazisme et le communisme un dénominateur commun, le collectivisme, c’est-à-dire leur haine de l’individualisme et de la pensée libérale […] Pour Hayek, seuls l’individualisme, la propriété privée et le capitalisme de marché garantissent la liberté politique » (pp. 125 et 126). Mario Vargas Llosa en invétéré et exceptionnel parangon de l’individualisme libéral : par les temps qui courent, le meilleur était pour la fin.
[1] Soit rappelé au passage : ce remarquable ouvrage a obtenu le prix du livre libéral décerné par l’ALEPS en 2000.




1 Commentaire
[…] L’Appel de la tribu de Mario Vargas Llosa […]