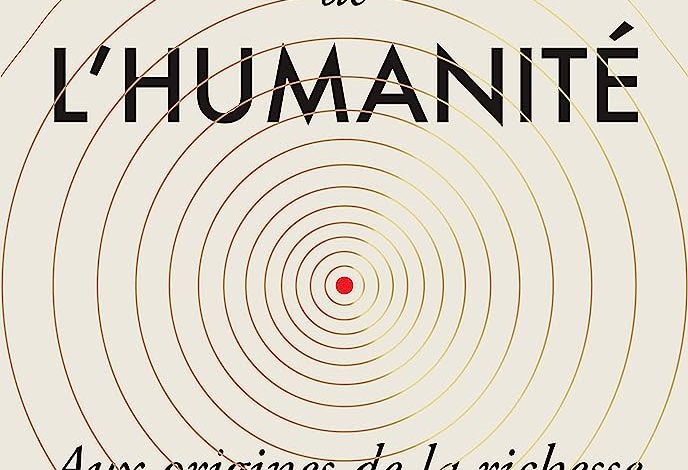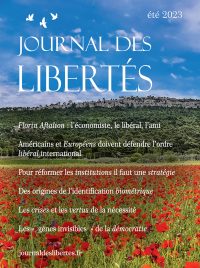de Serge Schweitzer
Presses universitaire d’Aix-Marseille, 2023 (150 pages)
Le dernier ouvrage de notre collègue Serge Schweitzer est consacré à un sujet qui peut intéresser les libéraux, évidemment, mais aussi tous les spécialistes d’économie et de sociologie de la connaissance. Il s’organise autour de trois chapitres : le libéralisme n’est pas un bon placement pour un opportuniste (Chapitre 1), Stratégie et tactiques des intellectuels sur le marché des idées (Chapitre 2) et Le libéral et le socialiste : portrait croisés (Chapitre 3). A ces trois chapitres s’ajoute une annexe qui défend les économistes français des facultés contre les assertions du Professeur Salin qui les juge sévèrement et propose une critique du concept d’intérêt général.
Cette note présente la question posée par le livre, les réponses qui sont données et conclut par une mise en perspective des réponses proposées par rapport à quelques grandes explications déjà avancées.

Question
La question posée par le livre trouve son origine dans un article du Professeur Pascal Salin pour l’Association pour la liberté économique et le progrès social (ALEPS) qui s’interroge sur les raisons pour lesquelles l’école autrichienne d’économie n’emporte pas l’adhésion du plus grand nombre et ne soit finalement pas enseignée dans les universités en France et plus généralement dans le monde (pp. 21-23).
La question du livre est celle-ci : « Pourquoi le libéralisme a non seulement si peu d’adeptes, mais tout autant charrie d’impressionnantes cohortes d’adversaires déclarés et si résolus qu’ils ne souhaitent rien moins que sa disparition ? » (p. 19). Ceci serait d’autant plus incompréhensible que le libéralisme a « permis de comprendre comment l’humanité a vaincu la malédiction ancestrale de la famine » et « désincarcéré l’individu des chaînes lui interdisant d’épanouir nombre de ses virtualités, hors des dogmes et des passages obligés ». Son adoption au XXe siècle par les élites politiques et administratives de nombreux pays occidentaux aurait de plus permis d’éviter les millions de mort des doctrines concurrentes qu’ont été le communisme, le national socialisme, le fascisme, le franquisme et plus généralement toutes les croyances dans les régimes autoritaires (p. 12). L’échec du socialisme réel aurait dû conduire à montrer au plus grand nombre sa nature insoutenable et immorale. Il y aurait donc un paradoxe du libéralisme. Il est bon et pourtant détesté.
Cette haine du libéralisme est palpable dans les médias et la presse contemporaine (p. 15 et p. 65). Elle n’est pas nouvelle. Elle remonte, au moins en France, nous rappelle Serge Schweitzer, à l’Empire et aux craintes exprimées par Napoléon, lui-même, qui écrit « j’ai toujours pensé que s’il existait une monarchie de granit, il suffirait des économistes pour la réduire en poudre » (p.35). Le pouvoir s’est toujours méfié de la doctrine libérale. Ce constat aurait pu être renforcé en mobilisant toutes les enquêtes qui ont été produites sur le positionnement idéologique des universitaires français (Rios et Magni-Berton 2003[1] ; François et Magni-Berton 2015[2]). L’anticapitalisme est plus ou moins fort selon les disciplines, mais il est une réalité dans les universités et les organisations de la recherche française. Il s’exprime d’ailleurs dans les urnes puisque, comme le rappelle l’économiste Gilles Saint-Paul (2007[3]), 72% des enseignants ont voté à gauche en 2002 aux élections présidentielles. Les enseignants sont plus à gauche que les Français et même plus à gauche que les autres fonctionnaires (Rios et al. 2003[4]).
Réponses
Pour l’auteur, l’explication de cette haine du libéralisme se trouve dans les travaux des Professeurs Alain Wolfelsperger (2002[5], 2006-2007[6]) (p.24) et Raymond Boudon (2004[7]) (p. 40), dans le concept de marché des intellectuels (p. 45) et au moyen d’une étude de caractère : les libéraux auraient des caractéristiques psychologiques que n’auraient pas les socialistes ou les dirigistes.
Pour expliquer la haine du marché, Raymond Boudon (2004) utilise la théorie de la frustration relative. Les intellectuels sont frustrés. Ils sont les premiers de la classe et se retrouvent au bas de la hiérarchie des revenus, derrière les sportifs, les boulangers et les restaurateurs. Ils haïssent alors l’économie de marché et le libre contrat parce qu’ils estiment qu’ils ne les rémunèrent pas à leurs justes valeurs (p. 40). Ils mériteraient mieux.
Le concept de marché des idées est aussi repris de Boudon & Bourricaud. Il y a trois marchés des intellectuels : le marché de type autarcique (p. 61), le marché de type commercial (p. 62), relation directe entre l’intellectuel et le lecteur de son livre et le marché des idées de seconde main animé par les journalistes[8] (p. 63). Comme pour les hommes politiques chez Max Weber dans son livre le Savant et le politique, les économistes peuvent chercher à vivre de la science économique (économiste par qualification) ou à vivre pour les sciences économiques (économiste par vocation).
Les économistes qui vivent de leur science répondent à la demande. Ils s’intéressent plutôt aux marchés de type commerciaux et aux marchés de seconde main. Ils sont pour cette raison obligés de traiter de l’actualité. Ils cherchent à répondre à la demande des journalistes, des médias, de l’opinion. Les journalistes sont les médiateurs du marché des intellectuels de seconde main. Les économistes par qualification ont une relation commerciale. Ils vendent des livres comme on vend des crayons. Ils ont besoin d’agrandir la taille de leurs marchés. Il y a les marchés privés et les marchés publics. C’est nous qui faisons cette distinction pour simplifier le propos. Sur les marchés publics il faut réussir à faire croire aux élus et aux hommes politiques qu’ils pourront faire mieux que les mécanismes de marché ou associatifs s’ils financent sur l’impôt la production de sciences économiques. Ces économistes ont intérêt à ce que le pouvoir politique demande de l’expertise. L’inflation législative et la complexité fiscale sont de bonnes raisons pour les élites politiques et économiques de financer des experts. Le dirigisme crée la complexité et la complexité sert l’expert, ici l’économiste (p. 51). « L’Etat providence est la providence des experts » (p. 51). Le dirigisme ne se justifie, cependant, que parce qu’il est censé faire mieux que les ordres décentralisés. Pour faire mieux il faut assurer le législateur qu’il peut disposer d’information de meilleure qualité que la connaissance des acteurs. Il vend l’existence de prédictions détaillées (p. 55) pourtant impossibles si l’on garde à l’esprit le principe selon lequel le futur est indéterminé (p. 55). L’économiste par qualification a aussi intérêt à développer la taille du marché pour les économistes. Il va alors proposer un prêt-à-penser aux journalistes et aux citoyens. Il va privilégier les sujets d’actualité et la conjoncture et ne pas s’engager dans la production de théories rigoureuses et complexes, mais privilégier la simplicité, la pédagogie (p. 67). Le mot d’ordre est de rendre accessible.
Le libéralisme et la théorie des ordres complexes d’un auteur comme Hayek sont couteux à acquérir (p. 67 et 68), à comprendre. Ils ne répondent pas, de plus, aux attentes des élus et de l’administration publique, alors que les doctrines dirigistes ou le socialisme sont directement applicables par des hommes politiques qui cherchent des discours et des mesures pour résoudre les problèmes sociaux qui ne manquent pas. Le libéralisme défend le commerce, mais est une doctrine qui a commercialement un marché de petite taille.
Les économistes par vocation se positionnent plutôt sur le marché autarcique. Ils vivent dans le temps long de la connaissance. Ils vivent sobrement ou grâce à un capital social, un patrimoine familial élevé (pp. 48-49). Ce qu’ils recherchent c’est la reconnaissance des pairs, la gloire, des médailles (p. 50) et peut-être, si leur œuvre est un succès, de l’argent via leur notoriété qui leur permet de devenir la source des intellectuels de seconde main ou une récompense comme le prix en l’honneur d’Alfred Nobel (p. 52 note 23).
Les deux catégories d’économistes ne sont pas imperméables. On peut très facilement passer de l’économique par vocation à l’économique par qualification. De nombreux membres du cercle des économistes ont fait ce chemin (p. 53). Pour obtenir cette réputation et la reconnaissance des pairs (marché des intellectuels autarcique, p. 61), deux stratégies sont possibles, laisser faire ou chercher par tous les moyens, même le dénigrement de la personnalité des autres économistes, à se hisser à la première place, à attirer l’attention du plus grand nombre (p. 50). Pour être lu et cité rien de mieux que de créer une école, avoir des disciples. Dans les universités publiques, il faut contrôler les commissions de recrutement et faire nommer comme dans les écuries des partis politiques, son candidat. D’une manière symétrique, dans un ordre universitaire où l’impôt finance la recherche et où le monopole domine la concurrence loyale entre les idées, les combines de faculté l’emportent sur le verdict de l’intérêt de la société civile pour une idée. La conséquence est un enseignement plutôt défavorable à l’économie de marché et à la défense des libertés et une formation dans les facultés qui conduit à faire croire que la seule science est dirigiste. Les médias, les médiateurs des marchés de seconde main, ne font alors que reprendre les positions qui leur ont été enseignées (p. 66).
Le marché des idées libérales aurait donc une taille restreinte. Ce qui limiterait les opportunités de profit et l’intérêt que les économistes par qualification et de seconde main lui portent.
Les idées libérales seraient aussi inadaptées à l’organisation publique des universités et de la recherche. Comment justifier que l’Etat finance des idées qui lui sont défavorables sous le principe traditionnel du qui paie commande ? Ces deux raisons peuvent expliquer la faiblesse de l’idéal libéral chez les économistes. Le socialisme et toutes les formes de dirigisme seraient à l’inverse beaucoup plus adaptés. Ils auraient des réponses conjoncturelles aux problèmes sociaux posés par l’actualité. Ils répondraient directement à la question des dirigeants : que dois-je faire pour montrer au plus grand que je suis concerné par leur problème ?
L’étude des caractères associés à chaque doctrine complète cette analyse par le principe de rationalité. Les croyances répondent au principe d’économie : les individus veulent comprendre le monde en minimisant leurs efforts. Le libéralisme est une doctrine coûteuse (intellectuellement exigeante) et dont les bénéfices en termes de réputation et de reconnaissance par les pairs sont faibles. Il est logique dans ces conditions que le nombre des libéraux soit faible. Il est logique dans ces conditions de retourner l’argument. Pourquoi dans ces conditions existe-t-il encore des libéraux si le calcul coût–bénéfice est si défavorable au libéralisme ? La raison tiendrait au tempérament du libéral (Chapitre 3, p. 81).
Le tempérament libéral privilégie l’autonomie. Le libéral accepte l’isolement et la marginalité. A l’inverse le libéral est « mal à l’aise dans les cohortes massives et les grands rassemblements » (p. 82). Cela affaiblit le mouvement libéral car le libéral joue rarement collectif (p. 82). Il craint la foule (p. 85) et l’esprit grégaire. La figure du chef lui est étrangère. Le tempérament libéral préfère, de plus, la raison au sentiment. Le libéralisme est qualifié « d’ascèse intellectuelle d’une exigence absolue » (p. 89). Il réprimerait « l’émotion au profit du cortex » (p. 89). Le libéral aurait une passion pour la raison (p. 84) et la lucidité (p. 85). Le socialiste à l’inverse serait dans les sentiments (p. 75). Il souffrirait avec les pauvres et refuserait cette réalité en privilégiant l’utopie, le volontarisme politique, la possibilité de changer non pas son existence, mais le monde, l’existence des autres. La popularité du socialiste trouverait alors ses origines dans le goût des autres qu’exprime une telle doctrine. Le socialiste est alors aimé par les journalistes parce qu’il est un rêveur. Il endosse tous les malheurs du monde (p. 87). Il se veut concerner par les questions sociales. Le socialiste serait « masochiste ». Il ferait « volontiers don de sa personne, mais avec les impôts des autres » (p. 87). Il promettrait « le pain et le vin pour tous par la grâce des banquiers centraux et des bureaucrates » (p. 88). Le socialisme s’installerait finalement par la démocratie qui est définie comme un régime où le peuple à le « pouvoir de substituer un tyran à un autre « (p. 93). Un tel régime est jugé incomparable par rapport aux régimes totalitaires que furent le communisme, le fascisme et le national-socialisme (p. 93). Il reste pourtant tyrannique car la démocratie oblige à faire la guerre et parfois des guerres inutiles comme la guerre d’Algérie (p. 94).
Conclusion
Pour conclure proposons quelques pistes pour compléter voire amender le propos de Serge Schweitzer. Il s’agit de rappeler l’enjeu de l’étude de l’antilibéralisme et de situer l’explication proposée dans sa littérature.
L’enjeu est l’explication des changements institutionnels et des choix de politiques publiques. Quel est le rôle de l’idéologie dans l’histoire des institutions[9] ? Si les idées ne jouent aucun rôle dans l’histoire des hommes, l’étude du déclin du libéralisme est finalement sans enjeu véritable. Il faut donc croire que sans le succès de l’idéologie communiste, socialiste, l’expérience soviétique n’aurait pas eu lieu[10]. Si tel est le cas, il est extrêmement important de savoir comment le socialisme est né et comment il s’est diffusé dans le corps social. Mais aussi pourquoi le libéralisme a décliné au XXe siècle.
L’explication proposée par Serge Schweitzer, cela vient d’être rappelé, repose sur le concept de marché des idées et sur l’existence d’un tempérament. En parlant de tempérament, elle focalise l’attention sur une sorte d’innéité du libéralisme qui rompt avec l’éducation et toute forme d’atavisme culturel. Tout comme nous sommes mal à l’aise avec l’explication qu’avance Mises (1927) de l’antilibéralisme, nous ne sommes pas très à l’aise non plus avec l’explication par le tempérament. Les explications par la structure incitative nous paraissent plus solide et plus en accord avec l’approche traditionnelle par le principe de rationalité de l’école libérale.
L’explication par le tempérament et l’idée que le libéralisme serait fondamentalement rationnel et coûteux à comprendre peuvent-être rapprochées des explications proposées par Ludwig von Mises.
Mises (1927[11]; [1956[12]] 2014) explique l’antilibéralisme par i) le ressentiment[13] envers ceux qui auraient mieux réussi, et ii) par ce qu’il nomme le complexe de Fourier (1927), du nom du socialiste français. i) L’opposition au libéralisme ne vient pas de la raison. Il s’agit d’une « malveillance envieuse » et d’une « attitude mentale pathologique ». Le sociologue allemand Helmut Schoeck ([1966] 1994[14]) a développé le lien entre envie et antilibéralisme. L’égalitarisme est une solution aux conflits que provoquent l’envie. L’envieux veut le mal, posséder ce que possède l’autre. L’envieux n’est pas jaloux. On est jaloux du possesseur ; on est envieux de la possession. L’envieux est parfaitement prêt à se blesser lui-même si, ce faisant, il peut blesser ou faire souffrir l’objet de son envie. Il préfère une situation dans laquelle tout le monde est pauvre à une situation dans laquelle tout le monde est moins pauvre mais un autre a plus que lui. L’ordre social doit se résoudre à traiter cette question des conflits par l’envie, les envieux ne gouverneront jamais le monde, mais il ne sera jamais possible d’éliminer les envieux (Schoeck [1966] 1994, Chapitre XXII). ii) Ludwig von Mises (1927 Section 6) va cependant encore plus loin lorsqu’il traite l’antilibéralisme d’attitude mentale pathologique. Le complexe de Fourier fait que le libéral doit faire face à une opposition provenant d’individus frappés d’ «une maladie grave du système nerveux, une névrose qui est plus du ressort du psychologue que du législateur [15] ». Cela signifie qu’il est vain pour le libéral de vouloir convaincre un socialiste par des arguments rationnels. Le socialisme relève au mieux du refus d’assumer ses échecs et au pire d’une pathologie.
Une telle explication n’a, cependant, à notre connaissance aucun fondement clinique et rend impossible toute controverse scientifique ou morale puisque l’une des partis aux débats est disqualifiée. Elle rompt à notre avis avec l’éthos libéral. L’explication par le tempérament est d’un autre ordre. Elle relève de l’inné et non du pathologique. Elle est une sorte de théorie de la fertilité appliquée aux idées. Le libéralisme ne peut pas s’épanouir chez tous les individus. Il ne suffit pas de le semer, encore faut-il qu’il trouve un sol qui lui soit favorable. Il ne se développe que chez des personnes qui ne privilégient pas l’émotion sur la raison. Une telle explication rompt avec le principe du libre arbitre. Il y aurait une sorte d’innéité du libéralisme. Trois arguments peuvent être avancés contre cette explication par le tempérament. i) Elle ne permet pas d’expliquer la conversion et l’évolution idéologique. Ne dit-on pas qu’Hayek était proche des idées du socialisme de la Fabian Society dans sa jeunesse[16] ? ii) Elle est incompatible, ensuite, avec le libre arbitre. Chacun hérite d’une idéologie et ensuite sous l’influence de sa pratique et ses lectures la fait évoluer. iii) Elle ne permet pas, enfin, d’expliquer pourquoi les Professeurs des facultés de droit étaient libéraux au XIXe siècle en grande majorité et qu’en 1968 leur part dans le corps professoral était tombé à moins de 5%. S’il s’agit d’une question de tempérament ce dernier ne devrait-il pas être réparti de façon équivalente d’une génération à l’autre ?
L’explication par le marché des idées peut répondre à cette question. Comme sur tous les marchés, le financement de certaines idées par l’impôt peut provoquer des distorsions et des biais de sélection qui peuvent rendre compte de l’antilibéralisme dans les universités publiques. L’étude du marché des idées est une innovation des économistes de l’école de Chicago (Stigler & Coase[17]). L’hostilité au marché est souvent justifiée par la condamnation des valeurs matérialistes, de l’égoïsme, du profit et des inégalités. George Stigler (1965[18]) répond très simplement à ces critiques en disant que tous ces maux sont aussi présents dans les débats académiques. L’égoïsme chez les universitaires n’est pas moins grand que chez les consommateurs de voiture (Stigler 1965, p. 72). Ils peuvent vendre leur conviction pour une publication, un poste ou la reconnaissance des pairs (Stigler 1965, p. 73). La prostitution académique n’est pas une vaine expression. Les universitaires ne sont pas, de plus, seulement motivés par la vérité. La critique d’un collègue, la joie de montrer que l’on est plus intelligent, plus malin a aussi sa place.
Le groupe des intellectuels devrait aussi garder en tête qu’il a énormément grandi grâce au capitalisme. C’est parce que les citoyens sont plus riches qu’ils peuvent acheter des biens culturels, des livres et que le marché des idées ne cesse de s’étendre. La conséquence est une hausse significative du nombre des intellectuels. Ces derniers peuvent vendre leurs idées au gouvernement ou aux consommateurs. Les romans, la poésie, et plus généralement la culture de divertissement est, cependant, un marché beaucoup plus vaste que le marché des idées économiques. C’est probablement la cause la plus évidente de la généralisation des idées dirigistes dans le corps universitaire.
L’impossibilité de vivre de son travail d’économiste conduit ses derniers à percevoir dans l’impôt et la subvention publique une opportunité de rente. Les économistes demandent à l’Etat d’acheter leurs œuvres, de financer leurs recherches. La contrepartie est une science économique qui sert les intérêts de ceux qui acceptent de les financer, les administrations publiques et les élus en démocratie. Les idées produites par les économistes et tous les intellectuels qui ne peuvent pas vivre de leur travail se mettent alors à produire des idées utiles pour les dirigeants politiques. Ils produisent un discours pro-gouvernement et anti-marché. Le discours anti-marché est presque plus utile que le discours pro-gouvernement, car le libéralisme n’est pas seulement inutile pour les gouvernements, il est nuisible. Le libéralisme est, en effet, né d’une critique de l’Etat et des risques du monopole de la violence. Le libéralisme politique est un outil pour limiter l’arbitraire du pouvoir Le libéralisme économique demande aux Etats de respecter la souveraineté des consommateurs. Le libéralisme peut affaiblir la légitimité de l’Etat. Une fois financées sur fonds publics, les universités publiques attirent des individus plutôt convaincus des bienfaits de l’Etat. Il y a un biais de sélection. Une fois en poste ils publient des ouvrages antilibéraux et favorables à l’action de leur employeur, le gouvernement. Cette surproduction d’ouvrages défavorables au libéralisme et favorables au dirigisme augmente les coûts de justification du libéralisme dans l’opinion et les médias (journaliste) et renforce la demande de prise de position anti-libérale. Elle génère sa propre demande. La pensée libérale décline probablement moins, pour cette raison, dans les systèmes universitaires où le monopole de la collation des diplômes n’existe pas et où le financement privé domine le financement par l’impôt de la production de sciences économiques.
La question de l’incompréhension du libéralisme traite donc d’un sujet essentiel pour l’histoire des idées, et des institutions formelles (droit) et informelles (culture). Elle incite, nous semble-t-il, aussi à focaliser l’attention des chercheurs en sciences sociales sur l’effet des règles qui président à la production des idées. Changer les règles du jeu académique dans les universités françaises pourrait changer la manière d’écrire l’histoire et de l’interpréter.
[1] Rios, D., et R., Magni-Berton 2003. La misère des intellectuels, Préface Raymond Boudon, Paris L’Harmattan.
[2] François, A., et R., Magni-Berton 2015. Que pensent les penseurs ? Les opinions des universitaires et scientifiques français, Grenoble, PUG.
[3] Saint-Paul, G., 2007. « Le rôle des croyances et des idéologies dans l’économie politique des réformes », Revue d’Economie Politique, 117 (4), 577-592.
[4] Ce résultat n’est pas démenti par les dernières enquêtes du CEVIPOF. Martial Foucault, « Enquête électorale – Présidentielle 2022 », CEVIPOF, Ipsos, Le Monde et Fondation Jean Jaurès. Vague 24, avril 2021.
[5] Wolfelsperger, A., 2002. « L’attitude des médias de masse à l’égard du libéralisme économique », Journal des économistes et des études humaines, 12 (4), 551-558.
[6] Wolfelsperger, A., 2005-2006. « L’ultra-libéralisme ou le style paranoïde dans la critique », Commentaire 116 (hiver), 909-918.
[7] Boudon., R. 2004. Pourquoi les intellectuels n’aiment pas le libéralisme, Odile Jacob, Paris.
[8] La qualification des trois marchés n’est pas celle de Serge Schweitzer, il s’agit de notre interprétation. L’expression intellectuelle de seconde main est issue de l’article de Friedrich Hayek sur le socialisme et les intellectuels. Voir: Hayek, F. A. (1949) « The Intellectuals and Socialism, » University of Chicago Law Review: Vol. 16: Iss. 3, Article 7. Disponible en ligne https://bit.ly/44kEmuK (consulté le 30/03/2023). On peut trouver une traduction française de cet article dans la revue Commentaire. Hayek, F., 2002. « Les intellectuels et le socialisme », traduit de l’anglais par Christophe Piton, Commentaire 99 (3), 673-684.
[9] Sur cette question on peut lire D.C. North et l’économiste et historien américain de l’Etat providence Robert Higgs. Voir par exemple North, D.C. 1992. “Institutions, Ideology, and Economic Performance,” Cato Journal, 11, 3, 477-488 et Higgs R. 2008 “Focus on reform and ideology: The complex course of ideological change,” American Journal of Economics and Sociology 67 4: 547-566.
[10] North, D.C., 1981. Structure and Change in Economic History, New York, London, W.W. Norton & Company.
[11] Mises, L., 1927. Liberalism, Lien : https://bit.ly/433LJpw (consulté le 30/01/2023).
[12] Mises, L., 1956 [2014], « La mentalité anticapitaliste », traduit par Hervé de Quengo, septembre, Institut Coppet.
[13] Le ressentiment touche différemment l’homme qu’il nomme ordinaire et l’intellectuel. L’anticapitalisme de l’homme ordinaire est la conséquence d’une ambition frustrée. Personne ne souhaite être confronté au constat qu’il est moins talentueux. Les individus qui réussissent moins bien vont alors trouver dans les théories anticapitalistes un moyen de minorer leur responsabilité dans leur échec (Mises [1956] 2014, p.26). Il adopte une théorie qui lui permet de penser qu’il n’est pas moins talentueux mais qu’il a eu moins de chance ou que la structure de pouvoir lui est moins favorable. L’inégalité de naissance joue un rôle central dans ce type de rationalisation. L’intellectuel développe de son côté un même type de frustration mais qui se focalise non plus sur un système, mais sur des hommes de chair et de sang. Les intellectuels fréquentent les élites économiques et les haïssent personnellement. Dans les deux cas, la haine du capitalisme cache la haine de la réussite (Mises [1956], 2014, p.31) et un « état neurasthénique qu’on pourrait appeler le complexe de Fourier » (Mises 1927 section 6).
[14] Schoeck, H., [1966] 1995. Une Histoire du mal, traduit de l’allemand par Georges Paulme, Les Belles Lettres.
[15] Traduction Hervé de Quengo. Lien : https://bit.ly/3CThneB (consulté le 30/03/2023).
[16] Boettke, P., 2022. “Friedrich von Hayek (1899-1992), his legacy and classical liberalism,” Lien : https://bit.ly/42Yyt5u (consulté le 30/03/2023).
[17] Coase, R.H., 1974. “The market for goods and the market for ideas,” The American Economic Review, 64 (2), 384-391.
[18] Stigler, G., 1965. “The Intellectuals and the Marketplace,” The Kansas Journal of Sociology, 1 (2), 69-77.