chez Robert Laffont |
Perrin, 2022 (464 pages)
Sous la direction de
Galia Ackerman et Stéphane Courtois
En 1997, les éditions Robert Laffont – et le regretté Charles Ronsac – avaient publié « Le Livre noir du communisme » qui révéla de manière documentée, grâce à l’ouverture des archives de Moscou, l’ampleur et le caractère intrinsèque des crimes du régime fondé par Lénine et systématisé par Staline. La diffusion de ce livre dans plus de vingt-cinq pays semblait alors avoir contribué à la ruine du prestige moral de l’URSS. Et l’échec du putsch de Moscou en 1991 suivi de la démission de Mikhaïl Gorbatchev avaient symbolisé pour la plupart des observateurs une sortie du communisme et un changement d’époque. Or nous montrons ici les étapes de « la reconquête » lancée par le KGB-FSB et sa créature, Vladimir Poutine, depuis l’ascension de celui-ci au pouvoir jusqu’à la guerre en Ukraine qui continue et dont on ne peut présager l’issue. Nous chroniquons la somme des crimes de Poutine contre son propre peuple, asservi et abêti, et contre d’autres peuples – les Ukrainiens, les Tchétchènes, les Géorgiens, les Moldaves, les Syriens, les Vénézuéliens, etc. – dont ce régime empêche un développement normal en soutenant leurs gouvernants dictatoriaux ou en leur imposant la guerre et la destruction de leur économie. C’est la nuisance comme principe politique qui a fait connaître Poutine aux habitants de notre planète. Décortiquer son parcours et son action est une tâche essentielle.
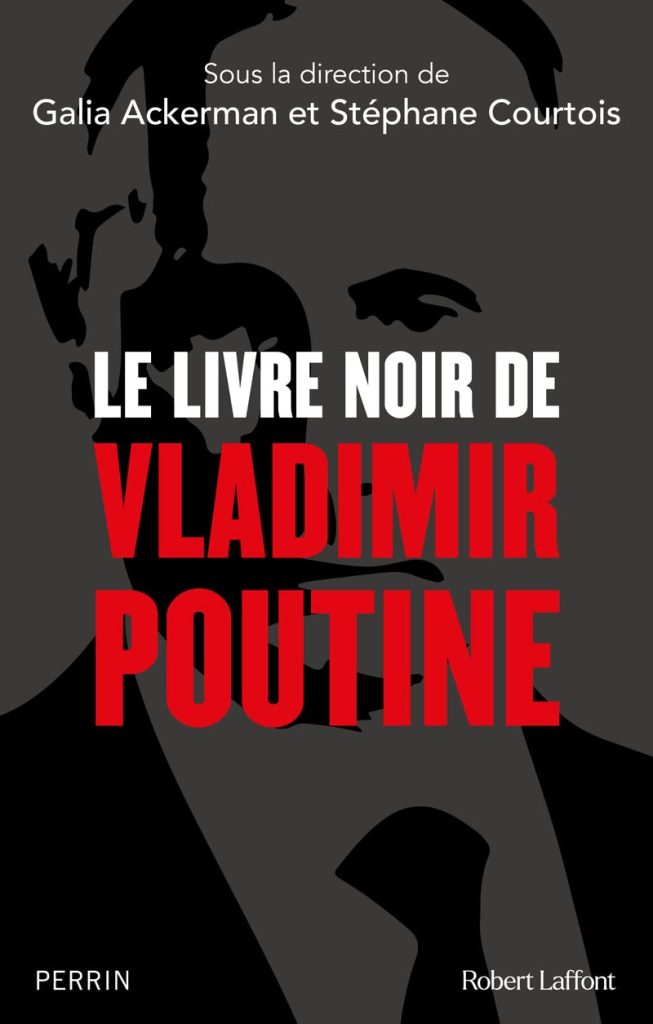
Le KGB revient au pouvoir
par Galia Ackerman et Stéphane Courtois
En décembre 1999, lors d’une réunion des hauts gradés du FSB, à l’occasion de la Journée du tchékiste [sic !], Poutine prononça une phrase symptomatique : « Je tiens à signaler que le groupe d’officiers du FSB envoyé en mission d’infiltration au sein du gouvernement en a bien rempli la première étape. » En effet, à peine élu président, le nouveau maître du Kremlin y appela tous les affidés de son clan de Saint-Pétersbourg, issus des rangs du KGB. Comme put le constater la sociologue Olga Krychtanovskaïa, vers 2003, près de 80 % des postes les plus élevés de l’État étaient occupés par des siloviki dont une proportion considérable issue des services secrets. Selon elle, au sommet de l’État et dans le premier cercle de Poutine, il n’y avait presque plus que des gens issus des services d’espionnage et de contre-espionnage. Plus intéressant encore, les siloviki firent leur entrée dans les conseils d’administration des grandes sociétés d’État ou privées. Rapidement, Poutine procéda à une réorganisation de l’administration présidentielle, instance qui ne figurait pas dans la Constitution mais formait le centre réel du pouvoir. Exactement comme du temps de l’URSS, quand le secrétariat du PCUS – quelques personnes, voire le seul Staline de 1931 à 1953 – était le lieu du pouvoir réel, masqué derrière les façades partisanes du Politburo, étatique du gouvernement et pseudo-démocratique du Soviet suprême. Cette réforme fut impulsée par Vladislav Sourkov, un personnage haut en couleur de l’establishment poutinien, qui commença sa vie adulte en 1983-1985 par le service militaire au sein du spetsnaz, les forces spéciales du GRU – le renseignement militaire –, avant de verser dans le domaine de la publicité et des communications où il alla de succès en succès, au service des oligarques, comme Mikhaïl Khodorkovski ou Mikhaïl Fridman.
Vite remarqué au Kremlin, il fut nommé, dès août 1999, vice-directeur de l’administration présidentielle. La réorganisation visait à instaurer un système politique débarrassé de la démocratie et de l’État de droit naissants ; selon un document officiel, mais secret, elle devait « faire de l’administration un puissant organe d’influence ou de pression sur les partis et mouvements politiques, leurs dirigeants, les dirigeants et législateurs régionaux, les candidats à tout poste politiquement important […], les journalistes […], sur les activités des commissions électorales et de leur personnel », afin de permettre au président « de prédire et de créer la situation politique “nécessaire” en Russie, mais aussi de diriger réellement les processus politiques et sociaux dans la Fédération de Russie, ainsi que dans les pays de l’étranger proche ». Tout le programme poutinien des vingt années à venir était déjà là, marqué par la culture du KGB : la vision paranoïaque d’une Russie menacée de tous côtés et l’obsession d’un contrôle autoritaire de la situation, tant intérieure qu’extérieure, qui impliquait l’unité absolue du pays et la chasse aux opposants de la « cinquième colonne ». En conséquence, dès le 13 mai 2000, les 89 régions de la Fédération de Russie furent regroupées en sept provinces, coïncidant avec les régions militaires de l’ex-URSS et dirigées par sept représentants plénipotentiaires nommés par le Kremlin. Rapidement débarrassés des risques de la démocratie électorale et des menaces que faisaient peser une presse libre, une opinion publique éclairée et une justice indépendante, ces potentats, issus en grande partie des « structures de force », inaugurèrent le règne illimité de la corruption et de l’arbitraire. À condition, bien entendu, de se soumettre au clan du Kremlin qui commença à mettre en coupe réglée les provinces, prélevant jusqu’à 80 % de leurs revenus fiscaux. Afin d’assurer le conformisme de l’opinion publique, Poutine édicta en septembre 2000 une doctrine sur la sécurité de l’information, puis créa en mars 2001 un Département de l’information dépendant du Kremlin. Dans la foulée, il priva les puissants oligarques Boris Berezovsky et Vladimir Goussinski du contrôle des médias télévisuels les plus importants (ORT et NTV), réduisit ainsi fortement la glasnost inaugurée par Gorbatchev – qui permettait à la presse de dénoncer nombre de scandales – et fit en sorte que le pouvoir devienne bien plus opaque à l’opinion. Bientôt, le citoyen russe lambda n’eut à sa disposition que quelques sources de radio et de presse écrite pour bénéficier d’une information indépendante, alors que la télévision, totalement sous contrôle, restait le média auquel accédait la majeure partie de la population.
Pour compléter son dispositif de pouvoir, Poutine décida, à la suite d’une loi de mai 2001, de soumettre les partis au financement de l’État et au contrôle intéressé d’une « justice » orientée. Last but not least, il donna l’ordre au FSB de les noyauter, la formation de « noyaux » chez les opposants étant une vieille pratique bolchevique officialisée par Lénine, dès 1920, dans ses ordres à l’Internationale communiste naissante. Puis il chargea Sourkov de fusionner de force son parti (Unité), créé à l’initiative de celui-ci, avec le bloc d’Evgueni Primakov et du maire de Moscou Iouri Loujkov (Patrie-Toute la Russie), pour former, en décembre 2001, le parti Russie unie, future ossature du pouvoir qui lui assura le contrôle de la Douma ; celle-ci, au lieu de représenter les intérêts de ses mandants, se contenta, moyennant de grasses rémunérations, de relayer les ordres du Kremlin et d’instaurer un semblant d’unanimité du pays. Cette dérive autoritaire du pouvoir fut accélérée par un événement inattendu. En effet, le 23 octobre 2002, en réponse aux exactions commises par l’armée russe en Tchétchénie, un commando d’islamistes tchétchènes prit en otage les 900 spectateurs et employés du théâtre Doubrovka de Moscou et exigea le retrait des troupes russes. Au nom de la lutte contre le terrorisme islamiste, devenu une préoccupation mondiale après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, Poutine refusa de négocier et fit donner l’assaut le 26 octobre, avec l’usage d’agents chimiques inconnus, entraînant la mort de 130 otages et l’exécution des 41 membres du commando. En 2011, la Cour européenne des droits de l’homme allait condamner la Russie à payer 1 254 000 euros à 64 plaignants – ex-otages ou proches des victimes –, pour ne pas avoir préparé assez sérieusement son intervention.
Mais il est évident, comme la suite allait le montrer, que le principe du Kremlin était de ne pas négocier avec les preneurs d’otages et de les exterminer, quel qu’en soit le prix pour les victimes. Pendant qu’il s’occupait en priorité de consolider son pouvoir, Poutine confia la gestion des affaires courantes à son Premier ministre Mikhaïl Kassianov, ex-ministre des Finances d’Eltsine. Celui-ci inaugura une série de réformes fiscales et juridiques qui favorisèrent la pérennité des entreprises privées et permirent, en quatre ans, un redressement de l’économie reposant largement sur les exportations d’un pétrole dont le cours ne cessait d’augmenter. S’y ajouta, en décembre 2001, un nouveau code du travail très défavorable à toutes revendications sociales, qui conduisit à l’épuisement progressif des syndicats indépendants. Cependant, le président ne perdait pas de vue les oligarques, désormais considérés non comme des chefs d’entreprise indépendants et propriétaires de leur société, mais comme des « mandataires de l’État chargés de gérer tel ou tel secteur rentable de l’économie, non pour le compte de l’État, d’ailleurs, mais pour celui des occupants du Kremlin qui les autorisent à se remplir les poches au passage ». Dès octobre 2000, Poutine exposa ses intentions et déclara à propos des oligarques : « L’État a entre les mains une matraque dont il peut se servir une fois pour toutes. En frappant à la tête. […] personne ne soumettra notre État à sa loi. Et, si c’est nécessaire, nous détruirons les instruments qui rendent ce chantage [des oligarques] possible ».
L’exemple le plus emblématique de ce maniement de la « matraque » fut l’arrestation stupéfiante, le 25 octobre 2003, de l’homme d’affaires le plus riche de Russie, Mikhaïl Khodorkovski, dirigeant de l’importante entreprise pétrolière Ioukos, l’une des plus grandes compagnies pétrolières privées au monde, qui produisait 20 % du pétrole en Russie, soit 2 % de la production mondiale. La raison ? Le comportement « insultant » de Khodorkovski qui avait osé parler de la corruption dans les hautes sphères du pouvoir et des affaires devant Poutine lui-même et ses acolytes, et qui avait des projets communs avec ExxonMobil et Chevron-Texaco. Il allait être condamné, le 31 mai 2005, à neuf ans de prison pour évasion fiscale, puis à six ans supplé-mentaires, en 2010, et interné dans une colonie pénitentiaire en Sibérie, à 6 500 kilomètres de Moscou, avec seulement quatre droits de visite de sa famille par an ! Plus encore qu’un procès politique, cette condam-nation était un avertissement sans frais pour tous les patrons russes qui non seulement envisageraient de se mêler de politique, mais ne se soumettraient pas strictement au Kremlin. L’arrestation de Khodorkovski préluda au renvoi, à la surprise générale, de tout le gouvernement Kassianov le 24 février 2004, ce dernier étant bientôt poursuivi, à son tour, pour corruption, alors qu’en réalité il s’était opposé à une décision de Gazprom.
Cette société d’État par actions créée en 1993, qui contrôlait une grande part de l’industrie pétrolière et gazière russe, devint, dès 2005, la première entreprise du pays et la cinquième au monde par sa capitalisation boursière ; elle assurait 20 % des recettes budgétaires de l’État, 8 % du PIB, et employait 400 000 personnes. Autant dire un mastodonte devenu le secteur réservé du président qui, en emprisonnant Khodorkovski, privait ostensiblement les oligarques de toute influence réelle. Dans la foulée, l’élection présidentielle du 14 mars 2004 annonça l’évolution dictatoriale du régime. Face à cinq candidats marginaux, Poutine recueillit au premier tour plus de 71 % des voix, avec un taux de plus de 96 % de suffrages exprimés. On ne peut qu’admirer chez lui l’art, typiquement kagébiste, des coups tordus parfaitement coordonnés pour impressionner l’opinion et terroriser ses adversaires. Et aussi ce reliquat fondamental du bolchevisme : la prédation économique, le pillage des biens d’autrui, l’économie de la rente des matières premières. Et, pour tout dire, l’incapacité fondamentale à créer une véritable économie de marché, ce qui implique inévitablement un État de droit assurant le respect des contrats, et suppose l’existence d’une justice indépendante et d’une presse libre. Se mirent ainsi en place des « empires » – du gaz, du pétrole, du cuivre, de l’aluminium, de l’armement –, entre oligarchie économique sous contrôle du Kremlin et réétatisation rampante qui rendirent une large majorité de la population dépendante du pouvoir – sur une population de 146 millions de Russes, 100 millions, familles comprises, sont rétribués par l’État. Rendu formidablement sûr de lui et arrogant par cette réélection facile, et commençant à se prendre pour un nouveau tsar, Vladimir Poutine voulut d’abord régler « définiti-vement » la question tchétchène. Après avoir fait écraser toute résistance armée et massacrer massivement la population civile, il avait installé au pouvoir, en 2003, le clan devenu pro-russe de l’ex-rebelle Akhmad Kadyrov. Celui-ci, assassiné dans un attentat le 9 mai 2004 – moins de deux mois après la réélection de Poutine –, fut bientôt remplacé par son fils Ramzan, après que le nouveau Premier ministre de la Tchétchénie, Sergueï Abramov, eut été victime d’un grave accident automobile à Moscou, en novembre 2005. Dès lors, largement financé par Moscou, le clan Kadyrov et ses kadyrovtsy – une sorte d’armée privée – s’imposèrent par une violence extrême, tandis que Poutine décorait Ramzan de la médaille de Héros de la Russie, la plus haute distinction du pays. La Tchétchénie et tout le Caucase du Nord furent soumis à une réislamisation dans le cadre de la doctrine eurasienne et de l’alliance avec l’Église orthodoxe russe complètement soumise au KGB ; avec même une référence à l’époque stalinienne quand la ministre de l’Éducation nationale de Russie se félicita que Staline eût fait appel à l’Église en 1943.
Cette réislamisation, entièrement tournée contre l’Occident, allait donner lieu, par la suite, à des gestes fortement symboliques ; ainsi, en janvier 2015, à Grozny, Kadyrov organisa-t-il une vaste manifestation pour condamner les caricaturistes de Charlie Hebdo qui venaient de se faire assassiner à Paris ; et en octobre 2021, depuis la Tchétchénie, le père de l’assassin du professeur Samuel Paty se félicita « que son fils soit parti en défendant l’honneur de tous les Tchétchènes et de tous les musulmans du monde » ! En réaction aux menées de Moscou, des activistes tchétchènes et ingouches – deux peuples déportés en Asie centrale en février 1944 – organisèrent plusieurs attentats dont l’explosion en vol de deux avions des lignes intérieures russes et, le 31 août, un attentat suicide dans le métro de Moscou qui fit 10 morts et 50 blessés. Le 1er septembre 2004, jour de la rentrée des classes, un commando prit en otage plus de 1 100 personnes dans la ville de Beslan, en république autonome d’Ossétie du Nord. Au bout de trois jours, les forces spéciales donnèrent l’assaut dans la plus grande confusion – au moyen de roquettes, tanks, lance-flammes –, d’où un bilan officiel très lourd : 382 tués, dont 186 enfants et 31 preneurs d’otages. Cette crise favorisa la mainmise des héritiers du KGB sur la politique étrangère russe, « y injectant leurs “mesures actives”, leur paranoïa, leur complotisme et leur incapacité foncière à se représenter objectivement la réalité ». De 2000 à 2003, Poutine avait lancé une offensive de charme vers l’Europe. Il engagea d’abord un énorme partenariat énergétique avec l’Allemagne – 40 % de ses importations de gaz et 30 % de celles de pétrole –, qui allait devenir un formidable moyen de chantage. Puis il dupliqua l’opération avec l’Italie dirigée par Silvio Berlusconi. Il séduisit même les Anglais et Tony Blair – qui le fit recevoir par la reine –, ainsi que les Français et Jacques Chirac, en accord sur le dossier irakien : les Russes allèrent jusqu’à exiger que Poutine fût reçu à l’Académie française, « comme l’avait été Pierre le Grand » ! (…)





