Les dystopies ou « objets redoutées » de la démocratie
« Le livre entier que vous allez lire », écrit Alexis de Tocqueville en 1835 dans l’introduction à De la Démocratie en Amérique (1835), « a été écrit sous l’impression d’une sorte de terreur religieuse produite dans l’âme de l’auteur par la vue de cette révolution irrésistible. » (p. 6, tome 1[1]).

Une terreur religieuse hante donc les deux tomes de Démocratie en Amérique. Quel est l’objet de cette terreur ? L’objet de la terreur change-t-il entre 1835, date de parution du premier tome, et 1840, date de parution du tome 2 ?
L’objet de cette terreur n’est pas cette « révolution irrésistible » elle-même. La « révolution irrésistible » désigne chez Tocqueville « l’égalité des conditions » dans l’un des sens de cette expression, à savoir l’égale sujétion de l’individu au peuple souverain sur un territoire (p. 76 tome 1, pp. 204 tome 2[2], pp. 334-335 tome 2). Cette égalité de sujétion est apparue dès lors que le souverain a été représenté par un César (p.25, tome 2) ou un roi (pp.3-4, tome 1) et prévaut encore au temps de Tocqueville. Certes l’apparat du souverain changea, mais l’égalité de sujétion persista. Cette « révolution », écrit-il en 1835, « marche depuis tant de siècles à travers tous les obstacles » (p. 6, tome1).
Tocqueville ne s’oppose pas à cette égalité de sujétion. Il ne propose pas non plus de résistance à ses nouveautés démocratiques. Il accepte la démocratie (pp. 6-7, p. 296 p. 304 tome 1, p. 147 tome 2). Mais il craint ce que l’État-nation démocratique moderne peut produire – en fait, produisait déjà, surtout en France.
Si Tocqueville nous met en garde contre ces objets redoutés, c’est afin que nous réagissions et que nous tentions de les prévenir ou de les atténuer. L’Amérique a montré, dans une certaine mesure, comment activer certains éléments préventifs, et Tocqueville voulait que les Français aient connaissance de ces éléments. Pour autant, Tocqueville n’était nullement convaincu que l’Amérique parviendrait à repousser ces objets redoutés. À certains égards, l’Amérique était plus proche de ces évolutions que la France. Mais, dans les aspects principaux – à savoir, dans les mœurs, dans un penchant pour une centralisation excessive et dans une large étatisation des affaires sociales – la France était bien plus avancée que l’Amérique. Dans L’Ancien régime et la Révolution (1856) Tocqueville expliquera comment l’administration étatique centralisée s’est développée sous l’Ancien régime et a été perpétuée par la République.
D’inquiétants avertissements prolifèrent dans sa Démocratie en Amérique et culminent dans la dernière partie du tome 2. Là, « pour conclure », il commence par quelques remarques liminaires. Revenant sur certaines étapes de sa réflexion, il amène en même temps le lecteur « à quelque vérité nouvelle » (p. 325, tome 2). La partie elle-même culmine dans le chapitre le plus célèbre du livre, « Quelle espèce de despotisme les nations démocratiques ont à craindre ». Il nous y confit que ses propres sentiments d’auteur ont changé : « Un examen plus détaillé du sujet, et cinq ans de méditations nouvelles n’ont point diminué mes craintes, mais ils en ont changé l’objet » (p. 355, tome2).
Tocqueville veut-il dire par là que l’objet de ses craintes a changé, tel un ancien bâtiment que l’on aurait rénové, ou fait-il référence à un nouvel objet d’inquiétude qui a surgi dans sa conscience ? Je pense qu’il a en tête deux objets différents, deux dystopies, que j’appellerai la Mauvaise et la Pire.
La Mauvaise
La Mauvaise pourrait se résumer au despotisme étouffant mais néanmoins doux de la « tyrannie de la majorité » (p. 230, p. 310 et p. 316 tome 1). C’est une tyrannie non seulement parce que l’opinion est dominée par des dogmes superficiels et simplistes, mais parce que cette opinion appelle le gouvernement à une expansion et une domination constantes des affaires sociales. Tocqueville l’appelle tyrannie même si le citoyen ne la considère pas comme telle, car un gouvernement expansif, « irrésistible » n’est pas dans l’intérêt du citoyen (p. 305 tome 1).
Voici « une autorité toujours sur pied, qui veille à ce que mes plaisirs soient tranquilles, vole au-devant de mes pas pour détourner tous les dangers, sans que j’aie même le besoin d’y songer » ; cette autorité est « maître absolu de ma liberté et de ma vie », elle « monopolise le mouvement et l’existence » (pp. 111-112 tome 1). « Le naturel du pouvoir absolu, dans les siècles démocratiques, n’est ni cruel ni sauvage ; mais il est minutieux et tracassier. Un despotisme de cette espèce […] ne foule pas aux pieds l’humanité… » (p. 156 tome 2).
Dans le chapitre où Tocqueville parle de l’objet changé, il élabore d’abord l’objet antérieur de ses craintes : « Il semble que si le despotisme venait à s’établir chez les nations démocratiques de nos jours, … il serait plus étendu et plus doux, et il dégraderait les hommes sans les tourmenter » (p. 356 tome 2). Tocqueville parle d’ « un pouvoir immense et tutélaire » qui pèse sur les citoyens, à la manière d’un grand « tuteur », cherchant à « fixer irrévocablement dans l’enfance » les citoyens. Il prétend leur « ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre » (p. 358 tome 2). Le souverain « étend ses bras sur la société tout entière ; il en couvre la surface d’un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes » (p. 358 tome 2). Le souverain « ne détruit pas, il empêche de naître ; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit, enfin, chaque nation à n’être plus qu’un troupeau d’animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger » (idem).
C’est alors que Tocqueville revient à raconter la progression de son sentiment d’auteur : « J’ai toujours cru que cette sorte de servitude, réglée, douce et paisible, dont je viens de faire le tableau, pourrait se combiner mieux qu’on ne l’imagine avec quelques-unes des formes extérieures de la liberté » (p. 359 tome 2), avec entre autres un souverain qui est « électif ou surveillé de près par une législature réellement élective et indépendante » (p. 359, tome 2).
Le Pire
Mais Tocqueville se tourne alors vers « le pire » objet possible, lorsque les pouvoirs législatifs et administratifs concentrés sont déposés « dans les mains d’un homme ou d’un corps irresponsable » (idem). Tocqueville peint alors ce que j’appelle le Pire : les citoyens sont portés « à renoncer à l’usage de leur volonté » ; ils perdent « peu à peu la faculté de penser, de sentir et d’agir par eux-mêmes » (p. 360 tome 2).
Le Pire est l’effondrement de l’état de droit et l’annulation de l’égalité de la sujétion. Alors que le Mauvais maintient un pouvoir gouvernemental tutélaire suffocant qui soumet les individus de manière universelle et égale, selon des règles officiellement affichées, le Pire est un régime corrompu et voyou dans lequel l’égalité de sujétion a disparu. Une faction despotique exerce le pouvoir gouvernemental de manière inégale et infidèle, si l’on prend pour référence les lois et procédures officielles.
Tocqueville termine le fameux chapitre par le paragraphe suivant, qui met en scène un « monstre éphémère » (le Mauvais) mais fait allusion à un éventuel monstre ultérieur (le Pire) :
Une constitution qui serait républicaine par la tête et ultra-monarchique dans toutes les autres parties [c’est-à-dire, avec une administration gouvernementale centralisée], m’a toujours semblé un monstre éphémère. Les vices des gouvernants et l’imbécillité des gouvernés ne tarderaient pas à en amener la ruine ; et le peuple, fatigué de ses représentants et de lui-même, créerait des institutions plus libres, ou retournerait bientôt s’étendre aux pieds d’un seul maître. (p. 361 tome 2)
Remarquez la phrase « m’a toujours semblé ». Tocqueville reconnaît ainsi que le dispositif d’auteur qu’il a utilisé – racontant une progression de son sentiment d’auteur depuis la publication du premier volume – n’est que cela, un dispositif rhétorique et pédagogique. Tocqueville a perçu le « Pire » alors même qu’il rédigeait encore le premier tome.
Le Pire : ce que nous en dit encore le tome 2
C’est principalement dans le tome 2 de la Démocratie que je puiserai pour élaborer la figure du Pire.
« Dans les sociétés démocratiques, écrit Tocqueville, les minorités peuvent quelquefois faire [des révolutions] … Les peuples démocratiques … ne sont entraînés vers les révolutions qu’à leur insu ; ils les subissent parfois, mais ils ne les font pas » (p. 289 tome 2). « Ceux qui … veulent faire une révolution [doivent] s’emparer à l’improviste de la machine toute montée du gouvernement, ce qui peut s’exécuter par un coup de main… » (p. 322 tome 2).
Parlant du « despotisme des factions », Tocqueville écrit à propos de « quelques hommes » qui « parlent seuls au nom d’une foule absente et inattentive… ; ils changent les lois et tyrannisent à leur gré les mœurs ; et l’on s’étonne de voir le petit nombre de faibles et d’indignes mains dans lesquelles peut tomber un grand peuple » (p. 158 tome 2).
Les personnes ambitieuses cherchant à usurper le gouvernement constitutionnel « ont grand’peine à [le] faire … si des événements extraordinaires ne viennent à leur aide » (p. 287 tome 2). La plupart des gens s’accordent à le dire : « [R]ien n’est plus familier à l’homme que de reconnaître une sagesse supérieure dans celui qui l’opprime » (p. 11 tome 2).
Tocqueville écrit à propos de la perte de l’intérêt, religieux ou autre, pour l’état futur : « Quand [les individus] se sont une fois accoutumés à ne plus s’occuper de ce qui doit arriver après leur vie, on les voit retomber aisément dans cette indifférence complète et brutale de l’avenir qui n’est que trop conforme à certains instincts de l’espèce humaine… [Pour eux,] le présent s’agrandit ; il cache l’avenir qui s’efface, et les hommes ne veulent songer qu’au lendemain » (pp. 167-168 tome 2).
Chacun s’habitue à n’avoir que des notions confuses et changeantes sur les matières qui intéressent le plus ses semblables et lui-même ; on défend mal ses opinions ou on les abandonne, et comme on désespère de pouvoir, à soi seul, résoudre les plus grands problèmes que la destinée humaine présente, on se réduit lâchement à n’y point songer.
Un tel état ne peut manquer d’énerver les âmes ; il détend les ressorts de la volonté et il prépare les citoyens à la servitude.
Non seulement il arrive alors que ceux-ci laissent prendre leur liberté ; mais souvent ils la livrent (p. 22, tome 2).
« Le public a donc chez les peuples démocratiques une puissance singulière dont les nations aristocratiques ne pouvaient pas même concevoir l’idée. Il ne persuade pas ses croyances, il les impose et les fait pénétrer dans les âmes par une sorte de pression immense de l’esprit de tous sur l’intelligence de chacun » (p. 10 tome 2).
Le Pire est préfiguré dans le premier volume
Déjà dans le premier volume, Tocqueville avertissait clairement qu’ « un grand peuple peut être opprimé impunément par une poignée de factieux ou par un homme » (p. 231 tome 1). La route est pavée par la vaste gouvernementalisation des affaires sociales : « un pouvoir souverain, celui du peuple… détruit [les institutions et les coutumes] ou les modifie à son gré » (p. 206 tome 1). Les gens en viennent à préférer « l’égalité dans la servitude à l’inégalité dans la liberté » (p. 64 tome 1). Le citoyen écrasé « jouit de ces biens comme un usufruitier, sans esprit de propriété » (p. 112 tome 2). « [V]oler le trésor public ou vendre à prix d’argent les faveurs de l’État, le premier misérable comprend cela et peut se flatter d’en faire autant à son tour » (p. 265 tome 1).
Des élections honnêtes peuvent-elles être maintenues ? « Les dangers du système d’élection croissent donc en proportion directe de l’influence exercée par le pouvoir exécutif sur les affaires de l’État » (p. 153 tome 1). « [V]ouloir… que le représentant de l’État reste armé d’une vaste puissance et soit élu, c’est exprimer, suivant moi, deux volontés contradictoires » (idem).
Tocqueville parle du souverain en Amérique comme du « maître » du peuple : « en lui sacrifiant leurs opinions, [les courtisans] se prostituent » (p. 313 tome 1). Le maître lui-même « se voit ainsi comme un étranger dans son pays, et il traite ses sujets en vaincus » (p. 381 tome 1).
« [Aux] États-Unis, la majorité… manque encore des instruments les plus perfectionnés de la tyrannie… Si jamais la liberté se perd en Amérique, il faudra s’en prendre à l’omnipotence de la majorité… On verra alors l’anarchie, mais elle arrivera comme conséquence du despotisme. [p. 316 puis p. 315 tome 1]
[C]ar les temps approchent où la puissance va passer de main en main, où les théories politiques se succéderont, où les hommes, les lois et les constitutions elles-mêmes disparaîtront ou se modifieront chaque jour – et cela non durant un temps, mais sans cesse. [p. 361 tome 1]
[J]e prévois que si l’on ne réussit point avec le temps à fonder parmi nous l’empire paisible du plus grand nombre, nous arriverons tôt ou tard au pouvoir illimité d’un seul. [p. 384 tome 1]
Conclusion
Tocqueville utilise le terme « libéral » comme un signal dans le chapitre intitulé « Quelle espèce de despotisme les nations démocratiques ont à craindre » (p.355 et 361). Il a écrit Démocratie en Amérique dans l’espoir d’empêcher la mort de la civilisation libérale. Pour Tocqueville, la civilisation libérale était un quelque part, à défendre par ses fils et ses filles. Tout au long de l’ouvrage, il exprime l’espoir (tome 1 : p. 7, p. 105, p. 205, p. 383, tome 2 : pp. 331-332, pp. 371-372). Tenir compte de son avertissement nous ouvrira les perspectives d’un meilleur avenir.
Republié avec la permission du City Journal, avec des modifications.
[1] Les références au tome 1 sont tirées de De la Démocratie en Amérique, treizième édition, Tome premier, Paris, Pagnerre éditeur, 1850. Disponible en ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65358454/f13.item.
[2] Les références au tome 2 renvoient à la même édition (Pagnerre, 1850). Cette édition est disponible elle aussi en ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65364363/f13.item




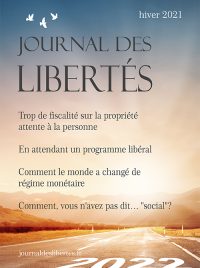
1 Commentaire
[…] Le Journal des Libertés, Dan Klein pense et écrit Tocqueville et souligne les potentielles failles dystopiques de nos institutions démocratique, et des citoyens […]