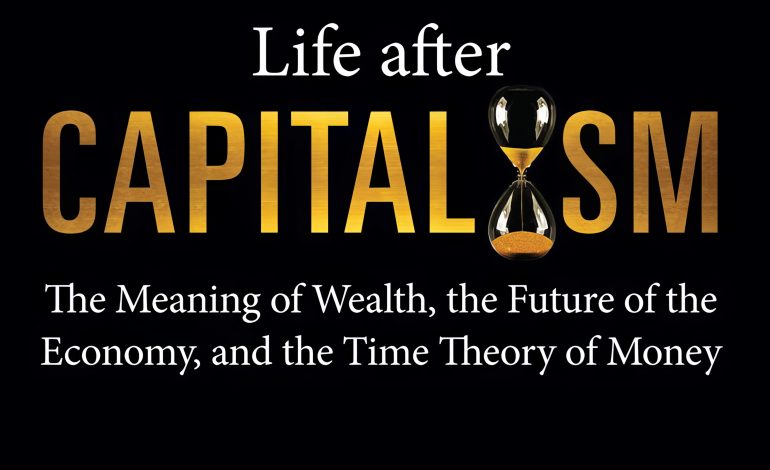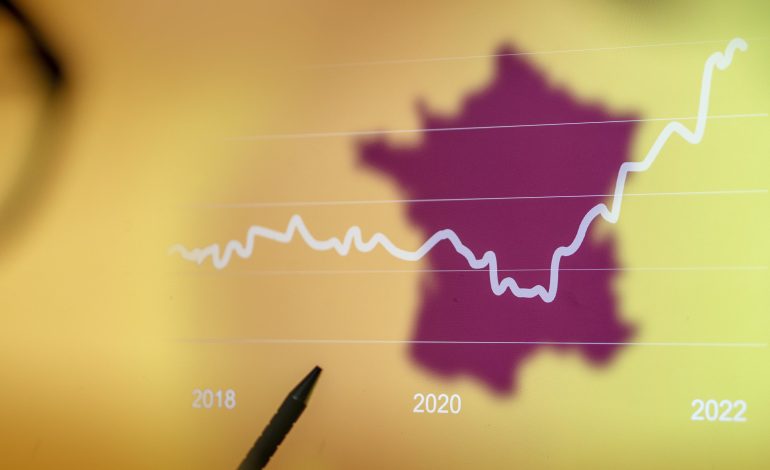de Xavier Jaravel
Editions du Seuil, 2023 (128 pages)
Professeur d’économie à la London School of Economics, Xavier Jaravel est affilié à l’Institute for Fiscal Studies (IFS), au Center for Economic Policy Research (CEPR) et au Centre de recherche sur l’économie de l’innovation au Collège de France. Il est membre du Conseil d’Analyse Economique. Il est titulaire d’un doctorat de l’Université de Harvard (2016) et diplômé de Sciences Po. En 2019, il a reçu le Philip Leverhulme Prize in Economics et en 2021 le Prix du meilleur jeune économiste décerné par le journal Le Monde et le Cercle des Économistes, notamment pour couronner ses recherches sur la croissance, l’innovation et l’inégalité. Son ouvrage détonne dans le paysage égalitariste de l’université française. Mais il est non-conformiste de manière intelligente et habile.
Dans la lignée des travaux de Philippe Aghion, Xavier Jaravel insiste sur l’importance de l’innovation. Celle-ci « permet aux pays en développement d’échapper à la pauvreté » (p. 7) et d’abonder les finances publiques et la protection sociale !
Il observe qu’à l’échelle des siècles, « l’innovation réduit les inégalités économiques par la prospérité matérielle qu’elle induit » (p. 19). Elle bénéficie également au plus grand nombre sur le court ou moyen terme. Contrairement à la doxa actuelle, si les activités entrepreneuriales créent la richesse, l’innovation accroit la mobilité des situations. Ainsi, favoriser le « marché qui promeut l’entrée de nouveaux acteurs reste la meilleure manière d’empêcher que des rentes de situation se constituent à long terme et que le marché soit figé » (p._26). Par ailleurs la concentration actuelle des parts de marché mondiales entre les mains de très grandes entreprises « va de pair avec une hausse de la productivité et du pouvoir d’achat pour les consommateurs, ce dont on ne peut que se réjouir » (p. 24).
Il faut d’autant moins avoir peur de l’innovation écrit-il que « toutes les études parviennent à la même conclusion, a priori surprenante : les entreprises qui automatisent augmentent leurs effectifs salariés » (p. 28) plus que les secteurs qui le font moins et sans que les inégalités n’augmentent au sein de ces entreprises. L’innovation augmente l’emploi, y compris au profit des moins qualifiés, et favorise une remise en cause des situations acquises qui peut « laisser présager une baisse des inégalités de revenus » (p. 31). Et si l’impact de l’IA sur les emplois de demain est encore incertain, l’auteur ne voit pas de raison que l’introduction de Chat GPT et autres machine learning ne permettent pas d’augmenter l’emploi et la productivité des métiers de base, donc leur rémunération. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu’il ne faut pas rester attentif à l’usage de ces innovations et à leurs conditions de mise en œuvre. Par exemple dit-il, Amazon a déposé un brevet « pour un bracelet électronique connecté afin de surveiller l’activité de ses salariés dans ses entrepôts ! » (p. 32). Il faut évidemment rappeler à ce géant de la distribution que des salariés ne sont pas des prisonniers.
Certes, observe Xavier Jaravel, les innovations contribuent souvent à satisfaire les besoins ou les envies des plus aisés et peut à ce titre accroître les inégalités. Il ne servirait à rien pour autant de surtaxer les plus riches, ce qui réduirait les incitations financières à l’innovation. Au-delà d’un certain niveau d’imposition, proche des taux pratiqués en France et dans les pays scandinaves, « l’État réduit ses rentrées fiscales » (p. 59). D’autres suggestions à la mode comme l’instauration d’un revenu universel, la taxation des robots ou le retour de la planification seraient tout aussi inopérantes les unes que les autres.
Xavier Jaravel considère que la croissance serait beaucoup plus forte, et donc également la prospérité française, si l’éducation y était plus solide et permettait mieux aux jeunes plus défavorisés et aux femmes, à haut potentiel, – les Marie Curie du Morbihan – d’accéder aux meilleures études et de se tourner vers les carrières de l’innovation à la même fréquence que les hommes de familles favorisées. Les milieux de l’innovation ont trop tendance à se reproduire sans intégrer autant qu’ils le devraient des entrants extérieurs. Il préconise donc de sensibiliser tous les jeunes aux carrières de l’innovation et souligne que les expériences engagées à cet effet ont été concluantes. Mais il faut surtout remonter le niveau de tout l’enseignement dont la baisse notoire en France est sans doute la cause de la chute de la productivité française. Il faut à cet effet augmenter sensiblement la rémunération des enseignants ; mais il faut plus encore les former mieux, et revoir « les pratiques pédagogiques, l’organisation du temps de travail, la taille des classes, l’aide aux devoirs, les activités péri- et parascolaires, l’organisation des établissements avec peut-être le retour des notes au collège… » (p. 97). On pourrait, dit-il, envisager des cours d’initiation à l’entrepreneuriat au lycée. D’autant conclut-il que « mettre le capital humain au cœur de notre stratégie d’innovation est bel et bien rentable » (p. 100).
La main invisible de Jaravel
Xavier Jaravel critique l’idée de ruissellement (trickle down) parce qu’il ne suffit pas de permettre aux gens de s’enrichir sans payer d’impôts pour que la société tout entière en profite. S’il décrit tous les caractères du « ruissellement » au travers de la création de richesse des innovateurs qui favorisent l’élévation du niveau de vie du plus grand nombre, il préfère parler de rhizome pour souligner le processus diffus, progressif et collectif du progrès général qu’induit l’innovation. Ce faisant, il rejoint bien cette idée que l’enrichissement des créateurs de richesse joue un rôle d’entrainement, de premier de cordée dit M. Emmanuel Macron. Ceux qui créent des produits répondant à des besoins insatisfaits, ou simplement de meilleure qualité et/ou moins onéreux, ceux qui inventent des nouveaux procédés de production, de stockage, de livraison, de communication…, » tous ceux qui améliorent les chaines de valeur travaillent pour eux-mêmes en même temps, souvent, qu’avec la satisfaction d’être reconnus. Mais ainsi, ils concourent au bien commun.
C’est une idée semblable qu’on trouve déjà chez Montesquieu en 1748 dans De l’esprit des lois : « Il se trouve que chacun va au bien commun, croyant aller à ses intérêts particuliers. » C’est la main invisible d’Adam Smith. Bien sûr celui-ci considère que la société ne peut être conduite à un état d’opulence généralisée que si le souverain fait respecter le système, qu’il souhaite, de la liberté naturelle, en assurant l’ordre et la sécurité de la société, en établissant « une administration exacte de la justice » et enfin en érigeant et en entretenant « certains ouvrages publics et certaines institutions que l’intérêt privé d’un particulier ou de quelques particuliers ne pourrait jamais les porter à ériger ou à entretenir, parce que jamais le profit n’en rembourserait la dépense à un particulier ou à quelques particuliers, quoiqu’à l’égard d’une grande société ce profit fasse beaucoup plus que rembourser les dépenses». A ce titre, Smith souhaite notamment que l’État s’assure de généraliser l’éducation et qu’il paye le maître, mais en partie seulement, dit-il, « parce que, s’il l’était en totalité ou même pour la plus grande partie, il pourrait prendre l’habitude de négliger son métier ».
Mais sous ces réserves importantes, Adam Smith énonçait déjà dans la Théorie des sentiments moraux, dans une vision providentielle, que :
« Les riches […], en dépit de leur égoïsme et de leur rapacité naturelle, quoiqu’ils n’aspirent qu’à leur propre commodité, quoique l’unique fin qu’ils se proposent d’obtenir du labeur des milliers de bras qu’ils emploient soit la seule satisfaction de leurs vains et insatiables désirs, [..] partagent tout de même avec les pauvres les produits des améliorations qu’ils réalisent. Ils sont conduits par une main invisible à accomplir presque la même distribution des nécessités de la vie que celle qui aurait eu lieu si la terre avait été divisée en portions égales entre tous ses habitants ; et ainsi, sans le vouloir, ils servent les intérêts de la société et donnent des moyens à la multiplication de l’espèce. »
Il a repris ce thème d’un point de vue plus économique et plus général dans la Richesse des Nations :
« Mais le revenu annuel de toute société est toujours précisément égal à la valeur échangeable de tout le produit annuel de son industrie, ou plutôt c’est précisément la même chose que cette valeur échangeable. Par conséquent, puisque chaque individu tâche, le plus qu’il peut, 1° d’employer son capital à faire valoir l’industrie nationale, et 2° de diriger cette industrie de manière à lui faire produire la plus grande valeur possible, chaque individu travaille nécessairement à rendre aussi grand que possible le revenu annuel de la société. À la vérité, son intention, en général, n’est pas en cela de servir l’intérêt public, et il ne sait même pas jusqu’à quel point il peut être utile à la société. En préférant le succès de l’industrie nationale à celui de l’industrie étrangère, il ne pense qu’à se donner personnellement une plus grande sûreté ; et en dirigeant cette industrie de manière à ce que (sic) son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu’à son propre gain ; en cela, comme dans beaucoup d’autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses intentions ; et ce n’est pas toujours ce qu’il y a de plus mal pour la société, que cette fin n’entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d’une manière bien plus efficace pour l’intérêt de la société, que s’il avait réellement pour but d’y travailler. Je n’ai jamais vu que ceux qui aspiraient, dans leurs entreprises de commerce, à travailler pour le bien général, aient fait beaucoup de bonnes choses. Il est vrai que cette belle passion n’est pas très commune parmi les marchands, et qu’il ne faudrait pas de longs discours pour les en guérir. »
En effet, Smith se méfiait de la morale des capitalistes et des marchands capables souvent de tout pour faire prospérer leurs affaires. Et dans l’opposition parfois radicale entre employeurs et employés, il demandait de veiller aux intérêts de ces derniers. Pourtant, malgré ces réserves, Adam Smith pense que le libre marché – sa main invisible – est la moins mauvaise solution :
« Quant à la question de savoir quelle est l’espèce d’industrie nationale que son capital peut mettre en œuvre, et de laquelle le produit permet de valoir davantage, il est évident que chaque individu, dans sa position particulière, est beaucoup mieux à même d’en juger qu’aucun homme d’État ou législateur ne pourra le faire pour lui. L’homme d’État qui chercherait à diriger les particuliers dans la route qu’ils ont à tenir pour l’emploi de leurs capitaux, non seulement s’embarrasserait du soin le plus inutile, mais encore, il s’arrogerait une autorité qu’il ne serait pas sage de confier, je ne dis pas à un individu, mais à un conseil ou à un sénat, quel qu’il pût être… »
* * *
* *
Xavier Jaravel est sans doute trop prudent pour s’en référer à Adam Smith, honni par tous ceux qui se coalisent contre la liberté du marché. Il en est pourtant très proche y compris en adoptant une approche morale qui était celle d’Adam Smith. Pour engager les réformes qu’il souhaite, Xavier Jaravel propose un « tournant délibératif » par la multiplication des consultations et conventions citoyennes. Il rêve sans doute un peu en méconnaissant les dérives de tous comités populaires et autres soviets. Mais il a probablement raison de proposer des jalons qui rendent acceptables à beaucoup son discours et sa démonstration que différemment certains remiseraient bien volontiers sans doute aux poubelles de l’ultra libéralisme.
Le petit livre de Xavier Jaravel se lit avec autant de plaisir que de facilité. Il saura convaincre ses lecteurs de bien des vertus libérales.