« Contre Napoléon »
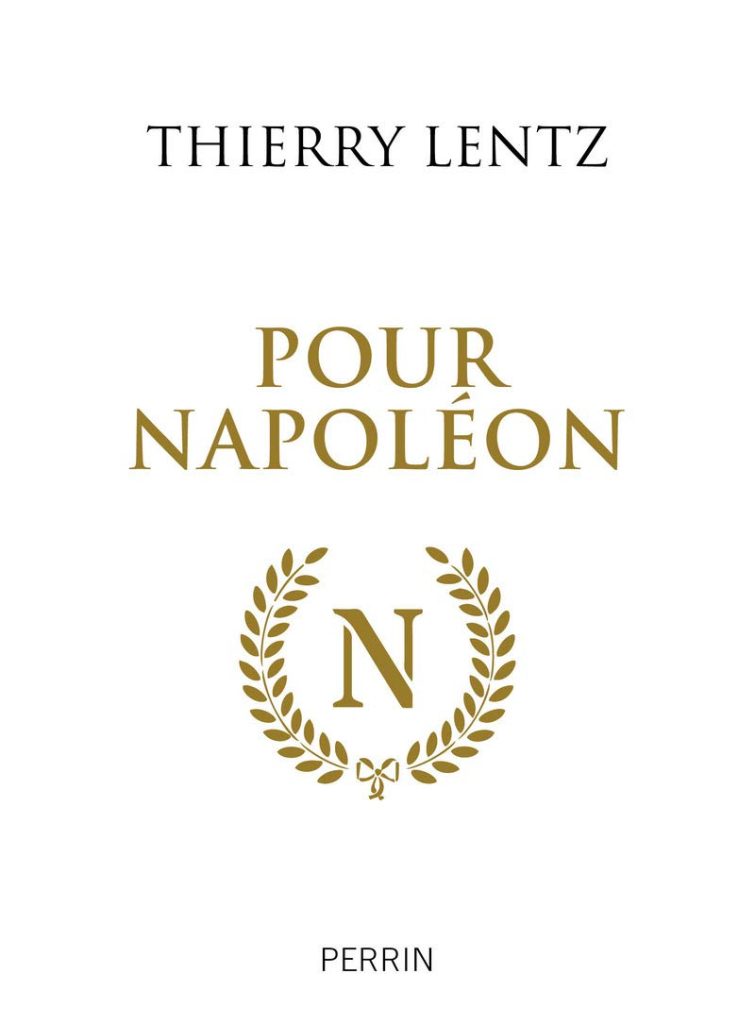 Le bicentenaire de la mort de Napoléon ne fait pas l’objet d’une commémoration officielle compte tenu des polémiques, mais il charrie son inévitable lot d’ouvrages consacrés qui à l’Empereur, qui à ses proches, qui au Consulat ou à l’Empire. Le livre de Thierry Lentz, Pour Napoléon, retient l’attention puisqu’il s’agit de la nouvelle œuvre de l’un des principaux spécialistes en la matière. Directeur de la Fondation Napoléon, il fait autorité. Toutefois, il est permis de ne pas pleinement accepter les thèses de l’auteur.
Le bicentenaire de la mort de Napoléon ne fait pas l’objet d’une commémoration officielle compte tenu des polémiques, mais il charrie son inévitable lot d’ouvrages consacrés qui à l’Empereur, qui à ses proches, qui au Consulat ou à l’Empire. Le livre de Thierry Lentz, Pour Napoléon, retient l’attention puisqu’il s’agit de la nouvelle œuvre de l’un des principaux spécialistes en la matière. Directeur de la Fondation Napoléon, il fait autorité. Toutefois, il est permis de ne pas pleinement accepter les thèses de l’auteur.
Le titre de l’ouvrage annonce la couleur : il s’agit de défendre Napoléon, sans pour autant, dixit Thierry Lentz, verser dans l’hagiographie. L’objet principal est clairement annoncé : briser les interprétations abusives qui font de Napoléon un suppôt de l’esclavage, le fauteur d’un totalitarisme avant la lettre ou encore le fondateur d’une ignoble société patriarcale. Le ton est alerte, il est aussi vif et polémique, particulièrement lorsque l’auteur s’en prend aux ignares, aux féministes hystériques et autres « racialistes ». Entre les lignes et parfois plus, le régime d’Emmanuel Macron n’est par ailleurs guère en odeur de sainteté.
Concis, l’ouvrage a le grand mérite d’être limpide et précis, sûr dans son propos et de mettre les points sur les i au gré des vingt brefs chapitres. La méthode de l’auteur renvoie systématiquement à la dénonciation des amalgames et avant tout de l’anachronisme. Mais, quoi qu’il s’en défende, le portrait de Napoléon apparaît au final très avenant. Et c’est à ce point que nous ne suivrons plus l’auteur.
Napoléon, c’est le « grand homme », c’est-à-dire celui « par son action et sa volonté qui influence la marche de son temps », celui qui est à la fois « l’effet et la cause d’une époque particulière » (p.20). Son œuvre intérieure, « hardie par ses méthodes et prudente dans ses choix, a si bien cimenté la France de l’époque contemporaine » (p. 71). Ce qui renvoie évidemment au Code civil, mais aussi à l’administration, à la justice, à la santé publique, à l’enseignement, etc. (pp. 13-15).
Mais à force de tout traiter par les « circonstances » et de tout mettre dans le « contexte », le directeur de la fondation Napoléon en vient à oublier que le vrai « grand homme » est peut-être aussi celui qui s’échappe des circonstances, celui qui s’abstrait du contexte. Faute de quoi l’on en vient à tout excuser, du moins à tout relativiser : les morts, la censure, les atteintes diverses aux libertés, etc.
« C’est d’après sa pensée et sous son impulsion qu’a été fondée, assise et préservée la France contemporaine », est-il mentionné à la fin de l’introduction (p. 15). Toutefois, il faut attendre le 18ème chapitre, consacré à l’ « Etat napoléonien », pour prendre connaissance de ce que le lecteur pressent depuis les premières pages et de ce qui constitue certainement le fil conducteur des thuriféraires de Napoléon. Après avoir prétendu dans le 8ème chapitre qu’à l’époque en Europe « un Etat de droit aussi poussé n’existait qu’en France » (p. 82) – sans préciser s’il s’agissait uniquement de l’Europe continentale…–, l’auteur n’hésite pas à écrire : « On ne remerciera jamais assez Napoléon d’avoir fondé en France un Etat central solide » (p. 171). L’héritage napoléonien semble remarquable, particulièrement après la Seconde Guerre mondiale puisque Thierry Lentz souligne par la suite ceci : « C’est aussi grâce à l’énergie de l’Etat, à sa vision stratégique et à sa neutralité qu’ont été menée la reconstruction post-1945 puis fondés l’aménagement du territoire et le développement de pans entiers de nos activités industrielles. Et c’est encore l’Etat qui, élargissant son champ d’action sous l’empire des nécessités [sic], a conçu ou suscité nos politiques sociales financées par les contributions, prélèvements, charges et taxes qu’il était le seul à pouvoir imposer » (pp. 171-172).
L’auteur loue ensuite l’exception française de l’unité et de l’indivisibilité de l’Etat, et il voue en conséquence aux gémonies la décentralisation, soutenue entre autres par les « tenants du néolibéralisme » (p. 178) : « Cette spécificité française du rôle de l’Etat, que Napoléon voulait “au centre de la société, comme le soleil” plonge ses racines théoriques dans la fin de la monarchie traditionnelle et la Révolution. (…) Cette centralisation eut pour première conséquence bénéfique d’asseoir l’unité et l’indivisibilité de la nation » (p. 172). « Complétée par la codification et la concentration du pouvoir, cette centralisation contribua au premier chef à l’avènement et à la préservation de l’unité française ». Elle a fait de la France « un solide Etat unitaire souvent érigé en modèle » (p. 174). Là, il ne s’agit plus des observations présumées objectives d’un historien, mais des appréciations éminemment subjectives d’un auteur en réalité étatiste et conservateur.
Son analyse de la pandémie de 2020 a le mérite de la conséquence. Il regrette le « fantôme » de l’Etat, les interventions « non coordonnées » des collectivités locales, l’incompétence de la Direction générale de la Santé… alors même qu’un « bon ministre de l’Intérieur et des préfets concentrant les moyens et les décisions auraient mieux réussi » (p. 179). Il ne vient pas à l’idée de Thierry Lentz que la décentralisation s’est faite en dépit du bon sens justement parce qu’elle a été réalisée… de manière centralisée, comme l’estimait avec bonheur le doyen Vedel. L’auteur fait encore preuve de conséquence lorsqu’il parle avec éloge de la « sage prudence des lois de 1982 » (p 175). Il ne vient donc pas à l’idée de Thierry Lentz que la pandémie a révélé au grand jour les faiblesses d’un Etat providence centralisé, et qu’une concurrence entre les collectivités locales et surtout une société civile plus puissante eussent été judicieuses pour juguler la crise.
Il n’est dès lors pas surprenant que les aspects économiques soient si peu traités dans le livre. On y trouve un éloge de la fiscalité napoléonienne « avec moins de 15 % de prélèvements obligatoires » (p. 11), sans que le directeur de la fondation Napoléon, pourtant féru de cette méthode, s’attache à comparer un tel montant avec celui des autres Etats de l’époque. On y trouve certes une critique cursive de la politique économique menée en 1810 : « Napoléon négligea les causes de la crise économique pour ne se consacrer qu’à ses effets par des commandes massives de l’Etat » (p. 84). On y trouve quelques vagues références au commerce (pp. 83, 84, 98, 101, 104 et 105) et un Blocus continental expédié en quelques lignes (p. 101).
Tout à son admiration de l’Etat napoléonien, de sa centralisation, de son unité et de son indivisibilité, tout à sa « contextualisation » des conflits – qui n’ont produit en définitive que 900 000 à 1 million de morts militaires français (pp. 130-131), chiffres relativisés au regard des excès des critiques du « grand homme » et des conséquences de certains conflits tant antérieurs que postérieurs–, Thierry Lentz ne se demande pas pour quelle raison Napoléon reste un personnage de son temps. Le fait que, pour paraphraser Benjamin Constant, l’ère de la guerre a passé au profit de l’ère du commerce, ne l’effleure pas un seul instant. Après la royauté et la Révolution, « Napoléon fut le dernier à avoir tenté de réaliser par ses seules armes le vieux rêve français de la prépondérance en Europe » (p. 99). Il eût mieux valu qu’il visât cette prépondérance par les « armes » du commerce, de la liberté et de l’ouverture des frontières plutôt que par le fracas des canons et la recherche de la gloire…
Nulle surprise à ce que les libéraux aient toujours exécré Napoléon : « L’idéal napoléonien, écrivait Gustave de Molinari, c’est une administration immense embrassant toute la sphère dans laquelle se meut l’activité humaine qu’elle dirige en la modérant ou en l’accélérant à son gré ». L’harmonie spontanée des intérêts lui était inconnue. « Bonaparte se convainquit qu’il était le seul capable de diriger l’Etat et la cité », écrit Thierry Lentz (p. 81). C’est bien le problème, qui manifestement ne trouble pas pour autant l’auteur.
Et pourtant – on ne peut que le rejoindre l’historien sur ce point–, Napoléon a marqué la France de son empreinte. Après Colbert et Louis XIV, avant De Gaulle, il participe de cette « exception française » qu’est notre Etat surpuissant et impuissant tout à la fois, mené par les « grands hommes » dont beaucoup de Français sont si friands.
Il y a trop de « grands hommes », rappelait justement Frédéric Bastiat…




