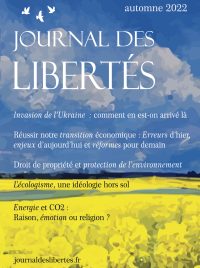Quelles sont les images les plus révélatrices de l’attaque russe contre l’Ukraine ? Des cadavres retrouvés les mains liées dans le dos. Des corps décapités et démembrés présentant des signes évidents de torture. Les hôpitaux, les immeubles résidentiels et les jardins d’enfants bombardés. Des voitures particulières avec le mot « Enfants » peint de tous côtés que l’on retrouve pourtant criblées de balles de mitrailleuses.

Qu’est-il arrivé aux soldats qui ont perpétré ces tortures, ces décapitations, ces démembrements, ces exécutions ; qui ont délibérément ciblé les civils et commis bien d’autres crimes de guerre encore ? La réponse du Kremlin est édifiante : le 18 avril – bien deux semaines après que des preuves indéniables des crimes de guerre russes aient été rendues publiques – les soldats qui avaient perpétré les exécutions et les tortures à Bucha – la 64e brigade détachée de fusiliers à moteur–, ont été officiellement félicités et promus dans leurs fonctions par le président Poutine pour « l’héroïsme et la bravoure collective, le courage et la fermeté dont a fait preuve le personnel de la brigade dans les opérations de combat pour la protection de la patrie et des intérêts de l’État dans le contexte d’un conflit armé ».
On le voit, les crimes de guerre ne sont pas une aberration pour la Fédération de Russie ; ils sont partie intégrante de la politique officielle. Ils ne sont pas punis, mais récompensés, félicités, loués et donnés en exemple à tous ceux que la Fédération de Russie a envoyés sur le champ des opérations, qu’il s’agisse de soldats sous contrat, de conscrits ou de mercenaires du groupe Wagner, de djihadistes tchétchènes ou des membres de divers gangs criminels organisés par le Kremlin et envoyés pour tuer des Ukrainiens. Les pillages et les actes cruels d’un extrême sadisme ne sont pas des « anomalies », mais le mode opératoire de cette intervention. Ils font partie du « deal ». Ainsi, entre fin février et mi-mai 2022, Mediazona a pu comptabiliser 58 tonnes de colis provenant des pillages qui étaient expédiés vers la Russie depuis une poignée de villes situées en Biélorussie ou en Russie, près de la frontière ukrainienne. Il existe également des séquences vidéo piratées montrant des soldats russes dans des bureaux de poste expédiant des marchandises et se félicitant de ce qu’ils avaient pillé. Pas étonnant que les Européens de l’Est qui ont connu la conquête et l’occupation russes parlent « d’hordéisme » pour expliquer le principe de fonctionnement de l’armée russe. Les amateurs du Seigneur des Anneaux comprendront également pourquoi les Ukrainiens appellent l’armée russe l’armée des « Orques ».
Alors à qui la faute ?
Qui porte la responsabilité de cette invasion ? On pourrait penser que la réponse à cette question relève de l’évidence. Pourtant, dans le monde complexe de la géopolitique, les réponses divergent. Il y a tout d’abord la réponse du gouvernement russe qui est le seul à affirmer que c’est l’Ukraine qui a attaqué la Russie. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a été dès le début on ne peut plus clair à ce sujet : « la Russie n’a pas déclenché une guerre, elle y met fin ». Le mensonge, toutefois, est trop évident pour être pris au sérieux par quiconque n’est pas soumis au monopole médiatique du Kremlin et à sa propagande.
La faute à L’OTAN ?
Plus subtile sans doute se veut la réponse apportée par certains intellectuels qui, à l’instar de John Mearsheimer de l’Université de Chicago, admettent que la guerre a été déclenchée par la Russie en 2014 et s’est intensifiée en 2022, mais soutiennent cependant que c’est l’OTAN qui a provoqué la guerre en se présentant elle-même avec l’Ukraine à ses côtés comme une menace pour les intérêts stratégiques du Kremlin. Dans un essai paru en 2014 dans Foreign Affairs, Mearsheimer livre sa version des faits que nous pouvons résumer ainsi :
Suite au « renversement illégal » et au « coup d’État » contre le Président pro-Kremlin de l’Ukraine, Viktor Ianoukovitch, le Président Poutine (qui selon lui est « un stratège de premier ordre ») a envahi l’Ukraine. L’invasion n’était donc qu’une « réaction spontanée à l’éviction de Ianoukovitch ».
Cette lecture des faits est cependant peu crédible. La vérité est sans doute que Ianoukovitch n’a pas été chassé ni renversé puisque, avant qu’il ne quitte la capitale, un accord venait d’être signé pour mettre fin au conflit qui opposait son gouvernement et les manifestants. C’est donc de son plein gré que l’ex-Président a quitté son pays. La thèse d’une « réaction spontanée » de la Russie est par ailleurs difficilement réconciliable avec le fait que soldats, uniformes, camions et autres équipements dont les marquages les identifiant comme des forces militaires russes avaient été soigneusement retirés, se trouvaient, de façon fort commode, déployés en Crimée. Ou encore le fait que les forces Berkut de Ianoukovitch – qui ont tué tant de manifestants–, ainsi que d’autres forces de sécurité se soient retirées de Kiev avant que Ianoukovitch ait signé l’accord convenant d’un règlement politique à la crise. La chronologie des événements a son importance. Le jour de sa fuite, le Président Ianoukovitch, après s’être entretenu avec Moscou et après le départ de ses forces spéciales, a signé l’accord puis, s’étant arrangé pour faire détruire des documents qui se trouvaient chez lui, est parti pour Kharkiv puis de là vers la Russie, laissant tous les bâtiments gouvernementaux, y compris sa résidence personnelle, complètement sans surveillance. Il pensait en agissant ainsi que ces bâtiments seraient pillés et brûlés, ce qui lui aurait fourni un prétexte idéal pour son retour accompagné d’une force armée suffisamment forte pour rétablir l’ordre.
Malheureusement pour lui, les événements ne se sont pas déroulés exactement comme il l’avait planifié. De nombreux documents ont été sauvés qui, jetés dans le lac artificiel à côté de sa maison, ont été repêchés par des volontaires et astucieusement séchés dans le sauna de la maison. En fait, aucun pillage n’a eu lieu et l’opulent palais, financé par la corruption de Ianoukovitch, est aujourd’hui une attraction pour des dizaines de milliers d’Ukrainiens qui font patiemment la queue pour constater à quoi ont servi les impôts qui leur avaient été extorqués. Ce qui devait être pillé et saccagé ne l’a pas été et est aujourd’hui transformé en « musée de la corruption ».
Mais laissons de côté les affirmations erronées sur le départ forcé de Ianoukovitch pour revenir à notre argument principal. En 2014, Mearsheimer – et il n’était pas le seul — affirmait donc que les manœuvres du Kremlin étaient « des réactions spontanées ». Or, si l’on pouvait voir les choses ainsi depuis Chicago, ce n’est pas ainsi que le voyaient celles et ceux qui avaient négocié et signé un accord politique qui aurait maintenu Ianoukovitch au pouvoir, ni celles et ceux qui avaient vu – ainsi que nous le rappelions plus haut – la police anti-émeute du régime monter à bord des bus d’évacuation avant même que l’accord fut signé, ni celles et ceux qui étaient agressés par les milliers de « petits hommes verts » jaillissant hors de la base militaire russe de Crimée. Naturellement, le Kremlin nia avec véhémence que les troupes d’invasion étaient russes, et l’ambassadeur de Russie auprès de l’Union européenne, Vladimir Chizhov, déclarait sans sourciller : « Il n’y a aucune troupe ; pas de troupes russes en tous les cas. » De même, interrogé sur la présence de troupes russes en Ukraine, Sergueï Choïgou, ministre de la Défense de Poutine, répondait : « Absolument [pas], vous plaisantez ! ». Poutine lui-même insistait sur le fait qu’il s’agissait là de « forces locales d’autodéfense » qui se procuraient leurs « uniformes d’apparence russe » et leur équipement, y compris des mitrailleuses et des lance-grenades, dans des surplus militaires locaux ! Du pain béni pour ceux qui soutenaient que la Russie était menacée. Ainsi, Mearsheimer pouvait-il affirmer qu’avant le 22 février 2014, « il n’y a pratiquement aucune preuve que [Poutine] était déterminé à prendre la Crimée, et encore moins un autre territoire ukrainien ». Pourtant, un an plus tard, Poutine lui-même confessait :
« J’ai donné des ordres au ministère de la Défense – pourquoi le cacher ? – d’y déployer des forces spéciales du GRU (renseignement militaire) ainsi que des marines et des commandos afin de renforcer la sécurité de nos installations militaires en Crimée. »
Si les certitudes de Mearsheimer sur la « spontanéité » de la réaction du Kremlin sont donc déplacées, sa thèse principale ne s’en trouve pas pour autant ébranlée, car il a, du moins le croit-il, un solide argument de secours : L’« expansion » de l’OTAN et de l’Union européenne avait déjà atteint les frontières de la Russie ce qui faisait craindre au Kremlin que cette « expansion » ne s’étende à l’Ukraine.
Avant de voir si cela peut effectivement avoir causé l’invasion russe, il convient de s’arrêter sur l’utilisation qui est faite ici du terme « expansion ». La Russie a réalisé sa propre expansion de manière très directe ; l’armée russe conquière des territoires, passe les populations locales au fil de l’épée, importe des colons russes et met en place un pouvoir d’État centralisé sur le territoire et le peuple conquis. C’est ainsi qu’ont procédé par le passé les princes de Moscovie, les tsars, les Commissaires, et c’est ainsi que procède à présent Poutine. Les peuples d’Asie centrale, du Caucase, de Bessarabie, de Biélorussie et de Pologne, des pays baltes, de Finlande et d’Ukraine ont connu à diverses époques cette tendre fraternité du Kremlin. Ces dernières années, nous avons vu la Fédération de Russie, héritière de cette longue histoire d’expansion, occuper par la force des territoires en Moldavie, en Géorgie et en Ukraine et imposer par la violence des institutions étatiques russes prédatrices sur le territoire et la population locale.
Voyons à présent ce qu’il en est de « l’expansion » de l’OTAN ; de toute évidence une tout autre affaire. Depuis la chute de l’URSS, les vagues d ‘ « expansion de l’OTAN » ont eu lieu pour donner suite à des élections ouvertes qui se sont déroulées après des débats prolongés au sein de nations démocratiques dotées de régimes multipartites et de médias libres. Et ce n’est qu’après les élections que les gouvernements concernés ont demandé à être admis dans une alliance défensive. Cette succession historique de délibérations démocratiques n’a pourtant pas empêché Mearsheimer d’affirmer que l’Union européenne et l’OTAN « marchent vers l’est ». Mais si la référence à « une marche » est d’une quelconque utilité – et elle semble en l’état plus trompeuse qu’utile – ce serait pour dire que les pays d’Europe centrale et orientale ont « marché vers l’ouest ». Cela montrerait clairement qu’ils cherchaient avant tout à échapper à la menace du Kremlin.
Les débats sur l’adhésion à l’OTAN ont été ouverts, démocratiques et solides. À la suite de ces débats et après délibération, quatorze gouvernements démocratiques ont choisi de rejoindre l’OTAN après la dissolution de l’URSS. Ceux qui avaient une frontière commune ou étaient proches de la Russie étaient les plus clairement motivés par la crainte de l’expansion russe. C’est indéniable. Poutine – le « stratège de premier ordre » à en croire John Mearsheimer – a même réussi à pousser la Suède et la Finlande, deux pays traditionnellement non-alignés, à renoncer à des décennies de neutralité et engager un processus d’adhésion à l’OTAN. Ils ne le font évidemment pas pour avoir accès à de meilleurs soins dentaires ou aux programmes de fidélité des compagnies aériennes, mais bien parce qu’eux aussi craignent l’expansion russe. Parler d’une « expansion » de l’OTAN est donc trompeur. L’OTAN ne conquiert pas, n’absorbe pas ni n’annexe des territoires ou des pays, mais accepte en son sein des gouvernements qui ont librement décidé de rejoindre une alliance de défense mutuelle.
Mais revenons au sujet principal. Poutine a-t-il oui ou non ordonné l’invasion en 2014 et l’escalade en 2022 parce que la Russie était menacée par l’OTAN ? Mearsheimer sans hésitation – mais il n’est malheureusement pas une voix isolée en Occident – répond par l’affirmative et, afin d’éviter d’avoir à fournir la moindre preuve de l’existence d’une menace pour le territoire russe, il précise immédiatement que « ce sont les Russes, pas l’Occident, qui décident en définitive de ce qui constitue une menace pour eux ». En d’autres termes, l’absence d’un iota de preuve que l’OTAN représenterait une menace pour le territoire russe peut être balayée, simplement parce qu’aucune preuve objective n’est nécessaire : Si Poutine dit que c’est une menace et si sa machine de propagande crée la croyance qu’une menace est présente, alors il y a menace ! Et tout groupe ou État identifié comme « menaçant » porte l’entière responsabilité de cette situation. Pourquoi ? Parce que certains ont affirmé qu’ils constituaient une menace ! Il est difficile de construire un ordre international stable et pacifique sur des fondations de ce type ; mais très facile de justifier un expansionnisme dictatorial…
Aucune personne raisonnable – pas même Mearsheimer – ne croit que l’OTAN a souhaité ou est susceptible de souhaiter envahir ou annexer le territoire russe. C’est absurde. Donc, s’il n’y a pas de menace territoriale, quelle pourrait être la menace ? C’est là que les choses deviennent intéressantes et que, une fois encore, Mearsheimer se trompe et interprète de travers la politique du Kremlin.
En 2014, après l’invasion initiale, l’occupation et l’annexion, il écrivait avec insistance que Moscou avait certainement « intérêt à avoir une Ukraine prospère et stable sur son flanc ouest » et qu’ « une Ukraine prospère mais neutre » ne « menacerait pas la Russie ». Quand, à quel moment de l’histoire le Kremlin a-t-il cherché à avoir des voisins « prospères et stables » ? Cela nous amène à la véritable menace que le Kremlin perçoit – et qui n’est pas celle envisagée par Mearsheimer qui préfère en rester à l’idée que les Russes « décident de ce qui constitue une menace pour eux ». La menace que le Kremlin redoute avant tout n’est pas l’annexion de son territoire, mais la simple existence d’un voisin prospère et stable sur le territoire de l’ex-Union soviétique ; car cette présence est de nature à déstabiliser le pouvoir de Poutine. L’Ukraine a « provoqué » Poutine en n’étant pas la Biélorussie, un État appauvri, branlant et faible, dirigé par un dictateur.
Pourquoi l’invasion et le génocide ?
Pourquoi Poutine a-t-il décidé d’attaquer l’Ukraine ? Il nous l’a dit lui-même assez directement. Certes, il a affirmé que l’OTAN menace la Russie, mais sans apporter aucune preuve. Il a encore dit que l’Ukraine est sous l’emprise de « nazis », mais là encore sans l’ombre d’une preuve. Il a également affirmé que les Russes du Donbass étaient victimes d’un génocide : pure allégation toujours sans preuve. Plus intéressant est le fait qu’il reprenne maintes fois une explication qui, elle, ne nécessite aucune preuve car sa véracité est établie du simple fait que c’est lui qui l’affirme. Il a dit clairement, en particulier en juillet 2021, que les Ukrainiens et les Russes sont « un seul peuple ». Peu importe ce que les Ukrainiens en pensent, car ils n’ont pas leur mot à dire. Ils sont revendiqués comme faisant inextricablement partie du « monde russe », un terme désignant une idéologie que Poutine a développée pour faire avancer sa dictature. En 2013, Poutine opposait déjà les États-Unis prétendument matérialistes à une Russie prétendument spirituelle, car « les Russes ont des ambitions différentes, bien plus élevées, d’une nature plus spirituelle. Il s’agit plus de notre relation à Dieu. Nous avons une vision différente de la vie ». (On s’interroge effectivement : à quel point la vision de la vie doit être plus spirituelle à bord de l’un de ces impressionnants méga-yachts dont les copains de Poutine sont si friands.) Toujours en 2013, avant l’invasion et l’annexion de certaines parties de l’Ukraine, il déclarait encore que Ukrainiens et Russes « sont un même peuple »,
Parce que nous avons les mêmes fonts baptismaux de Kyivan dans le Dniepr ; nous avons certainement des racines historiques communes et des destins communs ; nous avons une religion commune, une foi commune ; nous avons une culture, des langues, des traditions et des mentalités très proches… Bien sûr, nous avons nos propres particularités et notre propre coloration ethnique. Soit dit en passant, la culture ukrainienne, la langue ukrainienne, les danses et la musique – tout cela est merveilleux. Pour ma part, j’en tire toujours un grand plaisir.
Mearsheimer n’avait-il pas raison de penser que le véritable désir de Poutine était que ce voisin, qui ne faisait qu’un avec la Russie, soit indépendant, prospère et stable ?
Le fait est que Poutine considère qu’une Ukraine indépendante, démocratique, prospère et stable constitue en soi une menace, non pour la Russie, mais pour son pouvoir. Comme Vladimir Klitschko l’a écrit dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung en mai dernier, « Pour le régime impérialiste russe, notre existence même est une provocation parce que nous sommes une démocratie. »
L’existence d’un régime prospère, stable et démocratique sur le territoire de leur ancien empire insupporte Poutine. C’est pour cette raison qu’il a appelé à la « dénazification » de l’Ukraine, le pays voisin dont l’actuel président juif russophone a été élu lors d’une élection serrée qui l’opposait à un chrétien. L’Agence de presse russe a publié un article qui explique en des termes très clairs ce que signifie la « dénazification ». Dans un article intitulé « Que devrait faire la Russie avec l’Ukraine ? » son auteur dévoile la logique de la « dénazification » :
L’Ukraine actuelle, nazifiée, se caractérise par son aspect informe et son ambivalence qui lui permettent de travestir le nazisme en une aspiration à « l’indépendance » et à un développement (en réalité, à une dégradation) suivant le modèle « européen » (occidental, pro-américain) et d’affirmer qu’« il n’y a pas de nazisme » en Ukraine, « seulement quelques incidents sporadiques ». De fait, il n’y a pas de parti nazi d’importance, pas de Führer, pas de lois franchement raciales (si ce n’est une version édulcorée sous la forme de répressions contre la langue russe). Résultat : pas d’opposition ni de résistance contre le régime.
Les Ukrainiens, avec leur gouvernement pluraliste, multipartite et démocratique et leur président juif, auraient habilement déguisé leur nazisme en « aspiration à » l’indépendance et au développement. Des nazis très intelligents, en effet. Quant aux affirmations selon lesquelles il y aurait eu un génocide à l’encontre les russophones dans la région du Donbass, que des enfants russes ont été crucifiés par les nazis ukrainiens, etc., aucune preuve, une fois encore, n’a jamais été avancée pour appuyer ces affirmations. Pourtant, à suivre la logique de Mearsheimer, « ce sont les Russes, pas l’Occident, qui décident au bout du compte de ce qui constitue une menace pour eux ». Les fausses histoires d’enfants crucifiés et de génocide contre les Russes «_comptent » tant que c’est le Kremlin qui le dit…
Poutine, le stratège de premier ordre, a fait tout ce qu’il fallait pour que l’Ukraine ne fasse plus jamais partie de l’empire russe. Comme me le disait en août dernier un client alors que j’avais du mal à commander mon repas en ukrainien, « vous n’êtes pas le seul ; la moitié de l’Ukraine apprend l’ukrainien maintenant ».
Pourquoi Mearsheimer a-t-il si mal interprété Poutine ?
Le professeur Mearsheimer est un homme savant et intelligent. Comment a-t-il pu passer à côté de l’évidence ? S’il cite de façon sélective c’est parce qu’il est aveuglé par un cadre théorique qui exclut tout ce qui ne rentre pas dans ses catégories. Dans un ouvrage intitulé International Security, celui qui se décrit lui-même comme un « réaliste » décrit les relations internationales comme « une course sans relâche pour la sécurité avec, toujours en arrière-plan, la possibilité d’une guerre ». Il insiste, dans un style réaliste, sur le fait que les États agissent toujours pour servir ce qu’ils perçoivent comme étant leur propre intérêt. Il insiste également, et de manière contradictoire, sur le fait que lorsqu’un État n’agit manifestement pas selon son intérêt, il « devrait » rectifier sa conduite. Si l’attrait de la théorie « réaliste » est l’affirmation robuste selon laquelle les États agissent toujours d’une certaine manière, le véritable tour de passe-passe consiste à introduire l’affirmation normative sur ce qu’ils « devraient » faire. C’est ce glissement qui a propulsé à la notoriété le Professeur Mearsheimer. Or, si l’on peut admettre la perspicacité et la sagesse de nombreuses observations qu’il a formulées, on ne peut que déplorer cette forme de réalisme qui le conduit à rejeter tout rôle moteur pour l’idéologie. Il n’y a pas de place pour cette dernière, sauf lorsqu’il s’agit d’exprimer un désaveu à l’égard des démocraties libérales. Et pourtant ! Comment comprendre la Seconde Guerre mondiale sans considérer le rôle joué par les engagements idéologiques – le national-socialisme, le communisme, le fascisme, le nationalisme, la démocratie libérale, etc. ?
Mearsheimer considère « l’institutionnalisme libéral » comme une théorie concurrente de l’ordre international et le rejette. Mais ce rejet repose sur une analyse trop superficielle. Au cœur de l’institutionnalisme libéral se trouve l’interconnexion pacifique entre les nations grâce à la liberté du commerce. La croissance massive du commerce international a certainement coïncidé avec un déclin de la guerre entre les nations dont les économies sont intégrées. Des politologues comme Erik Gartzke (dans The Capitalist Peace) ou Patrick McDonald (dans The Invisible Hand of Peace : Capitalism, the War Machine and International Relations) l’ont solidement démontré. Le qualificatif « libéral » dans « institutionnalisme libéral » est important, car parmi les prémisses du libéralisme figurent la propriété et la liberté d’échanger. Les recherches de Patrick McDonald montrent bien que les relations commerciales importent peu pour les économies dominées par l’État, car en général « des niveaux plus élevés de propriété publique augmentent la probabilité d’un conflit militaire » et « des quantités plus élevées de propriété privée dans une économie nationale favorisent les opportunités d’interactions pacifiques », tandis que « des barrières réglementaires plus faibles au commerce ont réduit la probabilité que les États s’engagent dans un conflit militaire ». La paix du libre-échange, élément central de l’institutionnalisme libéral, est tout simplement ignorée par Mearsheimer. Le commerce est un bon indicateur de relations pacifiques quand il prend place entre des états libres, mais pas lorsqu’il implique des économies dominées par l’État telles que celles contrôlées par Poutine, dans lesquelles des entreprises d’État géantes, à l’instar des Gazprom, Rosneft et Transneft, sont gouvernées par les décisions d’un même homme – Vladimir Poutine – qui exerce un pouvoir dictatorial absolu sur l’armée comme sur les autres organes de l’État.
A en croire Mearsheimer, la discussion autour des valeurs libérales de démocratie, de pluralisme et d’économie de marché est hors sujet puisque
« d’un point de vue analytique, le réalisme ne fait pas de distinction entre les ‘bons’ États et les ‘mauvais’ États, mais les traite essentiellement comme des boules de billard de tailles variables. Dans la théorie réaliste, tous les États sont contraints de rechercher le même objectif : une sécurité relative maximale. »
Mearsheimer défend cette simplification analytique en insistant sur le fait que « le réalisme cherche simplement à expliquer comment le monde fonctionne ». En choisissant ce point de vue, cependant, il choisit de fermer totalement les yeux sur le rôle que l’idéologie peut jouer dans la détermination de ce qui est « dans l’intérêt du pays », rejetant du même coup les principes méthodologiques fondamentaux des sciences sociales, principes que l’historien Parker T. Moon évoquait ainsi dans son étude Imperialism and World Politics :
Le langage obscurcit souvent la vérité. Plus souvent qu’on ne le croit, nos yeux sont empêchés de voir les faits des relations internationales tels qu’ils sont par des jeux de langue. Quand on utilise la monosyllabe simple « France », on pense à la France comme une unité, une entité. Lorsque, pour éviter des répétitions maladroites, nous utilisons un pronom personnel pour désigner un pays – lorsque nous disons par exemple « la France a envoyé ses troupes à la conquête de Tunis » – nous imputons non seulement une unité mais une personnalité au pays. Les mots eux-mêmes cachent les faits et font des relations internationales un drame glamour dont les nations personnalisées sont les acteurs, et nous oublions trop facilement les hommes et les femmes en chair et en os qui en sont les véritables acteurs. Les choses seraient tellement différentes si nous n’avions pas de mot tel que « France », et que nous devions dire à la place : trente-huit millions d’hommes, de femmes et d’enfants aux intérêts et croyances très divers, habitant 565 000 kilomètres carrés de territoire ! Ensuite, nous serions conduits à décrire l’expédition de Tunis avec plus de précision en des termes qui pourraient ressembler à ceci : « Quelques-uns parmi ces trente-huit millions de personnes ont envoyé trente mille autres pour conquérir Tunis. » Cette façon de présenter les faits suggère immédiatement une question, ou plutôt une série de questions : Qui sont les « quelques-uns » ? Pourquoi ont-ils envoyé les trente mille à Tunis ? Et pourquoi ces derniers ont-ils obéi ?
Le choix d’une approche « réaliste » fait qu’il est beaucoup plus difficile de se poser ce type de questions pourtant fondamentales. Si nous devons postuler que « les États » agissent toujours pour garantir « leurs intérêts », nous nous interdisons de voir les conflits importants qui se déroulent au sein même des structures étatiques et ne sommes plus en mesure d’élucider de nombreux cas de conflit et de coopération à l’international. Les États ne sont pas des acteurs unitaires, mais des assemblages complexes de personnes, de pouvoirs et de relations. Un décideur public dans un État peut très bien promouvoir ses propres intérêts aux dépens des intérêts du reste des concitoyens et de l’ordre social plus large sur lequel il règne. Poutine peut sacrifier la sécurité et le bien-être du peuple russe à son propre désir illimité de s’accrocher au pouvoir. Les États ne ressemblent pas tant à des boules de billard compactes qu’à des nuages d’intérêts en interaction permanente, qui parfois vont dans le même sens et parfois dans des directions opposées.
Ce que Poutine considère comme essentiel à la sécurité de son État russe n’est peut-être pas ce que d’autres Russes considèreraient comme essentiel. Mais dans la dictature qu’il a construite, c’est lui qui décide de l’usage de la force et, contrairement au postulat de Mearsheimer, Poutine a clairement fait savoir par ses paroles et ses actes, depuis au moins 2006, qu’il ne voit aucun « intérêt à avoir un voisin prospère et stable ». Croire le contraire relève du fantasme.
Ajoutons encore une chose. L’engagement du soi-disant humble et entêté Mearsheimer à « expliquer le fonctionnement du monde » en évacuant toute considération du bien et du mal, du « bon » et du « mauvais », est rompu dès lors qu’il entend préciser la façon dont « les États devraient toujours agir », c’est-à-dire selon lui, agir comme s’il n’y avait pas de différence entre le juste et l’injuste, le bien et le mal. En pratique, cette mise en garde ne peut être dirigée que contre les États dont les politiques sont susceptibles d’être influencées par de telles considérations, à savoir les démocraties libérales.
La Russie est loin d’être une démocratie libérale. C’est une dictature avec un penchant pour la violence sans appel qui réprime la dissidence, manipule les élections et terrorise, exile ou tue ses opposants. (Les détracteurs de Poutine meurent de nombreuses façons, mais le poison semble être la technique préférée.) Poutine a envahi et occupé de nombreux pays dans le passé. Si on ne l’arrête pas, il est probable qu’il continuera. Il a violé de manière flagrante des traités internationaux, notamment le mémorandum de Budapest de 1994 relatif à l’adhésion de l’Ukraine au Traité international sur la non-prolifération des armes nucléaires, par lequel l’Ukraine renonçait aux armes nucléaires en échange d’une garantie russe « de respecter l’indépendance et la souveraineté ainsi que les frontières existantes de l’Ukraine ». Il récompense ouvertement le pillage, le viol et le massacre des populations civiles.
Poutine est publiquement attaché à l’idéologie du « monde russe », qui embrasse et revendique l’autorité sur tous ceux qui vivent en Russie, ou qui parlent russe, ou qui vivent dans des régions autrefois dominées par la Russie. C’est une idéologie expansionniste qui présente plus que des similitudes superficielles avec les doctrines qui ont conduit un autre État expansionniste à envahir l’Ukraine au cours du siècle précédent. Malgré les affirmations manipulatrices réitérées du Kremlin selon lesquelles « ce sont les Ukrainiens les vrais nazis », l’idéologie du Kremlin, bien que n’englobant certainement pas tous les éléments du National-Socialisme, adopte une vision du monde similaire en particulier sur la nécessité de dominer « les grands espaces » (un Großaumordnung international, pour reprendre les termes de Carl Schmitt, le théoricien du droit international du Troisième Reich), quitte à piller, ravager et commettre le génocide. Ils ont copieusement puisé, pour ainsi dire, dans les règles du jeu qui se déroula dans les années 1930, où l’un des objectifs – l’impératif – consistait à défendre les camarades de la même ethnie (Volksgenossen) vivants dans les États voisins, ce qui justifie invasion, conquête, annexation et purification.
Que l’État russe soit génocidaire est un fait établi clairement, non seulement par les exécutions et les fosses communes, mais aussi par l’enlèvement de dizaines de milliers d’enfants ukrainiens qui seront élevés en Russie par des institutions ou des familles russes, où ils seront russifiés, en violation de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide qui énumère parmi les critères suffisants du génocide « le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ».
En réponse à l’invasion massive lancée le 24 février dernier, Mearsheimer a repris son récit selon lequel l’abandon du pays par l’ancien président Ianoukovitch faisait suite à un « coup d’État » et a réitéré son affirmation selon laquelle la prise de la Crimée par Poutine était « une décision impulsive ». Plus récemment encore, dans un article de 2022 paru dans The Economist et donc destiné à un public mondial de leaders d’opinion, Mearsheimer a nié que l’OTAN soit une alliance défensive, sans pour autant étayer son affirmation par des preuves. Le langage qu’il utilise est assez révélateur de la manière subtile dont il nie sans rien réfuter :
Selon un récent document de l’OTAN envoyé aux dirigeants russes, « l’OTAN est une alliance défensive et ne représente aucune menace pour la Russie ». Les preuves dont nous disposons contredisent ces affirmations. Mais, pour commencer, la question qui se pose n’est pas celle de savoir quels sont, selon les dirigeants occidentaux, le but ou les intentions de l’OTAN ; mais de savoir comment Moscou interprète les actions de l’OTAN.
Notez bien la façon dont Mearsheimer invoque des « preuves disponibles » sans en proposer aucune. Et ce qu’il propose « pour commencer » n’est pas plus suivi d’argument ni de preuve et son « point de départ » revient à dire que ce qui constitue une menace ne peut en aucun cas être déterminé par des critères objectifs ou des preuves, car c’est une question qui relève exclusivement de l’appréciation du Kremlin. Dès lors que reste-t-il à démontrer puisque le Kremlin a clairement indiqué que la simple existence à ses frontières d’un pays qui aspire à l’indépendance et à une « voie européenne » de développement constitue ipso facto une menace. L’Ukraine menace le Kremlin parce qu’elle illustre ce qu’il est possible de réaliser dans un État post-soviétique et pour aucune autre raison.
Ce à quoi nous assistons n’est pas simplement un choc entre boules de billard, mais un affrontement de valeurs et de principes fondamentaux. Poutine règne sur un État génocidaire et agressif qui sème des cadavres torturés dans son sillage. Prudence et précaution sont nécessaires pour se défendre contre de tels prédateurs, comme est nécessaire une compréhension lucide de ce qui se passe. Une dictature hyper-nationaliste a attaqué une démocratie pluraliste, non pas parce que le dictateur craignait une quelconque perte de territoire ou parce qu’il voyait une menace pour la sécurité du pays qu’il dirige, mais parce qu’il perçoit l’existence de cette démocratie libérale comme une menace pour son emprise personnelle sur le pouvoir.
Ceux qui souhaitent un monde plus pacifique, plus libre et plus prospère doivent se tenir aux côtés des victimes, non des agresseurs criminels. Les gens raisonnables peuvent diverger sur la meilleure façon d’agir en ce sens, mais si aucune action n’est engagée, les jours de la démocratie libérale sont sûrement comptés. Car, à suivre la logique de Mearsheimer, toute démocratie peut être une menace pour une autocratie par sa simple existence et, par conséquent, sera tenue pour responsable de l’agression menée contre elle. Prochaine étape : Estonie, Lituanie, Lettonie, Taïwan.