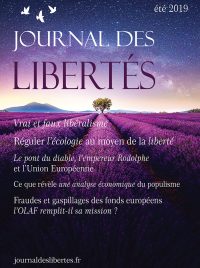Introduction
La démocratie est le grand tabou de notre époque, à tel point qu’elle est devenue souvent le critère unique par lequel on évalue les sociétés et même certaines organisations. C’est ainsi qu’on en fait un mode de fonctionnement nécessaire des entreprises, des universités ou même parfois des familles… Le terme « démocratie » a même évolué pour désigner une société où règne un certain égalitarisme, comme en témoigne par exemple l’expression « démocratiser l’enseignement » utilisée pour évoquer l’élargissement d’un système d’éducation à des catégories de populations considérées comme défavorisées dans ce domaine. La démocratie c’est le gouvernement du peuple, c’est un système où le peuple est souverain. En tant que telle, elle s’oppose à un système autocratique où un souverain – légitime ou non, héréditaire ou non – décide sans contrôle du « peuple ». Il semble donc, a priori, que la démocratie soit au minimum compatible avec les exigences d’une société d’hommes libres ou même la condition de son épanouissement.
Mais le peuple, c’est une abstraction. Le peuple ne pense pas, n’agit pas, ne décide pas. Ce sont les individus – et eux seulement – qui pensent, qui agissent et qui décident. Or, les êtres humains ne sont pas comme les abeilles d’une ruche, ils ne sont pas interchangeables, ils sont tous différents les uns des autres et cela contribue d’ailleurs à la grandeur des sociétés humaines. Il est donc purement imaginaire de penser que le peuple puisse se prononcer d’une seule voix, de manière unanime. Et puisqu’il en est ainsi, il faut trouver des règles de décision, par exemple celle qui consiste à procéder à des votes pour dégager une majorité ou, éventuellement, une majorité qualifiée (décision, par exemple, aux deux tiers ou aux trois-quarts des voix).
Il y a quelques années un auteur américain, Francis Fukuyama, avait acquis une certaine et étrange notoriété en proclamant la fin des idéologies et la convergence de tous les systèmes politiques vers un modèle unique qu’il appelait la « démocratie libérale ». Par conséquent, disait-il, on s’acheminerait vers un monde un peu ennuyeux, car les hommes n’auraient plus qu’à se soucier de questions médiocres de fonctionnement sans plus avoir à confronter leurs idéologies. Il y avait en fait de la part de Fukuyama beaucoup de myopie en annonçant ainsi la fin de l’Histoire. Il ne se souciait guère des contradictions ou des incohérences qui pouvaient exister entre les deux termes de son expression – démocratie libérale – et il ignorait superbement les divergences fondamentales d’idéologies et de visions que l’adoption d’un certain modèle politique pouvait éventuellement masquer, mais certainement pas faire disparaître.
Sa grande habileté consistait en fait à donner une légitimation intellectuelle à un sentiment prédominant de l’opinion, consistant à considérer que le modèle démocratique constituait la forme la plus aboutie de l’organisation humaine. On a d’ailleurs pu le constater peu après la chute du mur de Berlin ; cet événement extraordinaire et inespéré qui a mis fin à des décennies de totalitarisme abject. Tout d’un coup des millions d’êtres humains recouvraient la liberté qui leur avait été confisquée. Pourtant, ce n’est pas cette reconquête de la liberté individuelle qui a généralement été célébrée par les médias ou les hommes politiques, mais plutôt le retour à la démocratie, comme si le retour à la démocratie allait permettre de résoudre tous les problèmes, comme si les individus n’aspiraient qu’à une chose, avoir le droit de désigner ceux qui les dirigent. Cette prédominance accordée à la démocratie – et non à la liberté individuelle – n’était, pour beaucoup, pas tout à fait innocente. Comme l’a si bien souligné le regretté Jean-François Revel[1], elle permettait à tous ceux qui s’étaient largement et longuement trompé comme compagnons de route du communisme et du marxisme, d’essayer de retrouver une nouvelle virginité intellectuelle et politique. Devenir des défenseurs acharnés de la liberté individuelle était trop difficile pour eux. Mais il leur restait la possibilité de se proclamer démocrates : après tout, bien des régimes communistes et totalitaires se sont allègrement intitulés « République démocratique » (par exemple la RDA, République démocratique allemande) ! Ceci laisse d’ailleurs penser que l’on peut tout mettre sous le vocable de « démocratique ».
De même, à la fin du XXe siècle, un certain nombre de pays africains ont vécu une heureuse transition de régimes dictatoriaux vers des régimes démocratiques. Mais les populations de ces pays ont cru que ce seul changement les conduirait automatiquement sur la voie du développement. À la grande espérance de cette époque a donc succédé, quelques années plus tard, une ère de désillusions. De toute évidence, la démocratie ne suffit pas pour résoudre les problèmes des hommes.
En abordant le thème de la démocratie on se heurte donc à bien des confusions et c’est pourquoi il est particulièrement utile d’essayer de clarifier ce concept et de rechercher dans quelle mesure il peut être compatible avec d’autres. Pour nous, il conviendra plus particulièrement d’analyser le rôle que la démocratie peut jouer dans une société d’hommes libres. Mais pour répondre à cette question il nous faut, évidemment, d’abord nous demander ce qui caractérise une société d’hommes libres. Nous rechercherons alors comment la démocratie peut éventuellement être spontanément choisie comme le meilleur moyen de résoudre des problèmes d’organisation sociale dans des communautés et organisations de petite dimension, avant d’en tirer des leçons pour les Etats démocratiques que nous connaissons. Nous pourrons alors comprendre pourquoi le fonctionnement effectif des démocraties conduit à des situations paradoxales par rapport à ce qu’on attend d’elle. Et nous nous demanderons enfin s’il existe des solutions aux problèmes soulevés par la démocratie, de manière à permettre la survivance de la liberté.
- Liberté, propriété et démocratie
Etre libre c’est avoir la possibilité de poursuivre ses propres fins sans en être empêché par des obstacles imposés par autrui. De ce point de vue, la définition de la liberté est purement négative : la liberté c’est l’absence de coercition. Ceci conduit à rappeler qu’il existe deux modes d’action pour les êtres humains et seulement deux : ou bien ils agissent librement, ou bien ils subissent la coercition d’autrui.
Lorsque deux personnes échangent librement, il y a création de valeur pour les deux échangistes (ou groupes d’échangistes) concernés : étant donné que personne n’est obligé d’entrer en relation d’échange dans une société de liberté, il est en effet bien évident qu’une personne ne décidera d’effectuer un échange que dans la mesure où cet échange lui apportera un supplément de satisfaction. Il y a alors création de valeur (subjective). Par contre, lorsqu’un bien est transféré d’un individu à un autre au moyen de la coercition – qu’elle soit légale ou non – il y a création de valeur pour le bénéficiaire, mais perte de valeur pour celui qui doit céder ce bien sous la menace de la coercition.
On peut également dire qu’être libre c’est être propriétaire de soi-même, de son corps et de son esprit. Mais il serait incohérent de reconnaître ce droit de propriété à une personne et de lui dénier par ailleurs la propriété du fruit de ses activités, de ce qu’elle aura créé par l’exercice de ses facultés. Or, toutes les richesses humaines sont créées et elles résultent de l’action humaine, c’est-à-dire de l’exercice de la raison. C’est d’ailleurs parce qu’il constitue le seul système respectueux des droits de propriété légitimes que le capitalisme a un fondement éthique et qu’il est même le seul système social imaginable à posséder cette caractéristique.
La distinction entre un acte libre et un acte contraint est simple et chacun d’entre nous est capable de reconnaître spontanément cette distinction. De la même manière, la distinction entre un droit de propriété légitime et un droit de propriété illégitime est simple à faire : un droit de propriété est légitime lorsqu’il résulte d’un acte de création et non d’un acte de coercition. À partir du moment où quelqu’un a créé un bien, il en devient le propriétaire légitime et il peut légitimement l’utiliser, l’échanger ou le donner. Celui qui reçoit un bien de son propriétaire légitime, soit par un acte d’échange soit par un don, en devient à son tour le propriétaire légitime.
Une société ainsi fondée sur le respect des droits de propriété légitimes – c’est-à-dire une société capitaliste – est donc une société d’hommes libres. Elle est le contraire d’une société esclavagiste, c’est-à-dire une société où certains hommes s’approprient par la coercition d’autres êtres humains ou le fruit de leurs activités : quelle différence existe-t-il en effet entre le fait d’être propriétaire d’un esclave et le fait de s’approprier par la force la totalité (ou la presque totalité) du produit de l’activité d’un être humain ? De là vient la terrible ambiguïté de l’action étatique. Le mode d’action de l’Etat est en effet la coercition et l’Etat se définit même comme cette organisation qui a le monopole de la coercition légale. Mais, pour être légale, la coercition n’en est pas moins coercition. Il n’y a évidemment pas lieu de discuter ici de l’éventuelle légitimité de l’institution étatique, ce qui nous entraînerait trop loin de notre sujet. Mais peut-être peut-on au moins souligner que l’action étatique ne peut, au mieux, être considérée que comme une situation d’exception par rapport à un principe absolu, celui qui fonde une société d’hommes libres. Il faut en tout cas garder à l’esprit cette distinction fondamentale entre les actes libres et les actes contraints. Ainsi, il est légitime de parler de la répartition des ressources par celui qui les a créées, mais une expression – pourtant si souvent utilisée – telle que la « répartition du revenu national » est totalement dépourvue de sens : il n’existe pas un revenu produit par la nation et que l’Etat doit répartir arbitrairement entre ses membres. Tous les revenus – dont la somme constitue ce que l’on appelle le revenu national – ont été créés par des personnes qui les possèdent légitimement.
À partir du moment où les droits de propriété sont déterminés, on sait ce que chaque membre d’une société a le droit de faire ou de ne pas faire et l’on peut alors déterminer la responsabilité de chacun. Être responsable c’est subir les conséquences de ses actes. Mais on ne peut évidemment déterminer la responsabilité que dans la mesure où les droits de chacun ont été préalablement déterminés. C’est sur ces trois principes indissociables – la liberté, la propriété et la responsabilité – qu’une société libre est fondée.
On peut considérer que le respect par chacun des droits de propriété légitimes d’autrui constitue une règle socialement utile car elle assure la paix sociale : le respect de cette règle signifie l’absence de conflits. Mais nous venons de voir que son véritable fondement était d’ordre moral et c’est pourquoi on peut considérer qu’il s’agit là de la seule règle permettant de fonder une morale universelle ou, plus précisément, une morale universalisable, c’est-à-dire potentiellement acceptable par tous les individus de la terre. Une société libre est une société dont tous les membres considèrent qu’ils ont tous un même devoir, celui de respecter la propriété d’autrui.
Bien entendu, chacun d’entre eux peut ajouter une liste plus ou moins longue d’impératifs moraux qui lui sont propres et qui constituent des règles de vie pour lui. Ainsi, on peut considérer comme un devoir personnel d’être généreux à l’égard de certaines personnes et dans certaines limites (personne ne pouvant être parfaitement généreux et sans limites à l’égard de l’humanité entière puisque les ressources de chacun sont limitées). Ces morales personnelles sont certainement respectables, mais elles n’ont aucun caractère d’universalité : chacun a sa propre vision des devoirs personnels et rien ne permet de les rendre compatibles. On ne doit donc pas imposer à autrui d’adopter une règle de morale personnelle, car cette obligation entre nécessairement en conflit avec la règle morale universelle constituée par le respect des droits d’autrui : si je considère comme un devoir de donner telle somme d’argent à telle personne, si je veux imposer à quelqu’un d’autre d’agir de la même manière, je lui impose un devoir qu’il ne reconnaît pas nécessairement et qu’il a légitimement le droit de ne pas reconnaître. En lui imposant la pratique de cette règle morale particulière, on porte atteinte à ses droits.
Or, il est évident que la démocratie n’implique en rien le respect de la morale universelle. C’est une simple règle de décision collective. Elle est seulement le lieu de rencontre des intérêts et, éventuellement, des morales personnelles dont nous venons de voir qu’elles sont nécessairement incompatibles. Le problème de la démocratie peut donc se situer à deux niveaux :
- À un niveau moral supérieur, on peut l’interpréter comme l’expression d’un consensus de la part du peuple sur les grands principes de morale universelle. Dans cette perspective, la démocratie ne serait pas incompatible avec une situation où les droits individuels sont respectés.
- À un niveau pratique, la démocratie est un système où les décisions majoritaires sont considérées comme légitimes, sans considération pour les principes, mais en faisant éventuellement – mais pas nécessairement – appel à une convergence de morales individuelles.
En fait la démocratie concerne uniquement le problème de la détermination de la forme du pouvoir, lorsqu’il existe un pouvoir étatique. De ce point de vue, on peut opposer un régime démocratique à un régime autoritaire (dans lequel le pouvoir peut décider de manière discrétionnaire sans jamais en référer au « peuple »). Mais il existe évidemment toute une série de régimes intermédiaires. Ainsi, comme l’a dit un jour l’économiste péruvien Hernando de Soto, « le Pérou est un pays démocratique : tous les quatre ans on élit un dictateur ».
Mais il existe un problème bien plus important que celui de la forme du pouvoir, c’est celui de la détermination des limites entre la sphère publique et la sphère privée ou encore de la limite entre le pouvoir et la liberté individuelle. De ce point de vue, on peut opposer les systèmes de liberté individuelle (respectueux de la liberté individuelle) des régimes totalitaires dans lesquels la marge de liberté laissée aux individus est à peu près égale à zéro. Et, bien entendu, il existe toutes sortes de situations intermédiaires entre ces deux systèmes extrêmes.
Ces deux types de critères – « démocratie-autoritarisme » et « libéralisme-totalitarisme » – ne coïncident pas nécessairement. Ainsi, un dictateur peut facilement mettre en place un système totalitaire, mais on peut aussi fort bien imaginer – et il en existe des exemples dans l’Histoire – un dictateur bienveillant qui croit agir pour le bien-être du peuple. C’est au fond le mythe du « despote éclairé » du XVIIIe siècle. De la même manière, une démocratie peut être largement respectueuse des droits individuels, mais elle peut aussi être tyrannique. Tel est le cas lorsque les hommes au pouvoir, ayant obtenu au moins la majorité des voix à une élection, estiment que leur pouvoir est sans limites et qu’ils peuvent légalement porter atteinte aux droits de ceux qui se trouvent dans la minorité.
C’est pourquoi le caractère démocratique du pouvoir ne constitue pas un critère suffisant pour garantir l’existence d’une société d’hommes libres. Si l’Etat n’avait aucun pouvoir, il importerait d’ailleurs peu qu’il soit démocratique ou pas. Mais plus ses pouvoirs sont étendus, plus les libertés individuelles risquent d’être menacées sans que le caractère démocratique de l’Etat puisse constituer une garantie suffisante.
Dans une société fondée sur la liberté individuelle, une forme d’organisation démocratique peut éventuellement correspondre à une mise en commun volontaire de ressources par leurs propriétaires légitimes et il n’y a alors pas conflit entre la démocratie et la liberté individuelle, ainsi que nous le verrons. Mais s’il existe des transferts obligatoires de droits de propriété, il y a alors incompatibilité entre la démocratie et la liberté individuelle.
- Les paradoxes du fonctionnement de la démocratie au niveau de l’Etat
Les incohérences inhérentes à tout processus démocratique conduisent les démocraties à des résultats exactement inverses de ceux qu’elles sont censées obtenir.
Les intérêts particuliers
La démocratie est censée assurer le pouvoir du peuple et l’intérêt général. En fait, l’intérêt général n’existe pas (en-dehors de l’adhésion à des principes de justice, c’est-à-dire de respect des droits de propriété). Parce qu’elle introduit un mode d’appropriation par l’exercice de la coercition, la démocratie est le champ clos du conflit des intérêts. Comme nous le savons, les objectifs des individus sont divergents. Mais ils sont rendus compatibles par la définition des droits et l’échange libre, c’est-à-dire par des régimes de contrats libres et non des régimes de coercition. La démocratie, pour sa part, ne peut satisfaire les uns qu’aux dépens des autres et c’est pourquoi il est illusoire de penser qu’elle permet de défendre un « intérêt général » qui est en fait totalement mythique.
La littérature des économistes sur le fonctionnement effectif des démocraties est abondante. Elle montre, entre autres, que, loin de défendre ce fameux intérêt général, la démocratie permet aux gouvernants de défendre leurs propres intérêts. Ainsi, Buchanan et Tullock ont expliqué que l’on pouvait comprendre le fonctionnement réel des démocraties à partir de l’idée que les dirigeants politiques poursuivent leurs propres intérêts personnels ; Mancur Olson[2] a bien montré que les hommes politiques avaient intérêt à donner des avantages visibles et précis à un coût qui soit peu visible car largement diffus (c’est-à-dire supporté – sans qu’ils en aient conscience – par un grand nombre de citoyens). On est bien loin de l’intérêt général !
Les citoyens, le plus souvent, ne savent pas ce que leur coûte l’Etat, en particulier parce que les hommes de l’Etat ont recours à des impôts indolores – comme la TVA que la plupart des citoyens ne paient pas directement – ou à des techniques consistant à cacher l’existence des impôts, par exemple le prélèvement à la source. Par ailleurs, comme l’a souligné Bertrand de Jouvenel[3], dans une démocratie on ne cherche pas à limiter le pouvoir pour préserver les libertés individuelles, mais on cherche à le conquérir pour essayer de vivre aux dépens des autres.
La destruction de la cohésion sociale
Cette destruction est l’un des paradoxes de la démocratie car celle-ci est censée assurer la cohésion sociale et le maintien d’une société pacifique (comme l’a d’ailleurs souligné Francis Fukuyama que nous avons précédemment cité). Qu’une société humaine ne puisse pas fonctionner ni même survivre sans un minimum de cohésion cela est évident. Que l’être humain soit un être social et qu’il ne puisse pas vivre sans relations avec autrui est aussi une évidence. Mais la vraie difficulté apparaît lorsqu’on se demande comment ces liens sociaux doivent s’établir, comment ils doivent évoluer. Pour les critiques d’une société de liberté individuelle la cause est claire : dans une société libérale, la liberté laissée aux individus conduirait à l’anarchie, au désordre, à la destruction de la société. L’individualisme ne pourrait alors être que l’ennemi de la société. C’est pourquoi, tout en laissant une certaine marge d’autonomie – arbitrairement définie – aux individus, il faudrait qu’une institution, l’Etat, garant de « l’intérêt général », assure la cohésion sociale. Tel est le fondement de la social-démocratie.
Mais le débat sur la cohésion sociale souffre malheureusement d’une erreur d’interprétation majeure. L’individualisme y est vu comme la recherche par chacun de son propre intérêt aux dépens des autres et sans se soucier des autres. Si l’individualisme était effectivement cela, il conduirait en effet à l’anarchie et à la destruction des sociétés, puisqu’il impliquerait la lutte permanente de tous les individus pour s’approprier les biens d’autrui. Mais à cet individualisme anarchique il faut opposer une notion radicalement opposée et que l’on peut appeler l’individualisme libéral. Ce dernier consiste à respecter la liberté accordée à chacun de poursuivre ses propres objectifs, mais dans le respect des droits d’autrui. Cet individualisme-là est fondamentalement « social » en ce sens qu’il repose sur la reconnaissance des liens sociaux, c’est-à-dire des liens inter-individuels. Bien plus, on peut même dire que l’individualisme libéral repose ainsi sur le seul principe qui permette effectivement l’émergence et le maintien de la cohésion sociale.
Or, lorsqu’on recherche la cohésion sociale à notre époque – c’est-à-dire à une époque où l’on a totalement et malheureusement oublié la philosophie politique fondatrice des sociétés modernes qui a émergé dans les pays occidentaux avant d’acquérir une valeur universelle – ce n’est généralement pas à cette cohésion sociale libérale que l’on pense, mais à une vision radicalement différente, celle que nous propose la social-démocratie. Selon cette vision, l’Etat serait l’arbitre des intérêts divergents, l’intermédiaire obligé des rapports individuels, le fondateur des liens sociaux. Ce faisant on oublie que l’individualisme libéral assure la convergence des intérêts, fait naître et évoluer les liens sociaux. Or comment la social-démocratie peut-elle agir ? Nécessairement et toujours en ignorant les droits individuels. Elle consiste à prendre des ressources légitimement créées par certains pour les donner à d’autres, à interdire aux uns d’agir dans la limite de leurs droits et de permettre à d’autres d’empiéter sur les droits d’autrui. Ce faisant, l’Etat transforme des droits individuels en prétendus droits collectifs : on définit arbitrairement des catégories sociales ou économiques dans lesquelles on place ceux qui ne sont plus des individus, mais des citoyens, et l’on réalise des transferts visibles ou invisibles entre ces entités abstraites. Tout argent prélevé par l’Etat, parce qu’il n’a plus de légitime propriétaire, mais qu’il est censé être un « bien collectif », devient l’objet d’un conflit pour son appropriation. Et c’est pourquoi la social-démocratie est nécessairement conflictuelle. Loin de réaliser la cohésion sociale, elle la détruit. On risque alors d’entrer dans un tragique cercle infernal. Parce qu’il ne peut y avoir de cohérence dans la social-démocratie, parce qu’elle est destructrice des véritables liens sociaux concrets et qu’elle les remplace par des oppositions arbitraires entre classes et catégories sociales, elle fait naître une demande de « cohésion sociale » à la hauteur de la cohésion qu’elle détruit. Elle suscite nécessairement la déception de tous ceux qui sont avides de subventions ou de privilèges et qui ne peuvent évidemment jamais être pleinement satisfaits. Elle ne peut donc être que la source de conflits croissants.
Ce processus est exactement celui que nous voyons se dérouler sous nos yeux. C’est donc faire une erreur d’interprétation majeure que de vouloir renforcer une prétendue « cohésion sociale » en utilisant les instruments mêmes qui la détruisent, c’est-à-dire toujours plus de transferts, d’impôts, de contrôles.
Cela peut paraître paradoxal, mais la recherche constante de la cohésion sociale par l’interventionnisme étatique a conduit à l’éclosion de l’individualisme anarchique. Chacun sait en effet que son sort dépend peut-être davantage de ce qu’il peut soutirer aux autres grâce à la main de l’Etat et de ses satellites – collectivités locales, organismes « sociaux » – que de ses propres efforts. Après des années d’interventionnisme, l’Etat a réussi ce prodige : faire régner l’individualisme anarchique, c’est-à-dire la généralisation des conflits de chacun contre tous, au nom de la cohésion sociale et de l’intérêt général. Alors, devant ce que l’on appelle la « montée de l’individualisme », les moralistes à courte vue se lamentent, ils demandent à leurs concitoyens de faire preuve d’altruisme, de se sacrifier pour « l’intérêt général ». Mais ces vœux pieux ont peu de chances d’aboutir dans le climat de lutte généralisée qui s’est installé et, au demeurant, ils seraient incapables de résoudre le problème si jamais ils étaient exaucés. Et puisque les citoyens ne veulent pas se plier d’eux-mêmes à cette morale de bazar, on va les contraindre en mettant en place des politiques de « cohésion sociale ». En réalité ce qui manque c’est l’épanouissement d’un véritable individualisme, l’individualisme libéral. Car lui seul peut pacifier la société, lui seul peut réaliser la cohésion sociale.
- La juste place de la démocratie dans les petites organisations
Pour analyser les rapports entre la démocratie et un système fondé sur le respect de la liberté individuelle, il est peut-être bon de renverser la perspective. La démarche habituelle consiste en effet à chercher à appliquer aux petites organisations (entreprises, universités, organisations publiques) le système utilisé dans l’Etat moderne, à savoir la démocratie. Mais demandons-nous plutôt si la démocratie peut jouer un rôle – et quel rôle – dans les petites organisations humaines avant de rechercher s’il est possible d’en tirer des leçons pour l’organisation de l’Etat.
La démocratie dans les entreprises
La démocratie existe partiellement dans les entreprises, mais souvent la législation en accroît le rôle, comme cela est le cas, par exemple, en France ou en Allemagne (lois sur la participation dans les entreprises).
Il est bon de rappeler que l’entreprise n’est rien d’autre qu’un ensemble de contrats. Il y a tout d’abord un contrat initial, celui qui est signé entre les actionnaires lors de la création de l’entreprise. Ceux-ci décident de mettre en commun leurs ressources. Dans la mesure où ils deviennent propriétaires d’une partie du capital de l’entreprise, il est indispensable de mettre en place des processus de décision collective. On risquerait évidemment d’empêcher toute décision si on optait pour la règle de l’unanimité. C’est pourquoi les hommes ont spontanément sélectionné au cours de l’Histoire d’autres règles de décision, par exemple la décision à la majorité des voix ou à la majorité qualifiée, les droits de vote étant généralement proportionnels aux droits de propriété de chacun sur l’ensemble du capital de l’entreprise.
Un système démocratique de ce type n’entre alors absolument pas en conflit avec les droits de propriété puisque, d’une part, les droits de vote sont proportionnels aux droits de propriété et puisque, d’autre part, il y a entrée libre dans la démocratie (et d’ailleurs sortie libre) : c’est volontairement que les propriétaires acceptent de se soumettre à la loi de la majorité, même s’ils savent qu’il peut leur arriver de ne pas être d’accord avec une décision future qui serait prise conformément à cette règle. Ceci signifie évidemment qu’ils courent des risques en acceptant la règle démocratique, mais ils l’ont acceptée en connaissance de cause. Par ailleurs, ils savent aussi que leurs droits de propriété ne peuvent pas être modifiés ou transférés par des moyens illégitimes, c’est-à-dire par la coercition (contrairement à ce que fait l’Etat, qu’il soit démocratique ou non).
Ultérieurement, les propriétaires de l’entreprise signent des contrats avec les salariés, les fournisseurs, les clients, les prêteurs. Ces contrats prévoient en général des prix certains (qu’il s’agisse de prix de fournitures, de salaires, d’intérêts, etc.), et les propriétaires doivent honorer ces contrats et payer ce qu’ils ont promis. Ce qui reste de leurs recettes, une fois tous ces contrats honorés, constitue leurs profits, qui sont donc nécessairement incertains. L’Histoire a sélectionné ce mode d’organisation dans lequel le pouvoir de décision est donné aux actionnaires, précisément parce qu’ils supportent le risque et que leur rémunération n’étant pas déterminée à l’avance de manière contractuelle résulte de la qualité de leurs décisions. Ainsi, dans l’entreprise capitaliste normale la démocratie existe, mais elle est limitée aux détenteurs des droits de propriété.
On peut certes imaginer d’autres formes d’organisation que l’entreprise capitaliste et ces formes ont d’ailleurs existé dans l’Histoire, mais il s’est avéré qu’elles étaient moins efficaces que celle de l’entreprise capitaliste. Ainsi, une équipe de travailleurs pourrait prendre les risques de l’activité économique en charge, sans qu’il existe un entrepreneur. Le problème qui se pose alors consiste à savoir comment répartir le produit de leur activité commune. Le plus simple consisterait évidemment à décider à l’avance de la part que chacun pourrait retirer du produit final de l’activité collective. Mais si une telle règle n’a pas été adoptée, il existe alors un grand risque de conflits entre les participants de l’équipe qui essaient tous d’obtenir la part la plus importante possible du produit commun. Pour éviter le recours à la violence, on peut alors adopter une règle de décision a posteriori, par exemple la règle démocratique de décision à la majorité des voix. Cet exemple est intéressant parce qu’il nous montre que la règle démocratique ne constitue pas la solution idéale. On peut y recourir seulement dans la mesure où le problème de décision n’est pas résolu par une règle a priori, c’est-à-dire si les droits de propriété des uns et des autres sur le produit final ne sont pas déterminés précisément. La règle démocratique n’est donc qu’un substitut imparfait à une règle de détermination des droits de propriété. La démocratie est alors certes préférable à l’arbitraire ou à la violence, mais elle ne constitue qu’une solution de deuxième rang par rapport à la solution reposant sur des droits de propriété définis a priori de manière légitime. On comprend ainsi pourquoi dans l’Histoire la firme capitaliste a été sélectionnée aux dépens de l’entreprise mutuelle. L’invention de l’entrepreneur capitaliste a permis de se débarrasser de la démocratie et de respecter les droits de propriété.
Comme nous l’avons déjà rappelé, il existe, dans de nombreux pays, une tendance à imposer par voie législative le modèle démocratique à « l’entreprise », en particulier en faisant participer les représentants « démocratiquement élus » des salariés aux décisions stratégiques de l’entreprise. Un tel système a de nombreuses conséquences fâcheuses. En particulier, il conduit à préférer les gains à court terme aux gains à long terme. En effet, un salarié peut librement quitter son entreprise à n’importe quel moment et, dans la mesure où il ne sait pas combien de temps il restera dans la même entreprise, il est évidemment tenté d’obtenir tout de suite des bénéfices (par exemple sous forme d’augmentations de salaires ou de commodités de vie) plutôt que d’investir pour le futur. Les propriétaires, pour leur part, sont en quelque sorte prisonniers de l’entreprise. Ils peuvent certes vendre leurs droits de propriété, mais la valeur de ceux-ci dépend évidemment de la qualité des décisions de long terme qui ont été prises.
Les conséquences néfastes d’un système de participation des salariés aux décisions de l’entreprise viennent du fait que la démocratie dans l’entreprise introduit une structure de décision différente de celle qui apparaît spontanément et qui est fondée sur les droits de propriété. Un tel système provoque des changements dans la structure des droits et donc dans le système d’incitations.
Une entreprise n’est pas une démocratie et ne doit pas être une démocratie. C’est un ensemble de contrats et cela n’a aucun sens de vouloir gérer un ensemble de contrats démocratiquement. Mais il existe des « îles de démocratie » dans une entreprise, c’est-à-dire dans un univers qui n’est fondamentalement pas démocratique. Celles-ci correspondent seulement à des contrats de coopération – et non d’échange – entre des propriétaires qui ont mis en commun leurs ressources pour atteindre un objectif commun (par exemple la maximisation du rendement de leur capital).
Par contre, ceux que l’on appelle les « stake-holders » (salariés, prêteurs) ont des intérêts divergents par rapport aux « share-holders » (actionnaires) et c’est bien pourquoi il y a signature de contrats entre eux, le contrat permettant de trouver les situations qui sont acceptables pour les uns et pour les autres[4]. Mais c’est une illusion de croire qu’un accord mutuel entre des personnes ayant des intérêts divergents peut être obtenu par des méthodes démocratiques. Ce qui est décidé démocratiquement peut être profitable à certains, mais porte nécessairement atteinte aux droits de propriété légitimes de certains autres.
On peut enfin ajouter qu’il peut exister d’autres « îles de démocratie » dans une entreprise, en plus de celle qui concerne les actionnaires. C’est le cas, par exemple, s’il existe un syndicat qui est censé défendre les intérêts communs à une catégorie de gens (les salariés). À l’intérieur du syndicat, les décisions et nominations peuvent être prises à la majorité des voix, ce qui est préférable à la dictature ou au conflit violent.
De la démocratie dans les associations et copropriétés
Les membres d’une association ou d’une copropriété ont des intérêts communs (ce que l’on peut appeler des « biens publics » ou des « biens collectifs ») et ils doivent adopter des processus de décision collective. Le modèle démocratique est alors applicable.
Dans une association, les droits de propriété sont d’ailleurs flous et il est impossible de s’approprier privativement le produit de l’activité de l’association. En ce sens, une association a une nature proche de celle de l’Etat, avec toutefois une différence importante : Il est beaucoup plus facile d’entrer dans une association et d’en sortir que cela n’est le cas pour l’Etat. Par ailleurs, une association ne prend en charge que les intérêts communs à ses membres et pas les autres aspects de leur activité. Les membres entrent d’ailleurs librement dans une association pour cette raison. Au contraire, l’Etat prend en charge des activités pour lesquelles les citoyens ont des intérêts divergents et non communs.
Dans une copropriété, les droits de propriété sont bien définis, mais une partie de la propriété a une forme collective, c’est-à-dire qu’il existe des intérêts communs à tous les membres. La procédure de décision est généralement de forme démocratique (majorité des voix ou majorité qualifiée), mais les droits de vote sont proportionnels aux droits de propriété. Par ailleurs, on peut librement entrer dans la copropriété et en sortir. De ce point de vue la démocratie est désirée et elle est compatible avec les droits de propriété. Ceci constitue une grande différence avec ce qui se passe, par exemple, dans une ville ou une collectivité publique quelconque : le droit de vote y est totalement indépendant des droits de propriété, puisque chaque personne adulte dispose d’une voix et d’une seule. Il existe alors une distorsion entre la structure des droits de propriété et la structure des droits de vote. Or, les décisions, par exemple, d’un conseil municipal, peuvent avoir des conséquences importantes sur la valeur des propriétés. Mais les intérêts des votants sont divergents, par exemple ceux des propriétaires et ceux des locataires. Ces derniers peuvent facilement quitter la commune où ils se trouvent sans supporter de coûts importants. Mais les propriétaires sont en quelque sorte prisonniers de leur commune, comme le sont les propriétaires d’une entreprise : si la municipalité prend à la majorité des voix des décisions qui diminuent la valeur de leur propriété, ils en subissent définitivement le coût.
Dans les petites organisations, la démocratie existe donc et elle est compatible avec les droits de propriété dans la mesure où elle résulte de l’existence d’intérêts communs à plusieurs personnes. Cela est le cas, en particulier lorsque :
- Il y a mise en commun des ressources (cas des actionnaires d’une entreprise)
- Il y a une production privée de biens collectifs (association ou copropriété).
Les droits de vote sont compatibles avec les droits de propriété parce qu’ils ne sont pas identiques pour tout le monde (ils sont proportionnels aux droits de propriété) et, par ailleurs, les décisions prises font l’objet d’un vote au cas par cas pour chaque décision, c’est-à-dire que personne ne dispose d’un mandat illimité pour une certaine période, comme cela est le cas au niveau de l’Etat démocratique.
- L’Etat démocratique
Comparaison avec la démocratie volontaire des petites organisations
Nous venons de voir que, dans les petites organisations, la démocratie était compatible avec le respect des droits de propriété et ceci dans deux cas : mise en commun de droits de propriété et production de biens collectifs.
- a) La mise en commun des droits de propriété: cette situation n’est pas applicable au cas de l’Etat car personne n’est propriétaire de l’Etat et de structures publiques à notre époque. Ainsi, nous venons de voir qu’il existe un écart important entre les processus de décision dans une copropriété et dans une municipalité. Certes, on pourrait imaginer que seuls les propriétaires soient électeurs pour les élections au conseil municipal, comme cela a parfois été le cas dans le passé dans certains pays. En effet, on considère alors que les décisions du conseil municipal affectent la valeur des propriétés et que les locataires, pour leur part, ne sont que des clients. Les propriétaires sont motivés pour qu’une bonne gestion accroisse la valeur de leurs propriétés. Mais si les locataires votent aussi, le système d’incitations en est modifié : les locataires font le choix du court terme, car ils ne peuvent pas capitaliser les gains de valeur et ils ont tendance à faire payer les autres, c’est-à-dire que le pillage est généralisé. Mais, bien entendu, à notre époque, une telle limitation du droit de vote est considérée comme inacceptable et c’est la simple présence sur un territoire particulier qui permet d’obtenir un droit de vote, identique pour tous.
Par rapport au modèle de l’entreprise que nous avons considéré précédemment, la démocratie publique de notre époque a un caractère flou parce que personne n’est propriétaire de l’Etat ou des collectivités publiques. Les électeurs sont en fait les consommateurs des biens publics produits par les collectivités publiques et l’Etat et les producteurs de ces biens n’ont pas de droits de propriété. Or, un droit de propriété peut se définir comme un droit d’exclusion en ce sens que le propriétaire d’un bien peut exclure autrui de l’usage de ce bien. Dans le système étatique et public, les droits de propriété ne sont pas définis, mais ils existent implicitement dans la mesure où il existe nécessairement des exclusions, les ressources étant toujours limitées. Mais ces exclusions – ou droits de propriété implicites – ne sont pas clairement définies et elles ne sont en tout cas pas légitimes (au sens où nous l’avons entendu). Elles sont déterminées par des luttes de pouvoir ou par des décisions « démocratiques » des consommateurs de biens publics, mais certainement pas par des actes de création, contrairement à ce qui se passe dans une société d’hommes libres.
Ces luttes pour l’appropriation – personnelle ou catégorielle – sont censées être arbitrées par les électeurs, c’est-à-dire les consommateurs des services étatiques. Certes, dans toute organisation humaine, il faut avoir recours à un système de contrôle extérieur des producteurs, sinon c’est la lutte de tous contre tous pour l’appropriation. Ce contrôle est assuré, dans une société d’hommes libres, par la définition des droits de propriété et par la concurrence. Mais dans la sphère publique il n’y a pas de concurrence et pas de liberté de choix. Il faut donc trouver un système de contrôle externe : c’est la démocratie. Mais c’est un mode de contrôle imparfait. Certes meilleur que l’anarchie ou la barbarie, il est cependant moins bon que le contrôle extérieur par la concurrence entre des producteurs propriétaires et donc responsables.
On connaît le mot de Winston Churchill selon lequel la démocratie est le pire de tous les systèmes à l’exclusion de tous les autres. Mais Winston Churchill se trompait : il existe un système meilleur que la démocratie, le système de la propriété privée.
Il serait donc souhaitable :
- d’une part de ne pas utiliser des processus de décision démocratiques là où des droits de propriété existent,
- d’autre part de chercher à limiter le plus possible la sphère publique pour ne pas avoir besoin de la démocratie.
- b) Biens collectifs, biens publics[5]
Comme nous l’avons vu, dans le secteur privé il apparaît naturel d’utiliser des procédures démocratiques lorsqu’une décision collective doit être prise concernant la production de biens collectifs (que l’on peut appeler biens publics lorsque leur production est assurée par l’Etat). Peut-on alors trouver les mêmes justifications du recours à ces procédures démocratiques pour la production de biens publics que pour la production de biens collectifs privés ?
La théorie traditionnelle des biens publics repose sur l’idée que la définition de droits de propriété individualisés est impossible pour des biens qui posséderaient les deux caractéristiques suivantes :
- Non-exclusion, c’est-à-dire qu’il est impossible d’exclure quelqu’un de l’usage du bien public une fois qu’il est produit (ainsi on ne peut pas individualiser les services de la défense nationale et faire payer chaque citoyen en fonction de la quantité de ces services qu’il consomme)
- Non-rivalité, c’est-à-dire que la consommation d’un bien public par un individu ne diminue pas la quantité qui reste disponible pour les autres (en bénéficiant des services de la défense nationale, je ne diminue pas les services disponibles pour autrui).
Cette théorie traditionnelle des biens publics semble fournir la meilleure justification théorique possible de l’Etat et donc de la coercition légale : chaque citoyen, conscient des bienfaits que leur apporteraient les biens publics, sont prêts à accepter d’être contraints à payer pour ces services, à condition que les autres le soient également. Par ailleurs, puisque les droits de propriété ne peuvent pas être individualisés, il peut sembler à première vue qu’on évite le risque que les procédures de décision démocratiques entrent en conflit avec les droits de propriété légitimes.
Malheureusement, le problème n’est pas aussi simple. En effet, si les décisions concernant la production d’un bien public étaient prises à l’unanimité des voix des citoyens, on pourrait dire sans ambiguïté qu’ils acceptent de céder une partie des ressources qu’ils possèdent afin d’obtenir un bien – le bien public – qui a plus de valeur à leurs yeux que les ressources ainsi cédées : ils accepteraient donc la coercition étatique à condition que les autres l’acceptent aussi. Mais l’unanimité n’existe généralement pas, même dans des communautés d’hommes et de femmes très restreintes. C’est d’ailleurs bien pour cela qu’au lieu d’exiger l’unanimité, les procédures démocratiques reposent sur l’utilisation d’une règle de majorité simple ou de majorité qualifiée. Mais ceci signifie que les minoritaires considèrent que le bien public en question a moins de valeur pour eux que ce qu’ils pourraient obtenir si on leur laissait le montant de leur impôt pour des dépenses privées. Pour certains d’entre eux, le « bien public » peut même apparaître comme un « mal public » (par exemple la défense nationale pour celui qui est antimilitariste). La règle démocratique porte alors bien atteinte aux droits de propriété privés.
En réalité, on a tendance à appeler « biens publics » les biens et services que le pouvoir en place – démocratique ou non – s’approprie pour lui-même ou pour les catégories de citoyens qui les soutiennent électoralement. On prétend alors que la production et la répartition de ces biens est juste, puisque les titulaires du pouvoir sont contrôlés démocratiquement. Or, la monopolisation de la production des biens publics qui en résulte généralement a une conséquence grave : du fait que personne n’est autorisé à concurrencer l’Etat, personne n’a intérêt à rechercher les méthodes efficaces qui permettraient de définir des droits de propriété individuels pour les biens publics, faisant alors disparaître le caractère de « bien public » d’un bien ou service. En réalité, aucun bien ne peut être considéré comme un « bien public » par nature et pour l’éternité. A certains moments, compte tenu des techniques disponibles pour déterminer les droits de propriété, il peut sembler trop coûteux ou même impossible de définir ces droits et l’on préfère alors la production des biens correspondants par l’Etat. Mais les situations évoluent dans le temps. Ainsi, on connaît maintenant le péage urbain dans certaines villes, c’est-à-dire que chacun paie en fonction de l’usage qu’il fait d’un espace qui était antérieurement considéré comme nécessairement public, c’est-à-dire disponible sans limites et financé par l’impôt.
La démocratie est fondamentalement hostile à la liberté, car elle est hostile à la propriété privée
Par définition l’action étatique repose sur la coercition. Elle est certes légale, mais cela ne signifie pas qu’elle est légitime. Les impôts et réglementations sont des atteintes à la propriété. Comme toute atteinte à la propriété, ils n’ont donc pas un caractère de légitimité : en effet, les droits qu’ils établissent ne résultent pas d’actes de création, mais d’actes de coercition. Le fait qu’un impôt soit voté démocratiquement ne lui confère aucune légitimité. Le fait qu’une réglementation soit décidée par les représentants démocratiquement élus des citoyens ne lui donne aucune légitimité.
Pour s’en convaincre imaginons un village de 100 habitants. Si 51 habitants décident de se réunir pour voler les 49 autres, leurs actes ne deviennent pas moraux du fait qu’ils sont décidés à la majorité des voix, pas plus qu’ils ne le seraient s’ils étaient décidés par leurs représentants démocratiquement élus. Et le caractère immoral du vol subsisterait évidemment même si 99 habitants décidaient de spolier le centième ! Ceci veut bien dire qu’il existe des principes supérieurs à la démocratie auxquels celle-ci devrait être soumise.
Une société a besoin de principes moraux universels, elle a besoin de juges pour dire le Droit qui ne doit pas être confondu avec les lois produites par le Parlement. C’est ce message que l’on retrouve dans la distinction faite par Friedrich Hayek ou Bruno Leoni entre le Droit et la législation, entre les grands principes éthiques d’une société libre et les décisions de circonstance du pouvoir, qu’il soit démocratique ou non.
L’Histoire nous apporte d’ailleurs d’innombrables exemples de la manière dont les hommes ont pu trouver des solutions à des problèmes nouveaux sans avoir recours à une législation émise arbitrairement par le pouvoir. Ainsi, lorsque la radio a été inventée, ce sont les juges qui ont réglé les conflits entre propriétaires de fréquences aux Etats-Unis. Ils ont pour cela appliqué le principe du droit du premier occupant. Ce faisant, ils ont spontanément redécouvert le lien existant entre la propriété légitime et l’acte de création : celui qui, le premier, invente un usage pour une fréquence jusqu’alors inutilisée en devient le propriétaire légitime. Et son droit de propriété doit être défendu contre ceux qui arrivent plus tard et qui empiètent sur sa propriété. L’Etat, dans la plupart des pays, s’est ultérieurement approprié toutes les fréquences, au point qu’on en est arrivé à croire qu’il était le propriétaire naturel de ces fréquences ; mais il n’est pas nécessaire – et certainement pas souhaitable – que l’Etat soit chargé de l’allocation des fréquences ou qu’il remette cette tâche à une « autorité de régulation indépendante » qui répartit alors ce qui ne lui appartient pas et qui, n’étant pas propriétaire, est nécessairement irresponsable.
Nous pouvons alors clairement voir les différences qui existent entre la démocratie privée et la démocratie publique. La démocratie publique n’est pas fondée sur des droits de propriété. Elle consiste à donner un mandat illimité pour plusieurs années à des « représentants » élus. Ce mandat est donné pour une infinité de décisions qui ne sont même pas précisées à l’avance et qui sont adoptées de manière discrétionnaire et même arbitraire.
En fait, la démocratie est un système d’exploitation mutuelle – c’est-à-dire un système d’expropriation des droits d’autrui – sous le prétexte de défendre des morales particulières (et non universelles). Comme l’a écrit Frédéric Bastiat, « L’Etat, c’est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde »[6]. Il est d’ailleurs intéressant de souligner que Frédéric Bastiat – qui a été député à l’Assemblée Nationale française de 1848 à 1850, date de sa mort à Rome – a vécu de près ce qui était le tout début du suffrage universel et il en a vu tous les dangers potentiels. Il explique que la loi est devenue l’instrument de la spoliation et, le droit de légiférer étant devenu universel (du fait de la démocratie), la spoliation est devenue universelle. En conséquence la notion de juste et d’injuste disparaît. Et il écrit : « Quoi qu’en pensent les adeptes de l’Ecole de Rousseau, […] le suffrage universel […] n’est pas un de ces dogmes sacrés, à l’égard desquels l’examen et le doute même sont des crimes »[7].
- Quelles solutions ?
Quelles solutions peut-on imaginer pour les graves problèmes posés par le fonctionnement de la démocratie dans nos pays modernes ? Il n’existe malheureusement pas de recette magique et les solutions éventuelles seront indéfiniment à rechercher. De ce point de vue, l’Histoire n’est certainement pas terminée.
On pourrait certes adopter une position optimiste en admettant que, malgré ses défauts, la démocratie reste tout de même un rempart ultime contre le danger totalitaire, car les hommes aiment la liberté et le font savoir grâce à la démocratie. Mais cela n’est pas suffisant : Hitler n’a-t-il pas été démocratiquement élu au début ?
Il faut limiter l’Etat, limiter la démocratie et revenir à une société de propriétaires. Il faut réintroduire les droits de propriété partout où cela est possible, par exemple en préférant les co-propriétés aux municipalités. Il faut s’efforcer de réduire la dimension de la zone de pouvoir de manière à rendre plus facile pour les citoyens de se prononcer en connaissance de cause et pour donner à chacun un poids relatif plus grand. Plus la zone politique est large, moins la démocratie a de signification. C’est pourquoi la construction d’une Europe démocratique est une pure illusion ou, pire, un danger. Il n’y a pas de déficit démocratique en Europe, il y a un déficit de liberté. Il n’est pas nécessaire d’avoir un Parlement européen ou d’accroître les pouvoirs du Parlement existant. Il convient au contraire de rapprocher le pouvoir des individus et surtout de leur rendre le pouvoir de décider pour eux-mêmes. Ainsi, en Suisse, l’initiative référendaire porte sur un sujet précis – comme dans la démocratie spontanée privée – et elle s’exerce à une échelle réduite – par exemple celle du canton. Ainsi, dans certains cantons, les électeurs ont refusé les impôts nécessaires au financement de mesures qui avaient été antérieurement votées ou ils ont voté la dégressivité de l’impôt pour attirer des propriétaires.
Il faut soumettre l’Etat aux grands principes du Droit, le juge assurant la défense des droits des propriétaires ; il faut limiter l’Etat, concurrencer l’Etat, en dénonçant la fiction des biens publics.
Critiquer la démocratie ce n’est pas faire l’apologie des dictatures, bien au contraire. C’est dénoncer précisément ce qu’il y a de totalitaire dans la démocratie et faire l’apologie de la liberté et de la propriété individuelles. Ne cherchons donc pas à faire partie d’une majorité pour spolier autrui, mais cherchons à contribuer à l’émergence d’une majorité d’idées capable de défendre la liberté et la propriété.
[1] Jean-François Revel, La grande parade, Paris, Plon, 2000.
[2] Mancur Olson, The Logic of Collective Action, Harvard University Press, 1971 (traduction française : La logique de l’action collective, PUF, 1976)
[3] Bertrand de Jouvenel, Du pouvoir, Genève, Le cheval ailé, 1945 et Paris, Hachette, 1972 (traduction en anglais : On Power, Greenwood Press, 1981).
[4] Ainsi, l’acheteur d’un bien aimerait un prix aussi faible que possible, alors que l’offreur aimerait un prix aussi élevé que possible. Leurs intérêts sont a priori divergents, mais ils arrivent à trouver un prix acceptable pour tous.
[5] Pour faire court nous parlons de « biens », mais il est évident qu’il serait plus précis de parler de « biens et services »
[6] « L’Etat », Journal des Débats, 1848.
[7] « La loi », Pamphlets, 1850.