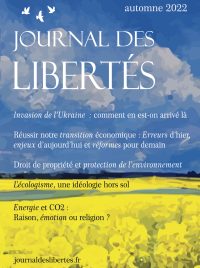Partie 2 :
Quelques considérations sur l’épistémologie, l’économie et la politique du climat[1]
La climatologie n’est pas tout à fait une science comme les autres, en ce que dès la création du GIEC, elle déborde de son lit scientifique pour investir le champ politico-militant : « quatre groupes participent activement au cadrage de la question climatique : les journalistes scientifiques et d’environnement, les scientifiques du climat, les services d’État chargés de ce problème (…) et les ONG environnementales… »[2]. Cela vient de ce que, tandis que la science tire historiquement son crédit social de sa contribution au progrès technologique, la climatologie dérive le sien d’un projet d’ingénierie sociale porté par les gouvernements et les institutions internationales : la « décarbonation » des économies, particulièrement en Europe.

C’est pourquoi le giécisme est une fusée normative à trois étages. Il ne lui suffit pas d’entériner que le CO2 réchauffe la planète, proposition que l’on doit tenir pour plausible. Il faut encore que l’impact de ce réchauffement soit catastrophique. Et enfin, que la politique publique y puisse quelque chose. Le premier étage, on l’a vu, est celui de la climatologie mainstream, selon laquelle un excès de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère contribue à un réchauffement dangereux de la planète. Le second étage est celui de l’extension du « carbocentrisme » à l’analyse socio-économique. Le troisième étage est celui de la capacité de la politique publique à décarboner les économies. Ainsi, quand bien même les pieds du colosse climatique ne seraient pas faits d’argile, sa réputation de colosse pourrait être surévaluée.
Dans la suite, on évoquera donc quelques considérations d’ordre épistémologique, économique et politique opposables à la puissance présumée du dogme climatique.
1. Quelques considérations épistémologiques : la controverse climatique
Comme je le précise dans l’essai béotien que je consacre à la physique du climat, je n’ai trouvé qu’un seul travail francophone explicitement dédié à la controverse climatologique ; il s’agit d’une thèse de doctorat en sociologie qui a été soutenue face à un jury comprenant le climatologue mainstream Jean Jouzel[3].
La controverse climatique renvoie schématiquement à deux niveaux d’analyse : un niveau circonscrit à la dimension strictement scientifique et un niveau plus partisan, qu’incarnent les travaux sur le « consensus » produits par quelques chercheurs en sciences économiques et sociales.
1.1. La controverse strictement scientifique :
Le premier niveau d’analyse est strictement scientifique. Schématiquement, les controverses relatives au forçage radiatif forment la ligne de démarcation entre théorie mainstream (giécisme) et hétérodoxie (solarisme et/ou tenants de la variabilité naturelle) ; mais en France, la recherche « solariste » (spécialisée dans l’interaction soleil-climat) serait réticente à entrer dans le débat climatique, pour des raisons d’ordre personnel et institutionnel qui peuvent se comprendre (Scotto d’Apollonia, 2014, p. 466-468)[4]. Les controverses et incertitudes relatives aux conséquences climatiques du réchauffement posent moins de problèmes d’identification puisqu’elles transparaissent du résumé technique du groupe de travail n°1 du GIEC (WG1). On peut cependant regretter que l’évaluation scientifique de cet organisme fasse plus clairement état des incertitudes – donnant lieu à jugements en probabilité – que des désaccords dont les « niveaux de confiance » semblent être le reflet. Cela vient de ce que, plutôt que de produire un état de l’art de la recherche climatologique, la vocation du GIEC est d’en fournir une évaluation à des fins d’action – voire de légitimation – politique[5]. Ce dessein n’affranchit pas ses rédacteurs d’un souci d’exactitude et de rigueur dont atteste le durcissement progressif des procédures de rédaction et relecture des fameux rapports. Mais il participe d’une science experte – dédiée au conseil – plutôt que savante – dédiée à l’exhaustivité des connaissances – conformément, d’ailleurs, au tour pris par la recherche dans maintes disciplines scientifiques.
Il faut le redire : une science sans controverse n’est pas une science (au mieux, une religion sectaire). Dans chaque discipline, il existe des orthodoxes et des hétérodoxes et il n’est pas rare que l’orthodoxie d’hier devienne l’hétérodoxie d’aujourd’hui, selon un processus d’évolution qu’a notamment mis au jour le philosophe Thomas S. Kuhn[6]. Le carburant de ce processus d’évolution est un hybride fait de curiosité et de doute. Les deux mènent au scepticisme, attitude cardinale du scientifique, dont nihilisme et dogmatisme sont les ennemis mortels : or, en matière climatique, on trouvera toujours à considérer qu’on ne sait rien, parce qu’on ne sait pas tout (nihilisme) et, symétriquement, à décider que l’on sait définitivement, au motif que cela repaît une envie de croire (dogmatisme).
1.2. La controverse envisagée par quelques travaux en sciences sociales
Le deuxième niveau d’analyse est celui de la controverse vue par certains travaux en sciences sociales. Celles-ci avalisent très largement le discours de climato-anxiété, quand bien même la science économique demeure prudente en la matière. De nombreux travaux en sciences sociales choisissent donc de donner valeur apodictique à la climatologie giéciste (dans tous ses aspects, y compris socio-économiques), sans naturellement être capables d’en juger sur le fond. Pour être pleinement crédible, un tel postulat réclame donc d’éliminer la possibilité même d’une controverse scientifique. Il s’agit de montrer que, tous les spécialistes étant d’accord quant au fait que « les émissions anthropiques de CO2 réchauffent le climat (de façon préjudiciable) », cette sentence a la même valeur assertorique que « la Terre est ronde ».
Deux arguments-clés sont avancés à cette fin : celui des « marchands de doute » et celui du « consensus ». L’un et l’autre me semblent intéressants en ce qu’ils illustrent une tentation climato-totalitaire dont la résonnance est respectivement politique et religieuse.
A. Les marchands de doute
Il s’agit du titre d’un ouvrage célèbre de Naomi Oreskes et Erik M. Conway (2010), historiens américains des sciences. Les auteurs montrent comment l’industrie du tabac d’une part, l’industrie pétrolière d’autre part, auraient financé des travaux scientifiques déficients dans le seul but de nuire aux thèses du tabac cancérigène et du CO2 « réchauffant ». Les scientifiques ayant mené ces travaux hétérodoxes sont qualifiés de contrarians et les faits allégués à leur propos sont vraisemblablement exacts. Il s’agirait donc d’une des manifestations du nihilisme climatique[7], inhérent à la transmutation d’une question scientifique en enjeu politique.
En l’espèce, la motivation du discours contrarian est économique. Il s’agit de transformer l’argument scientifique en un outil de lobbying pro-pétrolier (pour ce qui concerne spécifiquement notre objet climatique), opposable aux politiques de décarbonation des économies. Il est évidemment possible – voire vraisemblable – qu’une partie de l’industrie pétrolière se soit livrée à cette manigance (peut-être même sincèrement, à une époque où la science climatique était moins avancée qu’aujourd’hui). Rappelons toutefois qu’une autre parade aurait pu être mobilisée par l’industrie pétrolière : l’investissement de ses substantiels bénéfices dans le développement et l’exploitation des énergies renouvelables, d’une part, la décarbonation de ses opérations, d’autre part. Les deux stratégies sont aujourd’hui largement en cours car elles relèvent de la dynamique normale de l’économie de marché.
Toujours est-il que pour Oreskes et Conway, les contrarians auraient le monopole de l’hétérodoxie. Et seraient, seuls, responsables de la politisation de la question climatique, comme si la contradiction apportée au paradigme giéciste ne pouvait s’entendre qu’au regard d’une logique de l’intérêt. La thèse centrale des marchands de doute est donc marxiste : les climatologues mainstream étant désintéressés, ils disent le vrai (et le bien). Les pétroliers étant menacés par la décarbonation énergétique, ils mentent au nom de leur intérêt de classe.
Dans son travail de thèse, Scotto d’Apollonia bat (impitoyablement) en brèche cette vision manichéenne des choses : (i) les contrarians « représentent un tout petit groupe, pas plus de dix aux États-Unis (…). Ce groupe activiste n’est donc pas représentatif de la communauté des chercheurs travaillant sur le climat » (2014, p. 287). (ii) la politisation de la question climatique est d’abord le fait des scientifiques mainstream : « la création du GIEC semble plus être le résultat d’une mobilisation de la communauté scientifique que d’une demande sociale. Il marque une évolution des rapports entre les sciences et la politique et explique sa nature hybride » (2014, p. 26). Non seulement la controverse climatique n’est pas réductible à une théorie du complot pétrolier mais les scientifiques n’étant pas plus désintéressés que quiconque, l’institution du GIEC peut elle-même faire l’objet d’une analyse en termes stratégiques.
D’abord en faisant remarquer que l’hétérodoxie est toujours une position institutionnelle courageuse, a fortiori dans le cadre d’une recherche fréquemment financée sur appels d’offre à visées conformistes : l’indépendance d’esprit coûte généralement plus qu’elle ne rapporte. Or, l’originalité scientifique est une force d’innovation et de contrôle, à même de discipliner le monopole institutionnel de la science orthodoxe[8] ; elle contribue donc à la vitalité de son écosystème. En France, l’association des climato-réalistes, qui regroupe plusieurs universitaires, remplit précisément cette fonction de surveillance de l’orthodoxie. Elle confronte le giécisme à un travail de vigilance critique dont celui-ci ne peut que bénéficier, ne serait-ce qu’au regard des opportunités de contre-offensive qu’il offre. C’est, sans surprise, ce que confirme un travail épistémologique relativement récent : la science hétérodoxe est un aiguillon de la concurrence épistémologique, favorisant le développement des connaissances[9].
Le GIEC est-il, par ailleurs, une institution désintéressée ? La réponse est dans la question puisque celle-ci prend la forme d’un oxymore. Il est loisible d’envisager le GIEC tel un cas d’entrepreneuriat institutionnel, c’est-à-dire une organisation dédiée à la promotion de causes d’intérêt général ou catégoriel dans le champ socio-politique. Si les motivations d’un entrepreneur institutionnel peuvent être spirituelles, il est rare qu’elles ne s’accompagnent pas d’un soupçon de gratification temporelle. Grâce au GIEC, en effet, la climatologie jouit d’une reconnaissance académique convertible en généreux financements institutionnels et ses promoteurs en conçoivent un prestige pouvant éventuellement se monnayer au sein de cabinets de conseil. C’est absolument irréprochable mais ce n’est pas « désintéressé ».
Pourquoi, justement, le GIEC est-il devenu le succès institutionnel que l’on sait ? Une partie de l’explication réside en l’activisme de ses fondateurs. Une autre partie vient, naturellement, d’un contexte politique favorable à la cause du climat, celui-ci suscitant l’intérêt institutionnel de la « communauté internationale » – le G7 et l’ONU – à la fin des années 1980. Les raisons de cet intérêt institutionnel sont diverses. Mais il est intéressant de noter que le climat arrive à point nommé pour renouveler une doctrine de l’aide au développement dont l’ONU, entre autres grandes institutions, s’est fait une vocation historique. Pendant les années de guerre froide (1945-1985, en gros), les pays riches investissent des sommes considérables dans des projets de construction d’infrastructures et d’industries lourdes – les fameux « éléphants blancs » – dont la doxa technocratique de l’époque conçoit un cercle vertueux au bénéfice économique des pays pauvres. De nombreux rapports ayant documenté non seulement l’échec mais les terribles effets pervers de ces politiques d’aide (surendettement, corruption, chaos politique menant à de terribles crises humanitaires), les années 1980 sont celles d’une crise de légitimité du développementalisme. Le climat – devenu incarnation de toute la problématique environnementale – et la lutte contre la pauvreté vont lui donner un nouveau souffle doctrinal : quoi de plus légitime, en effet, que de « lutter contre la pauvreté » ou « sauver la planète » ? Que de budgets, de moyens et de personnel ne mobiliserait-on pas pour aussi noble cause ? L’activisme climatique des bureaucraties onusienne et européenne n’est donc pas dénué de reconnaissance du ventre dans la mesure où, si la rentabilité demeure l’argument principal d’une entreprise en quête de capitaux, la légitimité constitue celui d’une administration en quête de budgets. Les démiurges de bureau ne sont donc pas moins intéressés que les « marchands de doute ». Et généralement, ils créent moins de valeur économique.
B. Le consensus
Au lieu d’identifier les moutons noirs de la climatologie, la recherche sur le « consensus » va tâcher d’en compter les moutons blancs. L’idée directrice est d’évaluer le degré d’accord de la communauté scientifique quant à l’assertion majeure de la climatologie mainstream, à savoir le rôle déterminant joué par le CO2 anthropique dans le réchauffement « climatique ». Un premier papier – de Naomi Oreskes, déjà (2004) – ouvre la voie de cette recherche. Mais c’est un article de John Cook et huit collègues qui, en 2013, va médiatiser le fameux « consensus à 97% »[10].
Il revient à l’économiste Richard S. Tol d’avoir durement critiqué le papier de Cook et de ses collègues[11]. Cette critique a ensuite suscité une cascade de réponses, parfois qualifiée de débat relatif au « consensus sur le consensus ». En retravaillant les données de Cook, Tol parvient à un consensus scientifique de… 5% sur la question de recherche posée. De son travail, je retiens deux critiques méthodologiques et une critique fondamentale, qui méritent qu’on s’y arrête :
- Le parti-pris des climatologues pour la thèse mainstream est évalué à la lecture des abstracts, c’est-à-dire des résumés d’articles scientifiques faisant partie de l’échantillon d’environ 12 000 papiers sélectionnés par l’équipe de Cook. La première curiosité vient de ce que la mesure du consensus fait l’objet de… sept niveaux d’évaluation. On s’attendrait, au contraire, à ce que la question du réchauffement anthropique (ou principalement anthropique) puisse donner lieu à question fermée (oui-non). Comment prétendre mesurer un « consensus » sur un problème faisant l’objet d’autant de nuances que celles retenues par le protocole de recherche ? Tol concentre son attention sur le biais interprétatif auquel le travail de Cook donne lieu, les auteurs ayant un parti-pris mainstream. Pour ma part, c’est le design même de la recherche qui me laisse perplexe.
- Nettement plus embarrassant, 76,7% des papiers évalués sont consacrés aux « impacts » et à « l’atténuation » du changement climatique, correspondant respectivement aux groupes de travail n°2 et 3 du GIEC (WG2 et WG3). Or, il s’agit de papiers commis par des chercheurs en sciences économiques et sociales, n’ayant non seulement rien de substantiel à dire sur les causes du changement climatique mais devant, sauf exception, entériner sa nature anthropique à titre de postulat. A contrario, Tol identifie que l’échantillon de Cook et ses collègues sous-estime la contribution d’articles relevant des sciences de la Terre, susceptibles d’avoir un avis informé sur la question investiguée (géosciences, océanologie, etc.)
- Last but not least, deux tiers des papiers investigués ne prennent pas position sur la question posée. Ce chiffre, qui figure dans le résumé de l’article de Cook et de ses collègues, sous-estime même la réalité : car sur la seule partie pertinente de l’échantillon (les papiers relevant de la climatologie), le chiffre atteint 71%. Sans même tenir compte des objections susmentionnées, un tel taux d’abstention interdit, en toute rigueur, de conclure que la communauté scientifique entérine « à 97% » la thèse du réchauffement anthropique. En réponse aux critiques de Tol, Cook et d’autres chercheurs (dont l’omniprésente N. Oreskes) surmontent cette difficulté en usant d’un stratagème édifiant : en premier lieu, les auteurs raisonnent selon l’axiome du tiers-exclu de sorte qu’un papier neutre au sens de la requalification de Tol (« non-endossement ») équivaudrait à un déni. De la sorte, les auteurs enferment leur adversaire dans un biais cognitif qui leur est propre. Et ils en déduisent que si la lecture de Tol « était par exemple appliquée ailleurs, elle conclurait aussi au non-consensus à propos de théories bien établies comme celle de la tectonique des plaques »[12]. Mais si le consensus est d’emblée tenu pour évident, à quoi sert-il de le tester ? C’est un peu comme si on menait une expérience dont le résultat servirait aussi de postulat (et non d’hypothèse) ; il ne pourrait donc s’agir que d’un truisme ou d’une mystification.
La malhonnêteté intellectuelle des arguments pro-consensus ci-dessus évoqués est un indice supplémentaire de la crispation du débat climatique. Il eut été facile à Cook, Oreskes et autres chercheurs « pro-consensus » de reconnaître qu’entre le « pour » et le « contre », existe une grappe importante de travaux agnostiques ou neutres, quelles qu’en soient les raisons. Mais parce que leurs travaux sont mal conçus, et surtout idéologiquement motivés, ils échouent à apporter la preuve de ce qu’ils avancent.
Ceci dit, l’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence (N. N. Taleb). Or, Richard Tol – et c’est aussi mon sentiment – convient qu’en dépit des défauts (rédhibitoires) de l’article précité, le consensus « anthroporéchauffiste » est très vraisemblable. Si les travaux susmentionnés ne le confirment pas, aucun ne l’infirme à ma connaissance ; il est également possible que les critiques émises à leur endroit aient finalement permis aux recherches de Cook et consorts de progresser dans leurs tentatives de confirmation (Cook a produit quelques travaux ultérieurs sur ce thème). En tout état de cause, il ne peut précisément pas y avoir de science mainstream sans consensus sur les questions fondamentales : à cet égard, celui-ci revêt même un aspect performatif. La question importante porte plutôt sur l’existence d’une science climatique non mainstream, forcément minoritaire. Or celle-ci existe bel et bien[13].
Tandis que la thèse des marchands de doute s’arrime à une conception marxiste des idées et opinions, la thèse du consensus en colporte une vision plus religieuse, pour ne pas dire cléricale. Selon cette dernière, le réchauffement anthropique est une vérité révélée par la science, dont les conséquences sont écologiquement malignes. Une église – littéralement, une communauté de croyants – doit donc se former pour initier le monde à sa parole et convertir les derniers hérétiques à sa lumière, en luttant d’arrache-pied contre l’obscurantisme. Cette église a son clergé : il est frappant qu’un argument (trop) fréquemment opposé par (ou au nom de) la climatologie mainstream à ses détracteurs, leur reproche de ne pas être des « spécialistes ». Dès lors, un océanologue, un géologue, un physicien, un mathématicien ou même un ingénieur ne pourraient avoir un avis éclairé sur les théories ou méthodes relevant de l’astrophysique, de la systémique ou de la modélisation climatiques ? Un juriste, un historien, un sociologue sont-ils autorisés à formuler quelque avis sur une question économique ?
La parole climatologique ne pourrait donc émaner que d’un concile d’initiés, seuls exégètes de la vérité révélée (par le GIEC). Cette conception restrictive du débat scientifique est hélas concomitante d’une évolution plus générale de la production académique, qu’il serait ici trop long d’aborder ; en tout état de cause, la science n’a pas le monopole de la production d’idées et de connaissances. Elle se trompe et souffre de biais de conception que connaissent bien les enseignants-chercheurs de toutes disciplines (et dont les travaux susmentionnés, relatifs au consensus, sont emblématiques). Le débat climatologique ne peut pas s’en remettre à la sacralisation de la parole experte. Il doit procéder d’un effort didactique pour démonter patiemment fausses évidences et contradictions trompeuses.
2. Quelques considérations relatives aux impacts du réchauffement climatique (l’économie du climat)
Les travaux et réflexions sur l’économie du climat ont partie liée avec les impacts et les politiques d’atténuation évalués par les groupes de travail n°2 et 3 du GIEC (WG2 et WG3). Quant aux impacts, WG2 s’essaie à une modélisation des conséquences socio-économiques du réchauffement en fonction de divers scénarios de hausse des températures. On entre ici, bien sûr, dans ce que le giécisme a de plus conjectural et pour tout dire, de plus fragile.
Une réflexion liminaire s’impose : WG1 convient que les climats régionaux sont peu prédictibles, en dehors de quelques tendances très générales. La montée du niveau des mers par rapport à la terre ne devrait pas tourner au tsunami généralisé. Les catastrophes naturelles ne sont pas imputées au réchauffement terrestre. Dès lors, comment se fait-il que pour WG2, le réchauffement tendanciel soit censé « porter atteinte à la sécurité alimentaire », « influer (négativement) sur la santé humaine » voire – bien que les degrés de confiance soient ici simplement « moyens » – « accélérer les pertes économiques » et « augmenter les déplacements de population » (les fameux « réfugiés climatiques ») ? Indépendamment de toute critique de fond, la cohérence entre WG1 et WG2 ne saute pas aux yeux.
Au-delà de cette remarque, la trame présidant aux prédictions catastrophistes de WG2 se comprend à l’aune de l’idéologie carbocentriste. Il s’agit d’appliquer à l’analyse socio-économique ce que le GIEC privilégie à propos du système climatique, à savoir le rôle déterminant du CO2 (par réchauffement interposé, en l’espèce). Dans la suite, on identifiera donc quelques objections opposables au « carbocentrisme socio-économique ». On abordera, ensuite, quelques considérations plus générales relatives à l’économie du climat.
- L’insoutenable légèreté du carbocentrisme socio-économique
Décidément à la pointe du giécoscepticisme économique, Richard S. Tol a analysé les parties que le résumé pour les décideurs de WG2, AR5 consacre à ce qu’il appelle les « quatre cavaliers de l’apocalypse climatique » : agriculture, santé, conflits et pauvreté dans les pays en développement. En l’espèce, l’auteur qualifie le discours giéciste de lourdement sujet à caution (heavily caveated)[14].
- En matière agricole, le raisonnement de WG2 est rien moins que malthusien : hausse de la population et baisse des rendements céréaliers devraient conduire à des pénuries alimentaires (il est cependant précisé « sauf adaptation » des populations menacées, ce qui est aussi essentiel que sibyllin). Ainsi donc, l’agriculture des pays en développement serait à peu près aussi vulnérable aux conditions climatiques que celle du Néolithique. Implicitement, WG2 normalise donc le sous-développement économique, seul à même d’expliquer qu’une économie agricole ne bénéficie pas des progrès institutionnels, agronomiques et technologiques des deux derniers siècles (pourtant réchauffés), favorisant entre autres la résilience aux aléas météorologiques.
- Le réchauffement climatique augmenterait le risque de conflits. L’analyse des guerres civiles et autres exactions de masse ayant ravagé nombre de pays d’Asie, d’Afrique voire d’Amérique latine, dans les années 1980-1990-2000, discrédite largement cette thèse (quand bien même ces conflits sont-ils contemporains de décennies de réchauffement). Ayant travaillé pour l’ONG Médecins Sans Frontières dans une autre vie, je peux attester que jamais cette organisation ayant opéré au cœur des principaux conflits (et massacres) du vingtième siècle finissant, n’a imputé la moindre guerre ni la moindre famine à des causes climatiques. Plus déconcertant sans doute, j’ai moi-même travaillé au cœur d’une guerre civile dont une sécheresse a favorisé la cessation – il s’agit du conflit mozambicain, 1975-1992 – indice qu’une catastrophe naturelle peut avoir des conséquences socio-politiques… bénéfiques.
- Le réchauffement augmenterait la mortalité due aux canicules (au-delà du cas des pays en développement, en l’espèce). Tol reproche à cette partie de WG2 de ne citer que des études à charge et d’occulter la réduction de mortalité liée au grand froid.
- L’imputation au réchauffement climatique d’une augmentation de la pauvreté dans des pays (déjà) pauvres est sans doute le trait le plus emblématique du carbocentrisme socio-économique. Il est intuitif que des latitudes tropicales encore plus chaudes – a fortiori si elles réchauffent beaucoup – ne sont pas une bonne nouvelle pour les populations autochtones. Mais qui est le premier responsable du surcroît de précarité qu’en concevraient ces dernières ? Le flux de réchauffement ou le stock préexistant de grande pauvreté ? Or, à moins d’imputer la pauvreté des pays les moins avancés de la planète au climat, l’impact du flux est indissociable de la prégnance du stock. Ayant vécu dans des pays pauvres, je sais combien le moindre choc socio-économique (une hausse du prix de l’essence, par exemple) peut être préjudiciable aux populations affectées. Mais l’adversité du climat n’a au mieux qu’une incidence marginale sur cet état de fait. Le problème de la pauvreté est d’abord – voire exclusivement – d’ordre institutionnel.
C’est d’ailleurs ce que montre l’économiste Daron Acemoglu au travers de ses nombreux travaux, dont l’ouvrage Why Nations Fail, the origins of power, prosperity and poverty, est représentatif[15]. Les premières lignes du premier chapitre de son opus sont on ne peut plus explicites :
« la ville de Nogales est coupée en deux par une clôture. Au nord, c’est l’Arizona. Le revenu d’un ménage moyen y est de 30 000 USD/an. La plupart des adolescents sont scolarisés et la plupart des adultes sont au moins bacheliers. En dépit de la mauvaise réputation du système de santé américain, la population est plutôt en bonne santé et son espérance de vie est plutôt élevée. (…). Les habitants jouissent de services publics que beaucoup considèrent comme donnés, tels qu’électricité, réseau téléphonique, égouts, routes, santé publique (…) et, last but not least, loi et ordre. (…). La population peut aller et venir sans craindre pour sa sécurité et sans avoir à redouter le vol, l’expropriation et tout ce qui peut menacer ses investissements dans les affaires ou l’immobilier. (…). Au sud de la clôture, quelques kilomètres plus loin, les habitants de Nogales, Sonora, ont beau vivre dans une partie relativement prospère du Mexique, le revenu moyen d’un ménage représente le tiers de celui de Nogales, Arizona. De nombreux enfants ne sont pas scolarisés et les mères de famille s’inquiètent de la mortalité infantile. Les gens ne vivent pas aussi longtemps que leurs voisins du nord. (…). Le crime est omniprésent et monter une affaire est une activité périlleuse. (…). Comment deux destins peuvent-ils être si différents ? Il n’y a pas de différence de climat ou de géographie. La différence vient de la très grande divergence des institutions, entre les États-Unis et l’Amérique latine. »
Le carbocentrisme socio-économique ne constituerait-il pas la version moderne de la théorie des climats dont Montesquieu, en particulier, pensait qu’ils réglaient l’humeur et les institutions des peuples (De l’Esprit des Lois, Livres XIV-XVII) ? Si le GIEC semble raviver cet héritage intellectuel, il le fait en transposant à l’analyse socio-économique, la même théorie des « rétroactions positives » qui fonde sa vision du système climatique. Il suffit donc de paramétrer l’intégralité d’un système politico-socio-économique, en lui déniant toute possibilité d’évolution ou d’adaptation, pour obtenir un « modèle » de ce qu’engendrerait une hausse des températures sur l’alimentation, la santé, la paix ou la pauvreté dans les pays considérés. Il y a effectivement peu de doute que dans un pays « pauvre » et sec, plus de sécheresse devrait faire plus de dégâts. Mais avec ce type de raisonnement, on démontrerait que les Syriens ayant fui leur pays à cause de la guerre civile sont des « réfugiés climatiques ». Et l’on en viendrait sans doute à s’étonner que le pays d’Israël, pourtant si proche, ait transformé le désert du Néguev en une myriade d’oasis doublée d’une pépinière high-tech. Déterminisme climatique, vraiment ?
- Que nous dit l’économie du climat ?
Supposons cependant que le changement climatique soit globalement préjudiciable à l’humanité. C’est d’ailleurs ce qu’entérine la prospective économique, au travers de plusieurs modèles. Ainsi, un réchauffement non régulé de la planète serait associé à une perte de 3,6% du PIB mondial d’ici 2100[16]. Ce chiffre recoupe un ordre de grandeur fréquemment rencontré en prospective éco-climatique[17]. Je dois à l’honnêteté de dire que je n’accorde pas beaucoup de valeur probante à ce type d’évaluation. Certes, la prospective économique procède d’un exercice de haute volée intellectuelle ; les travaux de William Nordhaus (Prix Nobel d’économie 2018), en particulier, s’appuient sur une conceptualisation et une méthodologie aussi rigoureuses que possible. Imaginons cependant le prospectiviste de 2020 livrant ses prédictions de PIB mondial pour 2025 : notre cartomancien rationaliste aura-t-il songé à intégrer COVID 19 et guerre russo-ukrainienne dans son modèle ? Je laisse au lecteur le soin d’imaginer ce qu’il en sera d’ici 2100. Cela dit, tout argumentaire ne pouvant que composer avec ce dont il dispose, force est de constater que la prospective éco-climatique n’avalise pas l’éco-catastrophisme même si Richard Tol précise opportunément que si surprise climatique il devait y avoir, elle serait vraisemblablement mauvaise (cela renvoie au « risque » évoqué en première partie de ce double article).
Quelques évolutions économiques incitent cependant à un relatif optimisme : la principale vient sans doute de la croissance économique prospective de nombre de pays pauvres. Celle-ci devrait être largement supérieure à celle des pays riches, comblant progressivement le fossé entre pays en développement et pays de l’OCDE. Or, l’index de performance environnementale de l’Université de Yale (voir https://bit.ly/3EpxFhr) confirme que développement économique et excellence environnementale sont positivement associés. En somme et à rebours des prédictions souvent inquiétantes de WG2 à leur endroit, les pays en développement devraient augmenter à la fois leur performance et leur résilience environnementales.
Autre pierre dans le jardin de l’écologisme radical, Lomborg (2020, op. cit.) fait avantageusement remarquer que le coût évalué des catastrophes climatiques n’est jamais que la contrepartie de la richesse accumulée par le processus de développement économique, également concomitant d’une densification de la population sur les côtes et dans les villes. En somme, tenir la croissance économique pour responsable d’un réchauffement catastrophique comporte une part tautologique : il n’y aurait pas de « catastrophe » si la croissance, condition nécessaire (mais non suffisante) du développement économique, n’était justement à l’origine des richesses et populations susceptibles d’être affectées.
Dernier point particulièrement préoccupant, ressortant du papier très argumenté de Lomborg : le coût des politiques climatiques excèderait leurs bénéfices. Cela viendrait notamment d’un empilement incohérent de politiques publiques, le subventionnement des énergies renouvelables entraînant, par exemple, une baisse de la demande de quotas d’émission carbone sur le marché européen (ETS), donc une baisse du prix réglementé du carbone. Le rapport coût-bénéfice des accords de Paris serait particulièrement défavorable : selon Lomborg, ces accords n’élimineraient qu’1% de la quantité de CO2 devant cesser d’être émise pour limiter le réchauffement à 1,5°C d’ici 2100 (objectif idéal des accords de Paris), pour un coût de 1 000 à 2 000 milliards d’USD par an. Selon cet auteur, les politiques climatiques n’ont aucune chance d’arriver à leurs objectifs – excessivement ambitieux – sans devoir assumer un coût social très élevé. L’écologisme radical peut d’ailleurs prendre prétexte de ce diagnostic pour pousser à la roue d’un « quoi qu’il en coûte » vert, seul à même d’inverser la tendance haussière des émissions internationales de CO2, lesquelles continuent effectivement d’augmenter au rythme de 2% l’an, environ. La dernière partie de cet article donne peu de foi à cette (redoutable) espérance.
3. Et la France dans tout ça ? Quelques considérations sur la politique climatique nationale
- Une décarbonation lourde d’hypothèques
Dans la droite ligne des accords internationaux dont elle est signataire, la France ambitionne d’atteindre la « neutralité carbone » d’ici 2050. Cet objectif est naturellement en ligne avec le « Pacte vert » et le « Paquet climat » de l’Union européenne, dont on connaît le volontarisme climatique. Précisons que la neutralité carbone n’implique pas de réduire les émissions de GES à zéro mais d’atteindre un équilibre entre sources d’émission et pouvoir absorbant des puits de carbone (végétation, forêt et zones humides). Pour cela, l’action du gouvernement français s’appuie sur une double feuille de route : la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Les axes prioritaires de cette politique de décarbonation résident en la rénovation/modernisation thermique des logements, l’électrification du parc de voitures individuelles, le développement des énergies renouvelables au détriment du charbon et même du nucléaire. La transition énergétique s’appliquera à l’industrie, l’agriculture, l’immobilier résidentiel/professionnel ainsi que les transports, impactant en profondeur la vie des Français. Son coût est d’autant plus difficile à évaluer qu’il agrège des mesures et des acteurs très disparates. Il est également fréquent de confondre « coût » et « dépenses d’investissement ». En restant volontairement approximatif, les dépenses liées à la transition énergétique devraient se situer dans une fourchette 45-145 milliards d’euros par an d’ici 2030 (https://bit.ly/3Mmbpak).
Le problème du financement public se posera donc avec d’autant plus d’acuité qu’on le sait, les finances publiques sont exsangues et le contexte économique post crise sanitaire, tendu. Certaines des conséquences attendues de la transition énergétique s’avèrent, de surcroît, redoutables :
- En premier lieu, un renchérissement potentiellement considérable de la facture énergétique, du fait de l’exploitation prématurée de technologies immatures (photovoltaïque et éolien voire biomasse) ; on peut se demander comment un pays dont le pouvoir d’achat a constitué le thème majeur de la dernière campagne présidentielle pourra, compte-tenu du retour de l’inflation et de la chronicité de ses déficits publics, assumer une telle ambition. D’autant qu’au renchérissement de la facture énergétique des Français, s’ajoutera le problème du prix du logement, dont la construction est déjà rationnée pour des raisons écologiques (limitation des permis de construire). Même en admettant que la rénovation/modernisation thermique augmente le rapport qualité/prix des appartements à coût marginal nul, le ticket d’entrée des ménages dans la location et l’acquisition devrait demeurer élevé.
- En second lieu, la généralisation des véhicules électriques entraînera une pression haussière sur les capacités de production d’électricité, alors même que la stratégie énergétique nationale entend réduire la part du nucléaire dans cette dernière ; une relégation d’autant plus surprenante qu’il s’agit d’une technologie faiblement émettrice de CO2, expliquant largement que notre pays soit l’un des plus écologiquement vertueux du Monde, selon l’Index de Performance Environnementale de l’Université de Yale.
La planification écologique ne se laisse pas si facilement ébranler par le principe de réalité socio-économique. La communication gouvernementale insiste au contraire sur ce que sa batterie d’objectifs quantitatifs et autres outils d’intervention réglementaires ont de salutaire. L’argument relève classiquement du multiplicateur keynésien : la transition énergétique créera des emplois (croissance verte) et les économies d’énergie enrichiront les Français, qui réinjecteront ce pouvoir d’achat supplémentaire dans l’économie (https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc). Il est toujours étonnant de voir l’argument keynésien brandi et rebrandi dans un pays ayant fait de la fuite en avant dans la dépense publique, un projet de société concomitant d’une baisse tendancielle de son taux de croissance[18]. Au lieu d’une opportunité de croissance d’autant moins certaine que la France ne maîtrise guère les technologies qu’elle entend promouvoir, on ne peut exclure que la transition énergétique invente une économie de guerre en temps de paix, précipitant la destruction prématurée de tout un capital, matériel, immatériel, humain investi dans la production carbonée et justifiant la persistance une inflation élevée, c’est-à-dire un impôt subreptice sur l’épargne des Français, permettant d’alléger le poids la dette publique. Car si les énergies renouvelables – solaire, éolien, hydrogène, fusion nucléaire, etc. – représentent un portefeuille de technologies d’avenir bienvenues en elles-mêmes, rien ne dit qu’elles seront opérationnelles en temps administratif voulu, le problème se posant pareillement à propos des batteries automobiles. Remettre notre approvisionnement électrique et nos modes de transport entre les mains d’une planification qui, sous couvert de bonnes intentions, convoque le futur dans le présent à marche réglementaire forcée, est donc gros de déconvenues socio-économiques majeures.
De manière générale, la sensibilité croissante des populations aux questions écologiques ou l’investissement des entreprises dans l’innovation énergétique sont une bonne chose. Consommateurs, opérateurs privés et startups constituent donc la meilleure chance de succès d’une évolution énergétique dont certaines perspectives sont salutaires : il est évident qu’une production efficiente d’électricité renouvelable représenterait un progrès considérable pour l’humanité. Mais mieux vaut orchestrer la transition énergétique au pas de l’économie de marché qu’à celui de la bureaucratie publique. Il faut surtout souhaiter que la transition énergétique ne prenne pas un tour idéologico-punitif, intensifiant la guerre sourde dont sont déjà victimes les automobilistes « thermiques » ou stigmatisant l’individualisme du goût résidentiel français, au profit d’une politique concentrationnaire du logement.
- Le problème de l’élasticité-carbone
Il est une question que le débat public pose rarement, voire jamais : quelle peut être la contribution des politiques climatiques nationales à l’arrêt du processus de réchauffement terrestre ? Limitons la question au cas de la France même si on pourrait l’étendre à l’ensemble des pays de l’Union européenne, cette dernière ambitionnant d’être un phare climatique dans la nuit carbocentriste. L’efficacité des politiques climatiques renvoie au « budget carbone » dont dispose l’humanité (et donc, chaque pays) pour rester dans la fourchette de 1,5°C de réchauffement global, à l’horizon 2100. Ce budget carbone fait, sans surprise, l’objet des modélisations les plus variées, conduisant à diverses estimations du droit de tirage carbonique restant à l’humanité pour « rester nettement en-dessous » de 1,5°C, avec 66% de probabilité (https://bit.ly/3V8xKfn). Si ces modèles accouchent d’estimations variant schématiquement d’un facteur 5, il semble qu’ils intègrent des hypothèses quant au profil d’émission des GES autres que le CO2, ce qui leur permet de raisonner en Gt CO2 plutôt qu’en Gt CO2 éq (équivalent carbone)[19]. C’est important car les premières sont, semble-t-il, mieux connues/mesurées que les secondes (inévitablement plus complexes). Ainsi le Monde émet-il environ 40 Gt CO2/an, dont 0,33 pour la France (0,8% des émissions mondiales). Le site Carbon Brief (lien précédent) retient comme estimation raisonnable du budget carbone mondial, le chiffre de 416 Gt CO2, soit 10 ans d’émissions globales.
Cette donnée (très conjecturale) permet d’envisager le calcul grossier d’une élasticité-carbone : combien de gigatonnes de CO2 faut-il s’abstenir d’émettre pour obtenir un arrêt – ou un ralentissement significatif – du processus de réchauffement ? L’élasticité-carbone renvoie aux notions giécistes de « sensibilité climatique » ou de « réponse transitoire du climat » (effet, sur le réchauffement à long et court terme, d’un doublement de la concentration atmosphérique de CO2). Ces notions donnent cependant une élasticité trop vague pour être directement utilisable.
Admettons que la température moyenne du globe se soit réchauffée de 1,2°C depuis l’ère pré-industrielle. Nous ne disposons donc plus que de 0,3°C de crédit thermique pour rester dans l’objectif des 1,5°C (en acceptant de l’atteindre plutôt que de rester nettement en-dessous). Puisque l’humanité dispose de 416 Gt CO2 avant de toucher cette cible fatidique, cela signifie qu’une émission de 139 Gt CO2 est nécessaire à un réchauffement de 0,1°C. Voilà ce que pourrait être l’élasticité carbone, laquelle suppose que la température du globe soit une fonction linéaire (affine, ici) des émissions de CO2.
Faisons maintenant une dernière supposition : conformément à ses objectifs, la France atteint la neutralité carbone en 2050. Pour simplifier, on admet que nos émissions annuelles de CO2 restent stables pendant 30 ans et deviennent brusquement nulles en 2050 ; cette approximation surestime naturellement le chiffre réel des émissions cumulées sur la période 2020-2050. La France économiserait alors 9,9 Gt CO2 soit… 7% de 0,1°C de réchauffement (ou 2,4% du budget carbone mondial). En me livrant à des calculs (de coin de table) prenant d’autres données – les plus sévères que j’ai pu estimer – j’obtiens un chiffre de 20% de 0,1°C de réchauffement, toujours en misant sur un profil d’émissions (d’équivalent carbone, cette fois) largement surestimé.
Moralité : la politique climatique de la France n’aura aucune incidence sur le processus de réchauffement, sauf à ce que notre pays se pique de devenir un absorbeur net du CO2 mondial. Au regard des coûts et des risques liés à la transition énergétique et en considérant que la France est déjà un excellent élève sur le front de l’écologie, il semble plus raisonnable de concentrer l’action publique sur les problèmes bien réels qui affectent chroniquement le bien-être du pays : sans prétention à l’exhaustivité, l’état de notre système de santé, de notre défense nationale, de notre justice ou de notre système d’éducation.
Une manière habile de contourner le problème assurément désagréable de l’élasticité-carbone revient à recourir à la notion de « justice climatique ». Chaque habitant de la planète émettant entre 5 et 6 tonnes de CO2/an (les Français étant plutôt entre 4 et 5), il appartiendrait de répartir l’effort, voire d’en demander un peu plus aux habitants des pays riches. Mais cette manière de raisonner est un déplacement des buts, emblématique de la dimension religieuse aujourd’hui prise par la question climatique. Quelle est l’idée directrice ? Expier le péché que constituent nos émissions de CO2 ou contenir le réchauffement terrestre dans des bornes considérées comme acceptables ? Si ce dernier objectif prévaut, force est de constater que l’Union européenne pourra mener toutes les politiques de transition énergétique qu’elle veut, sans parvenir à contribuer significativement à l’objectif rêvé.
Conclusion
Dès lors, si le principe de précaution s’impose à quelque chose, c’est à notre interprétation de la question climatique. Mon sentiment général est le suivant : le GIEC procède bel et bien d’un projet politique qu’il faut envisager en tant que tel. Pour autant, la climatologie mainstream avance une batterie d’arguments solides à l’appui de sa thèse carbocentriste. Le simple fait que la Terre se réchauffe anormalement et que la concentration atmosphérique de CO2 continue d’augmenter, me semble constituer un facteur de risque climatique : toute nouveauté l’est, qui affecte notre environnement naturel et institutionnel. Il n’est donc pas plus rationnel de s’inquiéter de la conjoncture climatique que d’un régime monétaire international affranchi de l’étalon-or, de politiques monétaires « non conventionnelles » ou de déficits publics chroniques historiquement élevés en temps de paix, autant de caractéristiques saillantes – et originales – de l’ordre économique mondial, contemporain de ces dernières décennies (réchauffées).
La gestion du risque climatique n’implique aucune urgence dont la politique publique devrait s’emparer « quoi qu’il en coûte ». Les conséquences actuelles du réchauffement sont négligeables et la dystopie climatique n’inspire aucune espèce de consensus scientifique, quand bien même ne saurait-elle être ignorée. L’estimation prospective des conséquences économiques du réchauffement reste mesurée ; rien ne dit qu’elles s’avèrent plus coûteuses que les (éventuelles) pandémies, crises financières et autres conflits menaçant notre prospérité. Et en tout état de cause, l’épargne, l’innovation et la dynamique de l’économie de marché constituent le plus sûr bouclier opposable aux manifestations de ce qui nous inquiète.
Par ailleurs, la diabolisation du CO2 me semble recéler… une contradiction à long terme. Si l’évolution du climat dépend bel et bien d’un jeu à somme non nulle entre facteurs réchauffants et refroidissants, qu’en adviendra-t-il une fois atteinte la « neutralité carbone » ? On l’a dit, l’inertie du CO2 dans l’atmosphère diffèrera les effets « refroidissants » de cette dernière. Et après ? Tout porte à croire que, privé d’émissions réchauffantes, la planète refroidira. Est-ce mieux pour les fameuses « générations futures » ? Le débat public donne parfois l’impression d’un climat corrompu par la main de l’homme, nécessitant que des Justes animés de folles ambitions thermostatiques, se dressent pour sa cause. Mais le « climat » – la Terre, en vérité – ne cesse de refroidir et réchauffer. Il n’est pas anodin, de ce point de vue, que la mesure du réchauffement de ces (presque) deux derniers siècles soit évaluée à partir de 1850, année terminale du petit âge glaciaire, lorsque la température était froide et la concentration atmosphérique de CO2,faible. Il est toujours douteux de qualifier une évolution à partir d’un point de départ trop haut ou trop bas. Or, après tout, nos émissions de CO2 ne sont pas moins naturelles qu’autre chose, sauf à concevoir la zoologie humaine comme extérieure à la « nature » (aporie dont procède l’écologisme radical). L’espèce humaine n’est pas « non naturellement » anthropique, elle est naturellement entropique : ses considérables besoins sont à la hauteur de son ingéniosité, laquelle modifie en profondeur son environnement (rappelons que la notion même d’environnement est anthropo-centrique : l’environnement est ce qui « nous » entoure). Et la quête de notre espèce est inexorable : consentir beaucoup d’effort pour plus de confort et moins de peine. Dès lors, le meilleur service que l’humanité puisse se rendre à elle-même, consiste à décarboner au rythme de ses besoins ; tout indique que c’est d’ailleurs ce qu’elle fera. Cela pourrait venir rapidement : il a fallu peu de temps pour trouver une parade pharmaceutique à l’épidémie de Covid 19. Peu d’années nous séparent peut-être d’une production pleinement opérationnelle d’énergies renouvelables, à même de concurrencer des fossiles devenus plus chers. En tout état de cause, agissons au rythme de la Raison, plutôt que de l’exaltation idéologique. Et, en attendant, adaptons-nous à ce qu’il est raisonnable d’inférer du risque climatique.
[1] La première partie de ces Réflexions a été publiée dans le numéro 17, été 2022.
[2] Hélène Guillemot (2014), « Les désaccords sur le changement climatique en France : au-delà d’un climat bipolaire », Natures, Sciences Sociétés, 22, p. 343.
[3] Lionel Scotto d’Apollonia (2014), « Les controverses climatiques : une analyse socioépistémique », thèse de doctorat en sociologie, Université Paul Valéry, Montpellier III.
[4] J’ai identifié des réticences comparables à propos des États-Unis. Cela viendrait en partie d’un processus de recherche plus lent, aux résultats moins spectaculaires.
[5] C’est explicite dans la préface du résumé technique de WG1 (p. viii) : « Le rapport du Groupe de travail I est une évaluation, et non un inventaire ou un manuel de climatologie ».
[6] Thomas S. Kuhn (1972), La structure des révolutions scientifiques, Flammarion, Paris.
[7] Terme que je préfère à celui de « négationnisme ». Ce dernier est plus souvent rencontré mais il me semble manquer de pertinence, voire de décence (rappelons que le négationnisme qualifie habituellement la remise en cause des crimes contre l’humanité commis par l’Allemagne nazie).
[8] Sur ce besoin de régulation, voir R. S. J. Tol (2010), “Regulating knowledge monopolies: the case of the IPCC”, ESRI Working Paper, N° 350.
[9] F. Janko, N. Moricz, J. P. Vancso (2017), “Is climate change controversy good for science? IPCC and contrarian reports in the light of bibliometrics,” Scientometrics, juin, DOI 10.1007/s11192-017-2440-9.
[10] John Cook et al. (2013), “Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature,” Environmental Research Letters, 8(2) (http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024).
[11] Richard S. J. Tol (2014), “Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature: a re-analysis,” Energy Policy, 73, p. 701-705.
[12] Je tire cette sentence de l’article de Wikipédia francophone dédié à la controverse climatique (https://bit.ly/3fKhgK9). Sur le consensus, l’article de Wikipedia commet plusieurs erreurs (idéologiquement orientées dans un sens mainstream) : (1) il ne fait pas référence à l’article originel de Richard Tol ; (2) il confond « neutralité » et « vote contre » ; (3) il reproche à Tol d’avoir élargi l’échantillon de Cook à des « non experts », ce qui est un comble quand on sait que l’article de Cook mesure une partie du consensus à l’aune de ce qu’en disent des économistes tandis que celui de Tol inclut des papiers scientifiques écrits par des océanologues… Qui est le plus à même de donner un avis éclairé sur les causes du changement climatique ?
[13] Voir, par exemple, le rapport « Climate Change Resconsidered » produit par le Heartland Institute (https://bit.ly/3eksG7b)
[14] R. S. Tol (2016), “The impacts of climate change according to the IPCC,” Climate Change Economics, 7(1), p. 1-20
[15] Ouvrage écrit avec James A. Robinson (2013), Profile Books Ltd, Londres.
[16] Voir Bjorn Lomborg (2020), “Welfare in the 21st century : Increasing development, reducing inequality, the impact of climate change and the costs of climate policy,” Technological Forecasting and Social Change, 56, 119981, 35 pages.
[17] Pour une synthèse un peu datée, voir R. S. Tol (2009), “The Economic Effects of Climate Change,” Journal of Economic Perspectives, 23(2), p. 29-51.
[18] Sur ce thème, voir les articles que j’ai produits pour l’Institut Molinari et notamment https://bit.ly/3V5R8K9.
[19] Gt = gigatonne (milliard de tonnes de CO2 ou d’équivalent CO2).