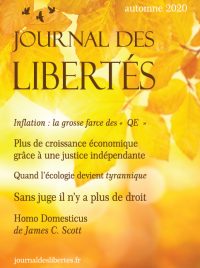Voilà de nombreuses années que l’ensemble des professionnels dénonce la lente agonie du système judiciaire français.

Magistrats, Greffiers, personnel de greffe, Avocats, Universitaires… tous s’accordent à dire que la justice est maltraitée depuis des décennies et que l’État ne lui donne plus les moyens d’assurer son rôle régalien au sein de notre République.
Notre système démocratique est pourtant fondé sur l’équilibre des pouvoirs. Si la Constitution de la Vème République ne parle pas de pouvoir judiciaire mais d’autorité judiciaire il s’entend que, sans juge pour trancher les différends, faire respecter la loi et l’appliquer, il ne peut y avoir de véritable démocratie. La période liée à l’état d’urgence sanitaire a manifesté de manière funeste un déclin objectif de l’état de droit que les quelques exemples exposés succinctement ci-dessous veulent illustrer.
1 : Le juge administratif face à la crise COVID
Le rôle du juge dans la société française est marqué par une exception notable née des principes napoléoniens : le juge judiciaire s’occupe des intérêts privés et de ceux de la société en matière pénale alors que le juge administratif (Tribunal administratif, Cour administrative d’appel et Conseil d’État) tranche les litiges entre administrations ou entre les particuliers et l’administration, les collectivités locales ainsi que l’État.
Dans un système dans lequel l’État et d’une manière générale les personnes de droit public ont une telle importance à la fois économique et juridique, le pouvoir des juges administratifs s’est accru ces dernières décennies et il faut reconnaître que l’État a mis les moyens dans le fonctionnement de la justice administrative notamment par la création de Tribunaux administratifs et de Cours administratives d’appel ou encore le maintien du pouvoir juridictionnel important du Conseil d’État.
Des procédures ont par ailleurs été mises en place, notamment le référé liberté qui permet en cas d’urgence d’obtenir de la juridiction administrative des décisions et surtout des injonctions faites aux administrations.
Mais pour le modeste praticien de base, qui reconnait volontiers la qualité des décisions des juges administratifs, nous nous heurtons de manière systématique à une forme d’ambiguïté, de crispation, de sentiment que les juges administratifs sont constamment sur une ligne de crête difficile à tenir notamment par vent mauvais ou tempête.
Il est difficile de sortir de l’idée, même s’il ne s’agit pas ici de dire que les juges administratifs manquent d’indépendance, que leurs pouvoirs sont en réalité limités au fait qu’ils ne jugent de la légalité des décisions administratives qui leur sont soumises qu’à l’aune de la règlementation qui elle-même d’une manière générale naît des règles édictées par l’autorité règlementaire, le gouvernement, l’administration.
A. L’exemple du droit au respect de la vie et aux soins
Lorsqu’on s’intéresse aux décisions du Conseil d’État, on découvre un raisonnement certes subtil, très équilibré, toujours très républicain mais donnant le sentiment parfois d’être « du côté » du gouvernement, de la puissance publique.
Si, faisant preuve de courage, le juge des référés du Tribunal administratif de la Guadeloupe par une ordonnance du 27 mars 2020 a enjoint au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe sur le fondement de l’article L 521.2 du code de justice administrative de passer des commandes de doses nécessaires au traitement de patients atteints de Covid_19 par hydroxy-chloroquine et azithromycineainsi que des tests de dépistage du Covid_19 en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de l’ archipel guadeloupéen dans le cadre définit par le décret du 25 mars 2020, le juge d’appel du Conseil d’État a été beaucoup plus protecteur de l’État.
Ainsi, si la décision 04.04.2020 n°439904439905 du juge des référés du Conseil d’État réaffirme qu’au sens de l’article L521.2 du code de justice administrative le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale, et qu’une carence caractérisée d’une autorité administrative dans l’usage des pouvoirs que lui confère la loi pour mettre en œuvre le droit de toute personne de recevoir sous réserve de son consentement libre et éclairé les traitements et les soins appropriés à son état de santé donne compétence au juge des référés de faire usage des pouvoirs d’injonction qu’il tient de ces dispositions, il réforme pourtant l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif, au motif qu’elles (les substances) ne pouvaient être administrées dans le cadre de dispositions réglementaires pourtant contestées issues de l’article 12.2 du décret du 23 mars 2020 ou dans celui de l’un des essais cliniques autorisés.
Le Conseil d’État affirme que le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale tout comme l’est sa conséquence à savoir le droit à l’accès aux soins, mais il admet aussi que l’accès aux soins peut être limité par une autre décision administrative…
En clair on pourrait imposer à l’État de permettre aux patients – au titre du droit à l’accès aux soins – d’être traités par l’hydroxy chloroquine, mais on ne le fait pas puisque le ministre l’interdit !
B. L’exemple de la liberté de culte
Le ministre Christophe Castaner a affirmé le dimanche 3 mai 2020 sur RTL : « la prière n’a pas forcément besoin de lieu de rassemblement » (sic). Dans cet esprit, le gouvernement a suspendu de facto la liberté de culte.
Conscientes du risque sanitaire, les religions se sont généralement pliées aux mesures prises mais il est à noter que peu d’évêques ont osé évoquer, alors même qu’ils appelaient au civisme républicain, qu’il s’agissait là d’une grave mesure suspendant une liberté publique fondamentale.
Saisi par des associations cultuelles, le Conseil d’État va heureusement réaffirmer que la liberté de culte était bien une liberté fondamentale qui ne pouvait être encadrée qu’en tenant compte notamment du principe de proportionnalité. Et, en effet, le juge des référés, dans sa décision du 18 mai 2020 n°440366, va estimer que le gouvernement a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte. Et il lui enjoint sous 8 jours de permettre, sous condition, le libre exercice du culte. Sage décision qui laisse pourtant un goût amer ; mais la symbolique est préservée.
Le Conseil d’État s’est par ailleurs, dans ces périodes complexes, illustré par un manque de courage assez frappant alors qu’il a été saisi, en vain, de la validité d’une circulaire du 26 mars 2020 et d’un courrier du 27 mars 2020 du Ministère de la justice relatif à la prolongation de plein droit et sans juge de la détention provisoire (arrêts du CE du 3 avril 2020 n° 439894, n° 439877, n°439887, n°439890, n°439898).
2 : Dans ce contexte de crise le gouvernement a, une fois de plus, affaibli le rôle du juge judiciaire
Dans un État de droit serein, le principe de présomption d’innocence est fondamental : toute personne qui n’a pas encore été définitivement jugée est présumée innocente. Elle ne peut donc être détenue de manière provisoire que dans le cadre de règles strictes.
Depuis plus de 20 ans ce n’est plus le juge d’instruction qui prononce une mesure de détention provisoire mais le juge des libertés et de la détention (dans le cadre des dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale) à savoir si cette détention est l’unique moyen de parvenir à un certain nombre d’objectifs fixés par la loi. Par ailleurs le juge doit automatiquement réexaminer la situation, et ce même en l’absence de demande de la personne incarcérée. En matière correctionnelle, la détention provisoire n’est prononcée que pour une durée de 4 mois et peut être reconduite pour la même durée sous certaines conditions. Ainsi une personne accusée d’un délit est-elle présumée innocente et ne peut être détenue que pour une période de 4 mois renouvelable après qu’un juge ait à nouveau statué sur sa situation.
Dans une démocratie élaborée, dans un État de droit digne de ce nom, lorsqu’il est impossible pour des raisons, même de force majeure, de présenter une personne détenue à son juge, ou de maintenir en détention une personne du fait de l’expiration du délai maximum au terme duquel elle peut être incarcérée, il est de principe que la liberté s’impose et que la personne doit être élargie. Dans un état de droit on n’applique jamais une sanction plus sévère de manière rétroactive.
Nous sommes les premiers à dénoncer tel ou tel régime autoritaire qui maintient en détention des personnes sans rencontrer un juge.
Ce qui paraît inconcevable a pourtant été mené à bien par la Ministre de la justice puisque dans le cadre de la loi 2020.290 du 23 mars 2020 qui a habilité le gouvernement à adopter par voie d’ordonnance des modifications importantes de notre droit, les délais maximums de détention provisoire et d’assignation à résidence ont été prolongés de plein droit de 2 mois lorsque la peine encourue était supérieure à 5 ans et de 3 mois lorsque la peine encourue était de nature criminelle.
Ainsi la République française a affirmé que, en l’état de panique organisationnelle dans laquelle été la justice et du risque d’incapacité de présenter une personne présumée innocente à un juge en vue de son éventuelle détention, il pouvait y avoir par simple ordonnance législative sur habilitation du parlement, une prolongation de 2 mois d’une détention sans qu’un juge n’ait à statuer.
On voit bien la tendance naturelle du gouvernement qui, au motif de propagation de Covid_19, a imaginé de prolonger les détentions de personnes présumées innocentes, et on ne voit pas le rapport avec la propagation du virus. On constate surtout avec amertume le manque de respect pour des principes essentiels de nos règles de procédure pénale.
La Cour de cassation par contre dans 2 décisions du 26 mai 2020 a rappelé heureusement nos principes républicains et a clairement indiqué que cette prolongation de détention sans juge méconnaissait des exigences de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, même si elle n’indique pas que toutes les prolongations automatiques seraient contraires au droit européen. L’honneur est sauf…
3. Misère de notre justice judiciaire
Mais le constat est d’une tristesse infinie, la misère de notre justice judiciaire est telle que nous sommes prêts désormais à renoncer à l’accès au juge par manque de moyens, par peur de l’inconnu, de la maladie, du Covid_19, par manque de masques, par manque de gels, par manque…
C’est d’ailleurs ce que notamment la profession d’avocat mais aussi la magistrature ont dénoncé tout au long des années 2019 et 2020 dans le cadre de la réforme de la justice avec la transformation des tribunaux de grande instance en tribunaux judiciaires et la spécialisation des juridictions.
Là encore, la profession d’avocat avait réaffirmé que dans notre système de droit, deux notions étaient importantes :
- La plénitude de juridiction,
- Le maillage territorial.
Plénitude de juridiction, cela veut dire qu’au sein d’un même Tribunal toutes les matières doivent et peuvent être traitées. C’est l’idée d’ailleurs que les juridictions d’exception qui traitent des matières spéciales ou spécialisées sont contraires aux principes démocratiques.
Le maillage territorial consiste à rappeler que la justice doit être égale pour tous et prononcer de manière identique sur l’ensemble du territoire, d’où l’organisation territoriale de la justice en 164 tribunaux répartis sur l’ensemble du territoire national.
Par la spécialisation des juridictions, par les difficultés et les complexités procédurales qui sont multipliées par le gouvernement, l’accès au juge pour le citoyen ordinaire est devenu de plus en plus difficile et l’affectation de telle ou telle matière dans un tribunal plutôt qu’un autre peut dévitaliser totalement une juridiction et à terme permettre sa fermeture. C’est la question des déserts juridiques et judiciaires au sein de nos territoires.
Au total – et de nombreux auteurs, philosophes et universitaires l’ont souligné bien mieux que moi – le printemps 2020 aura démontré combien notre démocratie est fragile. Face à un gouvernement pris d’angoisse et de panique, et utilisant tous les ressorts juridiques, les autorités judiciaires se sont retrouvées bien souvent démunies.
Une seule excuse : la gravité du moment et la volonté de bien faire que nul ne conteste. Il n’en demeure pas moins que tous les citoyens se doivent d’être vigilants.
 Jérôme Gavaudan est avocat au barreau de Marseille, dont il a été bâtonnier (2011-2012). Il a été élu en 2018 Président de la Conférence Nationale des Bâtonniers (2019-2020). Il a alors participé à la création du Collectif SOS Retraites pour défendre devant la Commission Delevoye l’autonomie des Caisses des Professions libérales. Il est ancien vice-président du Conseil National des Barreaux. Il a participé à de nombreux travaux, colloques et publications en droit du travail.
Jérôme Gavaudan est avocat au barreau de Marseille, dont il a été bâtonnier (2011-2012). Il a été élu en 2018 Président de la Conférence Nationale des Bâtonniers (2019-2020). Il a alors participé à la création du Collectif SOS Retraites pour défendre devant la Commission Delevoye l’autonomie des Caisses des Professions libérales. Il est ancien vice-président du Conseil National des Barreaux. Il a participé à de nombreux travaux, colloques et publications en droit du travail.