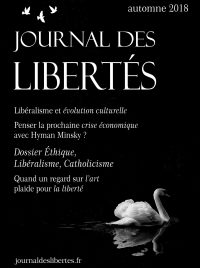Fin août dernier, lors de la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, au fin fond du Wyoming (Etats-Unis), Jay Powell montrait une grande sérénité. L’actuel président du Système de Réserve Fédérale (Fed) se glorifiait en ces termes : « L’inflation est proche de notre objectif de 2 % ». Et il ne manquait pas de confirmer sa détermination à continuer de hausser les taux d’intérêt du Fed. En clair, ce Powell qui paraissait être l’homme lige du Président Trump, nommé à ce poste pour conduire une politique monétaire « accommodante », affichait son indépendance à l’égard de la Maison Blanche. Nous étions donc rassurés !
Eh bien non ! Car, comme le démontre Brendan Brown dans son dernier livre, The Case Against 2 per cent Inflation, cet objectif de 2 %, aujourd’hui à la base de pratiquement toutes les politiques monétaires, non seulement n’a aucun sens, mais encore risque-t-il de nous conduire, s’il est maintenu, à une nouvelle catastrophe. De fait, ils sont toujours d’actualité, les fameux « coups de wiskey » à la cote qu’administrait en 1927 (deux ans avant le krach géant de 1929) Benjamin Strong, le lointain prédécesseur de Jay Powell à la tête du Fed.
Le bon sens est souvent trompeur. Mais ici il devrait inciter les esprits les moins curieux à se poser la question : pourquoi limiter la hausse des prix à 2 % ? pourquoi pas 1 % ? 0 % ? 3 % ? D’où nous vient donc ce fétiche, encore plus mystérieux – et certainement moins palpable – que celui que Keynes croyait voir dans l’étalon-or ? L’origine, il faut la chercher, nous dit Brown, en Nouvelle-Zélande dont la banque centrale à la fin des années 1980 a été la première à renoncer pour de bon au contrôle quantitatif de la masse monétaire – pour la simple et bonne raison qu’il était impraticable. Comme par hasard, la Nouvelle-Zélande est la patrie de l’inventeur des courbes de Phillips (1958) ; cette calamiteuse trituration de statistiques, mettant en relation inverse taux de chômage et hausse des prix, a fait croire à des générations d’économistes, et de politiciens trop heureux de les suivre sur ce chemin irénique, que l’on pouvait lutter contre le chômage par l’inflation.
Brown, en fidèle disciple de l’école autrichienne, rend compte magnifiquement de la manière étonnante dont le nouveau standard de l’inflation à 2 % s’est répandu en un quart de siècle sur la surface de la terre, y compris dans les pays les plus rétifs aux facilités de la planche à billets. Ainsi consacre-t-il un chapitre entier à ce qu’il nomme à juste titre l’abdication monétaire de l’Allemagne au moment de la création de l’euro ; chapitre qui est non seulement un régal de précision historique, mais répond aussi de manière cinglante aux démagogues de gauche ou de droite qui osent nous parler d’une férule germanique se servant de la Banque Centrale Européenne pour asservir l’Europe. Dans le duel Merkel-Draghi qu’il met en scène magistralement, c’est l’habile banquier italien qui l’emporte sur la chancelière allemande, laquelle se montre finalement incapable de lui résister. Un autre chapitre est fort utilement consacré à l’un des aboutissements du nouveau standard qui a défrayé la chronique : les taux d’intérêt négatif, une absurdité qu’il faut toute l’impudence des banquiers centraux pour nous faire avaler comme une potion magique.
Le 2 % Standard est en fait le dernier avatar d’un système monétaire qui va à vau-l’eau depuis que le monde a rompu le lien de la monnaie avec l’or en août 1914. Cet avatar a le redoutable inconvénient de bloquer la baisse des prix des biens de consommation qui devrait survenir en ces moments de progrès technique et d’ouverture des marchés. Car la déflation est considérée par les princes qui nous gouvernent comme un fléau redoutable qu’il faudrait combattre avec la dernière énergie – double erreur de diagnostic et de médecine partagée encore aujourd’hui hélas ! par la très grande majorité des économistes, et particulièrement par ceux qui sont proches des gouvernants.
Ainsi un nouveau type d’inflation est en train de ronger le pouvoir d’achat de notre porte-monnaie, encore plus insidieuse que la hausse des prix ordinaire parce que, pour reprendre l’expression de l’auteur, elle est camouflée. D’autant plus camouflée que la hausse flamboyante des actifs (bourse, immobilier) accapare toute l’attention des naïfs qui jugent du succès d’une politique par ce qui se passe à la corbeille – comme c’est le cas actuellement pour Trump – jusqu’à ce que la bulle éclate.
Supposons que les prix de biens et services doivent baisser en moyenne de 3 à 4 % à cause des progrès techniques et de la concurrence mondiale. Du fait de la politique monétaire des banques centrales, la hausse de ces mêmes prix s’affiche à 1 %. Le rythme de l’inflation camouflée est donc de 4 à 5 %. Il sera encore plus élevé si les banques centrales atteignent leur objectif de 2 % – ce qui maintenant ne saurait tarder. Un des lieux communs de la critique de l’économie de marché, qui est asséné pratiquement tous les jours dans les media, est la supposée inefficience des marchés. Mais comment les marchés pourraient-ils être efficients quand les prix sont faussés ? L’inconvénient du camouflage de l’inflation, comme l’explique fort bien notre auteur, est justement d’empêcher le marché des biens et services de livrer les indicateurs qui permettraient une anticipation des hausses des prix à venir justifiant des investissements qui seraient ratifiés finalement par les consommateurs ou les utilisateurs. Au lieu de quoi les entrepreneurs, privés et plus encore publics, se fourvoient dans des investissements artificiels, quand ce ne sont pas des bulles purement spéculatives – jusqu’au prochain inévitable krach.
En fin d’ouvrage, Brendan Brown nous ouvre une porte de sortie vers le rétablissement d’un étalon-or lorsque le prochain krach aura eu lieu dont la date évidemment ne peut être fixée à l’avance, sinon il aurait déjà eu lieu ! Dans son esprit, le nouveau krach devrait signer la fin du 2 % inflation Standard, et donc ouvrir enfin pour de bon la voie à une réforme authentique du système monétaire. Dans la patrie de Jacques Rueff, la conclusion de Brown devrait être lue avec une attention particulière. Nul besoin d’un accord international – certainement introuvable – pour revenir à une monnaie saine. Un seul pays pourrait prendre cette initiative, les Etats-Unis, bien sûr, dont les réserves en métal jaune sont encore de 8000 tonnes, ou bien un des trois pays européens disposant de réserves d’or conséquentes (Allemagne : 3800 tonnes, Italie ou France (2500 tonnes chacune) à condition certes de renoncer à l’euro. Même la Suisse, avec ses 800 tonnes d’or, pourrait, à lire Brown, initier une réforme qui se répandrait de proche en proche à l’ensemble du monde. La Chine, gorgée de dollars dont elle ne sait que faire et qui ne cesse d’acheter de l’or sur le marché pourrait être elle aussi candidate… De même la Russie, qui n’a pas abandonné sa course à l’or, pourrait entrer dans ce cercle vertueux. La bonne monnaie pourrait être au moins aussi virale que l’a été la mauvaise. Un rêve sans soute !