Saviez-vous que le grand philosophe pragmatiste américain John Dewey (partisan d’une « appropriation collective des moyens de production »), Lord Keynes (qui plaidait pour un « contrôle des mécanismes économiques par l’État ») et le philosophe John Rawls (pour qui « les talents supérieurs sont un atout » à utiliser par l’État afin de réduire les inégalités) sont désormais non seulement à considérer comme d’éminents penseurs libéraux, mais mieux encore les seuls à véritablement l’être au XXème siècle ? Et vous doutiez-vous que « l’orientation socialisante du libéralisme n’a fait que se renforcer au cours du XXème siècle », que dans la confrontation entre le « libéralisme planificateur » de John Dewey et le « collectivisme libre » de Walter Lippmann en 1925/1940, ce sont « deux conceptions opposées du libéralisme qui vont s’affronter », et accessoirement enfin que « le libéralisme ignore la société et est indifférent aux valeurs » ? Extraits de Il faut s’adapter – Sur un nouvel impératif politique (Gallimard), La fin des libertés – ou comment refonder le libéralisme (Robert Laffont) puis… Contre le libéralisme (Éditions du Rocher), trois ouvrages parus début 2019 et respectivement signés de Barbara Stigler, Monique Canto-Sperber et Alain de Benoist, ces « scoops » sont bien entendu autant d’assertions arbitraires qui, déplaçant le libéralisme sur la gauche du prisme idéologique en le teintant fortement d’étatisme et de collectivisme, contredisent l’historiographie libérale qui faisait consensus jusqu’à l’orée des années 2000.

L’autre stratégie anti-libérale : la capture du mot « libéralisme »
S’il vaut mieux d’entrée de jeu abandonner à son insignifiance l’opus d’un Alain de Benoist qui, lorsqu’il ne se livre pas à une plate compilation de ce qui a déjà été mille fois dit au sujet de l’histoire du libéralisme, se contente de nous resservir la nostalgie des « communautés organiques » chère à la « nouvelle droite » (et vraie extrême droite) qu’il avait créée à la fin des années 1970 et qui justifie son aversion pour la liberté libérale, il ne saurait en aller de même avec les deux influentes universitaires que sont Barbara Stigler (professeur de philosophie politique à l’université de Bordeaux- Montaigne) et Monique Canto-Sperber (directrice de recherches au CNRS et ancienne directrice de Normale Sup). Car formellement très savant, leur propos « révisionniste » sur le libéralisme illustre significativement et presque à merveille l’insidieuse stratégie alternative de ceux, de plus en plus nombreux actuellement, qui veulent en finir avec l’interprétation classique de la pensée libérale sans recourir à une mise en cause frontale et brutale (qu’elles réprouvent d’ailleurs) propre à l’anti-libéralisme primaire des Benoist, Onfray, Michéa et Badiou par exemple. La stratégie en question et la manipulation intellectuelle qu’elle véhicule consistent principalement (mais pas uniquement, on y reviendra) à s’emparer du label « libéralisme » en le délestant de son sens et de ses fondamentaux basiques légués par l’histoire pour leur substituer ce que recouvre un liberalism pris dans son acception anglo-saxonne et surtout américaine – qui est souvent tout le contraire du libéralisme classique – pour entreprendre sans le dire de l’acclimater en France au nom d’une liberté « positive » : et le tour est joué. Il convient d’autant plus de se préoccuper de la chose que comme ces deux philosophes sont loin d’être seules à la manœuvre et que l’opération a commencé depuis une bonne quinzaine d’années[1], ce travail de détournement, retournement et finalement presque de « grand remplacement » lexical et idéologique a déjà porté ses fruits empoisonnés – comme l’atteste la réception favorable et totalement dépourvue de regard critique dont ont bénéficié les ouvrages précités. Car il faut bien le constater : l’interprétation « gauchisée » du terme libéralisme et des applications sociales, culturelles et économiques qu’elle implique est en voie de devenir maintenant une doxa dominante sinon exclusive dans l’intelligentsia académique[2] et médiatique (le libéralisme « canal historique » et mis à jour étant évacué dans l’infamante catégorie de l’ « ultra-libéralisme » ou à tout le moins du « néo-libéralisme ») et s’invite amplement dans l’orientation des recherches des doctorants et les soutenances de thèses.
Mais avant d’amorcer leur réfutation, il importe de bien prendre la mesure des falsifications en cours en revenant au verbatim des deux ouvrages incriminés et de quelques autres qui les ont précédés et annoncés. Dans celui de Barbara Stigler consacré essentiellement au « Lippmann-Dewey debate » intervenu aux États-Unis entre 1920 et 1930 et dont l’intérêt intrinsèque est indéniable, on apprend par exemple que Dewey (pour lequel l’auteur prend parti contre un W. Lippmann jugé encore trop peu « progressiste ») promouvait une « socialisation de l’intelligence », « une intelligence socialement organisée » et « une intelligence collective de la planification » marquant l’avènement d’un « nouveau libéralisme ». Il est en revanche reproché à W. Lippmann d’ignorer « le retournement de signification que le libéralisme a subi au cours de son histoire ». Que cet allégué « nouveau libéralisme » se caractérise par son appétence pour la « planification » et, rappelons-le, une « appropriation collective des moyens de production », donne la mesure de l’incroyable travestissement infligé à l’idée classiquement libérale.
Du côté de Monique Canto-Sperber, on retrouve à l’envi de semblables distorsions lexicales et historiques. Il faut ainsi savoir que selon elle auraient eu lieu des évolutions « qui transforment le libéralisme dans la mesure où celui-ci dut se rendre compatible avec l’intervention de plus en plus marquée des pouvoirs de l’État dans la vie économique et sociale, en opposition apparente [un mot qui compte !] avec ses convictions de base » – et que « la définition des droits propre au libéralisme des origines a été complètement révisée du fait de l’évolution historique de ce mouvement ». Rien d’étonnant dès lors à ce qu’en soit conclu que « le libéralisme tel que nous l’avons connu depuis deux siècles soit sur le point de s’achever » – Turgot, Smith, Say, Constant, Bastiat, Tocqueville et bien sûr Mises, Röpke ou Hayek : au rebut, et dans les oubliettes de l’histoire. Mais ce qu’il faut aussi savoir, c’est que dans La fin des libertés – ou comment refonder le libéralisme Canto-Sperber ne fait guère autre chose que recycler en les résumant et actualisant les thèses exposées il y a une dizaine d’années dans Le libéralisme et la gauche [3], où l’on découvrait déjà que « les idées libérales firent l’objet dès la fin du XIXème siècle d’une véritable révision conceptuelle » [cette insistance dans l’emploi du terme « réviser » justifie qu’on parle ici de « révisionnisme »] et que depuis cette époque « le libéralisme français s’est accommodé d’une action forte de l’État et de formes d’intervention publique dans la vie économique ». Concernant l’ouvrage de 2019, c’est ce qu’on peut appeler avoir de la suite dans les idées, mais aussi s’acharner à persévérer dans l’erreur. Cependant, le plus instructif est ailleurs : cette remontée aux années 2003-2008 montre que le travestissement et le gauchissement généralisés du libéralisme auxquels on assiste actuellement ne sont rien d’autre que le résultat, l’aboutissement d’une entreprise déjà ancienne et de longue haleine. Et polyphonique.
Il n’est en effet pas sans intérêt de rappeler que dans Qu’est-ce que le libéralisme ?[4], une autre philosophe à fort capital académique et social comme disait Bourdieu, Catherine Audard (London School of Economics), avait en 2009 proposé une interprétation révisée et socialisée du libéralisme analogue à celles de B. Stigler et M. Canto-Sperber. Nouveau verbatim puisé dans cet opus : « Il faudra attendre l’émergence des sciences sociales pour que, sous leur influence, une transformation profonde du libéralisme s’opère, le rapprochant du socialisme émergent à la fin du XIXème siècle », moment-charnière où « le libéralisme va se réinventer de manière remarquable comme un nouveau mouvement d’idées, comme un libéralisme social » et où « le nouveau libéralisme met en place ce qu’on appellera au XXème siècle la social-démocratie ». On a bien lu : selon C. Audard, le libéralisme (et non pas une fraction de celui-ci ou un nouveau venu s’emparant de ce label) se « réinvente » en s’apparentant au socialisme et donnant naissance à la social-démocratie ! Á ce point de contrefaçon lexicale, les mots en viennent à perdre tout sens et on plonge dans la plus parfaite incohérence intellectuelle. Mais ce n’est pas tout. Non seulement cette traductrice de John Rawls consacre un chapitre entier (le VI) de son livre à célébrer « le libéralisme démocratique de John Rawls » et considère que Keynes « a parachevé le nouveau paradigme libéral » (fin du chapitre IV), mais elle soutient que « le libéralisme…prend dans les années 1920 le tournant du welfarism qui va servir de socle à toutes les politiques économiques et sociales de l’État-providence » : à rapprocher de Canto-Sperber (2009), pour qui « l’État-providence n’a pas été conçu par des socialistes mais par des libéraux républicains »… Il n’y a plus qu’à fermer le ban.
Dewey, Keynes, Rawls : des « liberals » – mais à l’américaine
Mais il faut maintenant revenir sur le cas de chacun des trois penseurs mobilisés pour incarner l’élargissement inconsidéré de l’acception de l’idée libérale, voire son inversion radicale, afin d’exposer plus précisément les raisons de fond qu’il y a de leur refuser la qualité de nouveaux champions du libéralisme au regard du sens bien compris de ce dernier. Pour Dewey, (1859-1952) les choses sont claires. On ne voit pas le moins du monde comment pourrait être qualifié de libéral l’auteur d’un ouvrage-clé, Liberalism and Social Action[5], où est prôné un « libéralisme collectiviste » et l’avènement d’une « organisation où les nouvelles forces productives seraient contrôlées collectivement », et qui reconnaît lui-même que le « libéralisme américain » du début du XXème siècle est « aux antipodes du libéralisme anglais du début du XIXème siècle ». Cela étant, comme la notoriété et l’influence de Dewey dans la philosophie politique « grand public » contemporaine en France sont relativement réduites, cette extravagance n’a qu’une valeur symbolique et ne tire guère à conséquence. Avec Keynes (1883-1946), l’affaire est plus grave, mais il suffit de souligner qu’un penseur ne jurant que par la macro-économie, qui a été le théoricien d’une relance artificielle et contre-productive de l’économie par une demande financée par une dépense publique hyper-inflationniste est exclu d’avance et par principe de la pensée libérale, d’autant qu’il fut en outre l’initiateur du « welfarisme » (toutes caractéristiques qui l’ont fait vouer aux gémonies comme anti-libéral absolu par l’ordolibéral Wilhelm Röpke). Le keynésianisme ayant cependant à nouveau acquis le statut de vulgate économique quasi-consensuelle, le rappel de ce tropisme dirigiste qui lui est consubstantiel n’est pas superflu. Á noter au passage que du fait de leur orientation profondément anti-libérale, ni Dewey ni Keynes n’ont participé au fameux et pourtant si ambivalent colloque Walter-Lippmann de 1938 sur le « néo-libéralisme »–qu ‘ils n’y aient pas été invités ou aient eux-mêmes compris qu’ils n’y avaient pas leur place…
C’est avec John Rawls (1921-2007) que la capture socialisante du terme « libéralisme » et consécutivement le déni d’identité intellectuelle du libéralisme atteignent leur capacité maximale de nuisance dans la mesure où la référence à son nom surgit immédiatement dès qu’il est actuellement question de penseurs libéraux contemporains et où même nombre d’esprits ne reniant pas l’héritage classique de la pensée libérale l’acceptent comme tel. Et pourtant, lorsque en exposant dans son ouvrage canonique La théorie de la justice [6] ce en quoi consiste son célèbre « principe de différence », Rawls écrit que puisque « personne ne mérite ses capacités naturelles supérieures » il s’ensuit que « ceux qui ont été avantagés par la nature…peuvent tirer avantage de leur chance à condition seulement que cela améliore la situation des moins bien lotis », on est bel et bien en présence d’une collectivisation et d’une instrumentalisation parfaitement illibérales des « talents » : sans le moindre souci du consentement des intéressés, voici nié leur droit de propriété sur eux-mêmes (celui que Locke a posé et sanctuarisé au début de son Second traité du gouvernement civil) et l’État consacré en Grand redistributeur unique et autoritaire des ressources humaines. Que dans la page 4 de couverture de la traduction française soit pourtant annoncé que ce texte propose ni plus ni moins que « la charte de la social-démocratie moderne » ne suffit pas à alerter sur l’imposture – sauf à définitivement considérer que le socialisme modernisé représente l’accomplissement ultime du libéralisme !
Extension de la lutte contre les infox à l’histoire du (faux) libéralisme
Dans le cadre de l’extension du domaine de la lutte contre l’intox de « fake news » ayant même réussi à envahir et parasiter l’histoire des idées en faisant passer un faux libéralisme pour le vrai, il faut donc rétablir les faits, redonner droit de cité à l’impératif de cohérence et tenir affabulations et falsifications pour ce qu’elles sont.
Que les trois penseurs convoqués pour incarner l’émergence d’un « nouveau libéralisme » puis la substitution de celui-ci au libéralisme historique sous le nom de « libéralisme moderne » ou « social » soient tous anglo-saxons (un Britannique et deux Américains) suggère la piste à remonter pour établir l’origine et la réalité de la tromperie sur « marchandise » suite à l’imposition d’un label usurpé. Quand, dans les années 1925-1930, Dewey et Keynes publient leurs ouvrages respectifs où ils défendent la thèse d’un « nouveau libéralisme » étatisé et socialisé, le contenu du terme liberalism a depuis longtemps déjà subi une forte inflexion en ce sens au Royaume-Uni. Ce fut de l’autre côté de la Manche l’œuvre successive de John Stuart Mill dans son autobiographie et son opus posthume On Socialism, puis du philosophe Thomas Hill Green (1836-1882) dans son article « Liberal Legislation and Freedom of Contract » (1880) et du sociologue Leonard Trelawny Hobhouse (1864-1929) dans Liberalism (1911), lequel avait été de peu précédé en cette voie par l’économiste socialisant J.A. Hobson (1859-1940), auteur de The Crisis of Liberalism en 1909. Lorsque donc en 1925 Keynes répond affirmativement à son interrogation Am I a Liberal ?, c’est dans cette acception radicalement revue et corrigée qu’il faut le comprendre, il n’a fait que prendre en marche un train lancé il y a alors presque un demi-siècle. Et quand le promoteur historique du « Welfare State » au Royaume uni, Lord Beveridge, publie en 1945 Why I Am a Liberal, c’est bien naturellement aussi dans cette version social-étatiste qu’il convient d’interpréter sa profession de foi. Le cas de Dewey est un peu différent. Outre-Atlantique, cette version social-étatiste du liberalism venait tout juste de commencer à se diffuser par capillarité avec les cousins britanniques de même orientation idéologique. Mais c’est assurément Dewey qui, en la reprenant à son compte dans son libelle de 1935, va lui donner un large écho et l’imprimer dans un contexte américain où il n’avait auparavant pratiquement jamais été question de libéralisme.
Un détournement lexical depuis longtemps repéré et dénoncé
Le plus étonnant mais aussi désastreux de l’histoire, c’est bien que cette altération du vocable « libéralisme » dans un sens gauchisé en totale contravention avec le legs de l’histoire des idées mais aussi la simple logique des concepts a été repérée, critiquée et souvent dénoncée par un nombre impressionnant et varié de lanceurs d’alerte et non des moindres comme on va pouvoir en juger – mais que face à son importation en France, pratiquement personne chez les chroniqueurs, commentateurs et autres auteurs traitant du libéralisme n’en tient compte, sans doute pas par hasard. C’est donc avant tout à leur usage que l’on va rigoureusement documenter ces « signalements » d’imposture intellectuelle.
En Europe, c’est ni plus ni moins que Ludwig von Mises qui, le premier en date, sonne le tocsin. Dès 1922, dans son Sozialismus, il avait décelé la supercherie en observant dans l’Introduction que « Les ʺlibérauxʺ anglais d’aujourd’hui sont plus ou moins des socialistes modérés ». Une clairvoyante caractérisation réitérée peu après en 1927 dans Liberalismus où il note d’emblée que « En Angleterre, il y a certainement encore des ʺlibérauxʺ, mais la plupart d’entre eux ne le sont que de nom. En fait, ce sont plutôt des socialistes modérés. » Et dans l’Annexe II de l’ouvrage intitulée « Á propos du terme ʺlibéralismeʺ », il se fait plus explicite et mordant : « Presque tous ceux qui se prétendent de nos jours ʺlibérauxʺ refusent de se prononcer en faveur de la propriété privée des moyens de production et défendent des mesures en partie socialistes et interventionnistes… » Il s’écoulera ensuite un certain temps avant que, sur le vieux continent, des voix s’élèvent pour pointer le dévoiement de sens infligé au terme « libéralisme » et incriminer le brouillage conceptuel tout sauf innocent qui en résultait. Ce sera chose faite peu après la fin de la seconde guerre mondiale, et pas par n’importe qui. C’est d’abord Raymond Aron qui s’en charge, en relevant dans son célébrissime et si salutaire Opium des intellectuels (1955) que « ce ʺlibéralismeʺ [celui du « New Deal » de Roosevelt] ressemblait à celui de la gauche européenne plus qu’à aucune autre époque, puisqu’il comportait des éléments, atténués et américanisés, du socialisme (du travaillisme plutôt que du socialisme autoritaire) ». Deux ans plus tard, dans Espoir et peur du siècle (1957), il se montre plus incisif en indiquant à propos des libéraux américains que « ce mot n’a pas aux États-Unis le sens qu’il a en France. Le mot ne désigne ni les défenseurs des institutions représentatives ou des libertés personnelles, ni les économistes partisans des mécanismes du marché. Les libéraux américains constituent l’équivalent de la gauche française, ils souhaitent des réformes économiques dans un sens favorable aux masses. Je mettrai en italiques le mot libéral quand je l’emploierai dans le sens américain. » Une sage précaution que les dames Canto-Sperber et Audard se sont bien gardées de respecter – et pour cause… Puis ce fut le tour de l’ordolibéral Wilhelm Röpke qui, au détour d’une note de bas de page de Au-delà de l’offre et la demande (1958), s’insurge contre le détournement du terme « libéral » dont, dit-il au sujet des États-Unis, « la signification ʺmoyenneʺ est là-bas à ce point différente de l’Europe qu’elle en devient précisément le contraire. (L’Américain) y perçoit ce que nous pouvons au mieux définir de ʺsocio-démocratique ʺ : New Deal, encouragement des syndicats, économie planifiée, centralisation, imposition radicale des revenus et des richesses, cela passe là-bas pour libéral. La confusion augmente du fait que la notion est usurpée par des gens et par des mouvements qui ne se distinguent des communistes que par leur prétention à ne pas l’être. »
De l’autre côté de l’Atlantique, la réaction à l’ « usurpation » et au gauchissement a été presque immédiate mais aussi plus vigoureuse. Dès 1928, le pré-libertarien Albert Jay Nock tempête : « De tous les hommes que je connais, les ʺliberalsʺ sont ceux qui ont la plus grande horreur de la liberté, la plus grande crainte d’envisager une humanité vivant dans une libre association volontaire » (On Doing the Right Thing). Aux lendemains de la World War II, deux penseurs et économistes de grand renom prennent part à la contre-offensive. Fondateur historique de l’École de Chicago, Frank Knight signale dans The Sickness of the Liberal Society (1946) que « le nouvel usage du mot ʺlibéralismeʺ pour signifier un supposé étatisme démocratique – socialisme ou planification économique – nous oblige maintenant à explicitement restreindre le terme à la conception qui apparut sous ce nom dans la théorie de la philosophie sociale au XIXème siècle » – à savoir le seul « vrai » libéralisme. Et Joseph Schumpeter (qu’on aura bien du mal à faire passer pour un horrible « ultra-libéral ») constate le plus objectivement du monde dans le chapitre 2 de la IIIéme partie de son Histoire de l’analyse économique (1954) : « Le terme [libéralisme] a acquis un sens différent – en fait opposé – depuis 1900 et surtout 1930 : comme un suprême mais non-intentionnel compliment, les ennemis du système de l’entreprise privée ont jugé sage de s’en approprier le label. » Hayek pouvait-il demeurer en reste ? Que non pas, puisque dans la préface à la réédition américaine en poche (1956) de The Road to Serfdom, il juge nécessaire de préciser :
« J’utilise le terme « libéral » dans son sens originel du XIXème siècle qui est toujours courant en Grande-Bretagne. Dans son usage courant aux États-Unis, il signifie souvent essentiellement l’opposé de celui-ci. Cela fait partie du camouflage des mouvements de gauche dans ce pays… que ʺlibéralismeʺ en soit venu à vouloir dire : être l’avocat de la plupart des formes de contrôle gouvernemental. »
On pourrait encore, toujours dans le contexte américain de l’époque, mentionner l’appréciation du « libertarian conservative » Frank Meyer (1909-1972) qui, dans In Defense of Freedom (1962), déplorant que « le terme ʺlibéralismeʺ a été depuis longtemps capturé par les partisans d’un État tout-puissant et d’une économie contrôlée, et corrompu en l’opposé de son vrai sens », qualifie le « libéralisme » à l’américaine de… « collectivist liberalism ». Ou celle d’Ayn Rand, pour qui « les ʺlibérauxʺ ont peur d’identifier leur programme par son vrai nom, ils justifient chaque nouveau pas ou chaque nouvelle mesure de ce qui est en fait de l’étatisme en les dissimulant par des euphémismes tels que ʺWelfare Stateʺ, ʺNew Dealʺ, ʺNew Frontierʺ… » (Conférence à Princeton le 7 novembre 1960). Mais le forfait étant dûment maintenant établi, il est temps de conclure en revenant en Europe et plus particulièrement en France en donnant sur ce point la parole finale à Jean-François Revel :
« ʺlibérauxʺ désigne, on le sait, aux États-Unis, une sorte d’extrême gauche du parti démocrate. Sans être organisé politiquement, ce ʺlibéralismeʺ exerce une influence diffuse mais souveraine grâce aux place-fortes qu’il commande dans la presse, l’édition et les universités. C’est évidemment le contraire du libéralisme au sens classique, lequel, d’ailleurs, en Amérique, répond à la dénomination de classical liberalism, pour éviter la confusion.[7] »
Le libéralisme n’a pas changé de sens et ne s’est pas « réinventé »
Au vu de toute cette accumulation convergente de constats et d’accusations de falsification de la signification du terme « libéralisme » par des partisans passés et présents d’une social-démocratie gauchisante, on est intellectuellement en droit de catégoriquement récuser l’assertion « Au début du XXème siècle, le libéralisme a changé de sens » et se serait « réinventé ». C’est là purement et simplement la commission d’un faux et un usage de faux. Rétablissons la vérité : le (puisque tout le problème se situe dans ce le) libéralisme n’a nullement alors changé de sens et ne s’est pas le moins du monde « réinventé ». Ce qui s’est passé, c’est qu’il a été victime d’une entreprise de capture de son label, qu’un autre sens frelaté a été inventé de toutes pièces afin de le substituer à l’acception classique – mais que la manipulation n’a d’abord pas rencontré le succès escompté contrairement à ce que veulent faire accroire ses initiateurs. Car nombre d’adeptes du libéralisme classique ont continué à se vouloir et se dire « libéraux » en demeurant fidèles à ses requis en matière de liberté d’entreprendre, créer, échanger, travailler, épargner, disposer de ses revenus, en privilégiant responsabilité individuelle et coopération volontaire, et préférant la protection d’un État limité (pierre de touche, s’il en est, du libéralisme cohérent) à l’emprise d’un État omnipotent, interventionniste en diable, alliant coercition et spoliation. Outre les « Autrichiens » Mises (dont l’opus de 1927, Liberalismus, réexpose magistralement ce que recouvre le vrai paradigme libéral) puis Hayek ainsi qu’un peu plus tard les premiers ordolibéraux, on en trouve un peu partout, en Europe comme aux États-Unis – un peu clairsemés au début mais ensuite en rangs plus garnis – jusqu’à leur « coming out » collectif et retentissant lors de la création de la Mont-Pélerin Society au début d’avril 1947. Petit mémo rétablissant ce qu’occultent les parangons de ce faux libéralisme qu’est le liberalism subrepticement introduit et adapté au contexte français : en 1934, tandis qu’à Paris le jeune Jacques Rueff inaugurant sa future brillante carrière proclamait « Pourquoi malgré tout je reste un libéral » (au sens classique, faut-il le préciser?) dans une conférence tenue à Polytechnique le 8 mai, aux États-Unis un autre éminent fondateur de l’École de Chicago, Henry C. Simons (1899-1946), publiait A Positive Program for Laissez-faire – Some Proposals for a Liberal Economic Policy en continuant à donner au mot « liberal » son contenu traditionnel et contribuant ainsi à faire reprendre consistance à ce qu’on dénommera désormais là-bas le classical liberalism. Et lors du fameux Colloque Walter-Lippmann, les échanges animés sur l’opportunité de forger un « néolibéralisme », une frange active de participants revendique haut et fort son attachement aux valeurs libérales classiques : aux côtés de Mises et Hayek, c’est aussi le cas de Jacques Rueff, et dans une certaine mesure de Lionel Robbins et Wilhelm Röpke. Au sortir de la guerre, les mêmes ne tarderont pas à se retrouver en compagnie entre autres de Karl Popper, Milton Friedman, Frank Knight et Michael Polanyi pour fonder la Mont Pelerin Society, dont le promoteur, Hayek, précisera bien dans son allocution d’ouverture du 1er avril 1947, qu’ « il n’y a pas de meilleur nom que le libéralisme » pour définir « les idéaux qui nous unissent et en dépit des abus que ce terme a connus » – et que l’objet premier de la Société est d’ « élaborer les principes généraux d’un ordre libéral ». C’est en se reconnaissant dans cet objectif et sous ce label à l’enracinement lexical historiquement assumé que viendront vite les rejoindre Walter Eucken (initiateur de l’école ordolibérale de Fribourg), Luigi Einaudi (longtemps chroniqueur libéral dans les colonnes du « Corriere della Sera » puis auteur d’ouvrages d’économie politique de référence) – et, pour un temps, Raymond Aron. On connaît la spectaculaire suite de l’histoire, mais ce qui importe pour le moment, c’est de constater que loin de s’être « réinventé » en adoptant une « orientation socialisante » et se substituant au libéralisme « canal historique », ce dernier, rafraîchi, revitalisé et conquérant, est plus que jamais présent et bien vivant à l’orée de la seconde moitié du XXème siècle. Et cela quand bien même les faux « libéraux » alliés à nombre d’épigones de la gauche étatiste tenteront de le caricaturer en le qualifiant de… « néo-libéralisme », insinuant par là que l’économie de libre marché prônée par les libéraux de la Mont-Pélerin Society serait en rupture avec les principes fondateurs du libéralisme historique et les trahirait même (autre faribole : libre concurrence et libre échange figuraient explicitement et résolument déjà, comme on le sait, dans l’agenda de Boisguilbert, Gournay et Turgot).
L’État-providence n’a pas été inventé par des libéraux
On ne saurait délaisser le vaste domaine des « fake news » à caractère historique distillées par les falsificateurs gauchisants du libéralisme sans enfin tordre le cou à deux d’entre elles, d’importance moindre que ce qui précède mais néanmoins pernicieuses et qui tendent surtout à être prises pour argent comptant dans la sphère académique et médiatique. Comme pour se dédouaner du reproche de vouloir abusivement transplanter le liberalism anglo-saxon en France, ne voilà-t-il pas que les promoteurs du « libéralisme moderne et social » prétendent que ce seraient les libéraux français des années 1890/1900 qui auraient inventé et introduit l’État-providence dans notre pays. Or ce qui est dans ce contexte désigné par « libéraux » (en précisant « républicains »), ce sont en réalité les théoriciens du solidarisme social (Léon Bourgeois, Charles Gide…) qui proclamaient eux-mêmes vouloir en finir avec un libéralisme injuste – et s’apparentent bien plutôt à de précoces sociaux-démocrates évolués sans liens avec le socialisme ultra-étatiste et autoritaire : donc, des non-libéraux au sens rigoureux du label. Mais le plus éclairant est que les « vrais » libéraux ont très tôt fait du combat contre un État-providence ou « État social » invasif, spoliateur et déresponsabilisant l’un de leurs chevaux de bataille privilégiés. En France, ce fut le cas des contributeurs du « Journal des économistes », à commencer par son rédacteur en chef, Yves Guyot (libéral « républicain » s’il en est, au demeurant !) mais aussi Henri Follin ou Eugène d’Eichtahl – auxquels s’ajoutent par ailleurs les voix d’Albert Schatz et de Vilfredo Pareto (Les systèmes socialistes). Par la suite, aussi bien Wilhelm Röpke que Jacques Rueff et même Walter Lippmann (La cité libre) se montreront des adversaires résolus et explicites de l’État-providence lui-même, ou des principes sur lesquels il repose, de l’attribution de « droits sociaux » dérivant en droits sur les autres par la redistribution forcée à la préférence pour la mise sous assistance durable de ses bénéficiaires.
Il faut enfin faire litière d’une dernière fable volontiers répandue par les thuriféraires d’un liberalism à la française, relevant cette fois-ci d’une étonnante mais volontaire confusion d’ordre « topo-idéologique ». En se « socialisant » et mobilisant les moyens politiques de l’État pour instaurer la justice sociale, le libéralisme « réinventé » n’aurait en réalité fait que renouer avec ses origines et sa nature de gauche. Or rien n’est plus faux. Certes, lorsque le libéralisme classique prend véritablement son essor à la fin du XVIIIème siècle et surtout dans la première moitié du XIXème, il se situe « à gauche » des tenants conservateurs de l’Ancien Régime et des grands propriétaires fonciers dont il bouscule ou abat les privilèges et autres monopoles. Mais déjà, pour ne prendre que l’exemple français, les libéraux sont sur l’échiquier idéologique et dans les assemblées à droite des nostalgiques du jacobinisme et de la Terreur. Et jusqu’à ce que surgissent les premiers socialistes en 1848, ils ne sont de manière relative « à gauche » que parce qu’il n’y a pratiquement personne à leur gauche. Tout change donc dès que le socialisme autoritaire, étatiste et collectiviste s’installe en force dans le paysage idéologique, et devient l’ennemi de classe juré du libéralisme : Bastiat, Tocqueville, Molinari (voir Les soirées de la rue Saint-Lazare) sont les premiers à monter au front pour dénoncer ce que l’excellent Yves Guyot fustigera plus tard sous le titre de La tyrannie socialiste. L’imposture réside ici dans l’assimilation d’une « géolocalisation » relative (être à la gauche de) à une imputation substantielle (être idéologiquement de gauche). Jamais le « mainstream » libéral n’a été substantiellement et dans l’absolu à gauche. S’il n’en était d’ailleurs pas ainsi, on ne voit pas pourquoi on parlerait d’un libéralisme… de gauche pour le distinguer d’autres versions de la matrice classique du paradigme libéral ?
Où l’on apprend pourquoi à gauche on veut récupérer le label « libéral »
Mais pourquoi donc cet acharnement activiste à avoir voulu pirater et gauchir le label « libéral » comme le corpus idéologique qu’il recouvrait depuis les origines ? La question se pose d’autant plus au terme de cette enquête que sous des formes nouvelles, il se poursuit de plus belle actuellement – et que « ça marche ». Historiquement, et même si le processus y aboutit en gros au même résultat, les raisons en sont différentes outre-Manche et outre-Atlantique. Au Royaume-Uni, avant que le socialisme « fabien » et le travaillisme s’en saisissent pour la radicaliser, la critique « sociale » du libéralisme économique s’est faite à partir de 1870 au nom d’une liberté « positive » impliquant l’intervention volontariste et égalitariste de l’État, par opposition à la liberté « négative » censée être abstraite et inégalitaire des libéraux fidèles aux conceptions « laissez-fairistes » de Smith puis Cobden : l’occasion était trop belle pour ne pas s’emparer du terme liberal en lui imprimant une connotation progressiste et en profitant en outre de la quasi-disparition de grands théoriciens classiques du libéralisme (ce pourquoi ils resurgiront sur le continent, avec les précoces marginalistes « autrichiens »). Aux États-Unis, il en est allé tout autrement : d’une part, le terme liberal, pratiquement jamais utilisé avant 1920, n’était pas idéologiquement préempté par les partisans d’une liberté en économie allant de soi, et d’autre part la critique sociale du capitalisme ne pouvait s’y développer au nom d’un socialisme totalement étranger aux mœurs américaines et même très négativement connoté de despotisme liberticide. Ne restait donc (pour un Dewey par exemple) qu’à se présenter en adeptes d’un liberalism interventionniste inspiré de celui des « cousins » britanniques déjà bien avancés en ce sens. Que des esprits de sensibilité social-démocrate et « progressiste » aient entrepris sur le continent européen et singulièrement en France (à certains égards aussi en Italie, avec le « socialisme libéral ») d’y transposer ce label et son contenu social-étatisé appelle un schéma explicatif autre. Il s’agissait tout à la fois de se démarquer du socialisme autoritaire d’obédience marxiste en se réclamant du libéralisme politique, donc de récupérer à leur profit l’idéal de liberté cher aux libéraux classiques tout en le leur contestant, et d’avancer masqués pour promouvoir des solutions économiquement et socialement dirigistes – mais sur un mode plus subtil, attractif et fallacieux que celui des « nouveaux libéraux » des années 1930 : Rawls, entre autres, était passé par là, faisant de zélés émules.
Le fait marquant, au cours des récentes décennies, est en effet bien que le faux libéralisme a su évoluer (« se réinventer » ?), d’abord sur le plan social et économique : plus question de « planification », de « collectivisation » ou de nationalisations archaïques. Même le keynésianisme a mis de l’eau dans son vin (rosé), sans doute sous les coups de boutoirs cumulés de la réalité et l’économie (réellement libérale) de l’offre. Le changement majeur mais trompeur, chez les faux libéraux « modernes » et « positifs », a consisté non pas à renoncer à collectiviser la société, mais à en déplacer le point d’application. On ne collectivise plus en amont les outils de production et les entreprises : reportée en aval, la collectivisation concerne les revenus et son outil principal est la fiscalité progressive et « progressiste », bardée de transferts autoritaires et spoliateurs de revenus et de redistribution forcée (dont le « revenu universel » et même l’ « impôt négatif » sont les actuels avatars tellement prisés par les suppôts du « social-libéralisme » : on ne citera pas de noms!), de taxations toujours plus inventives – le tout au service du « social » et d’un État-providence débordant de bienveillance bureaucratique sophistiquée et tentaculaire. Il serait possible de distinguer, au sein de cette mouvance pseudo « libérale », entre vrais « faux » libéraux (enclins à une inflation de réglementations nouvelles) et faux « vrais » libéraux (ouverts à l’économie de libre marché à condition d’en taxer sans modération les acteurs), mais on épargnera ces raffinements au lecteur afin d’en venir à des développements sociétaux et culturels contemporains qui ont fait passer le faux libéralisme du stade de moderne à celui de post-moderne.
De quoi le faux libéralisme post-moderne est-il finalement le nom ?
Sous couvert, en effet, d’extension illimitée des droits individuels, de la liberté politique et d’approfondissement de la société ouverte paraissant s’inscrire dans la logique d’un monde libéral, ceux qu’on présente désormais comme « libéraux » se sont faits les avocats d’une révolution culturelle « soft », lointain héritage des utopies « libérales-libertaires »[8] soixante-huitardes renommées en un « libéralisme culturel » qu’on a parfois peine à différencier du « gauchisme culturel » tant est forte la porosité entre les deux. Dans la perspective d’une liberté libérale pour le coup dérégulée et comme devenue folle, la tolérance s’est muée en hyper-tolérance, le pluralisme en caution d’un multiculturalisme (explicitement soutenu dans les ouvrages d’Audard et Canto-Sperber[9]) cheval de Troie d’un communautarisme tribal pétri de mœurs archaïques, et l’esprit d’ouverture en soumission inconsidérée à ce qui le nie – la belle idée classiquement libérale de « société ouverte » se dégradant en vaste ville ouverte et en opérations « portes ouvertes » à tous vents en même temps qu’en juxtaposition de microsociétés closes. Être « libéral », c’est actuellement aussi se déclarer en faveur d’une « diversité » multi-kulti sans limites ni exigences, d’un immigrationnisme de masse[10] (10), de l’idéologie du « genre », d’une écolâtrie irraisonnée, d’un pseudo-antiracisme porteur de discrimination positive, et d’un laxisme pénal (« culture de l’excuse » à tout va excluant une tolérance zéro) mais aussi éducatif (pédagogisme) : autant de postures qui renient et corrodent les valeurs basiques d’une civilisation occidentale dont le libéralisme classique représentait l’accomplissement le plus affiné. Mais tout aussi préoccupant s’avère le fait que ces « libéralisations » alléguées se révèlent en réalité profondément anti-libérales puisque leur mise en œuvre ne peut se faire que par le déploiement de nouvelles réglementations de la vie courante encore plus intrusives et coercitives destinées à les imposer à tous ceux qui n’en veulent pas et en contrôler le respect effectif. C’est ce que se chargent de faire la véritable police de la pensée et du langage déjà activement mise en place avec sa novlangue et par exemple son écriture « inclusive », mais aussi, avec le concours de l’État, une législation pénale permettant de porter plainte contre les récalcitrants et autres mal-pensants : fin annoncée d’une liberté d’expression qui était au cœur même de la pétition libérale classique.
De quoi donc, au final, le libéralisme revu et corrigé par des faussaires est-il réellement le nom ? D’un progressisme socialisant, égalitariste et relativiste, imprégné de « political correctness » et invitant à « faire du passé table rase » – en rupture radicale avec toute continuité conceptuelle historique. On aurait de ce fait grand tort de croire que l’esquisse de généalogie du détournement lexical qui précède ne présenterait qu’un intérêt anecdotique pour érudits : elle permet au contraire de comprendre comment et pourquoi nous en sommes venus à l’actuel confusionnisme lourd de conséquences pour la suite du combat des idées. Et il ne s’agit pas non plus d’une simple querelle de mots, car c’est dans et par eux que se forgent la pensée et la représentation du réel : tout reformatage arbitraire dans ce domaine n’est pas moins grave. Quand coexistent, comme c’est le cas maintenant, deux acceptions contradictoires d’un même terme, libéralisme en l’occurrence, et que l’une des deux, nouvellement venue, non seulement veut usurper la place du tenant du titre mais s’avère elle-même contradictoire (prétendre faire progresser la liberté en corrompant la logique de celle-ci), on a tout lieu de craindre que ledit terme ne veuille plus rien dire de consistant[11]. Et que toutes les mystifications soient possibles, et prises pour argent comptant par des esprits trop peu méfiants et ayant abandonné le souci du libre examen. Les (vrais) libéraux se laisseront-ils définitivement déposséder par leurs (faux) frères ennemis d’un libéralisme bien compris selon les exigences de sa logique et de son enracinement historique ?
[1] Ce fut particulièrement le cas au moment du débat sur la confrontation entre « libéraux et communautariens », où les « libéraux » n’étaient plus identifiés qu’aux figures de Rawls, Dworkin ou… Habermas : cf. de Justine Lacroix, Communautarisme versus libéralisme, Université de Bruxelles, 2003.
[2] Les récents ouvrages de David Spector, La gauche, la droite et le marché (Odile Jacob, 2017) ou de Laurent Bouvet, La nouvelle question laïque (Flammarion, 2019) en sont d’exemplaires illustrations.
[3] Monique Canto-Sperber, Le libéralisme et la gauche (Hachette-Pluriel, 2008).
[4] Catherine Audard, Qu’est-ce que libéralisme ? (Gallimard/Folio Essais, 2009).
[5] Paru aux États-Unis en 1935, cet ouvrage de John Dewey a été traduit par Nathalie Ferron en 2014 aux Éditions Climats sous le titre Après le libéralisme ? Ses impasses, son avenir.
[6] John Rawls, Théorie de la Justice, Le Seuil, 1987 ; traduit de l’américain par C. Audard.
[7] Jean-François Revel, dans La Grande parade (Plon, 2000, p. 32).
[8] On sait que pour la sensibilité « libertaire », toute référence morale est exclue puisqu’il « est interdit d’interdire » et qu’en conséquence, tout est permis : on est évidemment aux antipodes du libéralisme historique, avec lequel il est non moins évidemment impossible de le conjuguer.
[9] C. Audard y consacre tout le chapitre VIII de Qu’est-ce que libéralisme ? Elle s’y prononce « en faveur d’un multiculturalisme libéral » et croit pouvoir faire état d’un « consensus libéral sur le multiculturalisme » totalement contredit par les écrits de J.-F. Revel ou Mario Vargas Llosa. Pour sa part, M. Canto-Sperber soutient de facto une position semblable dans La fin des libertés – ou comment refonder le libéralisme : voir « Multiculturalisme et politique de reconnaissance » (pp. 73/74) où les thèses des « libéraux » multiculturalistes sont favorablement exposées. Dans les deux cas, la concordance avec les orientations du liberalism américain est totale.
[10] Les bonnes raisons libérales de s’opposer à une immigration de masse incontrôlée ont été avec grande rigueur développées par le libertarien (et « autrichien ») de choc Hans Hermann Hoppe dans un célèbre article intitulé « The Case for Free Trade and Restricted Immigration » paru à l’été 1998 dans le volume 13 du Journal of Libertarian Studies.
[11] Exemple édifiant de la confusion régnante et de la perte de sens de l’idée de libéralisme : en France, ce sont Macron et Cohn-Bendit qui sont censées l’incarner (sans commentaire !). Et au Parlement européen, c’est le grand écart entre les orientations des libéraux du FDP allemand et celles des LibDem britanniques…
 Alain Laurent est philosophe et historien, essayiste et éditeur aux Belles Lettres. Son dernier ouvrage paru est L’autre individualisme : une anthologie, Les Belles Lettres, 2016.
Alain Laurent est philosophe et historien, essayiste et éditeur aux Belles Lettres. Son dernier ouvrage paru est L’autre individualisme : une anthologie, Les Belles Lettres, 2016.



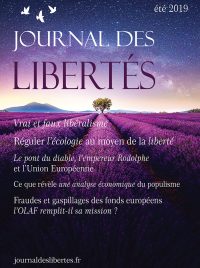
2 Commentaires
[…] d’Alain Laurent « Vrai et faux libéralisme » paru dans le Journal des Libertés n° 5 (été […]
Excellent article, merci beaucoup.