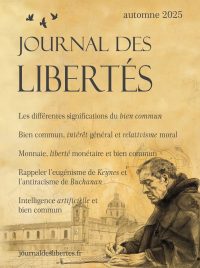Voyons le bon côté des choses : pendant des décennies les gouvernements successifs, avec le soutien de la majorité du Parlement, ont voté des budgets en déficit ce qui les poussait mécaniquement à accroître la dette publique. Or, après ces décennies de « laisser aller », des voix de plus en plus nombreuses se font entendre qui appellent à un changement de direction. Les déficits et la dette publics sont enfin perçus comme problématiques. Nous devons nous en réjouir ! Il eut été bien difficile il y a quelques années à peine de rassembler pour une journée d’étude sur le thème de la réduction des dépenses publiques un plateau si prestigieux d’experts, de responsables politiques et d’entrepreneurs.

Cette prise de conscience de la nécessité de revoir nos modes de fonctionnement constitue une étape importante, mais ce n’est qu’une première étape.
Il nous appartient à présent d’analyser nos erreurs, de comprendre ce qui cloche dans les mécanismes de la décision publique en France ; ce qui fait que nous nous retrouvons systématiquement en déficit et avec une dette qui ne cesse de croître. Cette seconde étape nous donnera les bases solides sur lesquelles élaborer une stratégie pour rétablir une dynamique saine pour nos finances publiques et, au-delà, pour notre économie et notre démocratie.
C’est précisément le rôle d’un think-tank tel que l’IREF d’accompagner les citoyens et plus particulièrement les décideurs publics dans cette démarche. C’est aussi la raison d’être de cette journée, et je tiens dès à présent à remercier toutes celles et tous ceux qui ont accepté d’y participer, à commencer par les chercheurs associés à d’autres think-tanks français ou étrangers. Le moment est trop important pour verser dans une cacophonie qui réduit les chances d’une possible et nécessaire réforme : les citoyens, lacés de débats sans fin, arrivant inexorablement à la conclusion que « si les experts ne sont pas d’accords entre eux autant continuer sans rien changer ! ».
Or un changement en profondeur est nécessaire. Pourquoi est-il nécessaire ? Que faut-il changer ? et Comment ? Ce sont là précisément les questions que nous aborderons à travers les différents panels et les témoignages qui seront présentés tout au long de cette journée.
Je ne peux évidemment vous dévoiler à l’avance ce qui sortira de nos discussions car, comme vous, je suis venu écouter et débattre, animé par ce désir de trouver enfin le meilleur chemin du retour vers la prospérité. Sans vouloir présumer des analyses qui suivront, et qui peut-être diffèreront de la mienne, je voudrais toutefois en quelques minutes présenter les éléments qui doivent, selon moi, guider notre réflexion.
Comment nous sommes-nous retrouvés là ?
Il faut commencer par répondre à la question essentielle : Comment nous sommes-nous retrouvés champions du monde de la dépense publique ? La réponse que l’on apporte à cette question déterminera la stratégie choisie pour maîtriser les dépenses publiques. Les réponses apportée à cette question permettent également de distinguer le point de vue des libéraux de celui des socialistes ou des conservateurs.
Un premier élément de réponse autour duquel un assez large consensus existe aujourd’hui est que les déficits publics – et donc l’endettement – sont les fruits d’une mauvaise gestion. Si c’était là l’unique élément de réponse nous devrions en conclure qu’il suffit de mieux gérer pour sortir de la crise. Évidemment, les avis peuvent encore diverger sur ce que l’on entend par « mieux gérer ».
Pour certains cela signifie redonner la main à l’État, peut-être aussi recentraliser les décisions publiques. Mieux planifier, mieux contrôler. Il faut retrouver la figure de l’instituteur de la Troisième République : confier la gestion des finances publiques à des personnes intègres, bien formées, soucieuses du bien public. Une forme de Colbertisme qui, à en croire ses adeptes, pourrait fonctionner pour peu que l’on sélectionne les bons ouvriers.
Pour d’autres encore, probité et reddition des comptes sont certes nécessaires pour mieux gérer, mais insuffisantes. Une meilleure gestion s’obtient non pas par la centralisation mais par la décentralisation des décisions publiques. Il faut faire jouer « la subsidiarité verticale » – pour reprendre l’expression de Jean-Philippe Feldman – ; mettre en concurrence les juridictions. Nous avons de bonnes raisons de croire que cette seconde voie est la plus prometteuse des deux et sans doute reviendrons-nous au cours de la journée sur les vertus de la subsidiarité.
Mais je pense que le bilan des dernières décennies ne s’explique pas uniquement par un problème de gestion. Nous ne nous sommes pas retrouvés champions du monde des dépenses publics et des déficits publics par simple manque de probité, de décentralisation ou de contrôle. Nous nous sommes retrouvés champions du monde des dépenses publiques parce que nous l’avons voulu ! Et les déficits ne sont dans une large mesure ni plus ni moins que les conséquences de cette volonté première.
Le choix du « tout État »
Pourquoi la France se retrouve-t-elle avec des dépenses publiques qui représentent 57 % du PIB alors que les Irlandais sont à 22,7 ; les Suisses à 32% ; les Etats-Unis à 34,38 ; les Pays-Bas à 43,5 % ; l’Allemagne à 48,4% ou encore la Suède à 49,4 soit près de 10 point de PIB en dessous de nous ? C’est avant tout parce que nous avons fait le choix de confier à l’État beaucoup plus de « missions » que ne l’ont fait nos voisins.
Nous lui avons confié notre assurance santé, nos services de santé, l’éducation de nos enfants, notre assurance vieillesse, notre assurance chômage, le financement de la culture, le pilotage de notre agriculture, l’offre de logements à bas loyers, les investissements du futur, une partie du financement des entreprises (BPI France !), le financement de la vie associative, et j’en passe. Dès lors, il n’est pas surprenant de constater que les pays qui ont fait le choix de s’en remettre à l’initiative et la responsabilité individuelle plutôt qu’à la sphère publique se trouvent 10, voire 20 ou 30 points en dessous de nous en termes de dépenses publiques.
Ce constat appelle à son tour une autre question. Pourquoi avons-nous fait ces choix ? Pourquoi avons-nous embrassé avec tant de force – et d’insouciance – ce « modèle à la française » ainsi qu’on le dénomme parfois ? Il n’y a pas de réponse simple à cette question mais deux éléments d’explication, complémentaires l’un de l’autre, viennent à l’esprit :
1. Une confiance bien française dans notre capacité – la capacité de nos élites – à organiser, à gérer. Ainsi que je le soulignais, la France demeure profondément marquée par le Colbertisme et le Saint-Simonisme. Mais une confiance aveugle et dans bien des cas démesurée.
2. Une méfiance à l’égard du marché. La France est un pays où lorsqu’on parle de « loi du marché » c’est presque toujours pour évoquer une catastrophe : des licenciements sauvages, de la corruption, des faillites. Trop de nos concitoyens voient encore dans la libre entreprise un pouvoir de nuisance plutôt qu’un pouvoir de bienfaisance.
On peut résumer cela en disant que la raison principale pour laquelle nous avons tout confié à l’État est une ignorance profonde des lois de l’économie. Une incapacité à concevoir le marché comme une procédure de découverte. En France on préfère faire confiance à un groupe d’experts plus ou moins anonymes qu’à la force entrepreneuriale des marchés.
Remettre en cause nos analyses
C’est ainsi qu’une majorité des Français accepte la servitude : les prélèvements obligatoires élevés et les réglementations omniprésentes. Tel est le prix à payer – c’est du moins ce que pensait jusqu’à aujourd’hui une large majorité des Français – pour avoir l’assurance de services de qualité. Ce modèle a fait illusion un temps. Je me souviens mes premiers déplacements à l’étranger dans les années 80 : tout le monde vantait les mérites de « l’exception française ». On nous enviait en particulier notre système de santé et nos retraites généreuses. Mais en fin de compte c’est Milton Friedman qui avait raison lorsqu’il nous mettait en garde :
« Une société qui privilégie la sécurité plutôt que la liberté ne connaîtra ni sécurité ni liberté. Et une société qui privilégie la liberté n’atteindra certes pas la sécurité absolue, mais elle se rapprochera de la sécurité plus que tout autre système jamais développé. »
Mais nous n’avons pas écouté les Friedman, pas plus que les Bastiat. Nous avons préféré enseigner pendant des générations les défaillances du marché – et c’est vrai que les marchés ne sont pas parfaits –, plutôt que les défaillances de l’État.
Nous nous sommes – pour paraphraser cette fois-ci Bastiat— focalisés sur « ce qu’on voit », les conséquences directes de l’action publique en négligeant « ce qu’on ne voit pas » ; les conséquences indirectes. Et pour citer cette fois-ci Bastiat dans le texte :
« il arrive presque toujours que, lorsque la conséquence immédiate est favorable, les conséquences ultérieures sont funestes, et vice versa. — D’où il suit que le mauvais Économiste poursuit un petit bien actuel qui sera suivi d’un grand mal à venir, tandis que le vrai économiste poursuit un grand bien à venir, au risque d’une petit mal actuel. »
Nous récoltons donc aujourd’hui les fruits de ce que nous avons semé et qu’une bonne analyse économique nous aurez permis d’éviter. Nous nous trouvons dans une impasse budgétaire.
Sortir de l’impasse
Alors que fait-on lorsqu’on voit arriver le bout de l’impasse : on freine et on fait demi-tour ! Freiner et opérer un demi-tour se réfèrent respectivement aux stratégies qui portent leurs fruits à court-terme et à celles qui porteront leurs fruits dans le long-terme.
A court-terme il importe de lutter contre les nombreuses poches d’inefficacité, de mieux gérer la dépense publique. Plusieurs chiffrages sont aujourd’hui avancés qui indiquent qu’il devrait être possible de réduire les dépenses de plusieurs dizaines de milliards par an, voire plus. Je suis certain que les orateurs qui suivent y reviendront. Mais cela, une fois encore, ne saurait suffire.
Il nous faut une stratégie ambitieuse sur le long terme si nous voulons sortir de l’impasse dans laquelle nous nous trouvons. Pour faire demi-tour, pour emprunter de nouveau une route d’avenir, un changement de philosophie s’impose. Il nous faut tenter ce que nous n’avons pas voulu tenter ces dernières décennies, alors même que nos voisins – qui eux étaient plus lucides – amorçaient un virage à 180 degrés.
Ce demi-tour consiste à réduire le domaine de l’intervention publique. Retrouver nos libertés, reprendre confiance dans les individus, les associations volontaires et les marchés.
L’IREF a décerné cette année le Prix Frédéric Bastiat à Javier Milei parce qu’il a eu le mérite de comprendre que l’on ne peut tourner la page de 50 années d’étatisme sans un engagement clair à changer de cap. Et il a eu le mérite d’incarner ce changement. Souhaitons-lui de réussir et souhaitons qu’une majorité parmi les électeurs français prenne conscience que ce changement de cap est salutaire. C’est notre seule issue et c’est notre tâche de les en convaincre.