L’un des piliers d’une réforme libérale est la réduction des dépenses publiques. Mais on ne peut, comme l’ont fait de nombreux « gilets jaunes », réclamer à la fois cette réduction et souhaiter davantage de services publics. Pourquoi d’ailleurs tant de services publics, d’administrations, de fonctionnaires dans notre pays ? C’est, dit-on, parce qu’ils sont indispensables pour produire des biens publics. Je propose de prendre la séquence à l’envers. Existe-t-il des biens publics[1] ? La théorie économique n’en repère que très peu – au contraire semble-t-il de la science politique ou juridique. S’il y a peu de biens publics, nul besoin d’autant de services publics ; ils n’existent qu’à titre subsidiaire. D’ailleurs les biens publics doivent-ils être produits par des monopoles publics ? Il va de soi que réduire la sphère des services publics c’est obligatoirement diminuer les dépenses publiques payées par l’impôt et autres prélèvements obligatoires. Je crois donc nécessaire de remonter à la source des dépenses publiques : les biens publics.
- Biens publics et biens marchands
La théorie économique oppose biens publics et biens marchands. La valeur d’un produit (bien ou service) marchand est fixée par contrat dans le cadre d’un échange volontaire[2]. Le plus souvent cet échange est monétaire, puisqu’un prix s’exprime plus facilement en monnaie.
Mais, disent les critiques de l’économie de marché, l’échange a-t-il été volontaire et le prix a-t-il été juste ? Les socialistes prétendent que l’échange est souvent inégal, parce que les parties sont inégales : l’un est plus riche, plus puissant, mieux informé que l’autre[3]. Ainsi les critiques adressées à l’économie de marché appellent-elles naturellement le recours à l’économie dirigée.
Mais la théorie économique admet aussi que l’économie de marché a ses limites, mais pas du fait de l’inégalité des parties : du fait de l’inexistence des parties, de l’impossibilité d’un contrat. Un bien public est public parce que l’acquérir par contrat est impensable. En effet l’échange suppose la propriété des biens échangés, et l’identification des propriétaires, et ce n’est pas possible pour certains produits. Pour quelles raisons ?
Res ullius res nullius
Les économistes de l’école des droits de propriété[4] repèrent au moins deux caractéristiques de ces biens : non-excluabilité et non-rivalité. Excluabilité : nul autre que le propriétaire n’a l’usage, le fruit et la disposition du bien. Par contraste ce qui est à tous n’est à personne. Rivalité : si quelqu’un tire avantage du bien il en prive quelqu’un autre. Par contraste tout le monde peut profiter d’un bien sans empêcher les autres d’en jouir également, la consommation des uns ne diminue pas la consommation des autres. Dans des conditions normales l’air pur n’est pas marchand : tout le monde le respire et il y en a pour tout le monde. Peut-on empêcher des spectateurs de voir un feu d’artifice tiré devant la Tour Eiffel ? Il va émerveiller des dizaines de milliers de Parisiens, dont on ne relève pas l’identité. La défense nationale est globale, elle protège toute la population, y compris les antimilitaristes. Voilà donc des biens non marchands : on ne peut fractionner ni leur production ni leur consommation.
Renoncer aux besoins ?
A priori, les informations indispensables à la conclusion d’un marché n’existent donc pas, ou sont trop onéreuses à obtenir. D’un côté le producteur ne peut pas identifier les consommateurs de biens publics, donc il ne peut pas les faire payer. D’un autre côté, le consommateur n’a aucune raison de payer pour un bien public qui est accessible à tous (c’est un comportement de « free rider » : laissons les autres payer). Les situations et exemples évoqués ont pour conséquence inéluctable que le bien ou le service risque de ne jamais exister, alors même qu’il répond à un besoin réel d’une population, qui ne pourrait s’en passer : besoins d’air, de fête, de sécurité. Aucun entrepreneur marchand ne tenterait la production d’un tel bien qui ne serait payé par personne, et qu’il devrait fournir à tous.
Là où l’entreprise et le marché défaillent, quelqu’un doit donc intervenir, et prendre en charge cette production, en faisant payer de force tout le monde. Mais qui peut se permettre d’instaurer un prélèvement obligatoire, sinon l’Etat ou quelque autre organe public disposant du pouvoir de coercition ? Les biens deviennent ainsi publics, puisqu’en principe la puissance publique a les moyens d’obliger tout le monde à leur création et à leur gestion. Le bien public est ainsi « nationalisé ».
- Quand les biens publics deviennent marchands
La dénationalisation est-elle pour autant impensable ? Si les socialistes ont tendance à prendre prétexte des biens publics pour élargir la sphère de la puissance publique, le prétexte est fragile.
Bien public et information
L’exemple du feu d’artifice est révélateur. D’une part il y a un marché non pas pour les Parisiens, mais pour tous ceux qui veulent avoir le plaisir de regarder le feu d’artifice sur leurs écrans de télévision. Et la retransmission télévisée peut très bien être payante. Voici d’autre part une nouvelle affaire à considérer : en passant de la diffusion par ondes hertziennes à la diffusion par câble ou par télécommunication (satellite), on peut repérer le téléspectateur, identifier la qualité et la quantité des émissions qu’il consomme. On peut alors lui facturer une prestation, et lui couper l’émission s’il refuse de payer : le bien naguère public (TV classique) est devenu bien marchand, et la redevance forfaitaire (payée avec l‘impôt sur le revenu) devrait laisser place à un abonnement ou à une facturation à l’unité.
Un autre exemple va dans le même sens : les routes peuvent devenir payantes si on installe des bornes qui enregistrent le passage d’un véhicule lui-même équipé d’une puce électronique (c’est ainsi que les péages d’autoroutes n’existent plus en Autriche ou d’autres pays). Ces exemples montrent que le classement d’un bien comme public est une question de fait et qu’il existe un lien étroit entre bien public et information.
Par conséquent, tout changement dans les techniques d’information peut transformer un bien naguère public en bien marchand. La défense « nationale » aura-t-elle encore un sens du jour où la précision de la cible des armes aura atteint celle d’un décimètre ?
Les externalités
Se poser cette question c’est relativiser le concept « d’externalités » popularisé jadis par A. C. Pigou pour décrire les effets indirects des actions humaines, effets qui ne pourraient pas être pris en compte[5]. Les externalités demeurent l’un des arguments majeurs des socialistes pour critiquer l’économie de marché : le prix d’un bien ne pourrait intégrer les effets négatifs ou positifs de la production et de la consommation du bien considéré. Mais en revanche la puissance publique serait capable d’explorer ce qui échappe à la connaissance et au calcul de l’entrepreneur. Voilà aussi une autre légitimation du « principe de précaution » inscrit dans notre Constitution : quand on ne sait pas calculer les externalités il ne faut rien faire. C’est une extraordinaire prime à l’immobilisme ou, plus précisément, c’est une justification de l’extension des interventions de l’Etat, allant jusqu’au monopole du changement. Seul l’Etat connaîtrait le vrai progrès.
Cette présomption est futile et fatale. Futile parce que l’importance et la rapidité avec lesquelles se diffusent les techniques d’information permettent de mesurer ce qui naguère était incommensurable. Fatale parce que l’acharnement contre l’économie de marché conduit à l’Etat totalitaire : tout devient public, et disparaît la liberté d’entreprendre, d’échanger, de contracter.
- Quand les biens marchands deviennent publics
Paradoxalement, en dépit du progrès technique, la liste des biens publics n’a cessé de s’allonger en France : les arguments socialistes ont convaincu. Ils ont même un regain de célébrité avec l’importance portée désormais aux biens environnementaux[6].
Biens publics par décret
On a en France l’habitude de parler de transports « publics » Seraient-ils par nature différents des voyages de « particuliers » ? Certainement pas. C’est en fait que le voyageur ne paye pas, ou pas entièrement, son voyage. Mais quelqu’un d’autre paye pour lui. Le prix du ticket de train ou de métro est diminué parce que le transporteur est subventionné par quelque administration publique. Le transport n’est public que par le mode de paiement. Il n’est pas un bien public par nature, d’ailleurs dans plusieurs pays ou plusieurs villes, c’est la totalité du prix qui est payée par le voyageur. Le transport est par nature « marchand », c’est une intervention publique qui l’a voulu public. Ce qui est vrai pour le transport l’est aussi pour de nombreux autres services (entre autres l’enseignement, le spectacle, les soins) voire même pour certains biens (énergie, armement, infrastructures routières). C’est donc finalement une décision politique qui fixe la frontière entre le public et le marchand.
Cette décision procède d’un choix entre le collectif et l’individuel, même dans les pays dits libres. Quand les considérations électorales entrent en jeu, progressivement s’installe l’idée que ce qui est public est généreux, ce qui est privé est égoïste voire injuste. La philosophie égalitariste est à l’œuvre : n’est-il pas normal qu’au sein de la société toute personne puisse vivre décemment, accéder aux mêmes droits que les autres ? Les droits ne sont-ils pas « sociaux », les besoins à satisfaire ne peuvent-ils être décrétés et organisés par les pouvoirs publics ?
C’est sans doute ce qui explique le succès des biens publics en France, un pays dont Tocqueville avait découvert le vice majeur : la jalousie. Un pays où chacun passe son temps à regarder « le jardin du voisin »[7]. Qui pourrait être exclu d’un voyage parce qu’il n’en aurait pas les moyens ? Qui ne pourrait aller à l’école faute d’argent ? Ni aller au théâtre, ni visiter un musée, et, évidemment, ni se faire soigner.
Egalitarisme et Etat Providence
L’inconvénient de l’égalitarisme est qu’il nivelle peut-être les conditions – bien qu’en république socialiste certains s’arrangent pour être plus égaux que d’autres –, mais qu’il est négation de la responsabilité et de la propriété. De la responsabilité puisque le lien entre la satisfaction des besoins et la contribution aux besoins des autres est rompu, la référence au travail, à l’épargne, à l’entreprise est effacée. De la propriété parce que ceux qui ont créé et servi la communauté par leurs initiatives sont spoliés pour pouvoir financer la « solidarité » à travers les transferts imposés par la puissance publique. Tout est évidemment bien résumé par la formule de Bastiat : « l’Etat c’est la grande fiction sociale à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde »[8].
Voilà comment les biens marchands sont devenus biens publics avec l’assentiment général, ceux qui sont spoliés devenant à leur tour des spoliateurs pour compenser le dommage qu’ils ont subi. C’est la « spoliation réciproque »[9].
Mais comment concilier l’existence des droits « sociaux » avec le droit commun et le plus fondamental, le plus humain des droits individuels, le droit de propriété ?
- « L’école des services publics »
En France la multiplication des services publics doit beaucoup aux juristes de « l’école de Bordeaux » créée par Léon Duguit et développée par Gaston Jèze. C’est une théorie juridique typiquement française, puisque notre pays a (au moins depuis la Révolution) la particularité de soustraire l’Etat et ses administrations au droit commun. Conseil d’Etat et Tribunaux administratifs sont seuls compétents pour juger d’affaires dans lesquelles la puissance publique est impliquée. C’est l’exact contraire de ce que l’on appelle « l’état de droit » (la rule of law des anglo-saxons). Toutefois au XIXème siècle la jurisprudence du Conseil d’Etat, n’est concernée que pour les missions régaliennes de l’Etat.
Du service public aux services publics
C’est à la fin du XIXème, et sans doute en liaison avec le progrès des idées socialistes, que les sociologues et les juristes proposent une nouvelle version du rôle de l’Etat et donnent au concept de « service public » un sens nouveau, même s’il est ambigu. Durkheim est le sociologue, Duguit est le juriste, professeur à la faculté de droit de Bordeaux. De son ami Durkheim Duguit va reprendre l’idée que l’Etat a une mission de service public : assurer la « cohérence sociale », apaiser et arbitrer les conflits. Duguit préfère d’ailleurs parler d’« interdépendance sociale »[10]. Jusque-là il n’y a rien de très nouveau, puisque depuis des siècles nombre de penseurs croient que le pouvoir politique est source du bonheur de tout le monde et agit dans l’intérêt général[11].
Mais Duguit va maintenant découvrir que le « service public » (singulier) implique la création de « services publics » (pluriel) destinés à assumer des activités qui n’ont aucun lien avec les missions régaliennes, en particulier des activités commerciales et industrielles. Les transports urbains (tramway de Bordeaux) sont un bon exemple de ces services publics. Et le juriste de soutenir qu’il y a des relations contractuelles entre les usagers et l’Etat. En transposant l’article 1134 du Code Civil (devenu 1103 depuis la réforme de 2016), ce contrat est la loi qui régit les parties. Donc les usagers peuvent ester en justice (administrative) contre l’Etat s’ils estiment que l’Etat ne respecte pas ses obligations contractuelles. Sans hésiter Duguit affirme qu’il s’agit ainsi de protéger les droits individuels.
Le contrat entre Etat et usagers
De la sorte va naître un curieux dualisme au sein du droit public entre actes d’autorité et actes de gestion[12]. La loi va être tantôt celle du Parlement (qui fixe le contenu du service public, c’est-à-dire le volume de la sphère publique) et tantôt celle des contrats passés entre Etat et usagers des services publics (comment est administrée la sphère publique). Il reviendra à Hans Kelsen et son disciple français Charles Eisenmann de soutenir que cet apparent désordre s’inscrirait en réalité dans une hiérarchie des normes du droit public, dont le sommet serait la constitution.
Ce sont de telles habiletés intellectuelles qui ont permis l’expansion extraordinaire du droit des services publics issu de la jurisprudence du Conseil d’Etat. L’Etat Providence a ainsi trouvé ses assises juridiques, et les services publics ont pu se multiplier sans craindre l’illégalité ou l’arbitraire, puisque leur existence et leurs bienfaits sont sous surveillance de l’autorité publique.
Progressivement les obligations contractuelles des services publics seront reconnues et (théoriquement) protégées : généralité (ouverts à tout citoyen), continuité (ils doivent être permanents) et gratuité (leurs bénéficiaires n’en paient pas le coût réel). C’est dire que même s’ils sont rendus par des personnes privées (associations ou établissements ou entreprises concessionnaires) ils échappent au droit commun et aux règles du marché (liberté contractuelle, concurrence).
Cette dernière particularité n’a pas manqué d’ouvrir un conflit entre le droit administratif français (dont le concept de service public est « la clé de voûte » disait Gaston Jèze) et le droit européen fondé sur le concept de marché unique.
Mais en s’affranchissant du droit commun le service public limite aussi le droit de propriété. Il peut aller jusqu’à le nier, comme lors des nationalisations de 1945[13] suivies de la Constitution de 1946 prévoyant le « retour à la nation » de la plupart des activités commerciales, industrielles et financières. Mais aujourd’hui encore l’idée du service public imprime sa marque dans le droit de l’urbanisme, de la construction, du transport, de l’hygiène et de la santé, de l’enseignement, du travail, etc. Dans ces diverses activités, le droit de propriété privée est ignoré ou limité par une réglementation à la fois arbitraire, instable donc incertaine, bureaucratique donc couteuse, mais une réglementation validée par le droit public toujours à l’heure de l’école de Bordeaux.
- Privatisation des services publics :le principe de subsidiarité
L’échec financier et le désordre bureaucratique des services publics ont progressivement suscité un reflux. Après une expérience particulièrement réussie avec la création de la SNCF, la grande vague de nationalisations de 1945 a été remise en cause par plusieurs privatisations.
Privatisations à la française
Ces privatisations se sont succédées à partir de 1986 et jusqu’en 2017 – aujourd’hui la bataille pour la privatisation d’Aéroport de Paris est toujours incertaine. Progressivement ont été rendues à la logique du marché, de la concurrence et du capital les entreprises nationalisées en 1945 ou 1981 : industries mécaniques, minières, énergie, banques et assurances, autoroutes et aéroports. On remarquera cependant que ces privatisations se sont faites « à la française » : avec une lenteur désespérante puisqu’il a fallu plus de 30 ans pour les réaliser, mais aussi en gardant pour l’Etat des dispositions permettant de lui assurer une présence et même parfois un contrôle au sein des conseils d’administration. Ainsi, contrairement à ce qu’on laisse croire, la SNCF n’a pas été réellement privatisée[14].
Pourquoi s’intéresser à ces privatisations ? La première raison est qu’elles ont bien confirmé l’analyse des biens publics : les activités qualifiées de « services publics » n’avaient d’autre source que la volonté délibérée des gouvernements. Les biens et services produits n’étaient pas publics par nature, mais par décret. C’est donc tout naturellement et avec succès que des entreprises et des secteurs naguère tenus pour publics sont entrés dans la logique marchande, même si l’héritage d’un long passé hors marché a lourdement pesé (notamment l’héritage syndical, puisque le public a été pendant un demi-siècle la chasse gardée de la CGT et de FO).
Le principe de subsidiarité
La deuxième raison est qu’elles donnent une illustration concrète de l’importance de la subsidiarité, principe de base du libéralisme. Suivant ce principe il n’est nul besoin de recourir à l’intervention publique et à sa puissance (notamment le monopole et les prélèvements obligatoires) quand des initiatives privées marchandes (rendues par des entreprises) ou communautaires (familles, associations) peuvent rendre les services nécessaires. Dans une société de liberté on ne recourt à l’Etat et ses administrations qu’à titre subsidiaire.
Le principe de subsidiarité exigerait une totale privatisation des services publics. La législation européenne (si nocive à d’autres égards) a obligé la France à soumettre ses « services publics » à la concurrence. La France ne l’a pas accepté de bon cœur, elle traîne les pieds pour le transport ferroviaire ; parfois même elle s’est refusée à tout changement, comme en ce qui concerne l’assurance maladie et les retraites[15]. Mais tôt ou tard la concurrence et le marché emporteront ce qui reste des pseudo services publics, sous la pression de la mondialisation, pression directe (respect des traités) ou indirecte (ruine des entreprises françaises et des finances publiques si le choix du protectionnisme est fait).
On peut enfin prévoir une prise de conscience des Français eux-mêmes. L’Etat et le secteur public ont perdu beaucoup de crédibilité, le lien se fait progressivement entre pression fiscale et poids des administrations. Les Français en viendront peut-être à réaliser la fiction de l’Etat Providence ; quand ils auront compris que les biens qu’ils attendent de l’Etat peuvent leur être fournis par d’autres voies, à meilleure qualité et à moindre coût.
- Dépenses publiques
Me voici revenu, sans doute grâce à un « détour productif », au point de départ : comment diminuer les dépenses publiques ? La méthode généralement évoquée pour diminuer les dépenses publiques consiste à « faire des économies », mais elle ne change pas la structure de la société et ne réduit pas la sphère publique. En finir avec les pseudo-services publics, privatiser tout ce qui ne concerne pas les missions régaliennes de la puissance publique, utiliser les ressorts de l’initiative privée pour mieux assurer ces missions : voilà qui non seulement conviendrait mieux aux citoyens, éliminerait la misère et les tensions, mais qui diminuerait drastiquement les dépenses publiques.
Le secteur privé fait mieux : pourquoi ?
Il est possible de mesurer les pertes actuelles liées à l’inflation de services publics. Les coûts de la Sécurité Sociale sont pour les assurés français plus élevés d’environ un tiers que ce qu’offrent à l’étranger la plupart des compagnes d’assurance privées, avec des démarches plus simples[16]. Les cliniques privées, pourtant contraintes par l’Etat, offrent des opérations et des soins en moyenne moins coûteux que ceux des hôpitaux publics, il leur est possible de réaliser des profits et investir. L’école privée, les cantines et les jeux sont à la portée de toutes les familles dans la plupart des pays européens. Les musées, les théâtres sont privés un peu partout. On peut estimer que le simple déplacement de la sphère publique vers l’activité privée vaudrait au moins un point de croissance du PIB total français[17].
Ces prévisions chiffrées ne sauraient d’ailleurs surprendre, car elles ne font que traduire le changement total de comportement des acteurs de la vie économique et sociale. Le changement est inéluctable parce que l’activité privée est dominée par le sens des responsabilités personnelles. Responsabilité imposée par la logique de l’échange marchand, qui fournit aux producteurs les signaux décisifs des prix et des profits et les met en concurrence, qui est un procédé de découverte et conduit à l’innovation[18]. Responsabilité engendrée par la solidarité volontaire et l’esprit de partage qui joue au sein des communautés familiales, locales, associatives.
Le champ ouvert à l’économie et la solidarité privées est considérable. C’en est même au point que les missions régaliennes elles-mêmes seront mieux assumées par la puissance publique si elles font appel au secteur privé. L’Etat et ses administrations ne sont pas seuls qualifiés pour les produire. Certains biens publics (comme les phares chers à Ronald Coase)[19] ont été créés par des initiatives privées. De plus, les missions régaliennes classiques peuvent avantageusement être assurées en recourant à des entreprises privées. Ce recours peut prendre la forme de sous-traitance (prisons privées), mais aussi bien de délégation pure et simple (sociétés de surveillance, mercenaires opérant sur de nombreux théâtres d’opération en Afrique ou au Moyen Orient). D’ailleurs le contenu même de la mission régalienne peut être affiné, il n’est pas toujours nécessaire pour la puissance publique de recourir au monopole de la violence qui lui est reconnu. Par contraste l’Etat a perdu beaucoup de sa puissance et de son prestige en devenant Etat Providence.
Les biens environnementaux
Un exemple remarquable et actuel est celui des biens environnementaux. Ils ont toutes les apparences des biens publics, car nul ne peut se passer d’air pur ni d’eau potable et la diversité biologique est sans doute vitale à long terme. Mais il est maintenant démontré que le droit de propriété privée ou plurielle est un des procédés les plus efficaces pour les produire. Les réserves marines sont un substitut salutaire de la pêche en mer, l’eau est moins gaspillée et de meilleure qualité quand le puits est exploité par un propriétaire, Les parcs forestiers nationaux ou les rivages protégés ne garantissent pas la conservation des forêts et des rivages, les plages privées ne subissent pas les dégradations des plages publiques, etc. Il existe maintenant tout un courant de pensée, validé par Elinor Ostrom[20], qui démontre la possibilité d’une alternance à l’écologie politique aujourd’hui dominante, mais bien davantage politique qu’écologique. Les néo-environnementalistes tablent aussi sur la responsabilité personnelle et l’engagement communautaire[21].
Miracles électoraux de la justice sociale
C’est dire, en conclusion, qu’il y a bien d’autres solutions pour régler des questions qui concernent une population entière ou très étendue que d’en confier la gestion à la puissance publique. Les solutions politiques souffrent toujours du comportement de la classe des politiciens, car la démocratie représentative engendre le clientélisme électoral, et crée sans cesse de nouveaux privilèges, c’est-à-dire de nouveaux transferts qu’il faut bien financer. Il est facile de trouver de bons prétextes pour subventionner, pour secourir. La « justice sociale » fait ici des miracles. Mais finalement, comme le disait Bastiat :
« on s’apercevra qu’on en est réduit à compter sur une population qui ne sait plus agir par elle-même, qui attend tout d’un ministre ou d’un préfet, même la subsistance, et dont les idées sont perverties au point d’avoir perdu jusqu’à la notion du droit, de la propriété, de la liberté et de la justice[22]. »
[1] Le concept de bien public n’a rien à voir avec celui de bien commun, ensemble des conditions qui permettent l’épanouissement de l’individu, son accomplissement en tant que personne, au sein de la société. Le bien commun, n’a d’ailleurs rien à voir avec l’intérêt général, dont le théorème d’Arrow a démontré la vacuité. Mais, dans le discours politique, on mêle imprudemment, parfois volontairement, bien public, bien commun et intérêt général : autant de piliers de la « justice sociale ».
[2] La comptabilité nationale calcule le PIB (produit intérieur brut) en y incluant le PIB « non marchand ». Par exemple si les administrations embauchent des fonctionnaires ou augmentent leurs traitements, le PIB augmente, le pays s’est enrichi. Mais de combien ? Du montant de cette dépense nouvelle ! Le PIB non marchand représentait en 2017 en France 21% du PIB (la moyenne pour les pays de l’Union Européenne étant à 17%).
[3] L’échange inégal est un sous-produit de la thèse marxiste de l’impérialisme et concerne les relations entre pays développés et tiers monde, (Cf. Arghiri L’échange inégal, Maspéro 1969). Aujourd’hui c’est surtout la thèse de l’asymétrie d’information qui a séduit beaucoup d’économistes, à la suite des travaux d’Akerlof (« The Market for Lemons », Quarterly Journal of Economics, Vol 84, n°3, 1970). Evidemment les critiques apportées à l’échange marchand rejettent la théorie de la subjectivité des échanges et des prix.
[4] La théorie économique des droits de propriété (Armel Alchian et Harold Demsetz) se distingue de la théorie juridique qui voit dans la propriété une relation entre une personne et une chose (usus, fructus, abusus). Le droit de propriété concernerait plutôt les relations entre personnes à propos d’une chose. Cf. “Property Rights and Economic Theory: A Survey of Recent Literature”, Eirik G. Furubotn et Svetozar Pejovich, Journal of Economic Literature, Vol. 10, No. 4 (Dec. 1972)
[5] Pigou, A. C. (1920), The Economics of Welfare. Macmillan. On lira avec intérêt l’article de Jean Pierre Centi, « Droits de propriété et coûts de l’échange : Ronald Coase revisité » dans Le Journal des Libertés Vol.1 n°2, Automne 2018.
[6] Cf. infra p. 90.
[7] Titre de l’ouvrage de Jean Fourastié et Béatrice Bazil Le jardin du voisin. Les inégalités en France, Livre de Poche,1980.
[8] Frédéric Bastiat cité in Jacques Garello, Aimez-vous Bastiat, Romillat, 2001 p.16.
[9] L’expression est de Montchil Karpouzanov (Université Américaine, Bulgarie), colloque IREF Aix en Provence 24 mai 2019 : les groupes spoliés par l’Etat Providence recherchent à leur tour privilèges, subventions, etc.
[10] Léon Duguit, Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon, Paris : Librairie Félix Alcan, 1912.
[11] « Le but de la société est le bonheur commun », Déclaration des Droits de l’Homme 1793.
[12] Cette distinction est due à Lafferrière, qui l’a introduite avec l’arrêt Blanco (1873). Elle est reprise par Duguit dans L’État, le droit objectif et la loi positive, Paris, Fontemoing 1901.
[13] Les ordonnances du 2 décembre 1945, prises à la hâte, prévoient les nationalisations des mines, de la sidérurgie, d’entreprises industrielles (Renault), des banques et compagnies d’assurance, du transport aérien et ferroviaire, de l’énergie, de la poste, etc. et la création de la Sécurité Sociale.
[14] Cf. l’article de Ronny Ktorza, « La réforme de la SNCF : beaucoup de bruit pour rien », Journal des Libertés, Vol.1 n°4, Printemps 2019.
[15] Les directives européennes de 1991 prévoyaient l’ouverture à la concurrence de toutes les activités d’assurance, que ce soit maladie ou retraites, avec un contrôle préalable des compagnies privées entrant sur le marché ; en revanche les organismes publics étaient dispensés de ce contrôle. L’Etat français a traduit ces textes comme la reconnaissance du monopole public de la Sécurité Sociale française. La Cour Européenne de Justice a dénoncé la confusion, mais n’a jamais voulu donner raison aux assurés français arguant de la législation européenne pour s’assurer ailleurs qu’à la sécurité Sociale (jurisprudence Garcia). Quant à l’ouverture à la concurrence des transports ferroviaires, la SNCF a donné aux compagnies étrangères des créneaux sans intérêt et la France a pris trois ans de retard pour le transport des voyageurs.
[16] Cf. mes ouvrages sur la question : Comment sauver vos retraites (Libréchange, 2015) et Futur des retraites et retraites du futur, (co-écrit avec Georges Lane), 3 tomes, Librairie de l’Université 2009-2012.
[17] C’est le calcul fait par Edmund Phelps, prix Nobel d’Economie 2006 La prospérité de masse, Od.Jacob 2017.
[18] Israël Kirzner Concurrence et Esprit d’Entreprise, Economica 2005
[19] Cf. Jean Pierre Centi, op.cit.
[20] Prix Nobel d’Economie 2009.
[21] Cf. Max Falque et Jean Pierre Chamoux, Environnement : le temps de l’entrepreneur, Libre Echange 2019 et Journal des Libertés Vol.1 n°3, hiver 2019.
[22] Frédéric Bastiat, Les Sociétés de Secours Mutuel, in Harmonies Economiques Chapitre XIV. Cf. mon ouvrage Connaissez-vous Bastiat, loc. cit. pp.19-20.



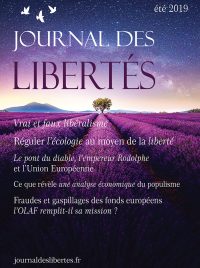
1 Commentaire
Tout ceci pour protéger tout à la fois fonctionnaires et élus afin qu’ils puissent continuer à prendre les caisses de l’état pour la Corne d’Abondance !