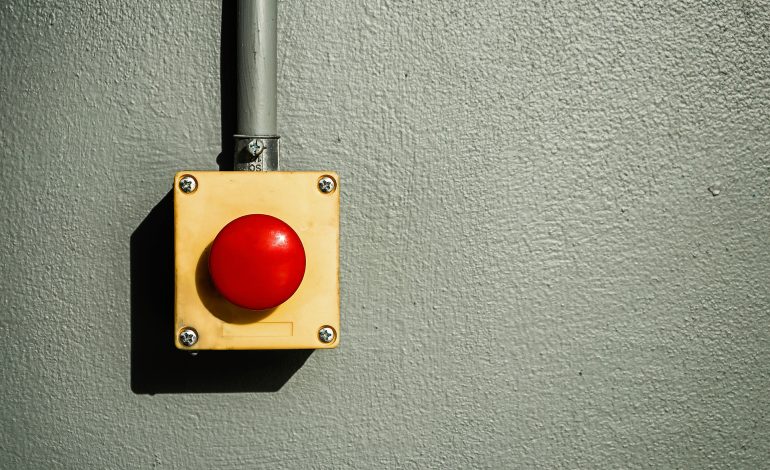La crise sanitaire du coronavirus a été en réalité une épidémie de panique à travers le monde, chaque État cherchant à en faire plus que son voisin pour éviter à tout prix la mort. C’est sans doute la première fois dans l’histoire de l’humanité que les gouvernements ont si largement cédé à la peur pour faire prévaloir la vie sur la liberté, quel qu’en soit le coût, fût-il celui de la liberté elle-même. La question de savoir si le confinement était nécessaire n’est pas examinée ici, même s’il faut constater que d’autres pays ne l’ont pas pratiqué ou de manière sensiblement plus légère. C’est parce que les Français ne sont pas disciplinés que ces mesures de confinement auront été nécessaires diront certains. Mais n’est-ce pas plutôt parce qu’on traite les Français en enfants qu’ils se conduisent en enfants. Quoiqu’il en soit, aucun confinement, si nécessaire qu’il soit, ne peut justifier un abandon par trop général des libertés, même s’il reste difficile de dire à quelles libertés il serait acceptable de renoncer pour lutter contre une épidémie. Tout reste matière de circonstances et de discernement, mais en France l’environnement politique et juridique, déjà étroitement soumis au contrôle de l’État, a favorisé des violations inconsidérées des libertés publiques.

L’OVNI « urgence sanitaire »
En France, face à l’épidémie, a été inventée la notion d’urgence sanitaire pour permettre au gouvernement de violer toutes les libertés fondamentales d’aller et venir, de commercer, de se réunir… Le Conseil constitutionnel a lui-même validé cette notion dans sa décision du 11 mai 2020 en considérant que « La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence sanitaire », ce qui est tout de même une façon lapidaire de constitutionnaliser cette notion sans la justifier sur le fond et au détriment de toutes les libertés que le dit Conseil constitutionnel est chargé de protéger. Une loi organique a été votée le 30 mars 2020 en défaut de la règle prescrivant la sagesse d’un délai de quinze jours entre le dépôt du projet de loi organique sur le bureau de la première assemblée saisie et l’examen en séance publique. Le contrôle constitutionnel des mesures édictées a lui-même-même été empêché par cette loi qui a suspendu jusqu’au 30 juin 2020 le délai imposé au Conseil d’État et à la Cour de cassation pour lui transmettre les Questions préjudicielles de constitutionnalité – QPC par lesquelles les justiciables demandent aux instances judiciaires de soumettre au Conseil constitutionnel les décisions légales et règlementaires qui leur semblent non conformes à notre état de droit. Par cette clause validée par le Parlement, la Constitution s’est trouvée en partie mise entre parenthèses pendant trois mois sans que le Conseil constitutionnel trouve à redire alors qu’il avait été automatiquement saisi de cette loi organique. Certes, Laurent Fabius a observé que la suspension des délais de recours n’interdisait pas qu’il soit statué sur une QPC durant cette période. Et d’ailleurs le Conseil constitutionnel a siégé et a rendu quelques décisions. Mais si peu !
Une magistrature en déroute
D’ailleurs, de très nombreux magistrats se sont enfuis dès le 17 mars des palais de justice comme des rats quittant un navire en perdition, sans crier gare, sans souci des affaires en cours, sans imaginer que la vie aurait pu continuer par téléconférence ou autrement. Pas tous certes, mais il y eut des Cour d’appel où une très large majorité des effectifs de la magistrature avaient déserté. Cet abandon de poste a ainsi mis la justice en veilleuse alors qu’elle est une institution essentielle dont l’État s’est arrogé le monopole, ce qui normalement devrait lui interdire de cesser son service, même devant la difficulté du virus : les militaires qui s’esquivent face aux dangers de la guerre sont des déserteurs.
Certains magistrats ont été plus courageux que d’autres, plus consciencieux, moins paresseux peut-être. Certains ont poursuivi leurs missions de service public. Le Conseil d’État en particulier a démontré son sens du devoir en traitant notamment des affaires qui lui arrivaient en référé pour statuer sur les mesures d’urgence liées au coronavirus en application des dispositions de l’article L521-2 du Code de la justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Malheureusement, outre que de nombreuses demandes ont été écartées par la justice administrative, les recours examinés ont donné lieu à des rejets dans près de 90% des cas, comme si la plus haute juridiction administrative jouait un rôle de supplétif du gouvernement. Mais les tribunaux se sont empressés de statuer quand il s’agissait d’empêcher les entreprises d’exercer leur liberté de travailler. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Nanterre s’est empressé, le 14 avril 2020, d’empêcher Amazon de poursuivre les activités de ses entrepôts parce qu’elle n’avait pas respecté un formalisme suffisant dans le recensement des risques dus au Covid et à leur prévention alors que par ailleurs le gouvernement s’exonérait en toute impunité du formalisme pour attenter aux libertés fondamentales.
Des libertés sous contrôle
Plus généralement, le poids de l’État lui a permis d’utiliser les risques du coronavirus pour faire peser sur la société des risques plus graves d’aliénation des libertés. Il a pu ainsi enfermer les personnes âgées dans les Ehpad au risque qu’elles s’y laissent glisser vers la mort par incompréhension et dépression plutôt que de mourir du virus, et pourtant sans empêcher qu’elles meurent aussi massivement du virus. Cet exemple est caractéristique de l’abandon progressif, doucement, insensiblement de l’état de droit à proportion de la croissance de l’Etat. Il n’est pas certain que ces mesures d’enfermement dans les Ehpad étaient légales, notamment pour les Ehpad privés. En vertu de quel droit peut-on empêcher les visites ou les sorties d’un pensionnaire entré librement dans un établissement pour y être logé, nourri, visité et soigné ? Mais tous les Ehpad n’existent que parce qu’ils y sont autorisés par les autorités sanitaires, beaucoup n’accueillent des pensionnaires que parce que l’argent public prend en charge une partie de leur séjour. Ils sont dans la main de l’État qui peut toujours trouver une porte qui ferme mal ou un appareil qui n’a pas été mis aux normes pour retirer l’autorisation ou supprimer les financements et faire mourir l’établissement qui n’a plus d’autre choix que d’être docile. Et il en va de même pour les familles qui auraient pu emmener leurs parents âgés hors de l’Ehapd où on les enfermait, mais au risque de se voir refuser d’y retourner le jour venu, voire d’être mis en accusation pour homicide en cas de décès de la personne âgée. Ainsi se généralisait une sorte de chantage latent au préjudice des libertés.
Le chantage était plus explicite en matière d’aide d’État aux entreprises. Le gouvernement français a annoncé que les grandes entreprises qui distribueraient des dividendes à leurs actionnaires cette année ou qui ont une société mère ou fille domiciliée dans un pays à fiscalité privilégiée ne seraient pas éligibles aux aides publiques : reports de charges, prêts garantis par l’État…. Mais les dividendes n’appartiennent pas à l’État, ils sont le juste retour des investissements des actionnaires, souvent des petits actionnaires ou des fonds de pension qui versent des retraites à de petits pensionnés. Ces mesures peuvent donc être injustes autant que néfastes en éloignant les capitaux des entreprises qui en auront plus que jamais besoin. Une société peut avoir sa société mère ou une filiale dans un paradis fiscal sans le cacher au fisc, sans chercher à réduire ses impôts, mais pour des raisons commerciales, juridiques… D’ailleurs, le gouvernement semble avoir réduit ses prétentions au titre de cette mesure, mais le seul fait de l’avoir annoncée souligne sa volonté d’intrusion dans la vie des entreprises. L’idée de punir les actionnaires qui ne se comportent pas comme le gouvernement le souhaite, pratiquer de la discrimination entre les bons, bénéficiaires des aides, et les méchants qui en sont exclus, relèvent d’une forme d’absolutisme. La société glisse naturellement vers le despotisme, voire jusqu’au totalitarisme, quand tout dépend peu ou prou de l’État. Le moindre prétexte, comme une pandémie, peut l’y faire basculer sans crier gare quand tous les rouages de la machine à broyer les libertés sont déjà là.
Des libertés entravées sans raison
Les libertés des entrepreneurs ont été phagocytées par des instructions aussi minutieuses que stupides parfois pour travailler dans les bureaux ou les ateliers pendant la période du déconfinement. Avant que le Parlement ait un instant de raison pour l’empêcher, le projet de loi d’urgence du 11 mai voulait que les médecins soient payés pour faire de la délation et rompre la confidentialité à l’égard de leurs patients. Et nos libertés ont été d’autant plus restreintes an nom du coronavirus que l’État impotent ne s’est attaqué qu’aux causes faciles : les policiers préféraient arrêter les trois prêtres et leurs trois chantres qui célébraient dans une église parisienne une messe radiodiffusée, plutôt que d’aller rétablir le calme dans des banlieues en manque exaspérées par le confinement. Il n’y avait peut-être pas suffisamment de forces de police pour y aller parce que des milliers de gendarmes étaient mobilisés, avec des drones, hélicoptères, quads, motocross et autres matériels sophistiqués, pour faire respecter l’interdiction d’accès aux espaces naturels. Ça devait les empêcher aussi de contrôler les rassemblements journaliers du ramadan !
Le risque le plus grand est encore que les mesures attentatoires des libertés prises au prétexte de la situation d’urgence soient, du moins en partie, pérennisées après la crise. C’est presque toujours ainsi sauf à ce que la société y prenne garde. Il est donc très important de veiller à ce que les mesures provisoires prennent effectivement fin à l’issue de l’urgence sanitaire. C’est écrit ainsi dans les textes d’exception, mais s’agissant d’une épidémie susceptible de résurgences et dont la fin ne pourra être décrétée qu’en fonction d’une appréciation plutôt que de critères objectifs, il est possible de craindre que certaines mesures d’exception soient maintenues, partiellement peut-être, pour un temps indéterminé avant qu’on oublie de les faire disparaître.
D’autres dispositifs pourront être installés durablement dans le paysage administratif à l’encontre de nos libertés. Il en va ainsi des systèmes d’information numérique visant à contrôler les contacts de chacun avec chacun. Les administrations de santé se sont déjà fait attribuer très largement par la loi du 11 mai 2020 le droit d’en utiliser les données. A terme nous serons ainsi tous un peu plus fichés.
Rétablir des institutions de liberté
Mais comme j’espère l’avoir démontré, à l’occasion d’un danger tel que le coronavirus, l’atteinte aux libertés ne peut largement prospérer que si les institutions et l’esprit de la société sont déjà corrompus par l’hégémonie du pouvoir. Et nous y sommes. Nous sommes en quelque sorte revenus à l’antique conception grecque de la liberté tout entière soumise au bien de la cité :
« Les Anciens, relève Lord Acton, connaissaient bien mieux les mécanismes du pouvoir que ceux de la liberté. Ils concentraient tant de prérogatives dans le giron de l’État qu’il ne restait plus d’espace d’où quiconque eût pu contester ses décisions ou fixer des limites à son action… Les obligations les plus sacrées s’effaçaient devant les intérêts supérieurs de l’État. Les passagers n’existaient que pour le bien du bateau[1]. »
Peut-être devrions-nous dire « pour le bien de son équipage », ces fonctionnaires toujours plus nombreux autant qu’inutiles. Nous autres, les passagers, ne sommes donc plus que des nombres, des morts à éviter pour conserver des usagers, au risque que nous abandonnions notre liberté sans laquelle pourtant nous pouvons perdre notre humanité. Seuls comptent les statistiques, les bilans de santé collective, les chiffres qui démontrent que le bateau fonctionne et que son commandement doit en être loué.
C’est la démocratie subordonnée au pouvoir de l’État qu’il faut rénover pour retrouver un État ordonné à la démocratie. Il y faut un équipage moins important, tant le nombre, au-delà d’une certaine limite, peut submerger la société. Ce qui veut dire qu’il faut faire maigrir l’État, le débarrasser de tout ce qui peut être mieux assuré par les acteurs privés de la société : de l’économie à l’école, de la santé à la culture. Il lui restera les fonctions régaliennes qui seules peuvent dans certains cas justifier un statut spécialement protecteur pour ses personnels.
Il faut encore rétablir le droit dans sa plénitude, c’est-à-dire un droit qui s’applique à tous, y compris et peut-être d’abord à l’autorité publique elle-même. « Enlève le droit, disait Saint Augustin, et alors qu’est-ce qui distingue l’État d’une grosse bande de brigands ? »[2]. C’est-à-dire aussi un contrôle constitutionnel qui soit réellement indépendant, et courageux, dont l’objet ne serait que de défendre le droit et non de louvoyer, à l’image de Cour de Karlsruhe qui n’a pas hésité à s’opposer à la BCE par sa décision du 5 mai 2020. Parallèlement, le partage des pouvoirs au sommet de l’État doit lui-même être clarifié et équilibré pour éviter le risque de dérive d’un pouvoir quasi entièrement entre les mains du Président de la République. La constitution doit préciser les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, très limitativement, aux libertés fondamentales au motif d’un quelconque cas d’urgence et ces dérogations ne doivent pouvoir être, intégralement, que provisoires pour une période courte renouvelable dans des conditions de majorité renforcée dans chacune des deux chambres parlementaires. Ça n’empêchera pas de prendre des mesures de précaution et de protection, mais sous un vrai contrôle parlementaire et constitutionnel. Il suffit sans doute de revenir à l’idée moderne de la liberté individuelle. La fonction du gouvernement y a vocation de permettre aux citoyens d’exercer la plénitude de leurs libertés dans le respect de celles des autres. Cette conception a permis de faire éclore de nouvelles libertés qui ont elles-mêmes été capables de transformer le monde pour que les hommes y vivent plus vieux en meilleure santé en souffrant moins de la misère. Elle a permis que Pasteur soigne en 1885 son premier patient guéri de la rage sans attendre que ses tests aient tous suivis le parcours labyrinthique des administrations de santé. Elle a permis que la vapeur, l’électricité, le moteur à combustion, l’électronique… arrivent sur le marché comme ils n’y seraient jamais parvenus s’il avait fallu respecter tous les principes de précaution et autres règlementations qui sont aujourd’hui le lot commun. Il faut donc, avec discernement, rendre aux hommes leur liberté pour qu’ils continuent d’être créatifs pour lutter contre tous les maux du monde, y compris les épidémies, avec plus d’agilité que les États obèses et leurs administrations tatillonnes. Il faut leur rendre leur liberté parce que c’est l’essence même de leur humanité qui consiste pour chacun à rechercher ses propres fins, à la quête toujours incertaine du bien que l’État ne peut pas déterminer pour nous. La notion de situation d’urgence, sanitaire ou autre, ne peut légitimer des contraintes que très exceptionnellement et très provisoirement, sous cet éclairage.
[1] Lord Acton, Le pouvoir corrompt, Bibliothèque classique de la liberté, Les belles lettres, mars 2018, p.78.
[2] Cité de Dieu, IV,4, 1
 Jean-Philippe Delsol est docteur en droit et licencié ès-lettres. Il travaille comme avocat fiscaliste et préside l’IREF (Institut de Recherches Economiques et Fiscales). Son dernier ouvrage est : Echec de l’Etat, Pour une société de libre choix, Le Rocher, 2017.
Jean-Philippe Delsol est docteur en droit et licencié ès-lettres. Il travaille comme avocat fiscaliste et préside l’IREF (Institut de Recherches Economiques et Fiscales). Son dernier ouvrage est : Echec de l’Etat, Pour une société de libre choix, Le Rocher, 2017.