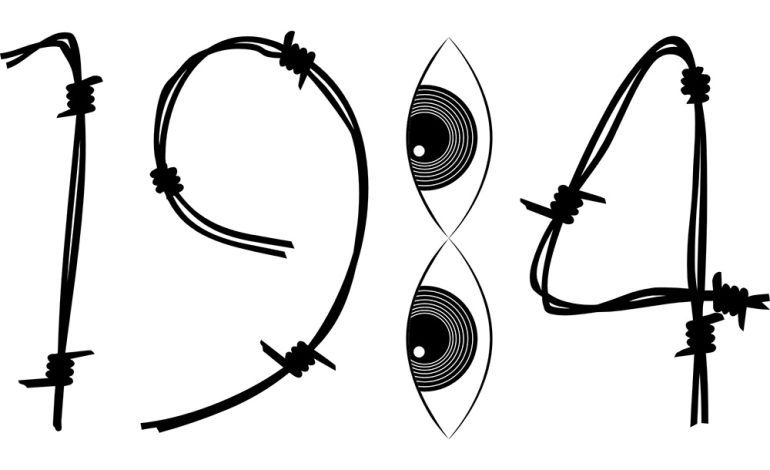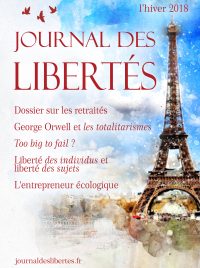Introduction :
Légitimité, droit de résistance, révolution et sécession
La légitimité d’un pouvoir désigne son bien-fondé. Sociologiquement, elle renvoie au régime qui est considéré par les gouvernés comme le régime légitime. Elle permet de fonder leur obéissance et leur obligation à obéir, au-delà du monopole de la violence que détient ce pouvoir dans certaines limites territoriales.

|
Jean-Philippe Feldman est professeur agrégé des facultés de droit, maître de conférences à SciencesPo et avocat à la Cour de Paris. Il a notamment publié La bataille américaine du fédéralisme (PUF, 2004) et De la Ve République à la Constitution de la liberté (Institut Charles Coquelin, 2008). |
Le droit de résistance se comprend comme celui d’un sujet de ne pas obéir à un pouvoir illégitime. La résistance peut aboutir à la révolution, c’est-à-dire au renversement du pouvoir en place. Historiquement, elle est entendue comme un droit consubstantiel à l’homme et même, révolutionnairement, comme un devoir. Dans une perspective lockéenne, le droit de résistance est la meilleure garantie contre la rébellion et la meilleure façon de l’empêcher. Le moyen le plus propre de prévenir les abus des gouvernants est d’en montrer les dangers et l’injustice à ceux qui seraient tentés de les commettre comme le rappellent les termes liminaires de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Le droit de résistance ne se retrouva pas dans la Constitution américaine de 1787, pas plus que dans les premiers amendements, pour la simple et bonne raison qu’il apparaissait évident aux yeux de la plupart des citoyens.
L’actualité, notamment européenne, invite à une réflexion sur une autre notion proche : celle de sécession. Comment peut-on la définir ? Quel est son traitement par le droit international ? Existe-t-il un droit de sécession ?[1]

Barcelone, Catalogne, Espagne, le 11 septembre 2017: les manifestants soutiennent l’indépendance de la Catalogne à l’occasion de la fête nationale
Riderfoot / Shutterstock.com
- Qu’est-ce le droit de sécession ?
Étymologiquement, le terme sécession vient du latin secedo et il trouve son origine dans le français du XVIIe siècle, avant d’apparaître en anglais au début du XIXe. Il se comprend alors comme l’action de se retirer de la vie publique ; dans l’histoire romaine, comme la migration temporaire des Plébéiens dans un lieu hors de la cité afin de contraindre les Patriciens à accorder réparation de leurs griefs ; enfin comme l’action de se retirer d’une alliance, d’une fédération, d’une organisation politique ou religieuse. Le verbe latin secedo signifie aller à l’écart, s’écarter, se retirer, s’éloigner ou encore se séparer, se révolter, faire scission. Le Littré fait état de deux sens issus d’étymologies différentes. Venant du latin sedeo, la sécession est l’action par laquelle une partie de la population d’un Etat se sépare de façon pacifique ou violente de l’ensemble de la collectivité en vue de former un Etat distinct ou de se réunir à un autre. Venant de secessio, elle se dit historiquement des trois époques où la Plèbe se retira en armes hors de la ville pour forcer le Sénat à reconnaître ses droits. Elle caractérise aussi la séparation d’un Etat confédéré d’avec la fédération dont il fait partie.
Dans son avis du 20 août 1998 dit « renvoi relatif à la sécession du Québec », la Cour suprême du Canada définit la sécession dans son paragraphe 83 de la manière suivante : « La sécession est la démarche par laquelle un groupe ou une partie d’un Etat cherche à se détacher de l’autorité politique et constitutionnelle de cet Etat, en vue de former un nouvel Etat doté d’une assise territoriale et reconnu au niveau international ». La sécession se définit ainsi comme le retrait du « peuple » d’un Etat moderne, selon le principe du droit de libre gouvernement, qui aboutit à un démembrement territorial de l’Etat. Ce n’est pas une révolution, parce qu’elle ne rétablit pas quelque chose au sens étymologique du terme, et parce qu’elle ne cherche pas à transformer l’ordre social et politique. Pour d’autres auteurs, la sécession est le processus de divorce politique et de formation d’au moins une nouvelle unité souveraine à travers une déclaration formelle d’indépendance. Pour d’autres encore, c’est un droit individuel de s’engager dans une action collective pour aboutir à une sécession. L’alternative posée par le droit de sécession est simple : soit la soumission totale aux lois du gouvernement ; soit le rejet total de ces dernières.
Classiquement et sociologiquement, l’Etat se définit par la réunion de trois éléments : un gouvernement, un territoire et une population. Avec la sécession, une partie de la population d’un Etat entend former son propre gouvernement sur une partie du territoire ou bien se réunir à une autre entité étatique préexistante. Elle œuvre à l’indépendance d’un territoire et en conséquence à un retrait des limites de l’Etat originel. Loin de se dissoudre, celui-ci conserve sa souveraineté et son rang au niveau international, mais il se voit amputé d’une partie de ses terres. La sécession présente donc une double face : pour et contre l’Etat ; contre l’Etat oppresseur et pour un nouvel Etat ou pour le rattachement à un autre Etat.
- Droit de sécession et droit international
En droit international, les Etats étant souverainement égaux, aucun d’entre eux n’a qualité pour imposer la signification qu’il attribue à un texte, ni ne peut, sauf exception, s’en voir imposer une par un organe tiers. La question de l’interprétation apparaît donc fondamentale. Au regard du droit international, deux clauses doivent être successivement analysées.
D’abord, la clause pacta sunt servanda -les conventions doivent être respectées- est une prescription qui se trouve dans les Décrétales de Grégoire IX et qui fut tirée par les canonistes du fondement moral qu’ils assignaient aux rapports juridiques. Elle traduit la règle selon laquelle les traités ont force obligatoire pour les Etats qui les ont signés et ratifiés, et pour tous les agents juridiques de la collectivité internationale dont ils règlementent l’activité. Elle répond à une fonction essentielle de tout ordre juridique, à savoir le besoin de sécurité. Principe fondamental de l’ordre juridique international, elle exige que tout traité lie les parties et soit exécuté par elles de bonne foi.
Ensuite, les traités doivent être respectés pour autant et tant qu’ils sont respectables. La règle de droit ne conserve son fondement juridique que si les choses demeurent en l’état : omnis conventio intelligitur rebus sic stantibus. Voilà la seconde clause. Le traité ne demeure valide qu’autant que les conditions en vue desquelles il a été passé se maintiennent. La clause rebus sic stantibus est donc relative au changement fondamental de circonstances. Elle n’est pas sous-entendue, mais il s’agit d’un accord tacite. Si les circonstances au vu desquelles les Etats ont consenti à s’obliger se modifient de façon telle que la poursuite de l’exécution, sans être impossible, imposerait à l’une des parties un fardeau dépassant le déséquilibre auquel elle devait raisonnablement s’attendre quand elle s’était engagée pour une longue période, cette partie pourrait être déliée de son engagement. La clause, dont l’origine remonte au Décret de Gratien, remplit une fonction en quelque sorte contraire à celle de la clause pacta sunt servanda. Qualifiée d’enfant terrible du droit international, elle constitue la norme qui doit permettre de dénoncer un traité quand les conditions dans lesquelles l’accord a été conclu, ont changé d’une façon fondamentale. Si la règle pacta sunt servanda garantit la stabilité juridique des relations internationales, la clause rebus sic stantibus permet l’adaptation du droit conventionnel. Son interprétation traditionnelle attribue à l’un des Etats signataires le pouvoir de dénoncer unilatéralement le traité sans avoir obtenu au préalable l’accord des autres signataires.
Avant la Deuxième Guerre mondiale, les juristes se sont interrogés sur la question de savoir si les dominions avaient le droit de se retirer du Commonwealth. La Charte des Nations Unies dispose que le but de ces dernières est, notamment, de développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur « droit à disposer d’eux-mêmes ». Selon les travaux préparatoires de la Charte, ses rédacteurs, avant tout les pays colonisateurs, n’entendaient en aucun cas admettre un droit de sécession. Pourtant, le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » va être interprété comme un principe anticolonialiste. Selon la résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations-Unies du 16 décembre 1952, les Etats membres doivent reconnaître et favoriser la réalisation de ce droit en ce qui concerne les populations des territoires non autonomes et les territoires sous tutelle placés sous leur administration. La résolution 1514 adoptée le 14 décembre 1960 et intitulée Déclaration sur l’octroi de l’indépendance immédiate aux pays et aux peuples coloniaux, appelle à l’émancipation immédiate de ces derniers en vertu du même principe.
Le droit de sécession constitue-t-il l’une des expressions du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », qualifié comme l’un des principes essentiels du droit international contemporain par la Cour internationale de justice ? Les nations ont entendu limiter le droit de sécession à la décolonisation. Une fois la décolonisation passée, les principes traditionnels du droit international, notamment le dogme de la souveraineté de l’Etat et celui de l’intégrité territoriale, ont repris le dessus. De manière rétrospective, on peut dire que ce qui était condamné n’était pas tant la soumission d’une population à une autre que la soumission des colonisés aux colonisateurs occidentaux. Autrement dit, le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » ne se traduisait que par le « droit des colonisés à disposer d’eux-mêmes »… Le libre choix du statut international par une population ne se trouve pas reconnu. Il serait en effet susceptible de mener à une sécession, donc de conduire à l’anarchie.
L’hypothèse d’un droit de sécession a connu une nouvelle jeunesse à la suite de l’effondrement de l’Empire soviétique et de celui par dominos de ses pays satellites. La question est devenue celle des droits des minorités ou des populations autochtones. Sur le plan international, aucune norme juridique ne conduit à la reconnaissance d’un « droit à l’autodétermination ». Aucun instrument juridique international n’autorise la séparation d’une partie d’un Etat sans son consentement. Au contraire, les principaux instruments juridiques internationaux qui traitent du statut des communautés infra-étatiques sur un territoire, ne contiennent pas de clauses qui permettraient de porter atteinte à l’intégrité territoriale d’un Etat existant.
- Le droit de sécession existe-t-il ?
Il convient de distinguer la question de l’existence d’un droit de sécession dans les Etats fédéraux, dans les Etats unitaires et dans l’Europe communautaire.
A. Le droit de sécession dans les Etats fédéraux
La question du droit de sécession a particulièrement retenu l’attention dans les Etats fédéraux. Même si elles étaient formelles, les constitutions successives de l’Union soviétique prévirent que chacune des républiques fédérées avaient le droit de sortir librement de l’Union….
Autrement plus intéressante est la question de l’existence du droit de sécession outre-Atlantique. Lorsque l’on pense au droit de sécession aux Etats-Unis, on pense immédiatement à la période des années 1860. Mais la question du droit de sécession a accompagné l’histoire des Etats-Unis depuis l’origine de la Constitution. A la suite de l’adoption des mesures de compromis par le Congrès, le gouverneur de la Caroline du Sud déclara dans un message au corps législatif de l’Etat le 26 novembre 1850 que le temps était venu d’affirmer le droit de sécession. L’Etat adopta une ordonnance de sécession le 30 avril 1852 aux termes de laquelle la Caroline du Sud était entrée librement dans l’Union et par conséquent pouvait librement en sortir. Le droit de sécession se trouvait hautement affirmé, mais son exercice se trouvait repoussé pour des raisons de simple opportunité.[2]
Le 20 décembre 1860, la Convention de Caroline du Sud adopta une ordonnance de sécession à l’unanimité. L’ordonnance avançait qu’un gouvernement aux pouvoirs expressément limités avait été établi par contrat entre les Etats, que l’irrespect par l’une des parties cocontractantes de ses engagements libérait les autres de toutes obligations et que, comme il n’existait aucun arbitre, chaque partie devait s’en remettre à son propre jugement pour décider de l’existence ou non d’une violation du contrat. -toujours la question de l’interprétation et celle de l’autorité interprétative-. Après avoir énoncé les infractions nordistes à ce contrat, l’ordonnance déclarait l’Union dissoute et la reprise par la Caroline du Sud de sa position parmi les nations du monde en tant qu’Etat séparé et indépendant. Dans les vingt-trois jours qui suivirent l’élection de Lincoln à la présidence, les autorités de cinq Etats du Sud appelèrent à des conventions. Les différents Etats firent sécession entre le 9 janvier et le 1er février 1861.
Aux termes de son message sur l’état de l’Union du 3 décembre 1860, le président Buchanan refusa au Sud un droit constitutionnel de sécession et au Nord un droit constitutionnel de coercition. Dans son discours d’investiture du 4 mars 1861, Lincoln avança que l’Union était perpétuelle et qu’elle était en tout état de cause impliquée par la loi fondamentale de tous les gouvernements. Même si les Etats-Unis n’étaient qu’une association d’Etats formés par un simple contrat, ce contrat n’eût pu être défait que par toutes les parties cocontractantes. Lincoln adoptait la règle du parallélisme des formes selon laquelle un contrat adopté à l’unanimité ne pouvait être rompu que par le consentement de tous. Pour souligner que l’idée centrale de la sécession était l’essence de l’anarchie, le président réduisait l’argument adverse à l’absurde : une minorité sécessionniste risquait de créer un précédent, suivi par la minorité de la minorité et ainsi de suite.
Dans son message au Congrès du 29 avril 1861, le président de la Confédération, Jefferson Davis, constata que l’évolution historique avait perverti les fondements de l’Union et que le gouvernement fédéral, formé par les Etats pour les protéger de l’extérieur, en était venu à la brimer de l’intérieur. Le processus de phagocytage nordiste ne laissait d’autre choix au Sud que la rupture. Davis tirait les conséquences de la perversion de la Constitution, à savoir la révocation de la délégation des pouvoirs au gouvernement fédéral et la dissolution du lien avec les autres Etats de l’Union. Il reprit la même argumentation dans son discours d’investiture du 22 février 1862 après qu’il fut devenu président permanent de la Confédération. Ainsi, la cause sudiste était la même que celle de ceux qui avaient formé originellement l’Union : créer et préserver un idéal du gouvernement par consentement des gouvernés.
La Constitution des Etats confédérés du 11 mars 1861 retient l’attention. Lors des travaux préparatoires, plusieurs délégués demandèrent que le droit de sécession fût inclus dans la Constitution. Il était proposé d’insérer le texte suivant : « Le droit de sécession de chaque Etat de cette confédération est expressément admis afin d’être exercé par chaque Etat à son gré ». La proposition fut repoussée à six voix contre une, celle la Caroline du Sud. De manière frappante, la nouvelle Constitution ne comporta aucune référence à un quelconque droit de sécession.
C’est la Cour suprême des Etats-Unis qui mit fin aux controverses dans sa décision Texas v. White en 1868. Selon l’opinion de la Cour lue par le président Chase, « La Constitution, dans toutes ses dispositions, vise à une Union indestructible, composée d’Etats indestructibles ». La Cour s’inscrit en faux contre les sécessionnistes en affirmant que la rupture du pacte ne pouvait être opérée qu’à l’unanimité des Etats. Ce que ces derniers avaient fait ensemble, il ne pouvait le défaire qu’ensemble. Selon la Cour, les Etats confédérés n’avaient jamais quitté l’Union. Il est également intéressant de constater que 15 Constitutions d’Etats formées entre 1864 et 1875 prohibèrent expressément le droit de sécession, selon des textes de circonstances adoptés par les nouvelles autorités des Etats lors de la Reconstruction, c’est-à-dire durant leur occupation par les troupes nordistes.
B. Le droit de sécession dans les Etats unitaires
Prenons l’exemple de la France. Depuis la Révolution, il existe un principe fondamental d’unité et d’indivisibilité de la République. Le refus de toute sécession en découle logiquement. D’ailleurs, l’article 1er de la Constitution de 1958 énonce que la France est une République indivisible.
L’article 1er de la Constitution doit cependant être mis en parallèle avec les dispositions de l’ancien article 85-2 et de l’article 53, de même qu’avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il ne faut pas oublier que de nombreuses colonies françaises ont fait sécession par voie d’accords conclus en vertu de l’article 85-2, lequel a été abrogé en 1995. Quant à l’article 53 alinéa 3, il dispose que nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. Or, dans sa décision du 30 décembre 1975, le Conseil constitutionnel a découvert le droit pour un territoire de la République de faire sécession. La question de savoir s’il s’agit d’un territoire d’outre-mer seulement ou d’une collectivité territoriale en général n’est pas tranchée. Toutefois, cette jurisprudence libérale est strictement encadrée par le fait que ce sont les autorités de la République qui contrôlent l’ensemble du processus sécessionniste, de l’initiative à l’autorisation finale.
C. Le droit de retrait dans l’Europe communautaire
Pour la première fois au niveau communautaire, le traité établissant une Constitution pour l’Europe mentionnait le droit de sécession, pudiquement appelé retrait volontaire de l’Union. L’article I-60 disposait que tout Etat membre pouvait décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union européenne. Une telle disposition se trouvait dans tous les projets établis lors de la Convention sur l’avenir de l’Europe. Le traité de Lisbonne s’inscrira dans les brisées du traité avorté. En vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, tout Etat membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles de se retirer de l’Union.
Selon un principe bien connu du droit de résistance, la consécration du droit de retrait, autrement dit du droit de sécession, n’a pas tant pour objet de permettre son application que de l’en empêcher ou, à tout le moins, d’encadrer strictement un phénomène politique. En effet, l’Etat sécessionniste ne dispose pas d’un droit unilatéral et absolu de retrait. Bien au contraire, il se trouve enserré par des règles procédurales, qui apparaissent comme une course d’obstacles, et qui rappellent les termes de la Cour suprême du Canada dans son renvoi relatif à la sécession du Québec. En effet, l’Etat sécessionniste doit notifier son intention au Conseil européen, avant qu’un accord soit négocié avec l’Union au sujet des modalités du retrait et que le Parlement Européen approuve cet accord à la majorité qualifiée.
* *
*
Le droit international envisage la sécession de manière réaliste. Certains diront qu’il l’envisage de manière hypocrite. La sécession est considérée comme une question de fait. Effectivement, il n’existe pas de droit de sécession en droit international public qui découlerait du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Il existe simplement un fait de la sécession qui, en cas de succès, provoque certains effets de droit. La sécession représente donc un combat en marge du droit, mais il doit s’agir d’un combat victorieux pour qu’elle produise des effets juridiques et qu’elle puisse être entérinée par la communauté internationale. Il va de soi – au grand dam des libertariens et plus encore des anarcho-capitalistes – que le droit international ne fait nulle mention d’un droit individuel de sécession puisque ce droit régit par définition les relations entre Etats…
[1] Nous nous permettons de renvoyer à Jean-Philippe Feldman, « Sécession (droit de) » in Joël Andriantsimbazovina et al. (dir.), Dictionnaire des droits de l’Homme, P.U.F., 2008, pp. 888-892.
[2] Nous nous permettons de renvoyer à Jean-Philippe Feldman, La bataille américaine du fédéralisme. John C. Calhoun et l’annulation (1828-1833), P.U.F., 2004 ; Id., « Les Constitutions des Etats confédérés d’Amérique », Revue française de droit constitutionnel, 2004/3, n° 59, pp. 503-531.
Image credit: Riderfoot / Shutterstock.com