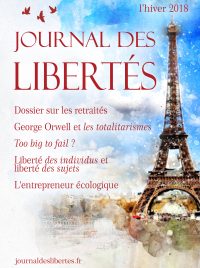On connaît maintenant dans ses grandes lignes les orientations de la réforme des retraites confiée au Haut-Commissariat présidé par Jean Paul Delevoye. Certes une phase de « consultations » va maintenant s’ouvrir, mais on sait déjà que tout n’est pas à négocier dans la perspective d’un projet de loi en 2019. Deux certitudes sont d’ores et déjà acquises : d’une part le système de répartition n’est pas remis en cause, d’autre part il sera universel pour tous les Français et les régimes spéciaux disparaitront.
C’est dire que l’on va faire beaucoup de bruit pour rien.

|
Jacques Garello est professeur émérite de l’Université Aix-Marseille. Président de l’ALEPS de 1978 à 2015, il publie depuis 1981 La Nouvelle Lettre, hebdomadaire. Il a été l’un des créateurs du groupe des Nouveaux Economistes (1977) et a organisé 38 Universités d’Eté de la Nouvelle Economie à Aix en Provence. |
Rien ne sert de réformer quand on ne remet pas en cause le système de répartition. Inutile d’être expert, financier, ou assureur, pour comprendre qu’une population vieillissante ne peut se donner un tel système, puisque le nombre des cotisants (population active et employée) diminue alors que le nombre et la longévité des retraités augmente. Poursuivre dans cette voie systémique signifie qu’on multiplie les mesures « paramétriques » : reculer l’âge de la retraite, augmenter les cotisations, diminuer les pensions. C’est ce qu’on ne cesse de faire depuis des années. C’est une erreur économique.
Rien ne sert de réformer quand on se donne pour objectif de faire disparaître tous les régimes spéciaux pour les fondre en un régime universel : initiative compréhensive dans un pays centralisé et bureaucratique.

Jacob_09 | Shutterstock.com
« Pour chaque euro cotisé, le même droit à pension pour tous » : le slogan est bien frappé, mais l’objectif est vain. Les régimes spéciaux[1] correspondent à des privilèges accordés au fil du temps aux salariés de certaines professions ou entreprises. Comment les bénéficiaires accepteraient-ils d’être désormais soumis à un régime « universel » moins avantageux ? On commence déjà à faire une subtile distinction : le régime « universel » ne serait pas « uniforme ». Cette subtilité suffira-t-elle à calmer les mécontentements et les manifestations ? Le régime universel n’a aucune chance d’être accepté : c’est une erreur politique.
Dans ces conditions, je me pose une question : pourquoi la capitalisation est-elle exclue ? Pourquoi persévérer dans les erreurs, alors que la capitalisation a été la base des réformes des retraites réalisées depuis trente ans dans une cinquantaine de pays ? Dans ces pays, elle est tantôt devenue le premier pilier (obligatoire) du système de retraites, tantôt elle a été introduite comme deuxième pilier, destiné à soutenir le système précédemment en place, tantôt enfin elle est devenue un troisième pilier, un complément apprécié pour couvrir les aléas des systèmes existants. Visiblement, dans ce qui est évoqué et débattu à l’heure actuelle en France, il n’y a aucune place pour la capitalisation[2].
Alors pourquoi ? C’est, je crois, parce que le procès de la capitalisation est inscrit et réglé depuis fort longtemps dans notre pays, et il semble inutile de s’attarder à un système qui aurait échoué partout et toujours. La capitalisation connaît le sort de l’économie de marché ; faute de connaître, on condamne, on y voit la source des crises, du chômage, des inégalités, sur fond d’exploitation et de tromperie.
Commençons donc par en finir rapidement avec ce mauvais procès. Nous pourrons ensuite faire l’éloge de la capitalisation en mettant en évidence ses mérites. Voilà qui permettra de comprendre que la capitalisation ploie dans notre pays sous le poids de l’idéologie et de l’ignorance.
Un mauvais procès
Directement ou indirectement la capitalisation est liée aux marchés financiers. Or la finance est incertaine : comment abandonner l’avenir des retraites à des opérations connues pour leur instabilité à court terme, et perturbées par la spéculation ? Que resterait-il de l’argent confié à des professionnels qui n’ont pas vu venir les crises de 1929 ou 2008 ?
Il faut d’abord rétablir la vérité sur les crises financières. Leur origine est à rechercher dans le dirigisme économique. La politique monétaire des gouvernements est totalement ou partiellement en cause. Soutenir les cours en bourse pour « réguler » le marché empêche de faire les corrections en temps voulu et la chute sera d’autant plus brutale qu’elle aura été retardée. Soutenir de grandes banques ou de grandes sociétés au prétexte qu’elles sont « trop grosses pour disparaître » (too big to fail) ne débouche que sur le désordre et l’irresponsabilité des acteurs financiers. Le dopage du crédit par des taux d’intérêt artificiels pénalise la bonne gestion et encourage les prises de risque inutiles. Ce n’est pas le marché financier qui est à incriminer, c’est le refus de la logique du marché.
Paradoxalement, les crises créées et aggravées par le dirigisme ont pu être digérées par le marché financier, et si les fluctuations boursières sont fréquentes et spectaculaires à court terme, elles sont lissées en longue période. Pour un placement sur 10 ans, on peut enregistrer des « accidents » nombreux, c’est-à-dire des rendements qui s’écartent fortement de la moyenne des rendements sur le long terme. Ce nombre diminue pour un placement sur 20 ans, et il n’y a plus d’écart sur 40 ans. Le temps fait son œuvre : il efface les mauvaises performances. Or, c’est évidemment le long terme qui importe s’agissant de constituer sa retraite : voilà de quoi apaiser la peur des futurs pensionnés.
Cette perspective rassurante, et observée dans les statistiques boursières et financières[3], n’est pas le fait du hasard. Deux facteurs l’expliquent : d’une part la cotation des titres se fait le plus souvent au vu des anticipations de profits de longue période et les évènements contingents ne perturbent le cours d’une action que sur quelques jours, voire quelques heures, d’autre part la gestion de portefeuille par les fonds de pension n’est pas de type « spéculatif », ce sont les « placements de bon père de famille » qui ont la faveur de ces financiers.
L’évidence est donc là : le taux de rentabilité des fonds placés sur une longue période s’établit (en termes réels) entre 6 et 9 %[4]. Aujourd’hui la plupart des bourses du monde entier ont largement retrouvé les performances qu’elles avaient avant 2007 : la « crise » n’a pas duré plus de cinq ans, en dépit des erreurs des politiques économiques de relance keynésienne pratiquées à l’initiative du G 20, du FMI, de la Federal Reserve et de la Banque Centrale Européenne.
Pourtant la capitalisation est toujours décriée, et les médias n’ont cessé de dénoncer les scandaleuses faillites de fonds de pension qui ont englouti l’argent des futurs retraités. L’affaire la plus célèbre a été celle d’Enron. En décembre 2001 cette société industrielle géante (gaz, électricité) fait faillite, entraînant dans sa chute le fonds de pension qu’elle avait constitué pour la retraite de ses salariés. Les gestionnaires d’Enron avaient puisé dans le fonds lorsque les difficultés financières de l’entreprise s’étaient aggravées. Ce vol avait été couvert par la firme Arthur Andersen, agence de contrôle et de notation, qui a masqué la vérité jusqu’au dernier moment. L’affaire Enron est-elle de nature à déconsidérer les fonds de pension ? Il s’agit en fait d’un vol, qui a été pénalement sanctionné (et Arthur Andersen a disparu). Du reste les fonds de pension d’entreprises sont à prohiber, précisément parce que leur sort est lié aux résultats de l’entreprise. On peut remarquer que la législation française sur la participation des salariés aux résultats sous forme de comptes d’épargne retraites est de ce point de vue totalement inacceptable.
Finalement l’affaire Enron, ainsi que d’autres malversations (comme celle du groupe anglais de presse Maxwell) ne relèvent que du fait divers et ne mettent pas en cause le système de capitalisation dont les mérites sont, volontairement ou non, ignorés.
De l’argent qui rapporte
Le premier mérite de la capitalisation est de mettre fin au gaspillage de l’argent qui caractérise le système de répartition. En effet les cotisations versées par l’assuré à l’URSSAF servent immédiatement à payer les pensions d’un retraité. L’argent n’est pas porté au crédit du compte de celui qui l’a versé, l’argent n’est pas placé. Il entre dans un tiroir-caisse pour en ressortir immédiatement. Faites le test : dites à un salarié assujetti à la Sécurité Sociale que personne n’a mis son argent « de côté », et qu’il s’est évaporé, vous trouverez un incrédule.
En fait ce que l’assuré obtient en contrepartie de sa cotisation² est un droit à pension, qu’il ne pourra exercer que le jour de sa retraite (normale ou anticipée). Quelle somme représentera ce droit dans quarante ou trente ou vingt ans ? Nul ne saurait le dire, la pension sera ce qui sera possible compte tenu de la situation de la Caisse au moment considéré. Cette incertitude est aggravée par le fait que le législateur pourra modifier le régime par répartition à tout moment, grâce à des « réformes paramétriques ».
Toute autre est la logique de la capitalisation, puisque l’argent versé par l’assuré va immédiatement être utilisé à un placement qui rapportera un intérêt tout de suite acquis au futur retraité. L’arithmétique élémentaire nous enseigne la loi des intérêts composés : avec un taux d’intérêt de 5 % la valeur du placement aura doublé dans 15 ans. Or, les fonds de pension peuvent (d’après les observations recensées à ce jour) obtenir un taux de rendement moyen compris entre 5 et 9 % pour un placement de 10 ans (et bien davantage sur une plus longue période).
Comment ce résultat peut-il être obtenu par les gestionnaires des fonds placés ? Simplement parce qu’ils investissent l’argent qu’ils ont reçu des cotisants. Alors que dans le système par répartition l’argent ressort immédiatement du tiroir-caisse, la capitalisation place cet argent dans l’économie.
Voici donc le deuxième mérite de la capitalisation : elle permet de financer en permanence la croissance économique. C’est sans doute le « miracle » le plus spectaculaire de la répartition : les pays qui adoptent le système voient leur économie immédiatement dopée par l’injection de la masse de cotisations reçues. Le « miracle » a un effet durable : d’une part l’argent nécessaire à servir les pensions au niveau garanti est accumulé plus vite (le niveau de pension aujourd’hui servi par l’URSSAF peut être atteint en 13 ans avec un taux de rendement de l’argent placé à 3%), d’autre part on peut donc diminuer le montant des cotisations si l’on prolonge la durée du placement (un smicard paie aujourd’hui environ 250 € par mois pendant 40 ans de cotisation, on pourrait ramener la cotisation à 120 €).
En fait ce résultat n’a rien de miraculeux : il provient simplement du fait que l’on substitue une logique financière et capitaliste, fondée sur la rentabilité, à une logique administrative et politique qui aujourd’hui domine l’investissement en France. L’épargne française est vigoureuse, l’une des plus importantes des pays de l’OCDE (environ 16 % du revenu des ménages), et cependant les entreprises manquent de crédits pour innover et développer leurs affaires (une lacune régulièrement relevée par la Cour des Comptes). Le paradoxe s’explique facilement : par diverses incitations ou obligations les gouvernements successifs ont drainé l’épargne vers l’investissement public. Les versements sur les livrets A, placement préféré des épargnants français, sont aspirés par la Caisse des Dépôts et Consignations, première puissance financière française, qui oriente les fonds vers ses propres filiales chargées d’investir suivant les choix publics, ou (plus récemment) vers la Banque Publique d’Investissement, véritable organe de planification économique. En fin de compte, la logique du plan a supplanté la logique du marché.
Passer à la capitalisation signifie donc revenir à la loi de la rentabilité marchande, qui veut que les investissements aillent par priorité là où ils rapportent le plus, c’est-à-dire reçoivent l’agrément durable des clients des entreprises. C’est le meilleur service de la clientèle, donc finalement de la communauté entière, qui guide l’usage de l’argent épargné. La croissance est donc accélérée dans des délais très rapprochés. Les économies en déclin ou en stagnation reprennent naturellement vigueur. L’exemple le plus spectaculaire aura été à ce jour celui du Chili. Les réformes Piñera (1980) ont valu un taux de croissance supérieur à 10 % pendant plusieurs années consécutives, de sorte que l’ancien système de répartition a été épongé 14 ans avant l’échéance prévue initialement. La comparaison entre pays prisonniers de la répartition et pays ayant introduit totalement ou partiellement la capitalisation fait apparaître que l’économie de ces pays-ci a été très vite relancée après la crise de 2008, qui a appris aux gouvernements lucides que la finance marchande est préférable à la finance publique[5].
Ainsi la capitalisation apporte-t-elle un double bienfait : micro-économique et macro-économique. Au niveau des assurés elle diminue les cotisations et garantit de meilleures pensions. Au niveau de l’économie globale, elle soutient et accélère la croissance. L’éloge de la capitalisation est mérité.
Des personnes responsables
Voici un autre mérite, plus rarement évoqué et pourtant plus important encore. Car la croissance n’est pas seulement affaire de milliards investis, ni d’épargne fructifiée. Elle tient beaucoup, certains disent surtout, au comportement des gens.
A propos du passage à la capitalisation Gary Becker a parlé de « changement de société ». Après avoir relevé que ce passage marquait le « retour au travail » (diminution du chômage et accroissement du temps d’activité) et le « retour à l’épargne » (ce qui implique l’exemption de tout impôt sur l’épargne et le patrimoine)[6] il souligne le retour à la responsabilité personnelle :
« La répartition contient tous les germes de la collectivisation et aboutit à faire disparaitre toute idée de progrès personnel. La capitalisation a le mérite de mettre chacun face à son propre progrès [7]. »
La responsabilité personnelle va s’exercer de diverses façons. D’une part, l’assuré décide d’abord quel organisme prendra en charge la gestion de son capital-retraite. Ce choix est nécessairement ouvert, la législation habituelle autorise l’assuré à changer en cours de contrat. La concurrence est vive entre des organismes collectifs de placement en valeurs mobilières (comme les OCPVM chez nous), des compagnies d’assurance, des banques, des fonds de pension au sens strict. Comme toujours la concurrence est à l’avantage du client. D’autre part, l’assuré est en permanence informé de sa situation : où en est-il de la préparation de sa retraite ? Le contrat qui le lie à l’organisme gestionnaire prévoit en général la possibilité d’exercer ou de ralentir le versement des cotisations.
Cette dernière possibilité est déterminante. Elle ouvre en effet la porte à une gestion patrimoniale personnelle, en fonction de l’âge, des revenus, de la composition de la famille. Nous savons qu’il existe un « cycle vital » de la dépense : la jeunesse n’investit pas beaucoup et le patrimoine des jeunes est généralement réduit, les premiers éléments de patrimoine se constituent à l’âge des premiers enfants (accession à la propriété immobilière par exemple), avec la quarantaine le niveau des revenus incite à épargner davantage. Ce cycle se traduit par des comportements variables avec l’âge sans doute, mais aussi avec la personnalité des assurés. Ainsi la responsabilité est-elle liée à la propriété, et réciproquement la propriété rend l’être humain responsable. Dans de nombreux pays on a observé que les titulaires d’un compte épargne retraite sont réellement très fiers du montant qui s’inscrit sur leur compte (et certains possèdent plusieurs comptes !).
Précisément il est important de remarquer le lien étroit qui unit les deux mérites de la capitalisation : la liberté patrimoniale récupérée par les individus est d’autant plus consistante que l’argent qu’il a placé améliore ses perspectives de pension. Par contraste dans le système par répartition l’assujetti est sous la dépendance complète des organismes gestionnaires et des initiatives du législateur. Certes il est maintenant prévu que la réforme des retraites pourrait consister à introduire un système « par points », permettant peut-être à l’assuré d’abonder son compte retraite en modulant ses cotisations, donc d’ouvrir la porte à une certaine autonomie de gestion patrimoniale, mais la valeur du point échappe à l’assuré et ne peut augmenter si elle s’inscrit dans un système de répartition excluant tout placement financier des cotisations. La capitalisation de points n’a donc aucun rapport avec un vrai système par capitalisation puisque l’argent des points acquis n’est pas investi, il est immédiatement affecté à servir des pensions. Certes il accroît le droit de l’individu à une pension plus consistante le jour venu de la retraite, et en cela il compense en partie la perte inhérente au système par répartition ; mais l’assuré aurait plutôt intérêt à placer lui-même son argent qu’à acheter des points. C’est ce que font d’ailleurs les épargnants français qui ont les moyens de souscrire à des contrats d’assurance-vie ou investissent dans la pierre : deux initiatives progressivement pénalisées depuis plusieurs mois puisque les avantages fiscaux des nouveaux contrats d’assurance vie vont être réduits[8], et l’impôt sur la fortune est maintenu pour la propriété immobilière.
Au lieu de compliquer sans cesse le régime de répartition pour le faire survivre, et de multiplier les dispositions fiscales sur l’épargne, les gouvernants n’auraient-ils pas le devoir d’ouvrir la porte à la capitalisation pour bénéficier de ses mérites financiers et moraux ?
Le poids de l’idéologie
Dans notre pays et à ce jour les gouvernants demeurent sourds à l’éloge de la capitalisation. Je pense que cette surdité est purement politique : l’idéologie régnante condamne la finance, le marché financier, le marché tout court, et vante les mérites de la solidarité, du partage, qui caractériserait le système par répartition.
La condamnation de la finance est directe chez les adversaires déclarés du capitalisme. Trente ans après la chute du mur de Berlin la pensée marxiste a une belle rémanence en dépit de l’échec du collectivisme et de la planification. La masse de ruines, de dictatures et de crimes accumulés dans les pays communistes (aujourd’hui encore) n’a pas ouvert les yeux des « révolutionnaires », dont l’ardeur se nourrit des imperfections d’une mondialisation faussée par les interventions publiques (le « capitalisme de connivence » crée en effet des perturbations et des corruptions dans les échanges demeurés « internationaux »).
D’autres sont partisans d’une mythique « troisième voie », faite d’une régulation dirigiste des marchés. Très populaire en France, héritée en particulier du gaullisme, la troisième voie se marie aussi avec les doctrines de la sociale démocratie. Elle n’a jamais apporté le moindre progrès, parce que la liberté se marie difficilement avec l’étatisme, et elle débouche finalement sur l’État Providence : une évolution parachevée dans notre pays. Finalement le collectivisme élimine initiative et responsabilité, elle crée la « servitude volontaire ».
La solidarité et l’esprit de partage sont invoqués pour justifier une telle évolution, et la capitalisation est alors condamnée au nom de la morale. Un système de retraite par répartition aurait la vertu de mettre en œuvre la solidarité entre générations ; les juniors au service des seniors quelle belle chose ! En fait on commence aujourd’hui à inverser les termes de la solidarité : les seniors auraient abusé du système au détriment des juniors, puisque les cotisations augmentent plus vite que les pensions ne baissent. Qui faut-il dépouiller ?
Un autre argument moral est très efficace pour détruire la capitalisation : la finance est un jeu de pure spéculation. Aristote avait déjà évoqué l’immoralité des jeux d’argent qui rapportent de l’argent. Il n’en faut pas davantage à certaines autorités morales (comme celle du Vatican) pour condamner un système qui serait fondé sur des intérêts égoïstes et dont la logique serait spéculative et spoliatrice[9]. Une telle condamnation s’adresse en fait au capitalisme de connivence et au dirigisme qui dominent aujourd’hui le marché financier, et ne devrait pas légitimer une attaque contre la finance qui procède le plus souvent de la seule ignorance du fonctionnement de la finance, et plus généralement de l’économie.
D’ailleurs la solidarité est-elle morale quand elle est publique et obligatoire ? On peut vanter le partage quand il est volontaire. Mais quand il est organisé à travers des prélèvements obligatoires, des exemptions, des privilèges et des subventions, il ne débouche à la longue que sur le désordre social, chaque personne ou chaque groupe ayant le sentiment que la redistribution instaurée par la puissance publique bénéficie aux autres. Est-il nécessaire de rappeler le fameux diagnostic de Frédéric Bastiat « L’État est la grande fiction sociale à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde » ? Un autre dommage causé par le solidarisme est que la solidarité publique et obligatoire prive les personnes réellement généreuses d’avoir assez de moyens pour aider les autres. Non seulement l’esprit de partage est menacé, mais les moyens du partage sont épuisés.
Pourquoi pas la capitalisation ?
Au terme de ces réflexions sur la capitalisation, il devrait vous apparaître que rien ne condamne le système de retraite fondé sur le placement de l’épargne et l’initiative personnelle et responsable. Rien si ce n’est l’aveuglement idéologique ou l’ignorance naïve.
La réussite de la capitalisation dans tous les pays qui l’ont adoptée, totalement ou partiellement, ne fait aujourd’hui aucun doute. Alors, pourquoi pas en France ? Pourquoi cette conspiration du silence ou ces attaques fallacieuses voire mensongères ? Il faudra bien en venir tôt ou tard à cette réforme systémique. Le plus tôt est le mieux, car le système par répartition sera de plus en plus ingérable. D’ores et déjà, il pénalise les plus pauvres des retraités ou de ceux qui sont sur le point de partir en retraite, car ils n’ont pas l’épargne ou le patrimoine qui leur permettrait de compenser la faillite du système. D’ores et déjà il est possible d’amorcer la transition vers une vraie libération ; celle qui permettrait de passer de l’assistanat à la gestion et à la fierté personnelles.
[1] Le COR (Conseil d’Orientation des Retraites) en dénombrait 24 en 2016. Au total les régimes spéciaux concerneraient plus de 9 millions de personnes
[2] Ces réformes ont été présentées à l’époque dans le 2ème tome Les retraites du futur : la capitalisation de la trilogie : Jacques Garello et Georges Lane, Futur des retraites et Retraites du futur, Librairie de l’Université d’Aix en Provence, IREF éd. 2008.
[3] Cf. Futur des Retraites et Retraites du futur, op.cit., tome 2, pp.136-138. Le rapport de l’OCDE (2011) sur la rentabilité des fonds de pension établit qu’après une chute de 22,5 % en 2008 le rendement était redevenu positif fin 2009 avec un taux moyen de 6,5 %. Dans certains pays (Chili, Luxembourg, Hongrie), le taux fin 2009 a pu atteindre plus de 10 %. On constate aussi que ce sont les portefeuilles plus riches en actions qui garantissent une rentabilité élevée, alors même que l’on attribue ordinairement aux actions une volatilité nocive.
[4] Voir dans ce numéro l’article de Laurent Pahpy.
[5] Cf. l’article de José Piñera dans ce même numéro.
[6] Pascal Salin, comme Gary Becker, parle « d’impôt sur la dépense » : ce qui n’est pas dépensé n’est pas taxé.
[7] Gary Becker, conférence à Paris décembre 1996, cf. Comment sauver vos retraites, op. cit. pp.118-119
[8] La disposition a été votée dans la Loi de finances de la Sécurité Sociale 2018. Cette loi modifie aussi les droits de succession sur cette épargne.
[9] Le document publié par le Vatican (avec l’accord du Pape François) en mai dernier (Questions économiques et questions financières) a fait l’objet d’un dossier complet sur le thème « Peut-on être libéral et catholique ? » dans le numéro d’automne 2018 du Journal des Libertés