Les Français croient avoir le meilleur système universitaire du monde. Pourtant les universités françaises n’ont pas de bons scores dans les classements internationaux. Les universitaires français s’en défendent en argumentant que les critères de ces classements sont construits pour avantager les universités anglo-saxonnes. Pourtant, malgré des critères différents selon les classements, tous convergent pour remiser la France loin derrière. Une récente étude de l’IREF (https://fr.irefeurope.org) fait apparaître que dans le classement QS World University Rankings dont la méthodologie apparaît la plus large, la plus équilibrée et la plus rationnelle pour estimer la qualité des universités, seuls cinq établissements français sont présents dans le top 200, dont deux universités publiques seulement (PSL – Paris Sciences & Lettres – (52e) et Sorbonne Université (83e)) et trois grandes écoles, contre 12 universités en Allemagne, 26 au Royaume-Uni et 45 aux États-Unis. La France est au 11ème rang mondial aux cotés de pays beaucoup plus petits comme la Suède. Il est difficile de nier l’évidence et de ne pas s’interroger, particulièrement au moment où une réforme du mode de recrutement universitaire met en émoi toute l’Université. D’autant que cette ouverture extrêmement timide du système universitaire français, centralisé selon les principes napoléoniens qui ont présidé à sa fondation, peut être nuisible si elle n’est pas l’amorce d’une évolution plus générale vers l’autonomie et la privatisation possible des universités.
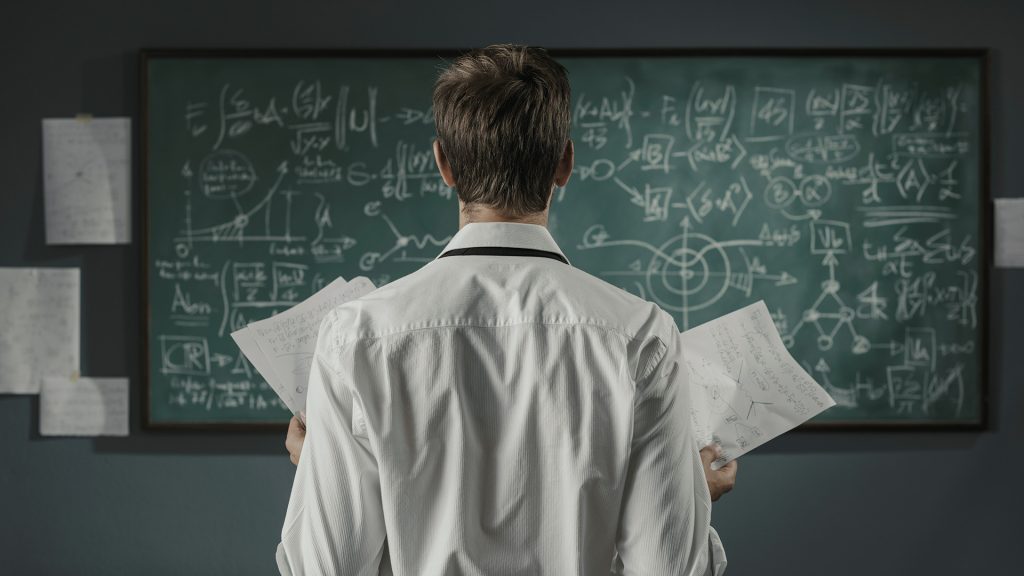
La réforme du CNU : oui, mais après ?
Le projet de loi sur la programmation de la recherche a été définitivement adopté le 20 novembre 2020 après qu’un amendement impromptu du Sénat permette jusqu’en 2024 de déroger à la qualification par le Conseil national des universités (CNU) des candidats aux fonctions de maîtres de conférences et professeurs. Aujourd’hui en effet, un candidat titulaire d’un doctorat ou d’une habilitation à diriger des recherches doit d’abord être qualifié par une section du CNU (histoire, mathématiques…) pour pouvoir être enseignant-chercheur. Après quoi seulement il peut postuler dans les universités.
A dire vrai il y a longtemps que des tentatives étaient initiées pour casser le monopole du CNU. En 2013 déjà, un amendement de suppression de la procédure de qualification par le CNU avait été déposé à l’occasion du vote de la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche par les écologistes et adopté au Sénat avant de lever contre lui une tempête universitaire qui l’avait remisé aux oubliettes. Vingt-cinq présidents d’université, dont Frédérique Vidal – l’actuelle ministre qui était alors présidente de l’université de Nice – avaient dénoncé la remise en question du « caractère national du recrutement des enseignants-chercheurs », « accentuant la fragmentation du système universitaire français et son évolution vers un régime à plusieurs vitesses ». Lors de sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron s’était engagé en faveur de la suppression du CNU : « Nous donnerons aux universités et aux grandes écoles la liberté de recruter eux-mêmes leurs enseignants-chercheurs, suivant les standards internationaux de qualité et d’indépendance ». Un amendement pour déroger au filtre obligatoire et exclusif du CNU avait été déposé, avant d’être retiré, en mai 2020 au texte de la loi sur la fonction publique par trois députés centriste/LREM. Il a fallu le dépôt subreptice d’un nouvel amendement sénatorial pour parvenir à cette si timorée ouverture provisoire.
Depuis lors, le monde universitaire est en ébullition. Des syndicats et comités dénoncent la « menace de la qualité de recrutement universitaire », une « atteinte à peine dissimulée au statut d’enseignant-chercheur ». Les défenseurs du CNU objectent qu’en France, la centralisation garantit la liberté contre les despotismes locaux, ils craignent, non sans raison probablement, que la possibilité de recruter au niveau local permette de petits arrangements pour que la copinerie prévale sur la compétence. Pourtant, on a l’impression que l’émotion est surtout celle d’une corporation en train de perdre son monopole et son entre-soi, peu encline à partager ses dépouilles avec d’autres, celle d’un « corps » qui dit redouter l’endogamie et le clientélisme que créera la loi dans chaque université parce qu’il veut conserver l’endogamie du CNU et son clientélisme syndical. Elle est aussi sans doute le fait de ceux qui ayant gagné leurs diplômes à la sueur de leur front ne veulent pas en perdre la valeur de sésame et se retrouver en compétition avec d’autres qui n’auront pas subi ce parcours du combattant qu’il leur a fallu suivre pour parvenir enfin à décrocher un poste à l’université. Le 21 janvier, des chercheurs ont tenté d’interrompre les vœux de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Frédérique Vidal, en clamant : « La communauté scientifique ne veut pas de cette énième soi-disant réforme dont nous ne savons que trop qu’elle porte le darwinisme, la concurrence toxique, la bureaucratie de l’évaluation permanente ». Les propos sont clairs : ils craignent la compétition et l’évaluation de leur travail. Ils s’inquiètent aussi que la liberté de recrutement des universités ouvre la voie à la suppression de leur statut protégé de fonctionnaire d’État.
Au surplus, ceux qui défendent la nouvelle loi ne sont pas toujours crédibles. La Conférence des Présidents d’Université –CPU – s’est prononcée en faveur de cette réforme dans une « approche proactive de l’autonomie ». Son président, Gilles Roussel, a œuvré pour ouvrir la procédure de qualification des enseignants.« Cette procédure n’assure pas aujourd’hui une cohérence nationale »,défendait-il en déplorant un doublon entre le travail du CNU et celui des comités de sélection des universités, ainsi qu’un calendrier trop contraint. « Il faut faire confiance aux établissements, qui sont les mieux à même de faire les bons recrutements. » Mais il souhaitait aussi en 2019 renforcer l’Agence Nationale de la Recherche, ANR, pour en faire la seule source de financement public de la recherche, ce qu’entérine la loi qui vient d’être votée ce 22 novembre. On peut donc craindre que le gain d’autonomie que les universités gagneront à la réduction du rôle du CNU, elles le perdent beaucoup plus largement dans le travail de recherche désormais entièrement piloté de manière centralisée et peut-être très dirigée. On peut penser que les présidents d’université ne sont favorables à cette réforme que pour avoir les mains plus libres dans le recrutement de leur personnel et mieux contrôler les crédits de recherche.
Cette ouverture du recrutement en dehors des fourches caudines du CNU recèle donc des dangers certains, notamment dans le cadre actuel de notre université d’État monopolistique et centralisée. Elle n’aurait de sens que si elle devait être une étape vers une véritable autonomie des universités, voire vers la possibilité de créer des universités indépendantes et capables de délivrer leurs propres diplômes, c’est-à-dire s’il était mis fin au monopole d’État de la collation des grades.
Vers l’autonomie des universités
La crise du CNU souligne au demeurant, s’il était besoin, à quel point l’université française est sclérosée, incapable de repenser son modèle, engoncée dans le corporatisme qui ronge son corps professoral. Le taux d’échec des étudiants pose question : 56% d’échecs en première année de licence (2018), des diplômes que seulement 30% des étudiants décrochent au bout de trois ans… Bien entendu, ces résultats désastreux sont dus pour partie à l’absence de sélection à l’entrée doublée d’une politique qui a consisté à donner le baccalauréat à quasiment tous les élèves dans une pochette surprise. Mais pas seulement. Il nous semble qu’il serait temps de réfléchir à faire évoluer notre université vers plus d’autonomie et une ouverture à la privatisation qui mettrait en concurrence des établissements encore publics, mais plus autonomes, et des établissements privés, ce qui signifierait que des universités privées pourraient délivrer des diplômes.
Il ressort en effet de l’étude susvisée menée par l’IREF que les pays ayant les meilleures universités, excepté l’Allemagne[1], sont ceux où la part du privé dans les dépenses consacrées à l’enseignement supérieur est la plus importante. De la même manière, plus la part des universités privées est élevée dans l’enseignement supérieur du pays, plus le taux de diplômés l’est aussi. Aux deux extrêmes de ce tableau, la Corée du sud, pays ayant 69,8% de diplômés chez le 25-34 ans, le plus fort taux, la part du privé est à 63.9 % ; en Allemagne, seulement 33 % de diplômés et 15,3% de privé.
Le coût des universités privées n’est pas un obstacle
Les Français qui sont habitués à l’école et l’université gratuites, ou quasiment, peuvent s’inquiéter de ne pas pouvoir payer les frais d’universités libres. Et pourtant, les études payantes ont leurs mérites ainsi que le montrent les exemples anglo-saxons.
Certes, les études universitaires sont chères dans les universités privées étrangères. La moyenne du coût annuel des universités américaines privées est de 35 000 USD (29 700 €) et plus bien sûr dans les institutions les plus prestigieuses. En Angleterre, le gouvernement a autorisé les 124 universités à demander jusqu’à 9 000 £ (soit près de 13 000 €) par an aux étudiants depuis 2012 et la plupart d’entre elles ont d’emblée rehaussé leurs tarifs à ce nouveau plafond.
Mais les étudiants ont de multiples moyens de financer leurs études par l’emprunt, le travail ou l’obtention de bourses :
- Il est courant qu’un étudiant américain décroche, d’une façon ou d’une autre, une bourse ou une aide (locale, régionale, nationale). En fait, près de la moitié des étudiants américains en obtiennent une. Ces bourses permettent aux étudiants de financer une partie de leurs études. Si le financement à 100 % reste exceptionnel (il est réservé quasi exclusivement aux étudiants-sportifs de haut niveau), le financement à 40 % est plus courant. L’enfant d’une famille gagnant moins de 13 500 USD par mois n’acquitte aucun frais de scolarité à Princeton (12ème université mondiale selon le classement QS) ; 38 % des étudiants du MIT (meilleure université mondiale) ne règlent aucun frais de scolarité ; dans les six meilleures universités américaines, 100% des étudiants ayant besoin d’une aide financière l’ont obtenue.
Les étudiants américains profitent aussi des nombreuses passerelles établies entre l’université et le monde professionnel pour financer tout ou partie de leurs études. En échange, par exemple, d’une aide financière apportée par une entreprise, un étudiant peut s’engager à travailler, après la fin de ses études, un certain temps, de façon directe ou indirecte, pour cette entreprise. Des entreprises qui s’impliquent concrètement dans les universités (sponsorisation, financement direct) n’hésitent pas à recruter des élèves diplômés au sein de ces universités (connaissance parfaite du parcours et du bagage des étudiants). Ces relations avec les entreprises offrent des ouvertures, voire des garanties aux élèves qui n’hésitent pas en retour, s’ils ne parviennent pas à financer dans leur totalité leur budget de formation, à contracter des prêts auprès d’organismes bancaires.
- D’une façon générale, un Anglo-Saxon, beaucoup plus qu’un Français, considère ses études en termes d’investissement et n’hésite pas à emprunter à cet effet si nécessaire. Au demeurant, le nombre d’étudiants qui s’endettent reste généralement modéré : 17 % à Princeton et 22% au MIT par exemple. L’étudiant anglais ou américain pense investissement tant au niveau du bagage intellectuel et personnel qu’au niveau financier. Il part du principe qu’il sera mieux payé que ceux qui n’ont pas fait d’étude et qu’il pourra rembourser. Et ceux qui n’atteignent pas des niveaux de rémunération suffisants bénéficient aux États-Unis du programme Pay As You Earn (PAYE), qui limite les remboursements à 10% du revenu. Le solde non remboursé peut dans certains cas être abandonné après 20 dans de vie professionnelle, voire 10 ans si l’ancien étudiant travaille pour un État ou pour une organisation à but non lucratif. De même, il est proposé aux jeunes anglais des prêts à taux avantageux, d’une durée maximale de trente ans, garantis par l’État, dont le remboursement n’est exigible que lorsque l’emprunteur gagne plus de 21 000 livres par an et sans que les mensualités puissent dépasser 9 % de ses revenus.
- Les jobs d’appoint permettent également de participer au financement des études. Il est tout à fait envisageable pour un étudiant américain de décrocher un emploi à temps partiel. Les campus sont de vraies communautés, des centres actifs où l’on trouve assez facilement du travail (restaurants, cafés, bibliothèques et librairies, magasins en tout genre…). Certaines universités, parce qu’elles offrent des bourses particulièrement intéressantes, demandent une contrepartie aux étudiants (en général quelques heures de travail hebdomadaire pour le campus).
Le système d’université payante responsabilise les étudiants. Ils ne s’inscrivent pas en première année de quoi que ce soit parce qu’ils ne savent pas quoi faire, ou juste en attendant de trouver un job qu’ils ne cherchent guère, ou pour être assurés sociaux à prix modéré. Les augmentations successives de frais d’inscription en 1998, 2005 puis enfin en 2012 au Royaume Uni ont sans doute réduit la progression du nombre d’étudiants mais n’en n’ont pas réduit le nombre sinon provisoirement. Tout au plus les étudiants ont délaissé certaines filières de lettres ou sciences humaines pour s’orienter vers des matières qui les conduisaient avec plus de certitude vers un emploi. Dans les pays développés ayant un secteur universitaire privé important, il y a plus d’étudiants diplômés, en pourcentage de la population, qu’en France.
Comparaison du taux de diplômés par rapport au classement QS des meilleures universités
| Pays | Taux de diplômés de l’enseignement supérieur chez les 25-34 ans, en 2019 | Classement des pays ayant le plus d’universités dans le top 200 du classement QS 2021 |
| France | 48.1 % | 11e ex-aequo |
| Allemagne | 33.3 % | 3e |
| Pays-Bas | 49.1 % | 6e |
| États-Unis | 50.4 % | 1er |
| Royaume-Uni | 51.8 % | 2e |
| Australie | 52.5 % | 4e |
| Japon | 61.5 % | 5e |
| Canada | 63.0 % | 7e ex-aequo |
| Corée du Sud | 69.8 % | 7e ex-aequo |
Source : http://bit.ly/34Dnpzl
La question se pose souvent de savoir pourquoi les États-Unis, dont les écoles publiques primaires et secondaires sont souvent encore généralement considérées comme médiocres, sont arrivés à obtenir et conserver depuis plusieurs générations le leadership mondial en matière économique. Une partie de la réponse est sans doute dans le fait que la plupart des universités y sont payantes, et chères. Les étudiants qui s’y inscrivent en s’endettant se sentent obligés de tout faire pour réussir et rembourser. Ceux qui travaillent ont hâte de finir leurs études.
Ça n’est pas parfait. Mais, le système rend les étudiants responsables d’eux-mêmes quand l’université française leur fait croire que le service est gratuit et que la vie est facile. Et il n’est pas injuste de demander de supporter le coût de ses études à l’étudiant, majeur, qui grâce à elles va pouvoir gagner plus que celui qui sera rentré tout de suite dans le monde du travail. Pourquoi le contribuable doit-il payer pour lui ? Demander à l’étudiant de payer le coût de son année universitaire, c’est le mettre en face des réalités économiques et lui faire comprendre la valeur réelle des études. C’est aussi permettre aux universités d’être indépendantes de l’État en même temps qu’elles sont livrées aux exigences de la compétition entre elles qui les oblige à veiller sans cesse à la qualité de leur enseignement et du service offert aux étudiants.
Parce qu’elles sont indépendantes, elles peuvent plus facilement organiser des partenariats avec le privé, vendre des services. De ce fait, et avec le prix élevé payé par les étudiants, elles ont des possibilités d’action et des moyens financiers que n’ont pas les universités d’État. Elles peuvent mieux rémunérer leurs bons enseignants et chercheurs, attirer à elles la qualité et la faire prospérer dans une dynamique vertueuse qui profite même à des élèves de niveau plus modeste. Le salaire des professeurs témoigne de l’intérêt pour eux aussi de changer de système[2] :
Royaume Uni : 79 030 £ par an en moyenne (86 830 €)
France : 36 560 à 73 343 €
États-Unis d’Amérique : 102 402 $ (83 900 €)
Source : https://academicpositions.com/career-advice/professor-salaries-from-around-the-world)
La solution française pour remonter dans les classements internationaux a consisté depuis une quinzaine d’années à regrouper les établissements de façon à gagner en taille. Mais la grosseur n’est pas toujours gage de qualité. Parfois elle contribue à la détruire quand elle génère plus encore de centralisation administrative, ce qui est le cas en France. De la même manière, la disparition du monopole du CNU ne servira à rien si la possibilité d’embaucher des profils plus diversifiés et moins normés est laissée à la discrétion d’établissements publics qui, dans un environnement entièrement étatique et centralisé, ne sont guère confrontés à la compétition d’autres établissements. Le risque de « combines localistes » évoqué par les contestataires de la réforme serait alors bien réel. Au surplus la centralisation de la recherche dans le cadre de l’ANR appelé à financer, et donc décider, seule de tous les projets de recherches sonnerait la fin définitive des libertés des chercheurs quant aux sujets et à l’orientation de leurs travaux. Cela risquerait d’attenter gravement à leur créativité et à la richesse naturelle des universités françaises. Car la liberté et l’émulation sont toujours à la base de la vitalité et de la fécondité de ceux qui se consacrent à la recherche et à l’enseignement. Des universités plus libres et plus diversifiées répondraient aussi mieux aux besoins d’une jeunesse en mouvement, qui d’ailleurs n’hésite pas à s’expatrier quand ses aspirations se heurtent à des murs comme en témoigne ces milliers de jeunes Français qui vont en Belgique pour y étudier la médecine ou les métiers vétérinaires. Dans une Europe qui reconnaît l’équivalence des diplômes, le monopole de l’État est désuet. Regardons les modèles qui marchent à l’étranger plutôt que de vouloir gagner seul et contre tous avec notre système entièrement étatique qui ne fonctionne pas aussi bien.
La souhaitable suppression du monopole
L’université française n’a d’ailleurs pas toujours été ni dépendante du pouvoir ni centralisée. Les universités d’Ancien Régime, qui ont fait la gloire de la France, étaient autonomes. C’est la Révolution, puis surtout le décret impérial du 17 mars 1808 qui créèrent une Université unique, monopolistique et centralisée dont l’université française est l’héritière directe, en défend la lettre autant que l’esprit et s’en veut le gardien obligé. Le monopole de la collation des grades (baccalauréat, licence, doctorat) reste à la fois le symbole et l’armature du système. Or il ne peut pas y avoir de véritable liberté de création d’universités, voire seulement d’autonomie, sans liberté, sous un certain contrôle éventuellement ou dans un cadre réglementaire commun, de délivrance des diplômes. La liberté de collation des grades pourrait d’ailleurs exister même pour l’accès aux professions réglementées (médecins, avocats, notaires, huissiers…) dans un cadre établi par chaque profession. On en est loin !
Certes, la loi du 12 juillet 1875 avait permis la création de « facultés libres » sous réserve du respect de règles souples et légères en matière de compétences, de locaux, de taille (au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les facultés d’État comptant le moins de chaires). Il y était prévu que ces facultés libres pourraient faire délivrer leurs diplômes par des jurys mixtes d’enseignants du privé et du public. Mais seules cinq institutions, catholiques, purent profiter de ces dispositions pour exister avant leur abrogation dans la loi du 18 mars 1880 par laquelle les partisans du monopole reprirent leurs droits. Depuis lors, par une autre loi du 12 juillet 1971, il a été prévu que les facultés privées puissent signer des conventions avec des établissements d’État sous le bénéfice desquelles le contrôle continu des établissements privés peut être pris en compte dans les examens. Bien que la loi Savary du 26 janvier 1984 ait réaffirmé le monopole de la collation des grades, le système conventionnel reste possible. Il est utilisé par les facultés libres qui subsistent en France. Ces quelques établissements facultaires privés se développent et disposent d’équipes professorales qui ne présentent pas tous les diplômes du corps enseignant public mais qui n’en sont pas moins compétentes et offrent parfois d’autres qualités d’attention aux élèves. Ils attirent de nombreux étudiants parce qu’ils les conduisent plus surement à l’obtention de leurs diplômes, avec des taux de réussite aux mêmes examens que ceux du public nettement supérieurs à ces derniers, et leur offre un meilleur encadrement. Sinon, les étudiants préfèreraient aller dans l’enseignement public beaucoup moins onéreux, même si ces facultés libres parviennent, comme les universités anglo-saxonnes, à réduire très significativement les charges financières des étudiants par le mécénat et autres contributions, voire à accueillir à très peu de frais les étudiants impécunieux.
La liberté d’enseignement pourrait d’ailleurs impliquer dans le supérieur, comme dans le primaire et les collèges et les lycées, que l’État donne aux élèves et étudiants des établissements répondant à un certain nombre de conditions, les moyens de payer leur scolarité. C’est le système de voucher ou bon scolaire pratiqué, sous une forme ou une autre, dans de nombreux pays tels que les Pays-Bas, la Suède… L’État pourrait y gagner financièrement car un étudiant du public coûte en moyenne 14 000 € en France alors que pour les mêmes formations, dans les facultés privées le coût d’un étudiant est inférieur de près de moitié. Si plus d’étudiants étaient pris en charge par ces établissements privés, cela déchargerait l’université publique tant en termes d’effectifs qu’au plan financier. Cela attiserait également une forme de compétition qui pourrait inciter chaque établissement à valoriser ses formations et mieux les gérer économiquement.
L’expérience vécue dans les facultés libres existantes démontre que des établissements privés peuvent utilement contribuer à la formation des étudiants et que la possibilité de créer de nouvelles universités libres – ou l’autorisation donnée aux établissements publics qui le souhaiteraient d’opter pour un statut d’université libre – pourrait redonner au système universitaire français la force et le rayonnement qu’il mérite.
La loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur, désormais adoptée, en offre d’ailleurs la possibilité dans ses dispositions portées à l’article 22, II, 2 :
« II. – Dans les conditions définies à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier le code de l’éducation afin de :
2° Supprimer le régime de reconnaissance par l’État des établissements d’enseignement supérieur technique privés et prévoir les conditions dans lesquelles l’État peut apporter sa garantie à un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur privé ou par un organisme d’enseignement à distance dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur, notamment par la délivrance d’un grade universitaire…»
D’ailleurs le rapport annexé au projet de loi est très clair sur la volonté du gouvernement de libérer la collation des grades de tout monopole :
« Cette relation renouvelée entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés est définie après consultation des organisations représentatives des établissements concernés. Elle passe d’abord par une clarification de la notion de cours et d’établissement d’enseignement supérieur privé. Il s’agit également d’harmoniser dans un but d’unification les modalités et les conditions d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés sans distinction, qu’ils soient « libres » ou techniques, dans un souci de clarification et de sécurité juridique. Il s’agit aussi de rendre l’exercice du contrôle de l’État lors des déclarations d’ouverture plus efficace, d’offrir la possibilité à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur privés de délivrer des diplômes visés par l’État ou conférant grade universitaire et de redéfinir les modalités d’habilitation des cours et établissements d’enseignement supérieur privés à recevoir des boursiers de l’enseignement supérieur ».
Malheureusement, le texte semble vouloir conserver un contrôle qui risque d’être pesant sur les établissements privés susceptibles de délivrer grades et diplômes. Mais c’est une réforme qui peut permettre d’instaurer de la concurrence entre établissements privés et publics. Ce qui inciterait tout le système universitaire à évoluer. On peut donc espérer que le gouvernement aille jusqu’au bout de la logique engagée, ce qui donnerait tout son sens à la suppression du monopole du CNU. Il y aura beaucoup de réticences à vaincre, mais cette réforme mérite d’être menée à son terme.
[1] Il faut toutefois observer que l’Allemagne est un cas à part eu égard à l’importance qu’y prend l’apprentissage par rapport à l’université.
[2] En annexe au projet de loi nº 478, adopté par l’Assemblée nationale de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur, il est indiqué que « Selon les informations citées par le rapport du groupe de travail consacré à l’attractivité des carrières scientifiques, le salaire annuel brut d’entrée moyen des chercheurs en France représentait en 2013, en parité de pouvoir d’achat, 63% du salaire d’entrée moyen des chercheurs dans les pays de l’OCDE ; le salaire maximum des chercheurs en France représentait 84 % du salaire maximum moyen des pays de l’OCDE. Ce constat a été confirmé par une étude menée par les conseillers scientifiques des ambassades de France dans huit pays clés de la recherche : Allemagne, Australie, États‑Unis, Grande‑Bretagne, Japon, Pays‑Bas, Singapour, Suisse. La situation s’est nettement dégradée depuis 35 ans : en 1985, le salaire brut d’un maître de conférences en début de grille représentait 2,25 SMIC, il n’est plus que de 1,53 SMIC en 2018, primes comprises (1,4 SMIC hors prime de fin d’année) ».



