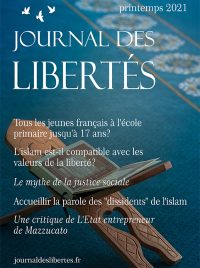Introduction aux extraits
par Jean-Philippe Delsol
L’islam n’a pas interdit la liberté économique, mais il l’a empêchée d’éclore. L’œuvre d’Ibn Khaldûn, cet humaniste arabe du XIVème siècle, en témoigne. Historien, philosophe, sociologue, juge, enseignant, poète aussi bien qu’homme politique, Ibn Khaldûn (732-808 de l’hégire, 1332-1406 de J. C.) est un autodidacte immensément cultivé. Alors même que l’islam a déjà perdu son lustre intellectuel, il innove dans une nouvelle approche sociologique de l’histoire pour raconter l’islam et en tirer des leçons rationnelles. Il reste néanmoins prisonnier du cadre de pensée du monde dans lequel il est né. Ministre ou Cadi, voire premier ministre ou Grand Cadi de nombreux princes ou sultans en Afrique ou en Espagne, il tente une approche universelle. Mais son histoire universelle n’est que celle de l’islam et c’est d’abord celle du pouvoir en islam comme force structurante et organisatrice essentielle de la société. Il est ce qu’on appellerait aujourd’hui un libéral au plan économique. Mais son libéralisme est utilitariste, au service du pouvoir. Il conseille de baisser les impôts ou de laisser une certaine liberté économique pour que le pouvoir soit riche et fort[1]. C’est aussi pour préserver les revenus fiscaux de l’État qu’il lui déconseille de faire du commerce lui-même aux lieu et place de ses sujets[2]. Il n’attache guère d’importance à l’individu. « L’État et le pouvoir sont la forme de l’humanité et de la civilisation. A leur tour, l’humanité et la civilisation — avec les sujets, les cités et toutes les autres conditions de la vie en société — constituent la matière de l’État et du pouvoir »[3], écrit-il dans son Livre des Exemples. De même son rationalisme trouve sa limite dans la prédestination. L’ascension des empires autant que leur déclin est le résultat d’un enchainement causal inévitable, une fatalité historique à laquelle ils ne peuvent échapper : « L’homme ne doit pas ignorer la sagesse de Dieu selon laquelle Ses créatures suivent le destin qu’Il leur a fixé »[4] ou encore « Dieu agit ainsi envers les États jusqu’à ce que soit accomplie la fin qu’Il a décrétée pour Ses créatures »[5]. Le rationalisme d’Ibn Khaldûn trouve sa limite dans le Coran qui n’est guère rationnel. Nous sommes après la fermeture de l’ijtihad, la libre parole ne sait plus s’exercer. Malgré sa force intellectuelle et sa sagacité, Ibn Khaldûn reste prisonnier de l’islam, il n’entrevoit plus la lumière des Mutazilites qui lui aurait permis d’affirmer la capacité de l’individu à surmonter son sort.

Ibn Khaldûn est au demeurant l’auteur d’une œuvre universelle et immense. Dans la deuxième partie desprolégomènes de cet ouvrage considérable qu’est Le Livre des Exemples, il examine notamment les causes qui font augmenter ou diminuer le revenu d’un empire. Il constate que les gouvernements commencent toujours par imposer peu pour finir par taxer beaucoup. Musulman, bien sûr, il mêle un peu de religion à ses explications. Mais sous ces réserves, son propos pourrait s’appliquer sans guère de modification à nos gouvernements d’aujourd’hui ainsi que vous pourrez le constater à la lecture de l’extrait suivant tiré de la traduction française réalisée en 1863 par William Mac Guckin, Baron de Slane, membre de l’Institut (1801-1878)[6], sachant que vous pouvez aussi trouver ce texte dans la nouvelle traduction proposée dans la Pléiade (Gallimard, 2002, pp 601 sq.) des œuvres de ce grand historien.
* * * *
* * *
Sur la cause qui fait augmenter ou diminuer le revenu d’un empire
Dans un empire qui vient de se fonder les impositions sont légères et rapportent beaucoup ; mais, quand il tire vers sa fin, elles sont lourdes et rapportent peu. En voici la raison : si les fondateurs de l’empire marchent dans la voie de la religion, ils n’adoptent que les impositions autorisées par la loi divine, c’est‑à‑dire, la dîme aumônière, l’impôt foncier (kharadj)et la capitation (payée par les juifs et les chrétiens). Or la dîme de l’argent monnayé est peu forte, comme chacun le sait, celle des grains et des troupeaux n’est pas lourde ; il en est de même de la capitation et de l’impôt foncier. Or le taux de ces impôts est fixé par la loi et ne peut pas être augmenté. Si l’empire a été fondé sur l’esprit de tribu et de conquête, la civilisation a dû y être d’abord celle de la vie nomade, ainsi que nous l’avons dit ailleurs. Or cette civilisation a pour effet nécessaire de porter le gouvernement à l’indulgence, à la générosité, à la douceur, à la répugnance de toucher aux biens du peuple et à l’indifférence pour l’acquisition des richesses, excepté dans des cas assez rares. Aussi les taxes et impôts individuels, dont le montant forme le revenu de l’empire, sont très légers et, cela étant ainsi, les sujets se livrent à leurs travaux avec ardeur et avec plaisir ; la culture des terres prend beaucoup d’extension, parce qu’on veut profiter des avantages que la faiblesse des impôts assure aux cultivateurs, et cela augmente beaucoup le nombre des personnes dont les contributions forment les richesses de l’État. Quand l’empire a duré pendant un certain temps, sous plusieurs souverains successifs, les chefs de l’État acquièrent plus d’habileté dans les affaires et perdent, avec leurs habitudes de la vie nomade, la simplicité de mœurs, l’indulgence et le désintéressement qui les distinguaient jusqu’alors ; l’administration devient sévère et exigeante ; les usages de la vie sédentaire développent l’intelligence des fonctionnaires publics ; dès lors ces hommes se montrent plus habiles en affaires et, comme ils se livrent aux jouissances du bien‑être, ils acquièrent les habitudes (du luxe) et de nouveaux besoins. Cela les porte à augmenter le taux des impôts auxquels les laboureurs, les cultivateurs et tous les autres contribuables sont soumis ; ils veulent que chaque taxe, chaque impôt, rapporte beaucoup, afin d’augmenter le revenu de l’État. Ils imposent aussi des droits sur les ventes et établissent des percepteurs aux portes de la ville ; mais de ceci nous parlerons plus tard. Les habitudes de luxe et de dépense augmentent graduellement dans l’État et, comme les besoins du gouvernement se multiplient, les impôts s’élèvent dans la même proportion et pèsent lourdement sur le peuple. Cette charge lui paraît cependant une chose d’obligation, vu que l’augmentation des impôts s’était faite graduellement, sans qu’il eût remarqué qu’on les avait portés au-delà du taux primitivement établi et sans savoir qui l’avait fait. Aussi ce taux augmenté demeure comme une obligation à laquelle on a toujours été accoutumé. Plus tard, l’impôt dépasse les bornes de la modération et détruit, chez les cultivateurs, l’amour du travail. Quand ils comparent les frais et les charges qu’ils doivent supporter avec les profits et les avantages qu’ils peuvent espérer, ils se laissent aller au découragement, et beaucoup d’entre eux renoncent à la culture des terres. Cela amène une diminution dans le produit de l’impôt et, par une suite nécessaire, dans le revenu de l’État. Quelquefois, quand les chefs de l’empire s’aperçoivent de cette diminution, ils croient pouvoir y remédier en augmentant les impôts, et ils continuent à suivre ce système jusqu’à ce que le taux des contributions atteigne une limite au-delà de laquelle aucun profit ne peut rester au cultivateur. Les frais du labourage et les impôts absorbent tout et ne laissent aucun avantage à espérer. Comme le revenu ne cesse de diminuer, le gouvernement continue à augmenter les impôts dans l’espoir de combler le déficit ; on renonce enfin à la culture des terres parce qu’on a perdu l’espoir de profiter de son travail, et tout le mal qui résulte de cela retombe sur l’État. En effet, quand l’agriculture rapporte beaucoup, c’est le gouvernement qui en profite. Le lecteur qui aura compris ce que nous venons d’exposer reconnaîtra que le meilleur moyen de faire prospérer l’agriculture, c’est d’amoindrir autant que possible les charges que l’État impose aux cultivateurs ; ils se livrent alors avec empressement aux travaux agricoles, avec l’assurance d’en recueillir les profits. Dieu est le maître en toute chose.
* * * *
Les droits d’entrée et de marché s’établissent quand l’empire tire vers sa fin
Comme les empires qui commencent n’ont d’autre civilisation que celle de la vie nomade, les chefs de l’État ignorent le luxe et ses habitudes, et ont peu de besoins. Leurs dépenses sont minimes, le revenu suffit pour tout couvrir, et alors même il en reste encore beaucoup. Bientôt cependant ils se font aux usages de la vie sédentaire et aux habitudes du luxe ; suivant, dans cette voie, l’exemple des dynasties qui les ont précédés. Cela amène une grande augmentation dans les dépenses de l’État et dans celles du sultan surtout, parce qu’il est obligé de pourvoir à l’entretien de toutes les personnes qui composent sa maison, et de faire beaucoup de cadeaux. Comme le revenu de l’empire ne peut plus suffire à la solde des troupes et aux dépenses du souverain, le gouvernement se trouve forcé d’y remédier en augmentant le taux des impôts, ainsi que nous l’avons dit.
La nécessité de satisfaire aux habitudes du luxe, et d’entretenir une armée pour la défense du pays, fait augmenter graduellement les dépenses et accroître les besoins du gouvernement. L’époque de la décadence arrive, et les forces militaires de l’empire ne suffisent plus pour faire rentrer les contributions dues par les provinces et par les contrées éloignées : le revenu diminue, les habitudes du luxe augmentent, et, avec elles, la solde et les gratifications qui s’accordent aux troupes. Alors le souverain invente de nouveaux impôts ; il fait prélever dans les marchés une certaine somme sur le prix de tous les objets vendus, et il soumet à une taxe les marchandises elles-mêmes, quand on les introduit dans la ville. Il est contraint de prendre ces mesures parce que les fonctionnaires publics ont besoin de forts traitements afin de vivre dans le luxe, et qu’une grande augmentation s’est faite dans l’armée. Quand l’empire est prêt à succomber, le poids des impôts a ordinairement atteint sa dernière limite, les marchés chôment par suite du découragement des négociants, ce qui annonce la ruine de la prospérité publique, malheur dont l’État pâtira. Cela continue jusqu’à la chute de l’empire. Dans les derniers temps des Abbassides et des Fatimides, les grandes villes de l’Orient offraient de nombreux exemples de ces impôts extraordinaires ; on en prélevait même sur les pèlerins à la grande foire de la Mecque ; mais Salah ed-Dîn (Saladin) Ibn Aiyoub les supprima tous et les remplaça en prenant des mesures qui contribuèrent au bien public. Il en fut de même en Espagne, sous les rois provinciaux ; mais Youçof Ibn Tachefîn, l’émir des Almoravides, y mit fin. De nos jours, les mêmes abus eurent lieu dans le Djérid, province de l’Ifrîkiya, quand les chefs qui gouvernaient les villes de cette contrée se furent déclarés indépendants.
* * * *
Le souverain qui fait le commerce pour son compte nuit aux intérêts de ses sujets et ruine les revenus de l’État
Quand le revenu de l’empire ne suffit plus aux frais et aux besoins du gouvernement, ce qui tient au progrès du luxe et des habitudes de dépense, on est obligé d’avoir recours à des moyens extraordinaires pour y remédier et pour se procurer de l’argent. On impose des taxes sur les objets vendus par les sujets de l’État et l’on établit des droits de marché, ainsi que nous venons de le dire dans le chapitre précédent ; ou bien on augmente les impôts de toutes espèces déjà existants, ou bien encore on pressure les agents du fisc et les percepteurs, parce qu’on suppose qu’ils se sont approprié une partie considérable des impôts, sans la porter sur leurs comptes. D’autres fois on cherche à augmenter le revenu au moyen d’entreprises commerciales et agricoles qui se feront au nom du sultan. Voyant que les négociants et les cultivateurs recueillent des profits considérables, malgré la modicité de leurs ressources pécuniaires, et s’imaginant que le gain est toujours en raison directe du capital employé, le prince se procure des bestiaux, fait des plantations dont il espère retirer un grand profit, et achète des marchandises pour les écouler sur les marchés, dans la pensée d’augmenter le revenu de l’État et de gagner beaucoup. Mais c’est là une erreur grave et nuisible, sous plusieurs rapports, aux intérêts du peuple : d’abord on rend très difficile aux cultivateurs et aux négociants l’achat de bestiaux et de marchandises, et l’on aide aux causes (qui amènent l’enchérissement). Les hommes de ces classes, étant à peu près égaux sous le point de vue de la fortune, se font concurrence jusqu’à la limite de leurs moyens ; mais quand ils ont pour concurrent le souverain, qui a sous la main des sommes bien autrement considérables que celles dont ils disposent, à peine un seul d’entre eux peut-il réussir dans ce qu’il entreprend. Cela chagrine les esprits et les mécontente. Ensuite il arrive très souvent que le sultan s’approprie des marchandises par force, ou se les fait céder à vil prix, parce que personne n’ose enchérir sur lui, ce qui est une cause de grandes pertes pour les vendeurs. De plus, quand il a recueilli les fruits de ses récoltes, tels que grains, soie, miel, sucre ou autres produits de cette nature, ou qu’il se trouve en possession d’une grande quantité de marchandises diverses, s’il est obligé de subvenir tout de suite aux besoins de l’État, il n’attend pas jusqu’à ce qu’il ait écoulé ces denrées par des ventes régulières sur les marchés ; mais il oblige les personnes qui en font le commerce, c’est-à-dire, les négociants et les cultivateurs, de se fournir auprès de lui, et à un prix qui dépasse ordinairement la valeur réelle de ce qu’ils achètent. De cette façon ils se voient privés de leur argent comptant, chargés de marchandises qui leur resteront longtemps sur les bras, et forcés de suspendre les opérations qui les faisaient vivre. Aussi, quand un pressant besoin d’argent les oblige à vendre une partie de ces marchandises, ils n’en retirent qu’un vil prix, vu l’état languissant du commerce. Il arrive souvent qu’un négociant ou un cultivateur se défait ainsi de ses fonds d’une manière graduelle, jusqu’à ce qu’il ne possède plus rien, et qu’il soit obligé de rester chez lui, sans aller au bazar. Ces cas se reproduisent fréquemment, au grand préjudice du public ; on finit par ne plus rien gagner, par tomber dans l’embarras et dans la gêne, et par renoncer tout à fait à ses occupations. Le revenu de l’empire s’en ressent, puisqu’il consiste presque entièrement en contributions payées par les cultivateurs et les négociants. C’est surtout après l’établissement des droits de marché pour augmenter le revenu du gouvernement que cela devient sensible. Quand les cultivateurs ont renoncé à l’agriculture et les négociants au commerce, le revenu n’existe plus, ou bien il subit une diminution énorme. Si le souverain voulait comparer les faibles profits (qui dérivent de ses entreprises commerciales et agricoles) avec les sommes provenant des impôts, il les regarderait comme moins que rien.
Quand même ces opérations lui rapporteraient beaucoup, elles lui feraient perdre considérablement du côté du revenu ; car d’ordinaire on ne l’oblige pas à payer les droits de vente et d’entrée, tandis qu’on les exige toujours des autres commerçants pour le compte du trésor. Ajoutons que ces entreprises tendent à ruiner l’agriculture, et cela est la perte de l’empire. En effet, si les sujets de l’État ne cherchent pas à faire valoir leur argent par l’agriculture et par le commerce, ils seront obligés de vivre de leurs capitaux, et, quand ils auront tout dépensé, ils seront ruinés. C’est là une chose qu’il faut bien comprendre.
Les Perses choisissaient toujours pour roi un membre de la famille royale distingué par sa piété, sa bonté, son instruction, sa libéralité, sa bravoure et sa générosité, et ils lui faisaient prendre l’engagement de gouverner avec justice, de ne pas avoir des fermes à lui, ce qui pourrait nuire aux intérêts de ses voisins ; de ne pas exercer le commerce, car cela augmenterait nécessairement le prix des marchandises, et de ne pas avoir des esclaves à son service, parce qu’ils ne donnent jamais des conseils qui soient bons et utiles. C’est le revenu de l’État seul qui enrichit le souverain et augmente ses moyens. Pour que le revenu soit ample, on doit ménager les contribuables et les traiter avec justice ; de cette manière on les encourage et on les dispose à travailler avec empressement dans le but de faire fructifier leurs capitaux ; car c’est d’eux que le souverain tire presque tout son argent. Toute autre occupation à laquelle un souverain pourrait se livrer, le commerce, par exemple, et l’agriculture, nuit promptement aux intérêts du peuple, au revenu de l’État et à la culture des terres.
Il arrive quelquefois qu’un émir ou le gouverneur d’un pays conquis se livre au commerce et à l’agriculture, et oblige les négociants qui visitent cette contrée et qui s’occupent de ces branches de commerce de lui céder leurs marchandises au prix qu’il fixe lui-même. Ensuite il s’empresse d’y mettre un prix (plus élevé) et de les vendre à ses administrés. Cela est encore pis que le système suivi par le sultan, et nuit plus gravement aux intérêts de la communauté. Les sultans eux-mêmes écoutent quelquefois les conseils de personnes engagées dans ces branches de commerce, c’est-à-dire des négociants ou des cultivateurs, parce qu’ils croient que ces gens, ayant été élevés dans le métier, le comprennent bien. D’après l’avis de ces individus, ils s’engagent dans le commerce et les associent dans l’entreprise. Cela permet à ceux-ci d’arriver à leur but, c’est-à-dire de gagner beaucoup et promptement, surtout s’ils ont la permission de faire le commerce pour leur propre compte, sans être obligés à payer des droits ou des taxes. C’est là, assurément, le moyen le plus certain et le plus prompt de faire valoir ses capitaux ; mais de pareilles gens ne se doutent pas du tort que cela fait au sultan en diminuant ses revenus. Les souverains devraient se tenir en garde contre ces hommes et repousser toutes leurs propositions, parce qu’elles tendent à ruiner également le revenu du prince et son autorité. Que Dieu nous inspire pour nous diriger nous-mêmes, et qu’il nous fasse jouir des fruits de nos bonnes actions. Il n’y a point d’autre seigneur que lui.
[1] Ibn-Khaldûn, Le Livre des Exemples, Nrf, Gallimard, La pléiade, 2002, p. 631.
[2] idem, pp. 604 sq.
[3] idem, p. 745.
[4] idem, pp. 623-624.
[5] Idem, p.631.
[6] Une version numérique de cette traduction se trouve au lien suivant : http://classiques.uqac.ca/classiques/Ibn_Khaldoun/Prolegomenes_t2/Prolegomenes_t2.html