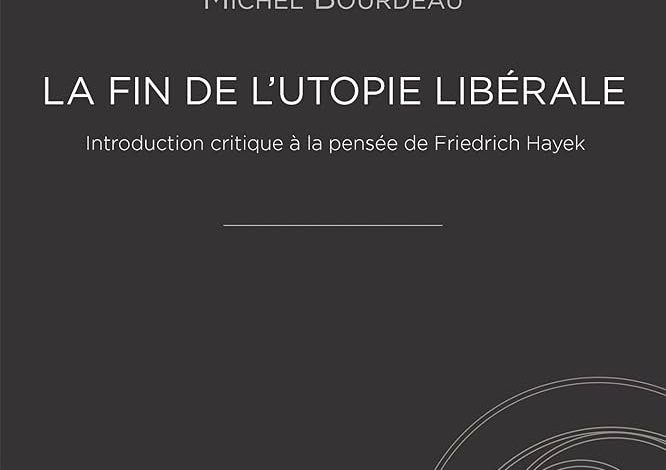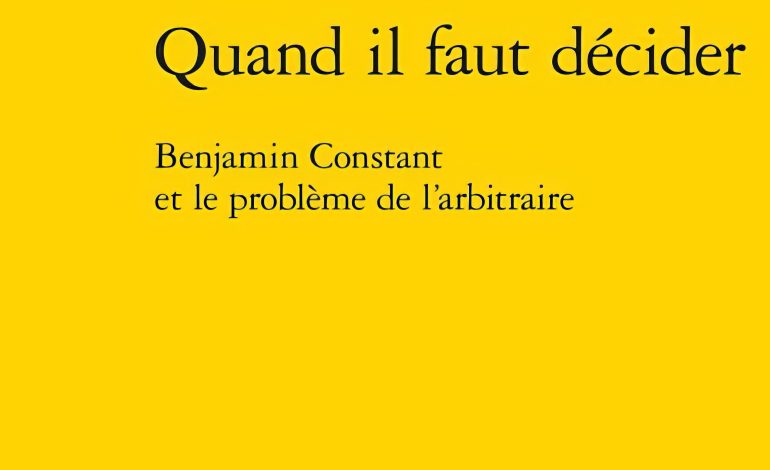Pourquoi faire des notes de lectures communes à deux ouvrages en apparence dissemblables, l’un plutôt à destination du grand public, l’autre publié dans la célèbre collection « Que sais-je ? » ? Deux raisons l’expliquent. D’abord, ils abordent en réalité le même thème : le « néolibéralisme ». Ensuite, ils l’abordent en réalité sous l’angle de la dénonciation, ce qui ne saurait surprendre s’agissant de deux économistes qui ont appelé à voter en faveur de Jean-Luc Mélenchon lors de l’élection présidentielle. Ce qui classe son homme (et sa femme). Remarquons en liminaire ce tropisme de l’édition française de faire paraître quasi-uniquement des livres antilibéraux…

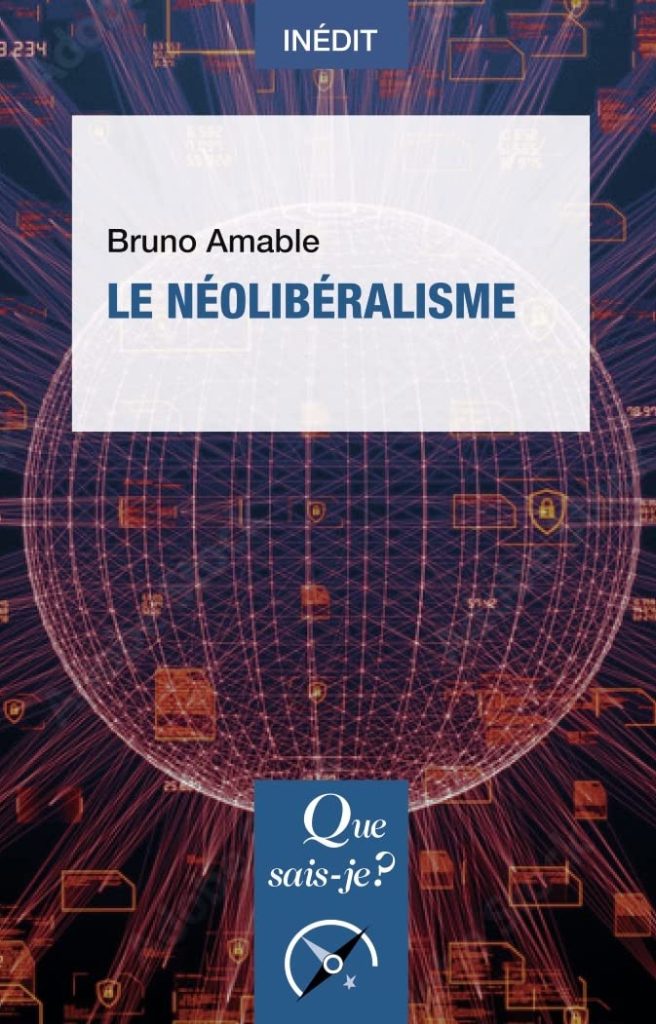
L’ouvrage de Anne-Laure Delatte, dont le titre peu élégant constitue une première indication peu engageante, est le fait d’une chercheuse en économie au CNRS, ancienne chroniqueuse pour Libération, membre du Conseil d’analyse économique et du comité scientifique de la Fondation Banque de France. L’essentiel de L’État droit dans le mur présente si peu d’intérêt que nous nous contenterons de quelques observations, à l’exception d’un point. L’idée générale est qu’il n’existe plus d’État-providence en France, remplacé qu’il a été – comme dans le monde (d’apparence) démocratique – par un État « néolibéral ». Aux naïfs et incultes qui se récrieraient devant pareille présentation, Anne-Laure Delatte répond que les impôts sont payés avant tout par les ménages et pas par les entreprises, plus précisément par les ménages les moins riches et par les entreprises les moins grandes (chapitre 2, pp. 49 s.) ; que le financement public profite aux entreprises, et spécialement aux plus grandes, plutôt qu’aux ménages (chapitre 3, pp. 71 s.) ; que l’action publique est plus « au service du marché » et qu’elle s’est détournée « de ses missions de protection et de planification » (chapitre 4, pp. 97 s.). Après le constat de la première partie suivent les conséquences catastrophiques du détournement de l’action publique (chapitre 5, pp. 135 s.) et les solutions idylliques du dépassement de la « logique du marché » par la « gauche radicale » au profit de vraies valeurs, non pas celles de la maximisation du profit, mais, avec force originalité, « le respect de la planète, la justice sociale, l’affirmation des identités [il ne s’agit évidemment pas de l’identité nationale…], le rejet du patriarcat, la protection du vivant [il ne s’agit évidemment pas du rejet de l’IVG…] » (chapitre 6, pp. 173 s. & épilogue, pp. 213 s.).
Deux développements valent le détour. Anne-Laure Delatte fait de la politique fiction en imaginant le retour à deux blocs avec soit la disparition du bloc de la « gauche de rupture », soit – solution de ses rêves – l’opposition de cette dernière au rapprochement entre « le bloc bourgeois (sic) » et le bloc de la droite identitaire. Ce qui interpelle, c’est la note de bas de page qui suit : « Le durcissement des restrictions de liberté à la fin du premier mandat d’Emmanuel Macron et les prises de paroles comme l’hommage au Maréchal Pétain » justifient le scénario de la première branche de l’alternative qui vient d’être énoncée (p. 211, n._1). On pourrait sourire, mais les derniers mots de l’épilogue sont, eux, au mieux inquiétants : « Nous n’avons plus d’autre choix que résister et désobéir » et ce, « contre tout ce qui s’oppose au vivant » car « on est du bon côté de l’Histoire » (p. 217). Conclusion de type mélenchonien qui constitue un appel à peine voilé à la violence et l’insubordination.
Revenons au développement précédent. Au-delà de la colossale finesse de l’appariement entre Emmanuel Macron et le pétainisme, ce qui frappe c’est le fait que l’auteur qualifie le « bloc bourgeois » et le « bloc de la droite identitaire », appelés à s’opposer entre eux uniquement ou au contraire à se liguer contre la « gauche de rupture », de « deux blocs néolibéraux » (p. 211). C’est ici que nous souhaiterions nous appesantir sur le seul paragraphe vaguement conceptuel de l’ouvrage : « Détour par le Mont-Pèlerin en 1947 » (pp. 36 s.). Voici la synthèse des cinq pages et demie à peine qui fondent finalement le livre : ce ne sont pas les participants au Colloque Lippmann de 1938, mais ceux de la première réunion de la Société du Mont-Pèlerin neuf ans plus tard qui vont « changer le destin du monde » (pp. 36-37). En effet, ils vont concevoir un « nouveau régime économique », qui va s’imposer presque partout dans le monde à partir des années 1970 : le « néolibéralisme ». Le Colloque Lippmann avait permis de poser les deux fondements du nouveau courant de pensée : l’échec du libéralisme classique et par conséquent l’opposition au « laisser-faire (sic) » – comme dans tout livre opposé au libéralisme, l’expression est à l’infinitif pour bien l’apparenter au laisser-aller –, d’une part ; le rejet du socialisme et du collectivisme, d’autre part. La solution ? L’intervention de l’État, qui doit organiser le marché pour créer et entretenir son bon fonctionnement et non pas, comme l’État-providence, la garantie du bien-être des citoyens. Au service des entreprises et non pas de ces derniers, l’État fort doit être dénué de pouvoir du fait de la minimisation de l’importance de ses fonctions, d’une démocratie tenue en lisière et des solutions du marché systématiquement prônées (pp. 38-41).
Malheureusement, lorsque l’auteur prétend que le Colloque Lippmann a rejeté le laissez-faire et la non-intervention de l’État dans l’économie, et qu’il ne croyait pas en l’harmonie naturelle des intérêts, il y a amalgame de plusieurs courants de pensée et surtout évincement de la position des libéraux autrichiens. Mais là, le lecteur est songeur. En effet, l’auteur gourmande un journaliste pour avoir confondu « ultralibéralisme » et « néolibéralisme » (p. 23) et il reconnaît que la France n’est pas un pays ultralibéral, mais « simplement néolibéral » (p. 130). Mais que veut dire dès lors ce mot « ultralibéral » ? ! N’y avait-il pas des « ultralibéraux » au Colloque Lippmann, et plus encore lors de la création de la Société du Mont-Pèlerin ?
Le second ouvrage commenté est – heureusement – plus sérieux d’apparence. L’objet de l’opuscule Le Néolibéralisme écrit par Bruno Amable, professeur français d’économie à l’Université de Genève, est de donner une vue d’ensemble de cette doctrine, ce qui n’a rien d’original pour un livre de la collection « Que sais-je ? ». Hélas, l’auteur échoue doublement dans sa quête, d’abord pour des raisons conceptuelles, ensuite pour des raisons idéologiques qui lui sont propres !
Sur le premier point, le lecteur s’attendait – c’est bien le moins – à une clarification conceptuelle du concept, et cette clarification devait logiquement se rencontrer dès les premières pages. Ce qui n’est pas le cas tant l’introduction verse dans le vague (pp. 5 s.). On saura seulement que le néolibéralisme « est constitué de plusieurs courants (l’ordolibéralisme, l’École autrichienne, l’École de Chicago…) », ce qui est déjà problématique ; et qu’il existe à travers diverses organisations, dont la Société du Mont-Pèlerin (p. 6). En réalité, il faut attendre le début du dernier chapitre pour trouver une définition – commune au demeurant – du sujet : « Le néolibéralisme est une idéologie et une doctrine pour l’action qui cherche à consolider les sociétés libérales et l’économie capitaliste en dépassant les apories du vieux libéralisme et en s’opposant au socialisme » (p. 58). Et il faut attendre la conclusion pour voir apparaître clairement les éléments centraux du néolibéralisme : marché concurrentiel, mécanisme des prix, opposition radicale au socialisme et au communisme (p. 112).
On peut considérer que le néolibéralisme est, comme son nom l’indique, un vaste mouvement historiquement situé qui a pour volonté de faire émerger un nouveau libéralisme. Dans l’entre-deux guerres, en réaction à l’émergence des totalitarismes et à la crise de 1929, des intellectuels entendent tirer les leçons de la naïveté et/ou de l’échec du libéralisme classique en redéfinissant les missions de l’État, chargé d’organiser l’économie et d’y intervenir tout en laissant le marché subsister. Peuvent effectivement s’inscrire dans ce mouvement les néolibéraux français et les tenants de l’ordolibéralisme allemand. Mais il est conceptuellement artificiel et historiquement faux d’y amalgamer le libéralisme autrichien.
Notable à cet égard est le développement sur l’ordre juridique (p._24). Après avoir exposé que « la rupture avec le laisser-faire (sic) passe par un interventionnisme de type juridique et règlementaire », l’auteur prétend que pour les néolibéraux, l’ordre de marché concurrentiel est « une construction délibérée (pour les ordolibéraux) ou, au moins, de l’action humaine (pour les Autrichiens comme Hayek) ». Manifestement, il s’agit d’une interprétation fausse (volontaire ?) tant de l’action humaine misesienne que de l’ordre spontané hayekien. Le début du chapitre 2 interpelle également : « Une vision commune de la société néolibérale est celle où toutes les relations sociales sont soumises à la loi du marché. Le comportement de l’homo economicus (…) ne s’appliquerait pas seulement aux échanges économiques mais à l’ensemble des relations humaines » (p. 31). Il est vrai que l’auteur apporte un bémol à son allégation au sujet des ordolibéraux, mais il renvoie en note de bas de page à Pierre Bourdieu interprété par Christian Laval. Or, il s’agit d’une confusion, dénoncée en son temps par Bastiat, entre gouvernement et société, et d’une incompréhension de la conception libérale de la société civile. Et lorsque l’auteur concède en conclusion que « le néolibéralisme a pu être associé à des discours différents voire contradictoires selon l’époque et les auteurs » (p. 111), qu’il « est flexible et il s’adapte aux circonstances » (p. 112), c’est sans doute que le concept a mal été envisagé et qu’il appartenait pourtant à l’auteur de démêler l’écheveau. En substance, le caractère flou de la définition du libéralisme adopté par Bruno Amable autorise de nombreuses confusions tant d’idéologies que de doctrines pour l’action. Ce flou artistique est peut-être volontaire, comme on va le comprendre plus loin.
Un dernier mot sur certains passages qui démontrent une connaissance parfois évanescente du libéralisme. Nous avons déjà relevé l’incompréhension de l’ordre spontané hayekien (p. 24). Mais certaines allégations méritaient à tout le moins quelques précisions. L’auteur fait référence à une politique libérale non interventionniste en citant en note de bas de page le fait que le secrétaire d’État au Trésor ait « dissuadé le Président Hoover d’intervenir » (p. 81, n. 1). Un lecteur peu informé en conclurait à l’absence d’interventionnisme du président américain, interprétation certes classique mais controuvée. La référence à la monnaie privée chez Hayek, avec citation du seul troisième volume de son œuvre majeure en 1979 et renvoi à la « rhétorique réactionnaire » de Hirschman (cité deux fois), démontre que l’auteur n’a pas lu la Dénationalisation de la monnaie (p. 88). On ne voit pas non plus en quoi « le courant néolibéral le plus radical au sein de l’économie orthodoxe est probablement l’école du choix public (sic) » (p. 88). Quant à l’idée selon laquelle « l’individualisme méthodologique de Buchanan » s’opposerait à « l’évolutionnisme de Hayek », elle laisse songeur (p. 111, n. 2).
Sur le second point, à savoir l’échec de Bruno Amable pour des raisons idéologiques qui lui sont propres, les lecteurs s’attendaient – c’est bien le moins – à un ouvrage scientifique qui expose de manière suffisamment neutre son sujet, quelle que soit l’idéologie – en l’occurrence très marquée à gauche – de son auteur. Il y a malheureusement loin de la coupe aux lèvres. On trouve bien entendu dans l’opuscule les morceaux de choix habituels contre la pensée autrichienne : l’éloge du fascisme par Mises en 1927, les liens incestueux de Hayek, mais aussi de Friedman, avec la dictature de Pinochet
(pp. 39-40)[1]. Bruno Amable tient manifestement à cœur l’exemple du Chili puisqu’il y revient au sujet de l’École « du choix public (sic) » et des célébrissimes Chicago boys quelques dizaines de pages plus loin
(pp. 90-91). Il insiste, dès l’introduction, sur les échecs du « néolibéralisme » : les grandes institutions internationales – la Banque mondiale, le FMI et l’OCDE – partagent « la croyance (sic) dans les vertus du marché concurrentiel pour apporter la prospérité » (p. 8. V. aussi p. 101) ; en 1982, le Chili « entrait dans une crise économique » (p. 40) ; les politiques de libéralisation depuis les années 1980 profiteraient « au consommateur du point de vue de la qualité du service » par rapport au monopole public précédent, « ce qui est moins certain » (p. 78) ; « les résultats en matière de performance éducative et d’égalité d’accès à un enseignement de qualité se sont révélés plus que décevants », s’agissant des écoles privées financées par l’État (p. 81). Le morceau de choix se trouve en conclusion où l’auteur donne une vue apocalyptique de la politique néolibérale à la fin du XXeme siècle et au début du XXIeme (p. 114). Et comme l’auteur a fait d’Emmanuel Macron l’acteur paradigmatique du néolibéralisme (pp. 64-65), le lecteur se dit alors : CQFD….
[1] Sur ce dernier point on pourra consulter F. Facchini, « Friedrich Hayek et la dictature chilienne d’Augusto Pinochet », Journal des libertés, N°22, automne 2023. https://bit.ly/3H04H7L