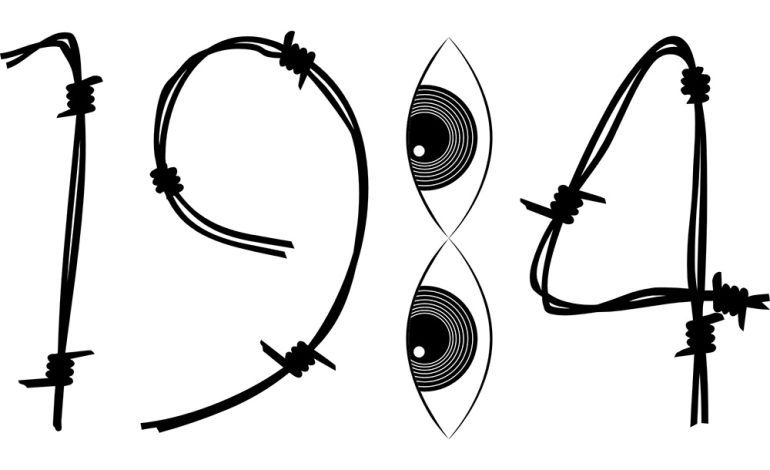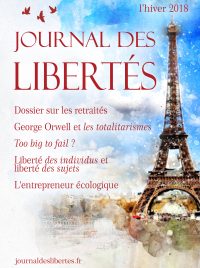Au tournant du siècle a été publié en France un livre dont le titre est Une société sans pères ni maris : les Na de Chine. L’auteur
est un ethnologue sino-français, Cai Hua. Il décrit, au cours d’un livre long et passionnant, une société d’environ 300000 personnes qui vit aujourd’hui en Chine sous les contreforts du Tibet, dans la province du Yunnan. Il s’agit d’une société matrilinéaire et matriarcale. Le mariage n’existe pas. Les relations sexuelles s’organisent selon le système dit de la « visite » : société polygame et polyandre à la fois, où les partenaires changent sans cesse. Chaque femme éduque ses propres enfants et héberge ses frères sous son toit, avec interdiction sévère de l’inceste. Le mot « père » n’existe pas dans la langue Na. Seul existe le mot « oncle ».
Ce livre a été très bien accueilli en France, car il répond de façon indirecte à certaines questions posées par l’évolution de la famille occidentale. Cai Hua a été invité par la presse et par la télévision pour développer les thèses de sa conclusion : « Le mariage n’apparaît plus comme le seul mode de vie sexuelle institutionnalisée possible. Le cas Na témoigne du fait que le mariage et la famille ne peuvent plus être considérés comme universels, ni logiquement, ni historiquement. »
Les sociétés occidentales de la fin du XXème siècle visent à développer la liberté individuelle la plus extrême : possibilité de divorcer unilatéralement et sans explication, possibilité pour les femmes de disposer entièrement de l’enfant à naître et droit à l’élever seule, possibilité pour les parents de se dessaisir de la responsabilité de leurs enfants (la loi sur le Pacte Civil de Solidarité, votée en 1999 en France). La multiplication des familles dites monoparentales et la disparition du père, en est le signe. A ceux qui voient là une évolution néfaste, Cai Hua répond : les Na vivent de cette façon depuis des siècles ; ce mode d’existence est donc aussi humain qu’un autre, et nous pourrions très bien vivre comme les Na.
Effectivement. L’historien Michel Rouche établit les principales caractéristiques du modèle matriarcal dans l’histoire (modèle assez fréquent dans les temps anciens) : absence de mariage, maîtrise de la fécondité par les femmes seules, éviction du père, sacralisation du plaisir. Nous sommes en train d’adopter peu à peu ce type d’organisation, au nom du progrès indéfini de la liberté individuelle. Le désir, dans les sociétés occidentales, de se débarrasser de la paternité est à la mesure de la fascination vis-à-vis de ces sociétés sans père. L’ONU, pour son 50° anniversaire, a déclaré le peuple Moso (ou Na), sans père ni mari, comme « peuple modèle », « société parfaite »… ce qui en dit long sur nos capacités d’illusion.
Chez les Na, le père n’a aucune responsabilité vis à vis de ses enfants, qu’il ne connaît pas. Les douloureux problèmes de la jalousie et de la fidélité, sont abolis. Les Na sont des individus très libres, sexuellement et affectivement.
Et pourtant ils vivent dans une société extrêmement contraignante. Ils sont soumis à des lois strictes qui réglementent leur vie intime (par exemple, le frère et la sœur n’ont pas le droit de déjeuner en tête-à-tête).
Y a-t-il là un paradoxe ? Non : une logique, au contraire. Car si les Na sont des individus libres, ils ne sont pas des sujets autonomes. Les contraintes sociales sont obligatoires pour compenser leur incapacité à se donner eux-mêmes des limites. Durkeim disait déjà que plus on allège les individus de leur responsabilité, plus on doit augmenter la contrainte sociale.
Autrement dit, la liberté de l’individu est la possibilité d’agir selon son gré à tout instant, sans responsabilité dans le temps, et sous une forte contrainte sociale. Tandis que la liberté du sujet est de délimiter son propre champ d’action, de se donner ses propres lois (autonomie) et de répondre soi-même de ses actes : autrement dit, de maîtriser son existence sous une contrainte sociale faible.
D’où cette conviction : l’évolution actuelle de la famille occidentale se heurte moins à une réalité anthropologique (comme le croient trop facilement les conservateurs), qu’à un fait d’anthropologie culturelle. Nous pouvons développer la liberté individuelle jusqu’à l’extrême, mais dans ce cas nous abandonnerons ce que notre culture a probablement construit de plus haut : la figure du sujet responsable. Dans l’exemple choisi, celui de la famille (mais ce serait vrai dans d’autres domaines), le matriarcat de la famille monoparentale ne permet pas l’instauration du sujet.
L’individu Na vit dans une collectivité contraignante et reçoit une éducation d’initiation. Le sujet européen reçoit une éducation d’initiative et répond de ses propres actes. Apprendre l’initiative, construire son autonomie, c’est intégrer la catégorie de l’impossible, c’est reconnaître soi-même les limites de sa propre action. Or c’est à travers la loi du père que l’individu devient sujet. Sous le règne de la mère, l’enfant vit dans le pays du désir, où il fait ce qui lui plait, à charge pour l’autorité sociale de le surveiller, de le contraindre et de le punir. La société matriarcale n’est pas capable d’abriter l’autonomie personnelle : car elle s’inscrit dans la double logique de la protection et de la soumission, dont l’autonomie est absente. Nos contemporains voient apparaître une forme plus moderne de famille dans ce que l’on appelle aujourd’hui les « tribus », ou familles recomposées. Mais ils ne voient pas que, contrepartie nécessaire, ce sont désormais les instances d’État (infirmières scolaires ou professeurs) qui organisent la vie de l’enfant. C’est ainsi qu’aujourd’hui en France, ceux-là mêmes qui revendiquent la famille monoparentale réclament la présence de la police à l’école, afin de répondre aux violences engendrées par l’absence d’autorité familiale. L’enfant peut avoir l’impression première qu’il devient plus libre en échappant ainsi à sa famille et en recevant la loi d’une autorité anonyme. En réalité, il a perdu ce qui aurait fait de lui un sujet : les instances sociales peuvent lui imposer un comportement, mais elles ne sont pas capables de lui apprendre l’autonomie. Car l’éducation à l’autonomie est une tâche de complicité, d’affection et de patience, qui s’accomplit par essais et erreurs, et accepte le risque. Seule une famille structurée dans laquelle les rôles d’autorité sont répartis et durables, peut assumer ce risque. La famille a les moyens de proposer une éducation d’initiative, essentielle à la construction d’un sujet. Les autorités sociales ne peuvent assurer qu’une initiation.
Aucune société humaine ne peut vivre dans l’incohérence des caprices individuels. Comme l’individu occidental contemporain, le Na de Chine est un amant de passage, un père inexistant, enfin un vieillard anonyme et souvent abandonné (quand sa sœur et ses neveux ne veulent plus de lui). Mais il est encadré par un système sévère qui vise à protéger les enfants et à perpétuer la vie. L’individu contemporain, de plus en plus « libéré » de ses responsabilités, se croit libre comme jamais : mais c’est là une fantaisie d’intellectuel, qui laisse attendre la main tutélaire de l’État. Si l’être humain est irresponsable, il faut qu’il soit soumis ; s’il veut être libre, il doit assumer la trace de ses actes.
L’été 2000, un voyage m’a amenée par hasard au pays des Na. Ce sont des paysans heureux, qui élèvent des yacks à 3000 mètres d’altitude. Partout les femmes travaillent et les hommes vaquent sans souci particulier. Ce pays est celui qu’un écrivain anglais a appelé Shangri-la, le pays du bonheur éternel. Les Na ont créé une société où les enfants rient et jouent comme en Europe. Mais ils ne sont pas des sujets. Aurons-nous la volonté et le courage de demeurer des sujets ? Cette question reste à notre charge.