Le problème n’est pas tant leur taille que le régime de faveur qui leur est accordé au nom de croyances théoriques non définitivement confirmées.
Tous les libéraux ne sont pas toujours d’accord sur tout. Ce qui est au demeurant une excellente chose. Il faut des désaccords, des discussions, des débats – même vifs – pour que la pensée avance et s’adapte notamment aux changements que suscite le monde réel.

|
Henri Lepage est économiste. Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, il a également étudié à l’Université du Colorado et à la LSE. Journaliste économique de 1967 à 1976 il a depuis enseigné et fait du conseil en divers endroits (dont Paris-Dauphine). Il est membre de la Société du Mont Pèlerin et administrateur de l’ALEPS. Ses nombreux ouvrages incluent Demain le capitalisme (Pluriel 1978) ou encore Demain le libéralisme (Pluriel 1980). |
Le domaine où ces discussions sont souvent les plus vives concerne la finance, les banques, et leur rôle dans l’origine des forces et processus qui ont donné naissance à la grande crise financière d’il y a dix ans, puis la cruelle déception qui suivit (et dure encore : l’absence de véritable reprise économique[1]). Elles se cristallisent généralement sur la question de savoir quelle attitude adopter à l’égard des « Too Big To Fail »[2] (TBTF) ; ces banques et établissements financiers géants considérés comme étant trop grands et trop interconnectés pour qu’on n’en laisse faillir un seul sans provoquer l’enchaînement fatal d’une panique globale.
C’est ainsi qu’à plusieurs occasions je me suis fait prendre à partie par des amis libéraux qui me reprochaient, à la différence de ce qu’ils lisaient dans les grands médias, de ne pas suffisamment souligner la responsabilité de ces entreprises dans l’enchaînement des événements. Certes, reconnaissaient-ils, il n’est pas question de passer sous silence ce que l’on doit aux excès réglementaires des pouvoirs publics ainsi qu’au choix pervers des autorités monétaires pour des taux d’intérêt durablement bas. Mais, ajoutaient-ils, « l’élément moteur de la crise de 2008 reste l’existence de ces TBTF, véritables mammouths privés qui, avec la garantie implicite de l’État, privatisent les gains et collectivisent les pertes, et se comportent comme des trous noirs cosmiques menaçant constamment d’absorber tout ce qui les entoure ». C’est notamment Drieu Godefridi qui, il y a deux ans, écrivait : « ces anomalies économiques doivent être encadrées, démantelées avant que ne s’envole le prochain cygne noir économique et financier[3] ».
Cette querelle m’a incité à reformuler la manière dont il convient, à mon avis, d’aborder la question des TBTF. Faut-il ou non intervenir pour les réglementer ? Jusqu’où ?

Katjen / Shutterstock.com
Les TBTF et la crise
Premier point : je ne suis pas d’accord avec l’interprétation de la crise qui consiste à en reporter toute la responsabilité sur la contagion systémique d’un capitalisme financier corrompu par l’hubris spéculatif fruit d’une série d’innovations problématiques (l’ingénierie des produits dérivés).
Je doute même de l’importance réelle de l’effet systémique prétendument déclenché par la faillite de Lehman Brothers.
Il y a vingt ans, je me souviens être tombé sur un article d’Anna Schwartz où la co-auteure de la célèbre étude de Milton Friedman exprimait ses doutes sur la vérité empirique des théories concernant la nature contagieuse des paniques bancaires[4].
Tout repose sur la conviction, colportée par les manuels, que ces paniques sont le talon d’Achille des économies capitalistes et que si elles ont quasiment disparu depuis les années trente (jusqu’à ces jours funestes de 2008) c’est seulement grâce à la mise en place des mécanismes publics d’assurance des dépôts, ainsi qu’à la prise au sérieux par les banques centrales de leur rôle de prêteurs en dernier ressort. Autrement dit, si les États-Unis n’ont plus connu de paniques depuis celles des années 1931-1933 (alors que, traditionnellement, ils en étaient jusque-là les champions), ils le doivent à la création de la Fed et aux économistes qui l’ont conçue.
Il existe en fait deux types de panique bancaire (bank runs)[5]. Le plus banal est celui où la crainte de l’insolvabilité d’un établissement incite les déposants à en retirer leurs dépôts pour les transférer vers d’autres banques dont la solidité financière n’est pas contestée. Le plus redouté par les économistes correspond à la situation où la défaillance d’une banque en particulier entraîne un mouvement de contagion et, par effet de domino, un arrêt généralisé des transactions financières dont seule l’intervention d’un prêteur en dernier ressort permet de sortir par injection massive de nouvelles liquidités. Le type même de schéma qui, nous dit-on, s’est déclenché à l’automne 2008.
Mais est-ce vraiment ce qui s’est passé ? Il y a trois ans, une équipe de chercheurs français, parmi lesquels Guillaume Vuillemey, a entrepris de dépouiller en détail les statistiques concernant le fonctionnement du marché des certificats de dépôts en euro pour la période 2008-2014. Leur objectif : vérifier si ce qui s’est passé au moment de la crise, du moins en Europe, relève bel et bien d’un schéma de contagion conforme au modèle de la pensée économique dominante[6].
Leur conclusion est négative et conforte la critique d’Anna Schwartz. Ce qu’ils observent est un mouvement de redistribution des ressources monétaires des « mauvaises banques » (celles qui sont financièrement les plus fragiles) vers les « bonnes » banques (les plus solides, les mieux gérées). La crise n’a pas affecté au même degré tous les établissements présents sur le marché bancaire des financements de gros (wholesale money market). L’idée que cela suffirait à générer un panne économique et financière généralisée est un mythe.
Si l’on a cependant connu le début d’un tel engrenage c’est parce qu’un autre facteur, totalement exogène, est intervenu qui, à la même époque, a progressivement suscité l’affolement. Ce facteur est le durcissement de l’application dans les banques et établissements financiers de la règle d’évaluation des actifs aux prix de marché (Marked to market). Cette règle entraînait ipso facto la contrainte pour les entreprises de répercuter dans leurs comptes de bilan (et notamment leurs comptes prévisionnels) non seulement les pertes d’exploitation dues aux opérations de liquidation forcées d’actifs, mais également – et ce fut cela le plus grave – les moins-values purement fictives résultant de la chute de valeur marchande de toutes les créances qu’elles entendaient pourtant conserver dans leurs livres. Comme le décrit l’économiste américain Jeffrey P. Snider, cette règle (dite d’impairment) équivalait à déposer une énorme charge de dynamite au cœur même de leurs comptes de pertes et profits. D’où la panique qui s’empara de Washington et de tous les marchés[7].
Les établissements les plus touchés par cette nouvelle contrainte réglementaire furent évidemment ceux qui affichaient et conservaient les plus gros volumes de créances – c’est-à-dire, en particulier, les grands groupes transnationaux (Global banks) qui, portées depuis trente ans par la dynamique de la mondialisation, étaient les plus impliquées dans la production d’instruments de paiement liée à leurs activités de shadow banking [8].
Près de deux dollars sur trois utilisés dans les transactions commerciales et financières mondiales proviennent désormais d’activités créatrices de monnaie hors de portée des banques centrales (Eurodollar), et non du déficit extérieur américain comme il est encore souvent écrit[9]. On imagine aisément la violence de l’impact déflationniste que ces dispositions réglementaires ont pu avoir sur les mécanismes mondiaux de financement et de production de liquidité (Global money). D’après Jeffrey Snider elles auraient entraîné dans les bilans une évaporation potentielle de valeur, et donc une réduction des capacités de financement d’instruments monétaires ou quasi-monétaires, d’un montant égal à plusieurs fois le total des sommes avancées par les autorités US (Trésor + Banque centrale) pour soutenir l’économie.
C’est ce choc monétaire, particulièrement brutal, qui fut la cause première de la catastrophe et non la contagion des subprimes qui, contrairement à ce que l’on croit communément, n’ont joué qu’un rôle relativement subalterne dans le processus[10].
La meilleure preuve en est que ce ne sont ni TARP[11], ni les swaps et multiples programmes de sauvetage de la Fed, ni les proclamations tonitruantes du G20 de novembre 2008, ou encore la mise en route du premier Quantitative Easing de Bernanke qui ont enrayé la descente aux enfers amorcée en septembre. Celle-ci a continué pendant six mois jusqu’au jour où, en mars 2009, il a été décidé de revenir sur le renforcement de la discipline d’application du Marked to market. C’est alors que la récession s’est arrêtée, lorsque a été levée l’aberrante hypothèque fiscale qui pesait sur les Global banks et, par leur intermédiaire, asphyxiait les canaux de la liquidité mondiale.
Il est donc bien vrai que ceux auxquels est attachée l’étiquette de TBTF ont joué un rôle de premier rang dans la suite d’enchaînements qui ont alimenté la grande récession, mais pour des raisons qui n’ont rien à voir avec les narratifs que l’on nous a resservis à satiété cet été à l’occasion du dixième anniversaire de la chute de Lehman. Ce n’est ni Lehman ni eux qui ont allumé la mèche initiale.
Il n’est pas question de nier les emballements spéculatifs, les excès managériaux et les fraudes ou crimes financiers qui ont marqué la période d’avant la crise. Mais les causes de son caractère exceptionnel, ainsi que de sa durée inhabituelle, sont prioritairement à rechercher ailleurs, en dehors des rouages endogènes de l’économie de marché capitaliste. On ne joue pas impunément avec les règles et pratiques héritées d’une expérience comptable multiséculaire.
La conquête d’un privilège
Second point : il y a effectivement un énorme problème de concentration bancaire. Celle-ci s’est accrue dans des proportions considérables juste avant et pendant la crise. Aujourd’hui les cinq plus grosses banques américaines contrôlent presque la moitié des actifs de toute l’industrie bancaire US.
Ce degré élevé de concentration est même l’une des causes de l’extraordinaire succès des activités du secteur bancaire parallèle au cours de la décennie 2000. Lorsque l’on gère des flux de trésorerie portant sur des dizaines ou centaines de millions, voire des milliards de dollars ou d’euros, la première des prudences est de multiplier les comptes en banques et de ne pas tout déposer dans un même établissement afin de minimiser ses risques. D’où une méfiance croissante des grandes entreprises et institutions comme les fonds de pension ou les fonds communs de placement vis-à-vis des réseaux bancaires traditionnels (trop concentrés pour satisfaire leurs besoins de dispersion) et leur préférence pour les shadow banks[12].
Cette concentration justifierait-elle une politique de démantèlement afin de rétablir davantage de concurrence dans les services bancaires ? En particulier au niveau international où, à eux seuls, une vingtaine de groupes mondiaux américains, européens et japonais – du type CitiBank, JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, UBS, Paribas, Société Générale, DeutscheBank, etc… – assurent quasiment toute la production d’eurodollars (les dollars « made in world », expression d’Alain Madelin). Peut-être, mais il faut bien préciser dans quel contexte.
Tout le monde parle des Too Big To Fail comme si l’existence de telles entreprises relevait d’une réalité objective dont on ne saurait – à l’instar du réchauffement climatique – ni douter, ni même contester la vérité.
Mais quels sont les critères concrets qui permettent de définir et de cerner cette réalité ? Trop grandes, trop interconnectées… par rapport à quoi ? A partir de quel seuil ? Force est de constater qu’autant les écrits universitaires qui traitent de cette question, que les textes réglementaires qui définissent les contraintes auxquelles ces entreprises dites « systémiques » doivent désormais être soumises, sont extrêmement imprécis, diffus, confus… En sorte qu’en fait les autorités publiques disposent de la plus grande latitude subjective pour décider qui rentre dans cette catégorie et à qui s’appliquent les nouvelles réglementations.
C’est la porte ouverte à toutes les dérives, à tous les arbitraires et, bien sûr, au jeu de tous les favoritismes et connivences politiques. Comme le réchauffement climatique, la notion même de Too Big To Fail n’est en fait qu’une croyance, une perception de la réalité ancrée dans un modèle théorique (celui de la contagion systémique des bank runs, dont j’ai dit plus haut ce qu’il faut en penser)[13].
Il est certain qu’en cas de faillite plus une banque est grande plus l’impact collatéral sur son environnement économique et financier est important. Mais là n’est pas l’essentiel. Ce qui importe n’est pas le débat sur la taille, ou la position stratégique qu’une banque occupe dans le réseau complexe de la plomberie monétaire (le sujet de thèse de Ben Bernanke), mais le changement de régime qui, à partir des années 1970, s’est imposé dans la manière dont les responsables publics réagissent au risque de faillite de grands établissements.
Avant la création de la Fed (en 1913), ce risque se trouvait internalisé au sein de chambres de compensation (Clearinghouses) locales ou régionales qui faisaient office d’associations professionnelles dotées de capacités d’autorégulation[14]. Il n’y avait pas de banque centrale, mais si un processus de panique bancaire s’esquissait, les membres de ces associations pouvaient solliciter un soutien mutuel de leurs confrères afin de mettre fin à l’hémorragie. Dans les cas les plus sérieux le soutien pouvait prendre la forme d’une émission obligataire sous la responsabilité collective des adhérents de l’association. Ces chambres de compensation remplissaient ainsi une fonction informelle de prêteur en dernier ressort, mais leurs règles étaient strictes : ne pouvaient prétendre à cette forme d’aide que les banques dont le bureau de l’association, après examen, avait acquis la certitude qu’elles souffraient d’un problème temporaire d’illiquidité, et en aucun cas de difficultés reflétant une situation d’insolvabilité.
Lorsqu’en 1873 le célèbre Walter Bagehot définit ce que devraient être les lignes de conduite d’une banque centrale en cas de crise économique, il ne fait que reprendre des principes qui sont déjà ceux de ces associations privées. S’il reconnait et rend légitime le rôle de prêteur en dernier ressort de la banque centrale, il n’en précise pas moins que ces opérations doivent remplir deux conditions : 1) les prêts de secours ne sont pas gratuits, ils doivent être facturés à un prix de pénalité (taux élevé) ; et 2) il s’agit d’intervenir pour rétablir un flux de liquidité temporairement rompu et éviter que la firme concernée ne soit acculée au dépôt de bilan, mais en aucun cas de voler au secours d’une firme dont la solvabilité est compromise et dont il ne peut être démontré qu’elle détient encore un montant suffisant d’actifs de bonne qualité. Autrement dit, dans un tel cadre, il ne suffit pas qu’une entreprise soit « très grande » et « très interconnectée » pour prétendre à l’aide des autorités bancaires. Encore faut-il qu’il puisse être prouvé que cette aide ne sera pas gaspillée pour seulement maintenir en vie une firme dont la survie est déjà financièrement compromise (ce que l’on appelle une entreprise « zombie »).
Ce qui change à partir des années 1980 est que se répand progressivement, à l’occasion d’un certain nombre de grandes affaires financières (la faillite de la Franklin National Bank en 1974, à l’époque la plus grande faillite de l’histoire des États-Unis, Continental Illinois en 1984, L.T.C.M. en 1998) une nouvelle attitude aux termes de laquelle il suffit de constater que l’on se trouve en présence d’établissements exceptionnellement jugés « trop gros » et « trop interconnectés » pour décider que les pouvoirs publics n’ont pas d’autre choix que de leur venir en aide indépendamment de savoir si leur solvabilité est véritablement garantie. C’est là que se niche toute la différence.
Auparavant, être « trop gros » et « trop interconnecté » était peut-être un argument recevable, un critère théoriquement nécessaire, mais pour les instances politiques et administratives concernées ce n’était jamais une condition suffisante. Depuis les années 1980, c’est devenu une condition suffisante. C’est alors que nait le concept du Too Big To Fail, l’expression apparaissant pour la première fois dans la bouche du député au Congrès Américain Stewart McKinney lors d’une audition parlementaire sur le sauvetage (bail out) de la Continental Illinois. Auparavant personne n’en parlait.
Dès lors Too Big To Fail est devenu un statut préférentiel qui, aux États-Unis, s’appuie maintenant sur un texte législatif : le Dodd-Frank Act de 2010 dont l’une des dispositions, imposée par les accords internationaux de Bâle III, est de créer une catégorie particulière de banques qualifiées de « systémiques ». Il s’agit des SIFI (pour Systematically Important Financial Institutions) auxquelles sont imposés des contraintes prudentielles plus sévères qu’aux autres[15].
En principe, il s’agit de réduire la menace systémique que ces grandes entités représentent pour la stabilité financière globale en les contraignant à présenter davantage de sécurités que les banques commerciales de moindre taille. Mais le fait même de mettre leurs noms sur une liste particulière d’établissements bénéficiant d’un statut spécial aboutit paradoxalement au résultat inverse. Puisque les pouvoirs publics les singularisent en soulignant ainsi le danger mortel qu’une défaillance éventuelle de leur part ferait courir à la collectivité, leurs actionnaires, leurs managers mais aussi leurs clients sont plus que jamais légitimement fondés à anticiper qu’en cas de difficultés graves les pouvoirs publics mobiliseront tous les moyens à leur disposition pour leur éviter la faillite. L’État devient ainsi le garant de leur survie. Ce qui est présenté comme une contrainte sécurisante se transforme en réalité en privilège au bénéfice d’un petit groupe professionnel par rapport à la grande masse des entreprises. Le sigle (SIFI) qui leur est accolé est plus l’expression d’un régime de faveur qu’une marque de prudence.
Faux géants économiques
Ce privilège est en effet un puissant facteur d’abaissement des coûts, donc de renforcement de leur position concurrentielle. Il leur est plus facile d’inspirer confiance à leurs clients, d’attirer les dépôts, de tisser des liens réciproques d’interdépendance pour développer des opérations financières de plus en plus complexes requérant l’intervention d’un grand nombre de contreparties. Cette garantie les incite aussi à prendre plus de risques, cependant qu’elle invite leurs concurrents à entrer à leur tour dans la course à la dimension pour bénéficier un jour de la même franchise. C’est ainsi que s’est enclenché un processus cumulatif, une course à la fois à la dimension (Mergers & Acquisitions) et à la prise de risque. Double résultat : la concentration croissante du secteur bancaire, et la généralisation chez ces mastodontes de prises de risques accrues générant ce qui a été décrit comme une économie de casino[16], générant d’énormes scandales financiers. Sans compter le ressentiment populaire que cela engendre à juste titre contre la « Phynance » et les formes contemporaines de capitalisme de connivence[17].
Que faire ? Dans une optique libérale tous les privilèges ont en principe vocation à disparaître. Il en va de celui-ci comme de tant d’autres. Il faut y mettre fin en revenant sur ce régime de faveur absurde dont l’effet pervers est d’atténuer, voire de détruire l’esprit de responsabilité au cœur même d’institutions financières et bancaires essentielles au bon fonctionnement d’une économie de concurrence – ce que les économistes appellent l’effet « hasard moral ».
Comment ? En faisant de ces entreprises à nouveau des firmes comme les autres, soumises au risque de faillite et ne pouvant prétendre y échapper au nom d’un quelconque risque systémique. Quitte à commencer par les couper en morceaux, si besoin est[18]. Ce qui exige d’accompagner cette politique d’une véritable réforme du régime des faillites qui accélère de manière décisive la résolution juridique des fermetures d’établissements bancaires et financiers en liquidation. Il faut qu’une banque en état de cessation de paiements puisse être en mesure de négocier rapidement la reprise de ses actifs et engagements par une ou plusieurs autres. C’est là le cœur du problème. A ce titre, on ne peut qu’être favorable à la généralisation des formules de bail in de manière à ce que leurs créditeurs s’intéressent d’un peu plus près à la qualité de la gestion de ceux auxquels ils prêtent leur argent (mais avec également le retour à des règles de responsabilité plus draconiennes pour les actionnaires : se rappelle-t-on qu’au temps du célèbre étalon-or la règle, sur la place de Londres, pour les sociétés à responsabilité limitée, était que les actionnaires sont responsables des dettes de l’entreprise jusqu’à concurrence de deux fois leur mise de fonds personnelle [19]?).
En 2013 la Fed de Dallas a présenté un projet de réforme du Dodd Frank Act dont l’objectif est d’abroger ce système de privilège et de ramener les Too Big To Fail au régime commun[20]. La Fed de Dallas est la plus libérale, voire la plus libertarienne des 12 banques fédérales de réserve américaines.
Ses propositions impliquent, pour commencer, de démanteler les grands groupes dominants selon des principes qui reviendraient à séparer de nouveau les activités bancaires commerciales usuelles des opérations globales de financement et d’investissement.
Mais il n’est peut-être même pas nécessaire de mettre en route un tel découpage[21]. Il n’est pas interdit en effet de penser que ces mastodontes bancaires ne sont en réalité que des géants aux pieds d’argiles résultant d’une quête d’effets d’aubaine. Il s’agit plus souvent d’ensembles artificiellement constitués pour capter et capitaliser le privilège d’appartenir aux TBTF que de véritables opérations économiques dont la finalité première est l’exploitation de synergies industrielles et managériales (ce qui, normalement, est la raison d’être d’une fusion).
Imaginez que votre entreprise fasse un chiffre d’affaires de X millions d’euros et que vous receviez le message que si vous arrivez à trois fois ce chiffre (3X) vous serez désormais hors d’atteinte, protégé contre les aléas d’un retour de fortune trop brutal, je serais très surpris que vous ne fassiez pas tout ce qui est en votre pouvoir pour atteindre cette taille, même si cela suppose de vous entendre et de fusionner avec votre pire ennemi professionnel. Vos concurrents penseront comme vous et vous vous retrouverez bientôt autour d’une table pour vous entendre sur la manière de constituer un nouveau géant désormais Too Big To Fail. Autrefois on appelait cela un cartel, aujourd’hui c’est une fusion, mais la nature du phénomène n’est guère différente.
Vous serez nominalement plus riche, mais cela ne signifie pas que votre entreprise se trouvera plus forte, au contraire. Ces opérations bidons sont par ailleurs facilitées par la folie des taux bas. Elles donnent naissance à de faux empires. En réalité, ce ne sont souvent que des confédérations d’entreprises dont le rapprochement ne donne pas nécessairement naissance à une nouvelle entreprise au sens plein du terme. Un cas exemplaire est celui d’AIG, la super société d’assurance américaine dont on a tant parlé au moment de l’affaire Lehman Brothers. Il s’agissait d’un groupe qui avait été constitué très rapidement à partir du rapprochement d’une constellation de petites et moyennes firmes d’assurances conservant cependant une totale autonomie de gestion[22].
Ces empires sont en fait extrêmement fragiles. Coupez-les de leur privilège, laissez remonter les taux, et vous verrez la plupart d’entre eux se défaire. Ce qui signifie malheureusement que toutes ces dispositions prudentielles souvent plus complexes les unes que les autres, mises en place pour sécuriser l’industrie bancaire et financière, risquent, le jour venu, de ne pas remplir exactement le rôle pour lequel elles ont été conçues.
[1] Cf. l’article publié dans Politique Internationale, Printemps 2018 : Henri Lepage, Le ressort brisé du système monétaire international. https://bit.ly/2GuBe9F.
[2] Expression que l’on pourrait traduire en français par « trop larges pour faillir ».
[3] Drieu Godefridi, L’ennemi c’est la Phynance, dans l’Echo (belge), 17 février 2016. https://bit.ly/2QBDdh4.
[4] Anna Schwartz, “Bank runs and deposit insurance reform,” The Cato Journal, Vol.7, n°3, Winter 1988, pp.589-594. Anna Schwartz, “Real and pseudo-financial crises,” NBER, 1987 https://www.nber.org/chapters/c7506.pdf
[5] George Kaufman, “Banks runs: causes, benefits and costs,” The Cato Journal, Vol. 7, N°3, Winter 1988, pp.559-594. Voir aussi : Charles Calomiris, “Banking crises yesterday and today,” Financial History Review, 17-1 (2010), pp.3-12.
[6] Christophe Pérignon, David Thesmar, Guillaume Vuillemey, Wholesale Funding Runs, IEIF, 13 février 2016 https://bit.ly/2EwcXxi. Une seule étude de ce type n’est pas en elle-même une preuve. Mais ce qui est intéressant est que ses conclusions rejoignent celles des professeurs Kaufman et Calomiris tirées de l’histoire bancaire d’avant la période de montée en puissance du pouvoir des banques centrales. Leurs travaux révèlent que, contrairement à la légende, on ne trouve quasiment pas trace de paniques bancaires de second type au 19ème siècle – la seule exception possible étant la récession de 1893. Il y a bien sûr l’épisode de la Grande Dépression. Encore faut-il garder à l’esprit que, dans les années trente, le mouvement de domino des faillites bancaires – on a compté cinq épisodes distincts de paniques – n’a alors principalement touché que l’univers de petites banques qui, à l’époque, constituait encore l’essentiel du tissu bancaire américain en raison des particularités de la législation des États-Unis (qui, depuis le siècle précédent, reposait sur le principe anachronique et pervers “one bank, one branch”).
[7] Sur ce sujet voir l’interview de Jeffrey P. Snider sur Macrovoices.com, août 2018 : Eurodollar University Season 2, Part 1 https://bit.ly/2A4rTQs, Part 2 , https://bit.ly/2S99rx3, Part 3, https://bit.ly/2SWKPYh.
[8] Sur les concepts de Global Banks et de Global Money, se reporter à mon article publié dans le second numéro du Journal des Libertés : La finance de marché, ressort de l’ordre monétaire mondial. https://bit.ly/2Brmbrx.
[9] Pour une explicitation des mécanismes de la création monétaire par les activités de Shadow banking et les marchés de l’eurodollar, voir notamment la thèse de Suzanne von der Becke de l’Université de Zurich : Liquidity Creation and Financial Instability, ETH Zurich, Research Collection, 2015. https://bit.ly/2CjvfAn. Voir aussi : Daniela Gabor et Jacob Vestergaard, « Towards a theory of shadow money, » Institute for a new economic theory, April 14, 2016. https://bit.ly/2rQ5Acy
[10] Pour un rééxamen du rôle joué par les subprimes dans le déclenchement de la grande crise financière, voir Jeffrey Snider (dans la transcription de l’interview mentionnée à la note 7), mais également le livre de l’historien britannique Adam Tooze dont la traduction française est parue au mois de septembre : Crashed, comment une décennie de crise financière a changé le monde, aux Éditions des Belles Lettres, Paris, 2018. Ce qui est habituellement présenté comme le produit systémique d’un problème sectoriel de solvabilité (l’immobilier américain) n’est en réalité que le faux nez d’un accident majeur beaucoup plus global qui a brutalement réduit les capacités de transformation (balance sheet capacities) du marché transnational des financements de gros. https://bit.ly/2rJSsWD.
[11] Le Troubled Asset Relief Program (TARP) a été adopté par un congrès démocrate et ratifié par le président républicain George W. Bush en Octobre 2008. Il autorisait le gouvernement à acheter des actifs toxiques et des actions auprès d’institutions financières afin de renforcer son secteur financier.
[12] Cf. Zoltan Pozsar, “Institutional cash pools and the Triffin dilemma of the US banking system,” IMF, Working Paper WP/11/190, 2011.
[13] Cf. Louise Bennetts, Too Big To Fail is too foolish to continue, Investor’s Business Daily, April 26 2013. Sur le site du CATO Institute, https://bit.ly/2LpxUvo.
[14] George Selgin, “Were Banks ‘Too Big To Fail’ before the Fed?” Alt-M, March 22 2016. https://bit.ly/2RaGDqQ.
[15] En 2018, parmi les 29 banques globales considérées comme systémiques au sens du Financial Stability Board et de la Banque des règlements internationaux il y a treize banques européennes, neuf banques américaines et sept asiatiques. A quoi s’ajoutent des listes nationales.
[16] Gerald O’Driscoll, “JP Morgan Chase and casino banking,” The Freeman, May 21, 2012, https://fee.org/articles/jpmorgan-chase-and-casino-banking/
[17] Expression utilisée pour décrire la relation d’imbrication réciproque et de favoritisme entre les grandes entreprises et l’État qu’encourage l’empilement excessif de contraintes réglementaires et administratives. La connotation péjorative du terme “Phynance” – utilisé par Drieu Godefridi dans son article de l’Echo belge – résume la vision très négative que les opinions publiques ont de la finance moderne. Cette détestation est nourrie par des faits qu’on ne peut contester : l’extrême concentration bancaire, les régimes de faveur et les rentes de situation qui en résultent, le développement des comportements de casino, les rémunérations hors normes, etc… Ceux-ci ne sont pas le produit de caractéristiques sociologiques ou d’attitudes psychologiques particulières (comme le goût du lucre que l’on retrouve aussi bien ailleurs), ni un résultat inéluctable inscrit dans les gênes d’un système de capitalisme de marché ; mais le résultat de structures de connivence, aussi bien intellectuelles et scientifiques qu’institutionnelles, nourries par les dérives de la pensée économique contemporaine (comme sa mathématisation à outrance). Dans cette optique, il importe de souligner que les banques centrales et autres instances de surveillance bancaire et financière n’appartiennent pas à un monde neutre, extérieur à cette “Phynance” tant décriée, mais en font intrinsèquement partie.
[18] Cf. Ben Bernanke, “Ending “too big to fail”: What’s the right approach?” Brookings Blog, 13 mai, 2016. https://brook.gs/2EC5ttD.
[19] Caroly Cissoko, “How to stabilize the banking system, lessons from the pre-1914 London money market,” Financial History Review, 23.1 (2016). https://bit.ly/2R8Qn4w.
[20] Cf. Richard Fisher, “Correcting Dodd-Frank to Actually End ‘Too Big To Fail’”, Statement before the Committee on Financial Services, US House of Representatives, 26 June 2013. Harry Rosenblum, “Choosing the road to prosperity: we must end too big to fail – now”, 2011 annual Report, Federal Reserve Bank of Dallas. https://bit.ly/2ClP1LH.
[21] Découper des entreprises trop grandes est une idée facile à proposer, mais beaucoup plus difficile à mettre en pratique. Pour deux raisons : d’abord parce que cela reste une opération de politique industrielle à l’état pur (la seule grande entreprise de démantèlement qui ait réussie – et encore ! – est celle de la restructuration de l’industrie allemande, au lendemain de la défaite nazie, dans un pays militairement occupé); ensuite parce que c’est ainsi appeler à la mobilisation du marché politique, avec tous ses excès et coups tordus. Il est présomptueux d’imaginer que cela pourrait se faire rapidement « avant que ne s’envole le prochain cygne noir ».
[22] S’agissant d’AIG, David Stockman, ancien ministre du budget de Ronald Reagan, apporte la précision suivante dans son livre The Great Deformation (2013). Dès le lendemain de la chute de Lehman Brothers, le gouvernement américain a expliqué que, compte tenu de son énorme taille, il ne pouvait pas ne pas intervenir pour empêcher l’effondrement du groupe AIG car cela aurait balayé l’ensemble du système économique et financier américain. Cet argument, explique Stockman, était un mensonge. On sait aujourd’hui, et cela a été démontré par l’analyse détaillée du bilan, qu’à l’époque de tels risques de contagion étaient impossibles. Les créances douteuses du groupe (subprimes) étaient en effet concentrées dans la holding et une faillite de celle-ci ne pouvait entraîner d’effets en chaîne sur l’ensemble des filiales d’assurance soumises à des contraintes réglementaires très strictes et très surveillées qui ne s’appliquaient pas à la holding.





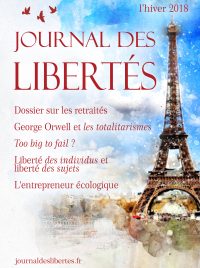
1 Commentaire
[…] Great Article on the Causes of the Depth of the 2008-09 Global Crisis https://journaldeslibertes.fr/article/a-bas-le-privilege-des-too-big-to-fail/#.XC-VxYzQg2w […]