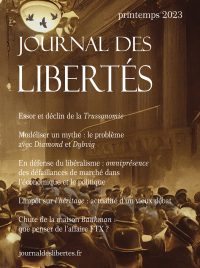Y-a-t’il eu un travail théorique sur les banques plus influent que l’article de Douglas Diamond et Phillip Dybvig paru en 1983 dans le Journal of Political Economy, intitulé « Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity » [Ruées bancaires, assurance des dépôts et liquidité]*? Si c’est le cas, je ne vois pas lequel. Avec plus de 12 000 citations sur Google, cet article figure certainement parmi les plus cités en économie, sans parler de la sous-discipline de l’économie monétaire.

L’influence de cet article n’a pas non plus été purement académique. Loin de là : les décideurs politiques le citent régulièrement pour justifier l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur bancaire et, en particulier, la mise en place d’un système national explicite de garantie des dépôts. Le fait que le nombre de pays ayant adopté de tels systèmes ait plus que quadruplé au cours des deux décennies qui ont suivi la parution de l’article — passant de 20 à 87 pays — doit très certainement quelque chose à l’influente publication de Diamond et Dybvig. Cette influence s’est aussi retrouvée dans la réflexion des experts du FMI et d’autres agences internationales qui ont présenté l’assurance des dépôts comme étant le meilleur remède aux crises bancaires[1]. Hélas pour Diamond et Dybvig et les citoyens des pays qui les ont suivis, on ne peut pas dire que les résultats pratiques de ces conseils d’experts aient été universellement bénins[2].
Aucune surprise en revanche à ce que le modèle Diamond-Dybvig soit devenu si populaire dans les cercles politiques. Pour de nombreux décideurs politiques (et pour plus d’un économiste), il démontre « rigoureusement » que les systèmes bancaires ordinaires (c’est-à-dire, à réserves fractionnaires) sont intrinsèquement instables et que l’assurance des dépôts, un prêteur en dernier ressort vigilant et efficace ou une autre forme d’intervention, comme celle consistant à limiter l’activité bancaire à la gestion des dépôts (narrow banking)[3], sont nécessaires pour les stabiliser. Demandez à un expert qui préconise l’une de ces solutions de vous prouver qu’elle est nécessaire, et il y a de fortes chances qu’il finisse par vous dire, en substance, « Voir Diamond et Dybvig (1983). » C.Q.F.D.
Il n’y a qu’un seul problème : Diamond et Dybig (1983) ne démontrent rien de tel.
Bien que j’aie l’intention de critiquer le modèle de Diamond-Dybvig plutôt que d’en faire l’éloge, je n’ai aucune envie pour autant de l’enterrer. Je suis tout à fait d’accord avec Ricardo Cavalcanti lorsqu’il écrit que ce modèle
a constitué une avancée conceptuelle et méthodologique significative dans l’étude des accords bancaires. Sa contribution méthodologique a été l’utilisation de la théorie du mechanism design plutôt que l’ancienne stratégie, encore répandue dans les manuels et dans certaines macroéconomies, consistant à plaquer un secteur bancaire sur un modèle d’échanges marchants[4].
En effet. Si le modèle de Diamond et Dybvig est si souvent cité, c’est en partie parce qu’il a été critiqué et affiné à maintes reprises, chaque critique et chaque amélioration ajoutant, ne serait-ce qu’un tout petit peu, à notre compréhension des véritables causes des crises bancaires systémiques[5]. Ce n’est donc pas Diamond et Dybvig en soi que je critique. Je m’attaque à ceux qui prétendent que leur modèle fournit des raisons suffisantes pour l’intervention du gouvernement dans le secteur bancaire. La vérité, mise en lumière depuis longtemps par les experts, et qu’il n’en est rien et j’expliquerai ici pourquoi.
Quand la légende devient réalité…
Dans « The Man Who Shot Liberty Valence », le western de 1962 de John Ford, Jimmy Stewart joue le rôle d’un éminent sénateur américain, Ranse Stoddard, qui vient de revenir dans la ville frontalière qu’il avait quittée 25 ans plus tôt. Maxwell Scott, rédacteur en chef du journal de la ville, veut connaître son histoire. Stoddard le régale de ses nombreuses réalisations depuis son départ, mais Scott, entre-temps, entend la rumeur selon laquelle le jeune Stoddard a tué le méchant de la ville lors d’une fusillade. La rumeur s’avère fausse (c’est John Wayne qui l’a fait). Mais cela n’empêche pas Scott de décider que la rumeur est plus intéressante que les véritables exploits de Stoddard. « C’est l’Ouest, monsieur », dit-il au sénateur dépité après avoir déchiré ses notes. « Lorsque la légende devient un fait, il faut imprimer la légende ».
Le secteur bancaire a lui aussi ses légendes. Et, du moins aux États-Unis, ces légendes ont plus en commun avec les films de John Ford qu’on ne pourrait le croire. En effet, elles sont elles aussi, du moins en partie, des légendes de l’ancien Ouest, qui, outre ses bandits armés et ses fusillades régulières, comptait des banques prédatrices[6] (wildcat banking ) sans foi ni loi et des shinplasters [papier-monnaie de très faible dénomination pour pallier la pénurie de pièces] sans valeur.
C’est du moins ce que l’on nous dit. Or, tout comme les fusillades étaient en fait rares y compris à Dodge City[7], de nombreuses études ont montré que les banques prédatrices l’étaient tout autant[8]. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de ruées sur des banques ou de faillites bancaires : il y en a eu beaucoup. Mais c’est en vain que l’on cherchera leur cause dans le fait que les dépôts bancaires d’avant la guerre civile n’étaient pas garantis, ou dans le fait que les banques ne détenaient que des réserves fractionnaires, ou encore dans l’absence, après 1836, d’une banque centrale, ou encore dans l’absence de toute réglementation bancaire. Au contraire, même s’il y eut des lois très malencontreusement nommées « lois sur la liberté bancaire » qui pourraient faire croire à un vide réglementaire, la plupart des faillites bancaires de l’époque sont imputables à une réglementation irresponsable qui les empêchait, notamment, de créer des succursales ou les contraignait à investir dans des titres douteux pour pouvoir émettre de la monnaie.
Pourtant, le mythe selon lequel les banques ont fait faillite en masse avant la guerre civile parce qu’elles n’étaient pas assez réglementées persiste. Comme je l’ai fait remarquer dans un précédent essai[9], cela s’explique en partie par le fait que de nombreuses personnes supposent naïvement que si les autorités gouvernementales appellent quelque chose « banque libre », c’est forcément le cas. C’est aussi parce qu’une histoire qui décrit des banques adoptant un comportement « prédateur » est bien plus excitante à lire que celle de la masse des échecs, moins romanesques mais non moins malheureux, des banques libres. Le « wildcat banking » est à l’histoire de la banque ce que O.K. Corral et Wild Bill Hickok sont à l’histoire du Far West.
Si les gens adhèrent aujourd’hui encore au mythe de la banque prédatrice, rien de surprenant à ce que Diamond et Dybvig y aient eux aussi adhéré en 1983, à une époque où les travaux des historiens de l’économie n’étaient pas encore largement appréciés, même parmi les économistes. Toutefois, il est plus probable que leur hypothèse selon laquelle les banques sont intrinsèquement sujettes aux défaillances ait été alimentée par un autre mythe : celui des ruées et des faillites bancaires du début des années 1930, et en particulier de la crise bancaire systémique qui s’est déroulée fin février et début mars 1933[10].
Ayant déjà abordé ce « grand mythe bancaire américain » ailleurs[11], je me contenterai d’observer ici que, tout comme Hugh Rockoff, Arthur Rolnick et Warren Weber ont commencé à démolir le mythe des banques prédatrices de l’antebellum à partir du milieu des années 1970, d’autres, dont Barry Wigmore et Elmus Wicker, ont examiné de près les crises bancaires des années 1930 et ont constaté que les craintes autoréalisatrices d’insolvabilité des banques y ont joué un rôle beaucoup plus limité que d’autres ne l’avaient supposé[12]. Wigmore, en particulier, a soutenu de manière assez convaincante que la ruée de 1933 était une « ruée sur le dollar », ce qui signifie qu’au lieu de penser que toutes les banques encore debout étaient sur le point de faire faillite, les gens craignaient qu’une fois devenu président FDR dévaluerait le dollar. Ils ont ainsi pu acquérir de l’or en organisant une ruée sur les banques de la Réserve fédérale et, en fin de compte, sur la Federal Reserve Bank de New York, qui détenait la plus grande partie de l’or du système. C’est parce que la Fed de New York manquait d’or qu’elle a finalement incité le gouvernement à déclarer la fermeture temporaire de toutes les banques (bank holiday) à l’échelle nationale.
Hélas, la littérature théorique sur les paniques bancaires, y compris l’article fondateur de Diamond et Dybvig, semble davantage reposer sur des mythes tenaces concernant les banques aux États-Unis que sur une étude bien informée de l’expérience bancaire américaine, et encore moins de l’expérience d’autres pays. « Il ne semble pas exagéré », observent Gary Gorton et Andrew Winton dans leur chapitre du Handbook on the Economics of Finance sur « l’intermédiation financière » (Elsevier 2003), « de dire que la plupart des travaux théoriques sur les paniques ont été motivés par l’expérience américaine, qui a ensuite été généralisée de manière incorrecte. Les paniques ne sont tout simplement pas une caractéristique de la plupart des économies bancarisées ». Ce que Gorton et Winton auraient dû dire plus précisément, c’est que les travaux théoriques en question ont été exclusivement motivés par des interprétations erronées de l’expérience américaine.
En bref, lorsque Diamond et Dybvig ont entrepris de rédiger leur célèbre article, les légendes bancaires américaines cédaient rapidement la place aux faits. Pourtant, comme Maxwell Scott face au sénateur Stoddard, Diamond et Dybvig ont imprimé, involontairement, la légende. Ou plutôt, ils ont modélisé la légende et le Journal of Political economy l’a imprimée.
Le modèle de base de Diamond-Dybvig
Ce n’est pas que la modélisation de la légende ait été facile. Au contraire, il n’a pas été facile de trouver un modèle d’économie raisonnablement gérable dans lequel une « banque » remplit une fonction essentielle tout en étant presque certaine de faire faillite (ce n’est pas pour rien que leur article a été publié dans le JPE). En effet, la véritable leçon tirée de l’exercice Diamond-Dybvig ne pourrait être plus éloignée de celle que beaucoup en tirent, en particulier s’ils ne connaissent pas les nombreuses études qu’il a inspirées. La leçon à tirer de l’exercice est la suivante : s’il est possible de créer un modèle où les banques succombent facilement à la panique, il est pratiquement impossible d’en créer un où ces mêmes banques ressemblent aux banques du monde réel.
Pour comprendre pourquoi, nous devons d’abord nous attaquer au modèle de Diamond-Dybvig (D-D, en abrégé). Ayant fait de mon mieux pour expliquer ce modèle ailleurs, je me contenterai de répéter cet effort ici.
L’économie du modèle D-D commence avec N consommateurs, tous dotés de la même quantité de l’unique bien de consommation de l’économie, par exemple, … un boisseau de maïs. Il y a trois périodes, 0, 1, 2 — une période de « semences », une période « intermédiaire » et une période de « récolte ». Un boisseau de maïs planté à la période 0 produit R > 1 boisseaux à la période 2, mais seulement un boisseau à la période 1. Étant donné que les consommateurs peuvent rencontrer des situations d’urgence au cours de la période 1, l’investissement dans la production de maïs est risqué. Les consommateurs malchanceux — appelés investisseurs de « type 1 » —devront liquider leurs investissements en maïs prématurément, réalisant ainsi un rendement net de zéro. En revanche, les consommateurs chanceux de « type 2 » peuvent se permettre de retarder leur consommation jusqu’à la récolte, bénéficiant ainsi d’un rendement positif. Tous les consommateurs se sentent toutefois vulnérables à partir de la période 0, car ils ne connaissent leur type qu’à partir de la période 1.
Selon Diamond et Dybvig, une banque est un dispositif qui permet un partage optimal des risques en mettant en commun les investissements et en répartissant les rendements anticipés entre les consommateurs de type 1 et de type 2. En supposant que la fraction, t, des consommateurs de type 1 est inférieure à un, le partage des risques prend la forme de contrats de dépôt (non transférables) donnant aux déposants le droit à un paiement prédéfini de r1 boisseaux de maïs par boisseau déposé à la période 0 et retiré à la période 1 (R > r1 > 1) et à un paiement résiduel de r2 (< R) boisseaux de maïs par boisseau déposé à la période 0 pour les retraits de la période 2, où r2 représente une part au prorata du maïs récolté à la période 2. Un « bon » équilibre bancaire avec un partage optimal des risques se produit lorsque les contrats de dépôt sont utilisés et que les consommateurs de type 2 se comportent comme des consommateurs de type 2, en retardant leurs retraits jusqu’à la récolte.
Malheureusement, Diamond et Dybvig démontrent que ce « bon » équilibre n’est qu’une possibilité parmi deux. Un « mauvais » équilibre peut également se produire dans lequel les agents de type 2 paniquent et se joignent aux agents de type 1 pour retirer leurs dépôts prématurément. Étant donné que le modèle D-D suppose une seule banque, de tels retraits dus à la panique sont l’équivalent d’une panique générale dans un système multi-bancaire. Une panique ruine l’accord de partage des risques car, avec r1> 1, la valeur des actifs de la banque à la période 1 (= N boisseaux de maïs) est inférieure à la valeur de remboursement des dépôts bancaires promise pour la période 1 (qui est de N x r1). En supposant qu’une « contrainte de service séquentielle [premier arrivé, premier servi] » soit en vigueur, les déposants qui récupèrent leurs dépôts initiaux plus les intérêts à la période 1 laissent les autres avec un avoir inférieur à leur dépôt initial. Il s’ensuit que « tout ce qui amène [les consommateurs de type 2] à anticiper une ruée entraînera une ruée », y compris des événements aléatoires intrinsèquement non pertinents tels que les taches solaires.
À première vue, le modèle D-D semble répondre à toutes les exigences d’un modèle rigoureux de panique bancaire. Il commence par une économie dans laquelle des besoins de consommation incertains coexistent avec une technologie de production qui nécessite des investissements illiquides. Dans cet environnement, une « banque » peut améliorer la situation de tous en permettant aux consommateurs de mettre en commun leurs investissements pour partager le risque de devoir consommer prématurément. Mais l’assurance offerte par les banques les rend vulnérables aux mouvements de panique. En cas de panique, l’assurance ne fonctionne plus et, au lieu d’être avantagés, certains déposants — ceux qui tardent à encaisser leurs dépôts — sont perdants et gagnent moins qu’ils ne l’auraient fait en se débrouillant seuls.
Mais il y a un problème. Dans la version simple que nous venons de décrire, le modèle D-D propose en fait une solution contractuelle simple au problème des retraits massifs : puisque la valeur de t — la fraction des déposants impatients de type 1 — est connue, au lieu d’autoriser des retraits illimités, la banque peut inclure des clauses dans ses contrats de dépôt lui permettant de « suspendre » les paiements de la première période dès que la part des dépôts retirés atteint t. En garantissant aux déposants patients de type 2 qu’ils recevront toujours le rendement promis, l’option de suspendre les paiements élimine leur incitation à la panique, ce qui exclut le « mauvais équilibre » avec ruée vers la banque. Étant donné que l’option de suspension améliore la situation de tous, elle constitue une solution de marché libre au problème des paniques bancaires. Il s’avère donc que la banque de référence de Diamond-Dybvig n’est pas intrinsèquement instable après tout.
« L’incertitude générale » et les arguments en faveur de l’intervention
Mais Diamond et Dybvig montrent qu’une modification mineure et parfaitement plausible de leur modèle de base suffit à rendre la solution qui passe par la suspension des retraits moins qu’optimale. Il suffit pour cela de dire que, au lieu d’être connue avec certitude, la fraction des déposants de type 1 est une variable aléatoire. La banque doit dès lors estimer la valeur de t et, si elle la sous-estime, elle suspendra les paiements même lorsqu’aucun déposant de type 2 ne panique, et avant que tous ses déposants de type 1 n’encaissent leur argent. Les déposants de type 1 laissés pour compte subissent alors une perte de bien-être par rapport au cas d’un « bon » équilibre sans suspension. Il s’ensuit que dans une situation d’ « incertitude générale » (c’est-à-dire, lorsque la valeur de l’ensemble des retraits de type 1 est incertaine), les accords de dépôt qui autorisent la suspension peuvent ne pas être suffisamment attrayants pour constituer une solution viable, sur le marché libre, au problème des paniques.
Le gouvernement, en revanche, peut faire quelque chose pour arrêter les paniques — c’est du moins ce qu’affirment Diamond et Dybvig. « L’assurance des dépôts par l’État, écrivent-ils, peut conduire à des allocations meilleures que celles que nous donnent les marchés privés en garantissant que le rendement promis sera payé à tous ceux qui se retirent ». En profitant de son pouvoir de taxation, en s’engageant à taxer les clients des banques qui retirent leurs dépôts au cours de la période 1, à un taux basé sur la valeur réalisée de l’ensemble des retraits, l’État peut réduire le rendement après impôt auquel les clients de type 2 peuvent s’attendre s’ils paniquent. L’assurance peut donc, dans une situation d’incertitude générale, atteindre la même structure de rendement qui évite les paniques que celle que les contrats de suspension ne peuvent atteindre que lorsque la part des déposants de type 1 est connue.
Cela ne veut pas dire que l’assurance des dépôts est la seule solution possible. Diamond et Dybvig affirment qu’une action appropriée de la banque centrale peut également empêcher les retraits massifs. La Fed, par exemple, pourrait « fournir un service similaire à l’assurance des dépôts » en utilisant ses facilités de prêt en dernier recours pour « acheter des actifs bancaires … à des prix supérieurs à leur valeur de liquidation. Si les taxes et les transferts sont fixés à des niveaux identiques à ceux de l’assurance-dépôts optimale, l’effet serait le même ».
Ce qui est bon pour les uns doit être bon pour les autres
Un demi-siècle après les faits, la version « incertitude générale » du modèle D-D semblait enfin offrir une preuve solide de l’instabilité inhérente aux banques ordinaires, ainsi qu’une base tout aussi solide pour la mise en place par l’État d’une assurance des dépôts. Cependant, à peine les inspecteurs ont-ils commencé à pointer leurs lampes sur cette structure réputée solide que ses profondes faiblesses sont apparues.
La première faiblesse a été identifiée au sein de l’argumentaire de Diamond et Dybvig en faveur de l’assurance des dépôts. Cet argumentaire repose en effet sur une hypothèse explicite : la contrainte dite de « service séquentiel » qui impose à leur banque de répondre aux demandes de ses déposants selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Cette contrainte est importante car en son absence (et donc, si la banque pouvait retarder le paiement de ses clients jusqu’à ce qu’elle ait reçu toutes leurs demandes de retrait), une banque de type Diamond-Dybvig pourrait subordonner ses paiements de la période 1 au total des retraits de la période 1. Cela exclurait toute possibilité de panique, même en présence d’une incertitude générale, et permettrait d’obtenir une structure des rendements espérés identique à celle qu’elle obtient lorsqu’elle peut utiliser la menace de suspension des retraits et qu’il n’y a pas d’incertitude générale (c’est-à-dire lorsque la proportion, t, des déposants qui vont retirer leurs fonds à la période 1 est connue).
Le problème de l’argumentaire de Diamond et Dybvig en faveur de l’assurance des dépôts est qu’il exempte implicitement et de manière illogique les autorités gouvernementales de cette contrainte de service séquentiel qu’il impose à la banque « D-D ». Pour que la solution de l’assurance des dépôts soit viable, il faut en effet que les autorités gouvernementales soient en mesure d’assurer la continuité du service. Pour cela, le gouvernement doit pouvoir recueillir toutes les demandes de paiement de la période 1, puis présenter aux demandeurs leurs factures fiscales (optimales) avant qu’ils ne retirent effectivement des fonds. Dans le cas contraire, des retraits non désirés viendraient réduire les rendements de la période 2 en interrompant le processus de production. En d’autres termes, pour que l’assurance des dépôts fonctionne correctement, le gouvernement doit avoir le droit de faire ce qui est refusé à la banque. Bien que Diamond et Dybvig aient admis que leur argument en faveur de l’assurance des dépôts repose de façon cruciale sur cette « asymétrie », ils n’ont jamais pris la peine de la justifier. Ils s’exposaient de la sorte à l’accusation portée contre eux par Neil Wallace qui leur reproche de ne pas « prendre au sérieux » la contrainte de service séquentiel de leur modèle[13].
Cette accusation suggère à son tour deux alternatives évidentes. La première — imposer la contrainte de service séquentiel au gouvernement et à la banque — invaliderait le mécanisme assurantiel de Diamond et Dybvig. La seconde — exempter le gouvernement et la banque — rendrait ce mécanisme inutile puisque la banque aurait la capacité de proposer une solution contractuelle sur le marché privé en dépit de l’incertitude générale. Comme l’expliquent Hu McCulloch et Min-Teh Yu[14], étant donné que la « taxe » impliquée dans le système d’assurance de Diamond et Dybvig n’est en réalité qu’une « redistribution entre les personnes qui effectuent des retraits à la période 1 et celles qui n’en effectuent pas », une fois que la banque « D-D » est libérée de la contrainte de service séquentiel, elle peut s’arranger pour mettre elle-même en œuvre la même « taxe » par contrat.
Aussi fatale que soit l’observation de McCulloch et Yu pour l’argument de Diamond et Dybvig, elle sous-estime encore la faiblesse de cet argument car celui-ci repose également sur l’hypothèse d’une technologie de production unique et sans risque. Comme Diamond et Dybvig le reconnaissent eux-mêmes, parce qu’elle « fait abstraction du choix du risque du portefeuille de prêts bancaires », l’hypothèse d’une technologie de production unique et sans risque permet d’éviter le fameux problème de l’aléa moral[15].
Or Denise Hazlett[16] a bien montré que lorsque la banque « D-D » a la possibilité d’investir dans des actifs risqués ou sans risque, la balance peut facilement pencher en faveur du laissez-faire. Hazlett explique cela clairement en faisant abstraction de l’incertitude générale. Certes, cette nouvelle possibilité fait que le système d’assurance de Diamond-Dybvig devient viable même avec une exigence de service séquentielle généralisée. Mais, comme nous l’avons vu, cela fait également de la suspension de la convertibilité la meilleure solution au problème des ruées bancaires. Le système assurantiel, en revanche, n’est pas une si bonne solution, car bien qu’il décourage les ruées bancaires, il encourage également à une prise de risque excessive. Il est vrai, comme le rappelle Hazlett, que certaines réglementations pourraient venir limiter ce problème d’aléa moral auquel est confronté le mécanisme assurantiel, mais cela aurait aussi pour effet de rendre l’assurance moins efficace dans sa lutte contre les ruées.
Les capitalistes à la rescousse
Le fait que l’argument de Diamond et Dybvig en faveur de l’assurance des dépôts ne soit pas défendable n’élimine pas en soi leur principale conclusion, à savoir que les accords privés ne peuvent pas garantir un résultat bancaire optimal lorsqu’il existe une incertitude générale et que les retraits sont accordés selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Mais cette conclusion dépend de façon cruciale de plusieurs caractéristiques étranges de la « banque » qu’ils ont imaginée.
L’une de ces particularités est le contrat de « dépôt à vue » de la banque Diamond-Dybvig. Comme le souligne Kevin Dowd[17], ce contrat diffère des contrats de dépôt bancaire que l’on a dans le monde réel en cela qu’il traite les déposants patients (ceux de type 2) comme des ayant droits résiduels, même lorsqu’ils ne paniquent pas. Par ailleurs, la banque Diamond-Dybvig ne recourt pas au financement par fonds propres au sens où on l’entend habituellement. Au lieu de cela, ses engagements sont des « hybrides » de dettes et de fonds propres. La « banque » elle-même est donc en quelque sorte un croisement entre une banque réelle et un fonds commun de placement.
Cette différence entre une banque Diamond-Dybvig et une banque réelle s’avère être plus qu’un simple raccourci technique. En effet, la question de fond est de savoir si les banques du monde réel, et pas seulement les institutions hybrides et entièrement imaginaires que l’on trouve dans l’article de Diamond et Dybvig et dans la plupart des études ultérieures qui s’en inspirent, sont intrinsèquement sujettes à l’échec ; et il s’avère que les banques du monde réel — qui s’appuient à la fois sur le financement par l’emprunt et par les fonds propres au lieu d’un hybride des deux — sont moins susceptibles de présenter le « mauvais » équilibre que ne l’est la banque de type Diamond-Dybvig. Elles pourraient même ne jamais se retrouver dans cette situation.
Pour comprendre pourquoi, il suffit, comme Dowd le démontre ailleurs[18], de supposer que, outre les consommateurs de type 1 et de type 2, le monde est peuplé d’autres personnes — appelons-les « capitalistes » — qui sont suffisamment bien dotées pour pouvoir investir K unités de capital sans le moindre risque de vouloir les consommer à T = 1. Supposons qu’ils le fassent en achetant des actions dans une « banque » qui est par ailleurs la même que celle modélisée par Diamond et Dybvig. Dowd montre qu’une telle banque, avec son ensemble distinct de créanciers résiduels « purs », pourrait s’avérer attrayante pour les capitalistes. Plus important encore, elle serait certainement plus attrayante pour les déposants qu’une banque D-D ordinaire, car elle rendrait les retraits à la fois moins probables et moins préjudiciables pour eux s’ils se produisaient.
La possibilité d’une ruée sur une banque D-D survient, observe Dowd, parce que les déposants de type 2 savent qu’ils pourraient subir des pertes si un trop grand nombre d’autres déposants retiraient leur argent au cours de la période 1. Mais si K est suffisamment grand — plus précisément[19], si K ≥ (r1 – 1) — les déposants de type 2 n’auraient absolument aucune raison de craindre des pertes et de se retirer prématurément. En bref, les capitalistes peuvent faire ce que ni l’assurance des dépôts ni la possibilité de suspendre les paiements ne sont capables de faire : ils peuvent garantir un « bon » équilibre malgré la présence d’une incertitude générale.
Prise en compte de la monnaie émise par les banques
Une autre particularité des « banques » de type Diamond-Dybvig est que, contrairement aux banques du monde réel, elles n’offrent pas de services de paiement. En effet, comme le notent Gary Gorton et Andrew Winton[20], il n’existe aucun moyen de paiement ou d’échange distinct dans le modèle Diamond-Dybvig et dans la plupart de ses variantes. En particulier, « [i]l n’y a pas d’achat de biens de consommation en utilisant les engagements bancaires comme monnaie. Dans le modèle, la banque est, en fait, également le magasin ». Dans le monde réel, au contraire,
les consommateurs achètent des biens avec des engagements bancaires sans avoir besoin de retourner à la banque pour retirer de l’argent. C’est l’essence même d’un moyen d’échange. Et c’est ainsi que fonctionnent les billets de banque et les dépôts bancaires. Si le lissage de la consommation et le désire d’assurer une consommation sont probablement des caractéristiques importantes de la réalité, il n’est pas certain que le lissage de la consommation soit réellement un moyen d’échange significatif pour les engagements bancaires.
Ici encore, la particularité de la banque Diamond-Dybvig n’est pas anodine. C’est uniquement grâce à cette particularité que l’on ne peut pas compter sur la suspension des paiements pour obtenir un résultat bancaire optimal face à l’incertitude générale.
Le problème de la suspension dans la version d’incertitude générale du modèle D-D est qu’elle peut contrecarrer les plans de consommation des consommateurs de type 1 : si la banque sous-estime t, elle suspendra les paiements même s’il n’y a pas de ruée vers la banque, laissant certains clients impatients dans le froid : parce que la banque est leur seule source de « maïs », ils sont obligés de s’en passer. « Une suspension des paiements dans le modèle D-D, note-t-on ailleurs, a le même effet que la fermeture de tous les points de vente de biens réels dans une véritable économie »[21].
En revanche, la suspension des retraits par une banque dans le monde réel n’empêche pas nécessairement les clients de la banque d’acquérir des biens de consommation. Dans la réalité, les biens sont vendus par des producteurs et des commerçants distincts. Les banques, pour leur part, utilisent l’épargne qui leur est confiée pour financer ces marchands et ces producteurs, mais ne produisent ni ne vendent elles-mêmes aucun bien. Cependant, leurs « billets » peuvent être utilisés pour acheter des biens, et pas seulement pour récupérer les fonds déposés. En d’autres termes, ils servent de moyens de paiement. Il s’ensuit que, lorsqu’une banque du monde réel suspend ses paiements, bien qu’elle empêche ses créanciers de les encaisser, elle ne les empêche pas nécessairement de faire des achats. Tant que les commerçants restent disposés à recevoir à leur valeur nominale des reconnaissances de dettes provenant de la banque qui a suspendu les paiements, la suspension peut contrecarrer une ruée sans limiter pour autant la capacité des déposants impatients à consommer leur épargne.
Pour illustrer ce point, j’ai construit il y a quelques années une version alternative du modèle D-D standard, conçue pour permettre à un moyen d’échange non bancaire, que j’appelle « l’or », de jouer un rôle[22]. Pour rendre l’or utile, je suppose que les N consommateurs de l’économie n’ont pas de dotation en maïs à la période 0, mais qu’ils sont dotés d’une once d’or chacun. J’ajoute ensuite des « marchands de maïs » dans cette économie, les dotant d’un stock d’au moins N boisseaux de maïs, mais pas d’or. Les consommateurs et leur banque doivent acheter du maïs aux marchands de maïs, qui sont supposés le vendre à un prix « mondial » donné d’une once d’or par boisseau. Enfin, je suppose que les marchands de maïs, comme les déposants bancaires de type 2, sont des consommateurs « patients ».
Je considère ensuite deux cas. Dans le premier, une technologie de paiement « or seulement » prévaut. Dans le second, des engagements bancaires « échangeables » peuvent remplacer l’or (des billets). Je montre ensuite que, dans le cas de l’or uniquement, tous les résultats du modèle D-D original sont reproduits, y compris la conclusion selon laquelle, en cas d’incertitude générale, la suspension peut nuire aux consommateurs de type 1. La différence est que ce résultat est dû, non pas au « fait que tous les « biens » sont enfermés dans les coffres des banques », mais au fait que les agents de type 1 ne peuvent pas échanger leurs crédits de dépôt bancaire directement contre du maïs disponible. Je note que cette différence rend ma version « plus cohérente avec les « faits stylisés » des crises bancaires historiques, qui ont généralement impliqué des pénuries d’argent mais pas de biens de consommation ». La fermeture des banques nationales en 1933 (bank holiday) en est un exemple notoire[23].
Le deuxième cas que j’examine diffère du premier uniquement en ce qu’il permet d’échanger directement les dépôts bancaires contre du maïs. Les consommateurs impatients peuvent alors proposer d’échanger leurs dépôts bancaires directement contre le maïs des commerçants, ces derniers rejoignant alors les rangs des autres déposants de type 2. Je montre que ce modèle modifié reproduit également les résultats du modèle original de Diamond et Dybvig, mais avec une différence cruciale : la suspension ne nuit plus aux consommateurs de type 1 qui peuvent continuer à échanger leurs dépôts contre du maïs, comme ils le feraient s’il n’y avait pas eu de suspension. La « patience » des commerçants suffit à garantir ce résultat, car elle les dispose à détenir des dépôts bancaires suspendus tout comme les déposants de type 2, de sorte qu’ils n’ont aucune raison de refuser les paiements qui prennent la forme de tels dépôts.
Alors que les conséquences de la fermeture forcée des banques (bank holiday) de 1933 ressemblent à celles de la suspension dans la version « or seulement » de mon modèle D-D modifié, les « restrictions » de paiement qui lui ont été antérieures et mises en place par des chambres de compensation bancaires privées se rapprochaient davantage de la suspension sans danger de la version avec monnaie bancaire négociable. En effet, les chambres de compensation privées et les banques qui en étaient membres continuaient à traiter les chèques, et les banques et les chambres de compensation émettaient toutes deux du papier monnaie « faible » en remplacement de l’or et du papier-monnaie fort de la banque centrale. Pendant le « bank holiday » de 1933, en revanche, les banques ont été complètement fermées et les chambres de compensation n’avaient plus le droit d’émettre de la monnaie « d’urgence ». En d’autres termes, il semble qu’au lieu d’illustrer les défauts inhérents à la suspension en présence d’une incertitude générale, les dommages causés par le « bank holiday » illustrent plutôt les inconvénients potentiels d’une suspension des paiements imposée par le gouvernement par rapport au type de suspension le plus probable lorsqu’il est décidé librement par les acteurs du système bancaire.
Une théorie qui ne peut être testée
Il n’est pas surprenant que les prédictions du modèle Diamond-Dybvig semblent plus cohérentes avec ce qui s’est passé aux États-Unis fin février et début mars 1933 qu’avec ce qui s’est passé ailleurs au cours de cette décennie, ou aux États-Unis à d’autres moments. Comme je l’ai indiqué au début de mon analyse, Diamond et Dybvig se sont très certainement inspirés de cet épisode américain particulier.
Il ne s’ensuit pas pour autant que les implications du modèle D-D soient incompatibles avec d’autres épisodes, notamment ceux de l’Écosse, du Canada et d’autres pays[24] où, pendant de longues périodes, l’absence d’assurance-dépôts ou de prêteur en dernier ressort est allée de pair avec une absence presque aussi complète de ruées sur les banques et de paniques. Il en est ainsi pour la simple raison que le modèle D-D est empiriquement vide : selon lui, les paniques sont des événements aléatoires. En effet, comme l’ont souligné Andrew Postlewaite et Xavier Vives[25], il s’agit forcément d’événements aléatoires, car personne ne placerait de l’argent (ou du « maïs » !) dans une banque D-D en sachant qu’une panique est imminente.
Ainsi, bien que des paniques soient possibles dans le modèle, leur occurrence n’est pas une nécessité. La différence entre l’expérience bancaire des États-Unis et celle, par exemple, du Canada des années 1930 ne pose donc aucun problème : le Canada a simplement eu de la chance (tout comme, apparemment, la Tchécoslovaquie, le Danemark, la Lituanie, les Pays-Bas et la Suède, entre autres). La « chance », ou son absence, explique les différences de résultats qui pourraient autrement être attribuées à des différences dans les conditions macroéconomiques, l’organisation de l’industrie bancaire, les fondamentaux des investissements bancaires, les réglementations prudentielles et autres, ainsi qu’à une multitude d’autres facteurs potentiellement pertinents. Et puisqu’une seule cause, la malchance, est à l’origine de toutes les paniques, la même solution ou un petit ensemble de solutions — l’assurance-dépôts, un prêteur de dernier recours vigilant ou un système bancaire bridé — sont les seuls remèdes concevables à toute crise bancaire réelle ou potentielle.
Parce qu’elle est compatible avec tout schéma observé de ruées et de paniques, la théorie D-D de l’instabilité bancaire n’est pas testable et, par conséquent, infalsifiable. Cela peut sembler une bonne chose. Mais ce n’est pas le cas. Tout d’abord, cela rend la théorie inapte à rendre compte des « faits stylisés » de l’histoire bancaire. Comme le soulignent Gorton et Wintrop[26], pour toute personne connaissant ces faits il est « évident que les banques ne sont pas des institutions fondamentalement défectueuses… Les paniques ne sont tout simplement pas une caractéristique de la plupart des économies dotées de banques. Le monde est plus compliqué ».
En d’autres termes, d’autres facteurs que la simple « chance » semblent jouer un rôle. Comme nous le verrons, l’un de ces facteurs consiste en des lois qui limitent la liberté des banques de gérer leurs affaires comme elles l’entendent.
Un Graal qui n’est pas si saint
Pratiquement tous les modèles qui s’appuient sur l’effort pionnier de Diamond et Dybvig en conservent les mécanismes clés, avec cette idée de départ bien spécifique que, quel qu’en soit l’objet, un bon modèle bancaire doit être capable de montrer que les banques et les systèmes bancaires sont intrinsèquement vulnérables aux ruées. « Certains chercheurs pensent », observent Gorton et Winton (en ayant à l’esprit Diamond et Dybvig et leurs partisans), « qu’un modèle théorique de l’existence d’intermédiaires financiers doit simultanément être un modèle de panique ; les banques et les paniques sont intrinsèquement liées et les modèles doivent le refléter ».
En d’autres termes, pour de nombreux économistes, l’affirmation de l’ « instabilité inhérente » n’est pas seulement une hypothèse parmi d’autres à explorer et à tester, mais un axiome qu’aucune théorie digne de ce nom ne peut contredire. Huberto Ennis et Todd Keister observent que l’objectif inébranlable de « l’importante littérature économique » initiée par l’article de Diamond et Dybvig a été « d’identifier les composantes essentielles » d’un système bancaire de laissez-faire qui justifierait l’opinion « selon laquelle les banques… sont intrinsèquement fragiles, dans le sens où elles sont susceptibles de faire l’objet d’une ruée auto-réalisatrice de ses déposants ».
Pour le dire crument, une théorie plausible de la banque qui soit compatible avec l’idée obsédante selon laquelle les banques sont intrinsèquement instables a longtemps été le Saint Graal des économistes qui se sont penchés sur le sujet.
Dans son excellente étude de la recherche post-D-D jusqu’en 2010[27], Ricardo Cavalcanti y voit lui aussi une recherche du Saint Graal. Soulignant que les modèles qu’il étudie « semblent si éloignés de la théorie monétaire », il affirme que cela était inévitable, car d’autres approches auraient donné lieu à des « conclusions controversées… sur la fragilité ». En d’autres termes, des modèles plus réalistes auraient été encore moins capables de démontrer l’instabilité inhérente des banques que ceux qui suivent « l’approche par les mécanismes » de Diamond et Dybvig ; approche qui consiste à partir du principe que la ruée bancaire est un parmi plusieurs « résultats » que sa banque doit pouvoir atteindre, et à construire le modèle sur cette base. Selon M. Calvalcanti, les économistes ont dû
envisager sérieusement la possibilité que la fragilité financière soit une conséquence intrinsèque de la volonté d’offrir aux individus les meilleurs arrangements possibles en matière de liquidité. Cela favorise l’approche par les mécanismes aux dépens de la théorie de l’équilibre général.
C’est effectivement le cas. Mais après une nouvelle décennie de modélisations allant dans le même sens et qui ont donné des résultats de plus en plus pauvres, n’est-il pas temps d’envisager la possibilité qu’en cherchant les causes des crises bancaires dans la nature même de la banque, les économistes se soient trompés de cible ? Une autre approche pourrait-elle s’avérer plus fructueuse ?
L’une d’entre elles renverse la stratégie Diamond-Dybvig en partant de l’hypothèse qu’une banque non réglementée est une institution robuste, puis en s’interrogeant sur le type d’intervention réglementaire susceptible de la rendre moins robuste. L’un des apports de la littérature basée sur Diamond-Dybvig est d’avoir établi qu’il est relativement facile de modéliser un système bancaire robuste, c’est-à-dire un système dont les contrats excluent un « mauvais » équilibre avec panique. Pourquoi ne pas commencer avec un tel modèle — et plus il est réaliste, mieux ce sera — et examiner ensuite si et comment diverses restrictions réglementaires peuvent nous éloigner du bon équilibre, soit en l’excluant complètement, soit en introduisant un « mauvais » équilibre alternatif ? En fait, il n’est pas nécessaire de lancer un tel programme de recherche. Il a déjà été lancé, car au moins certains des « mauvais » résultats des modèles Diamond-Dybvig existants sont facilement interprétés comme des conséquences, non pas du laissez-faire, mais de restrictions légales inutiles.
Alors que l’hypothèse d’ « instabilité inhérente » est rarement étayée par des données empiriques (et non mythiques), les preuves ne manquent pas en faveur de cette théorie alternative selon laquelle des « restrictions légales » sont à l’origine des crises bancaires[28]. Pour commencer, il y a le fait que certains des systèmes bancaires les moins fortement réglementés au monde ont également été remarquablement épargnés par les crises[29]. Il y a aussi le fait que les contrats volontaires permettant aux banquiers de suspendre la convertibilité de leurs engagements — le dispositif le plus évident du marché libre pour empêcher les retraits massifs — ont souvent été interdits[30]. Enfin, il existe de nombreuses preuves du rôle (souvent crucial) que d’autres réglementations mal conçues ont joué dans les crises bancaires passées — tellement de preuves, en fait, qu’il est difficile de découvrir une calamité bancaire passée dans laquelle des réglementations malavisées n’ont joué aucun rôle clé. Outre les ouvrages que nous venons de citer, les lecteurs sceptiques sont encouragés à consulter Fragile by Design, l’excellente étude réalisée en 2014 par Charles Calomiris et Stephen Haber qui, aussi volumineuse soit-elle, n’est que la partie émergée d’un très volumineux iceberg[31].
***
Dans son essai intitulé Monetary Theory and History: An Attempt at Perspective, Sir John Hicks a observé que
« la théorie monétaire est moins abstraite que la plupart des théories économiques ; elle ne peut éviter une relation avec la réalité, qui fait parfois défaut dans d’autres théories économiques. Elle appartient à l’histoire monétaire, alors que la théorie économique n’appartient pas toujours à l’histoire économique. »
Ce que Sir John a dit de la théorie monétaire vaut nécessairement pour ses sous-disciplines. La théorie bancaire « appartient » également à l’histoire monétaire et ne peut donc pas éviter une relation avec la réalité. Le problème du modèle de Diamond et Dybvig est qu’il est si éloigné de la réalité que les deux pourraient tout aussi bien être de parfaits étrangers.
* Ce texte est tiré de deux articles publiés sur le site Alt-M : Ideas for an Alternative Monetary Future, les 17 et 18 décembre 2020 : http://bit.ly/3ZwRhY1
[1] La multiplication des crises financières à l’étranger a sans doute également joué un rôle dans la popularité de l’assurance des dépôts. Toutefois, il convient de noter que les crises internationales de cette période étaient principalement des crises monétaires, impliquant des attaques spéculatives sur les taux de change fixes, plutôt que des crises bancaires au sens strict. Si l’assurance des dépôts peut stopper les ruées sur les banques ordinaires, elle ne peut généralement pas empêcher les ruées sur les banques par des personnes cherchant à acquérir de la monnaie nationale dans le but de la convertir en devises étrangères.
[2] Voir Deniz Anginer et Asli Demirguc-Kunt (2018), “Bank Runs and Moral Hazard: A Review of Deposit Insurance,” Policy Research WP 8589, World Bank Group.
[3] John H. Cochrane (2014), “Toward a Run-free Financial System,” chapter 10 in Martin Neil Baily, John B. Taylor, eds., Across the Great Divide: New Perspectives on the Financial Crisis, Hoover Press.
[4] Ricardo de O. Cavalcanti (2010), “Inside-Money Theory after Diamond and Dybvig”, Economic Quarterly, Vol. 96, N° 1, 59–82.
[5] L’espace et le temps m’empêchent de mentionner la plupart de ces écrits inspirés de Diamond et Dybvig, et encore moins de leur rendre justice : si certaines des critiques que je formule ici à l’encontre de l’effort initial de Diamond et Dybvig s’appliquent à bon nombre de ces autres travaux, il est loin d’être vrai que toutes mes critiques s’appliquent à chacun d’entre eux. Cela est particulièrement vrai pour les articles qui soulignent eux-mêmes les problèmes de l’analyse de Diamond et Dybvig, même s’ils conservent et développent nombre de ses caractéristiques.
[6] NDLR : Nous traduisons ainsi l’expression anglaise de « wildcat banking » ou « wildcat bank ». L’expression désigne des banques qui sont établies dans l’optique de faire un maximum de profit puis de faire faillite.
[7] Terry L. Anderson et P.J. Hill (1979) “An American Experiment in Anarcho-Capitalism: The Not So Wild, Wild West,” Journal of libertarian studies, Vol. 3, N°1, 9-29.
[8] Gerald P. Dwyer Jr., “Wildcat Banking, Banking Panics, and Free Banking in the United States”, Economic Review, Vol. 81, Nos. 3-6, 1996, George A. Selgin (2021) “The Fable of the Cats”, Alt-M, July 6 at https://www.alt-m.org/2021/07/06/the-fable-of-the-cats/
[9] George A. Selgin (2015), « Real and Pseudo Free Banking,” Alt-M, 23 juillet, at https://www.alt-m.org/2015/07/23/real-pseudo-free-banking/
[10] Pour motiver leur article, Diamond et Dybvig mentionnent eux-mêmes les faillites de Hartford Federal Savings and Loan (février 1982) et de l’Abilene National Bank of Texas (juillet 1982), ainsi que les pertes importantes subies par les déposants non assurés lors de la faillite de la Penn Square Bank de l’Oklahoma (juillet 1982). Il est notoire que la Penn Square a fait faillite parce qu’elle avait consenti toutes sortes de mauvais prêts. L’Abilene National Bank était l’un des principaux correspondants de la Penn Square Bank, qui a fait l’objet d’une ruée lorsque l’on a appris qu’elle avait subi d’importantes pertes sur prêts. Enfin, la Hartford Federal a fait l’objet d’une ruée après que le Hartford Current ait rapporté, à juste titre, qu’elle avait « perdu un montant record de 7,3 millions de dollars en 1981 et qu’elle prenait maintenant des mesures draconiennes pour rester à flot ». La panique pure n’a joué aucun rôle évident dans ces retraits, tandis que l’assurance des dépôts n’a pas réussi à empêcher le dernier d’entre eux. En résumé, si Diamond et Dybvig ont pu être inspirés par ces épisodes, on ne peut pas dire que leur célèbre article permette de les mieux comprendre.
[11] George A. Selgin (2019), “Warren Mosler and the Great American Banking Myth,” Alt-M, 3 décembre, at http://bit.ly/40azneG
[12] Hugh Rockoff (1074), “The Free Banking Era: A Reexamination,” Journal of Money Credit and Banking, Vol. 6, N°2, 141-167. Arthur J. Rolnich et Warren E. Weber (1984), “The Causes of Free Bank Failures: A Detailed Examination,” Journal of Monetary Economics, Vol. 14, N°3, 267-291. Barrie A. Wigmore (1987), “Was the Bank Holiday of 1933 Caused by a Run on the Dollar?” Journal of Economic History, Vol. 47, N03, 739-755. Elmus Wicker (2000) The Banking Panics of the Great Depression, Cambridge University Press.
[13] Neil Wallace (1988), “Another Attempt to Explain an Illiquid Banking System: The Diamond and Dybvig Model With Sequential Service Taken Seriously,” Quarterly Review of the Federal Reserve Bank of Minneapolis.
[14] J. Huston McCulloch et Min-The Yu (1998) “Government Deposit Insurance and the Diamond-Dybvig Model,” The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, Vol. 23, N°2 139-149.
[15] Voir “The Moral Hazard Implications of Deposit Insurance: Theory and Evidence,” Patricia A. McCoy, February 18, 2007.
[16] Hazlett, D., “Deposit insurance and regulation in a Diamond-Dybvig banking model with a risky technology,” Econ Theory, 9, 453–470 (1997). https://doi.org/10.1007/BF01213849
[17] Kevin Dowd (1992) “Models of Banking Instability: A Partial Review of the Literature,” Journal of Economic Surveys, Vol.6, N°2, 107-132.
[18] Kevin Dowd (2000) “Bank capital adequacy versus deposit insurance,” Journal of financial services research, 17 (1). pp. 7-15.
[19] Cette condition, note Dowd, « est une condition suffisante pour exclure les paniques, mais elle n’est pas nécessaire… Alors que les déposants préféreraient évidemment être aussi rassurés que possible, une base de capital plus élevée signifie un rendement plus faible sur les fonds propres de la banque, toutes choses égales par ailleurs, et un rendement plus faible sur les fonds propres de la banque rend les fonds propres eux-mêmes plus difficiles à attirer. …[L]e niveau optimal de fonds propres sera un compromis entre l’assurance qu’il donne aux déposants et le coût des fonds propres eux-mêmes ».
[20] Gorton, Gary B. and Winton, Andrew, “Financial Intermediation” (May 2002). NBER Working Paper No. w8928, at https://ssrn.com/abstract=311424
[21] Selgin, G. “In Defense of Bank Suspension,” J Finan Serv Res 7, 347–364 (1993). https://doi.org/10.1007/BF01046928
[22] Cf. note supra.
[23] Cf. George Selgin, “The New Deal and Recovery: Part 6 – The National Bank Holiday”, Alt-M, 28 juillet 2020. https://www.alt-m.org/2020/07/28/the-new-deal-and-recovery-part-6-the-national-bank-holiday/
[24] http://bit.ly/3JPz1mV
[25] https://www.sas.upenn.edu/~apostlew/paper/pdf/bank%20runs.pdf
[26] Gorton, G. B. and W. Andrew, “Financial Intermediation” (May 2002). NBER Working Paper No. w8928, Available at https://ssrn.com/abstract=311424
[27] Ricardo de O. Cavalcanti, “Inside-Money Theory after Diamond and Dybvig,” Federal Reserve Bank of Richmond leEconomic Quarterly, Volume 96, Number 1, First Quarter 2010, 59–82.
[29] G. Selgin (1994) “Are banking crises free‐market phenomena?” Critical Review, 8:4, 591-608
[30] https://bit.ly/3ZdxBbf f
[31] Charles W. Calomiris et Stephen H. Harber (2014), Fragile by Design: The Political Origins of Banking Crisis and Scarce Credit, Princeton Economic History of the Western World Series, Princeton Univ. Press.