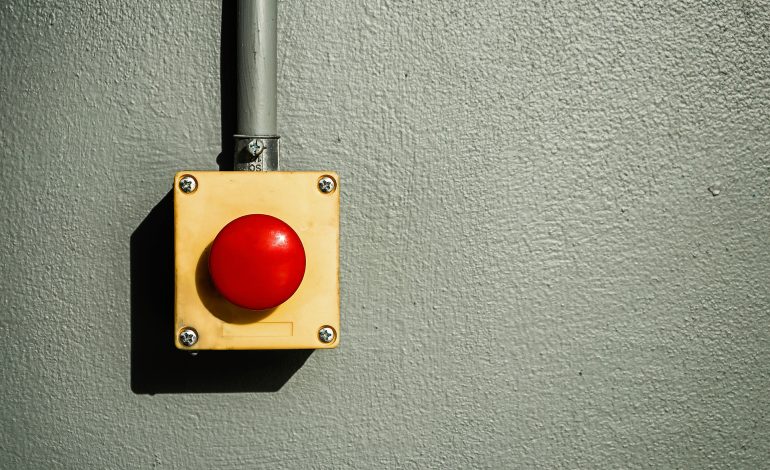L’épidémie de coronavirus a mis en exergue les imperfections de notre système de santé. Alors que la plupart de nos concitoyens se félicitaient d’avoir le meilleur système au monde, celui-ci a révélé d’importantes carences au cours des derniers mois. Afin d’éviter la saturation des hôpitaux, certains patients furent envoyés dans les hôpitaux des pays voisins ; d’autres furent accueillis au sein d’hôpitaux créés en urgence, et un confinement fut imposé à la population afin de ralentir l’évolution de l’épidémie.

A bien des égards, la France ne fait pas figure d’exception, et il serait aussi simpliste que masochiste d’accabler notre système pour avoir été pris par surprise par une épidémie que personne ou presque n’avait prévu. En effet, rares furent les pays qui parvinrent à éviter un confinement, au moins partiel, tout en assurant la sécurité sanitaire des citoyens. Et même dans ces pays, les conséquences sanitaires et économiques demeurent dramatiques.
Aussi, l’objet du présent propos n’est pas de décrier le système français pour le plaisir, mais de tenter une analyse, à chaud, des difficultés spécifiques à la France afin d’en tirer des propositions constructives pour l’avenir. L’intérêt d’une telle entreprise tient avant tout à la situation quelque peu paradoxale de notre pays. La France fait partie des pays qui dépensent le plus dans la santé et s’est pourtant trouvée parmi les pays développés les plus en difficultés. Plus paradoxal encore, alors que nous, Français, pensions avoir le meilleur système du monde, aucun pays, aucun dirigeant de la planète n’a cité notre modèle en exemple ni félicité notre capacité de réaction face à l’épidémie. Non, la vedette lui fut volée par des pays qui, vus de France, n’ont jamais brillé par leur système de santé, qu’il s’agisse de la Corée du Sud, de l’Allemagne, des Pays-Bas ou encore de Singapour. Voilà qui force à s’interroger sur notre modèle.
Comment expliquer en effet que ces pays, qui dépensent moins ou autant pour leur système de santé, se soient mieux adaptés ; pire encore, comme expliquer qu’ils étaient tout simplement mieux préparés à affronter un événement inattendu et d’une telle ampleur ?
La réponse, habituellement proposée en France, du manque de moyens ne tient pas puisque d’autres pays surent faire mieux avec moins de dépenses. Alors que manque-t-il au système français ? Que dit cette crise de la gestion de la santé à la française ? Tentons d’y voir plus clair.
- Le paradoxe français : dépenses élevées, pénurie d’investissement, de biens et de services
Selon les statistiques de l’OCDE, la France alloue 11,2% de son PIB à la santé ; un effort équivalent à celui de l’Allemagne, à peu près identique à celui de pays tels que et uniquement inférieur à celui de la Suisse ou des Etats-Unis[1]. Cette dépense est d’ailleurs relativement stable depuis 2009, avec une croissance moyenne de 1,4% par an, traduisant un effort constant au cours de la dernière décennie[2].
Pourtant, professionnels de santé et personnels hospitaliers déplorent un manque de moyens qui les avait conduits à manifester plusieurs fois contre les différentes mesures annoncées par le gouvernement actuel, notamment le 20 novembre 2018 et le 29 octobre 2019[3]. Et les chiffres leur donnaient raison. Alors que dans les pays de l’OCDE, le salaire des infirmiers représente 114% du salaire moyen, il ne s’élève qu’à 95% du salaire moyen en France. Autrement dit, la France fait partie des rares pays développés dans lesquels les infirmiers sont moins bien payés que la moyenne des salariés ; alors même que les dépenses de santé sont parmi les plus élevées au monde.
Et la situation des infrastructures hospitalières n’est pas meilleure. Depuis 2006, les investissements des hôpitaux publics ont diminué de près de 45% et ceux des cliniques privées de 57%. Dans le même temps, leur situation financière s’est dégradée ; le résultat net des hôpitaux publics comme privés ayant toujours été négatif au cours de la dernière décennie[4].
Ainsi, les hôpitaux français manquent de moyens alors même que les dépenses augmentent au rythme de la croissance économique et demeurent plus élevées que dans la majorité des pays développés. Et cela ne traduit même pas un arbitrage en faveur de la recherche et développement ou d’un excédent de matériels. En effet, la faiblesse des revenus des personnels soignants ou la baisse des investissements dans les hôpitaux auraient pu s’expliquer par une préférence pour davantage d’investissement dans la recherche fondamentale et l’innovation médicale ou encore par la volonté d’allouer prioritairement les budgets à la production et au stockage de matériels médicaux stratégiques. Dans ce cas, le système français ne saurait être considéré comme défaillant. Malheureusement, il n’en est rien.
Les dépenses publiques en recherche et développement ont stagné au cours de la dernière décennie[5] et la France compte moins d’entreprises innovantes dans la santé que ses voisins. A titre d’exemple, en 2017, il y avait en France 16 entreprises de biotech et 60 entreprises de medtech pour 100 mille habitants, alors qu’il y en avait respectivement 45 et 120 en Allemagne, 176 et 396 en Belgique et 179 et 60 en Suisse[6]. Autrement dit, le budget des hôpitaux n’a pas été comprimé au bénéfice de l’innovation médicale.
Figure 1. Dépenses de santé, en pourcentage du PIB (2018)

La même conclusion s’impose à l’égard des stocks de matériel. Si l’épidémie a révélé une chose, c’est bien le manque criant de masques, de gels hydroalcooliques et de lits de réanimation disponibles en cas de crise. Loin d’avoir dédié davantage de budgets à la création de stocks stratégiques, les gouvernements passés et présents les auraient plutôt réduits.
Face à ce constat amer, deux questions s’imposent : d’abord, comme l’on dit familièrement, « où va l’argent » ? Puisque ni les infrastructures ni les personnels soignants ne bénéficient de cet excédent de dépenses publiques – par rapport aux autres pays développés – à quoi est-il alloué ? Ensuite, la France dépensant autant sinon davantage que les autres pays développés, comment expliquer qu’elle n’ait pas mieux réagi au cours de l’épidémie ? Nécessairement, ce n’est pas la faiblesse du budget qui est en cause, mais plutôt son allocation et la façon dont il est géré.
- Le cœur de la défaillance française : une gestion comptable et centralisée, méconnaissant les besoins des professionnels et des patients
Au fond, ces questions révèlent un problème bien connu. La France souffre d’une gestion centralisée et d’une administration trop lourde qui réduisent l’efficacité des dépenses publiques. La France dépense beaucoup, mais mal ; et cela pour deux raisons majeures. Le financement est défini à l’échelon national alors que les besoins ne peuvent être connus qu’à l’échelle locale. La mise en œuvre d’une telle stratégie impose de multiplier les strates de décisions et les administrations, créant des rigidités qui privent les acteurs de terrain de toute autonomie. Il s’agit là d’une malédiction française, à laquelle le système de santé ne saurait déroger.
Au contraire, la gestion des hôpitaux en serait même une parfaite illustration. Au cours des vingt dernières années, l’autonomie de l’hôpital n’a cessé d’être étouffée par le carcan législatif et administratif. Dès 1996, l’introduction du PLFSS – projet de loi de financement de la Sécurité Sociale – consacrait la gestion des hôpitaux à l’échelle nationale, en imposant les objectifs des hôpitaux et en définissant leurs stratégies. Puis, en 2004, la volonté de renforcer les interactions entre les différents professionnels de santé, et notamment entre médecine de ville et hôpital, accouchait de la création des ARS – agences régionales de santé –, les agences régionales de santé, qui allaient piloter les hôpitaux et coordonner leurs activités.
Concrètement ces deux réformes se sont traduites par une nationalisation des décisions hospitalières, empêchant les directeurs d’hôpitaux de choisir leur stratégie de développement et de fournitures des soins, réduisant leurs capacités d’innovation et, in fine, les privant de toutes marges de manœuvre dans le pilotage de leur activité.
Ajoutons l’introduction de la T2A – tarification à l’activité – et tout s’éclaire. Cette réforme, de 2007, définit le budget alloué à un hôpital en fonction du nombre d’actes qu’il a tarifés au cours d’une année, à un prix imposé à l’échelle nationale. Dès lors, afin de conserver son budget, financé majoritairement par l’Assurance Maladie, l’hôpital a intérêt à multiplier les actes, et non à soigner réellement les patients. La quantité prime alors sur la qualité, production et prescription de masse l’emportent sur l’innovation et la personnalisation des soins.
Sous l’effet de ces réformes, l’indépendance des hôpitaux disparaît ; d’une part, leurs recettes dépendent du volume d’activité et non de la qualité des soins ; d’autre part, ils n’ont le choix ni de l’activité à développer, ni du salaire du personnel, ni des tarifs à appliquer, et même le choix des fournisseurs de matériels est effectué au niveau national.
Pour les économistes, les conséquences de ces réglementations sont évidentes. Les fournisseurs de soins, contraints de respecter les ordres qui viennent de plus haut, ne peuvent utiliser leur connaissance du terrain pour satisfaire au mieux leurs patients. Dès lors, d’entrepreneurs de soins au service de leurs clients, ils se transforment en gérant d’un service administré ; leur mission n’est plus d’assurer la meilleure qualité des soins, mais de veiller à ce que l’hôpital se conforme aux exigences réglementaires et législatives. Ainsi, le patient n’est plus le centre de l’attention, et puisque le satisfaire n’est plus l’objectif principal, le personnel soignant en charge des soins perd de sa valeur. Rien d’étonnant alors à ce que les infirmiers, pourtant interlocuteurs privilégiés des patients, soient si faiblement rémunérés. Leur activité est dévalorisée, au profit d’une survalorisation des procédés administratifs. Voilà pourquoi le personnel administratif représente 35% du personnel hospitalier en France, contre 24% en Allemagne. Plus la réglementation est complexe, plus les administrations se multiplient, et plus leurs coûts augmentent, réduisant d’autant les dépenses productives. En ce sens, les infirmiers français ont raison de se plaindre, mais au lieu de se concentrer sur l’augmentation des budgets, ils devraient s’intéresser à leur allocation.
Les hôpitaux, et plus généralement l’ensemble du système de santé, souffre donc d’un excès de planification, qui prive les acteurs de toute motivation entrepreneuriale. Pire, cette planification tend à sanctionner les véritables entrepreneurs comme en témoignent les décisions absurdes prises par certaines ARS durant l’épidémie. Au motif de coordonner l’activité des différents établissements hospitaliers, l’ARS PACA a par exemple réquisitionné les masques commandés, et payés, par des cliniques privées de la région pour les redistribuer à des hôpitaux publics. Cette stratégie s’insérait dans un plan plus vaste qui consistait à orienter les patients atteints de Covid-19 vers l’hôpital public en priorité. Ainsi, les hôpitaux publics furent rapidement saturés, et le personnel se trouva en manque de masques et de moyens. Face à cela, l’ARS imposa des réquisitions de matériels afin de répondre aux demandes pressantes des personnels hospitaliers. Conséquence : les cliniques disposant de lits libres en grande quantité se trouvaient dans l’impossibilité d’accueillir des patients par manque de matériels et de stocks dont elles avaient pourtant pris soin de se pourvoir. Voilà comment le pilotage centralisé a créé simultanément une pénurie dans les hôpitaux publics et un gaspillage de ressources dans les cliniques.
Tout le problème est là. Les détracteurs de l’économie de marché ont beau répéter à l’envi que la logique capitaliste est responsable des défaillances, la vérité est tout autre. C’est bien le poids de l’administration et l’impossibilité pour les hôpitaux de fonctionner comme de véritables entreprises – c’est-à-dire des organisations visant à satisfaire au mieux les patients et non à maîtriser leurs enveloppes – qui explique l’échec du système. D’ailleurs, comment pourrait-on expliquer autrement que les grandes entreprises privées ont su, si rapidement, pallier les pénuries publiques ? Là où l’Etat mit plus d’un mois à récupérer des masques, les grandes surfaces n’ont eu besoin que d’une semaine. Et qui, si ce ne sont des entreprises privées, ont fait preuve d’une flexibilité suffisante pour transformer leurs chaînes de production afin de fournir à l’État des masques – alors qu’elles produisaient des vêtements –, des gels hydroalcooliques – alors qu’elles produisaient des spiritueux –, ou encore des respirateurs – conçus à partir de masques de plongés ?
Il faut le dire, encore et encore, ceux qui ont sauvé le système de santé, assuré son fonctionnement, se nomment LVMH, Pernod-Ricard ou Décathlon, sans mentionner les dizaines de petites entreprises et d’anonymes qui ont su réagir lorsque la machine publique était à l’arrêt, coincée dans son trop-plein d’administration.
- L’alternative marchande : la concurrence des professionnels au service des patients
Ce qui a fait défaut durant la crise, c’est ce qui fait défaut au système de santé dans son ensemble : le lien entre patient et professionnel de santé s’est délité, au rythme des réglementations et d’une planification aveugle.
Et le plus triste est que cela s’est produit sous l’effet de la volonté de rapprocher le fonctionnement des hôpitaux de celui des entreprises. Comme le précise la direction de l’information légale et administrative au sujet de la T2A par exemple : « la tarification à l’acte incite à gérer l’hôpital comme une entreprise, en recherchant la meilleure productivité. » Mais, déjà elle ajoute : « Des actes médicaux sont plus rentables que d’autres, et l’hôpital a tendance à accroître ses activités rémunératrices, comme la chirurgie, en délaissant les longues prises en charge moins bien rémunérées (comme la psychiatrie, les maladies chroniques, les soins aux personnes âgées »[7].
Tragique ironie du sort, la planification et la perte d’autonomie des hôpitaux auraient été imposées afin d’encourager leur gestion entrepreneuriale. Et cela, à regret, semble-t-il. Comment est-ce possible ? C’est qu’il y a une incompréhension profonde du fonctionnement de l’entreprise et plus généralement du marché. Ce que les pouvoirs publics appellent économie de marché se résume à la maîtrise des coûts. Mais cela n’a rien de commun avec un marché, sans quoi dans tous les secteurs marchands, on ne disposerait que de produits peu chers et souvent de mauvaise qualité. Un marché n’a pas vocation à réduire les coûts dans l’absolu, mais à garantir la plus grande satisfaction du client au prix le plus faible. Et cela se produit par la mise en concurrence d’entrepreneurs qui, tentant de comprendre au mieux leurs clients potentiels afin de les satisfaire, vont sans cesse offrir un bien ou un service qui coïncide au mieux avec les attentes du plus grand nombre.
Au cœur du processus de marché, ce n’est pas le coût qui importe, mais le bien-être du client. Or, ce bien-être dépend de la satisfaction qui découle de la consommation d’un bien ou d’un service et du sacrifice monétaire que le client est prêt à accepter pour l’obtenir. Ce rapport entre qualité et prix n’est jamais connu d’avance, mais se révèle, au gré des décisions d’achat, sous l’effet de la concurrence entre des entrepreneurs désireux de satisfaire des besoins identiques.
Il en va de même de tous les biens et services, dans la santé comme ailleurs. Aussi, pour bénéficier des avantages d’une économie de marché, il ne suffit pas d’imposer des prix bas – cela n’est ni utile ni nécessaire –, ce qu’il faut c’est permettre aux patients de révéler leurs préférences en termes de qualité des soins et de consentement à payer. Et pour qu’ils soient en mesure de le faire, il leur faut avoir les moyens de changer de prestataires de soins, d’arbitrer entre différentes offres, de sanctionner ceux qui ne répondent pas à leurs attentes. Autrement dit, il faut qu’une concurrence existe entre les fournisseurs de soins et il est nécessaire que ces derniers puissent prendre toutes les décisions qu’ils désirent en termes de qualité et de prix proposés.
Et comment éviter que les patients ne soient contraints d’accepter les prix et les conditions de ces prestataires désormais soumis à un impératif de maîtrise des dépenses ? Un tel système ne conduirait-il pas inévitablement vers une hausse des prix et une dégradation de la qualité des soins, notamment pour les plus pauvres ? La concurrence entre prestataires de soins ne fait-elle pas courir le risque d’une médecine à deux vitesses ? Toutes ces questions, souvent utilisées comme épouvantail contre les rares propositions de mise en concurrence du système, sont légitimes.
Pour autant, elles masquent une mécompréhension de l’économie de marché, ou plutôt un oubli : pour qu’il y ait concurrence, il faut libérer l’offre mais aussi la demande. Les patients doivent être en mesure de choisir leur prestataire, leur hôpital, et d’imposer leur choix. Comment faire, alors que les patients, individuellement, n’ont que peu de marge de manœuvre ? La réforme de 2006 du système de santé au Pays-Bas apporte une réponse intéressante et efficiente. Face à des dépenses de santé considérées comme insoutenable, le gouvernement de l’époque a profondément transformé le système de soins, imposant la mise en concurrence des prestataires ainsi que des assureurs. Concrètement, les hôpitaux ont été largement privatisés et les Néerlandais ont eu l’obligation de s’assurer auprès d’assureurs privés. Ces derniers, contraints par la concurrence nouvelle, d’attirer des assurés, ont proposé une large gamme de choix à leurs clients, leur permettant de choisir leur niveau de prime d’assurance et leur reste à charge, et tous les assurés ont eu le droit de changer d’assureurs une fois par an.
Ce mécanisme s’est avéré efficace pour satisfaire des assurés ayant des niveaux de revenus très hétérogènes : certains préférant payer une prime faible et prendre le risque d’avoir un reste à charge important en cas de problème de santé, d’autre préférant payer une prime élevée pour éviter tout reste à charge. Et pour les personnes ayant les revenus les plus faibles, une subvention publique, financée par un impôt sur les salaires, a été conservée. Par ailleurs, afin de faciliter le paiement des primes d’assurance, les Néerlandais ont eu le choix de s’assurer individuellement ou en groupe, par l’intermédiaire de contrats collectifs offerts par les entreprises.
Après une phase de concentration du secteur des assurances, les assureurs ont atteint une taille critique, leur permettant de négocier le prix des prestations offertes par les hôpitaux et de coordonner le parcours de soins de leurs assurés, afin de réduire les coûts d’hospitalisation, de suivi et les dépenses de médecine de ville. L’offre de soins a donc fait face à une demande, représentée par des assureurs regroupant suffisamment de personnes pour devenir des acteurs de poids dans la négociation des tarifs, exerçant de ce fait une pression à la baisse sur les dépenses de santé.
Et comme les assureurs étaient en concurrence pour attirer les Néerlandais, ils ont été contraints de répercuter ces baisses en réduisant les primes d’assurance. Quatorze années plus tard, les hôpitaux sont à l’équilibre financier, les assureurs sont rentables[8] et les patients néerlandais ont un reste à charge équivalent à celui des Français[9] pour une qualité de soins identiques, voire meilleure dans le cas des soins dentaires et ophtalmologiques[10].
Ainsi, la concurrence dans le domaine de la santé a révélé les attentes et le consentement à payer des Néerlandais tout en assurant des services de qualité à des prix maîtrisés. Bien sûr, certains assureurs ont disparu, et des hôpitaux ont changé de dirigeants, il en va de la dynamique du marché, qui récompense ceux qui parviennent à satisfaire les patients et sanctionne ceux qui échouent. Le même phénomène aurait eu lieu en France, au cours de l’épidémie.
S’il avait existé une économie de marché de la santé, certains hôpitaux auraient connu une pénurie de masques et de matériels stratégiques – ayant sans doute préféré réduire leurs coûts à court terme au détriment d’une stratégie de long terme –, mais d’autres auraient eu d’importants stocks et auraient été en mesure d’accueillir un plus grand nombre de patients. Certains hôpitaux se seraient montrés incapables de modifier leur organisation, souffrant alors de la saturation que nous avons connue presque partout, mais d’autres auraient démontré leur agilité, et en auraient tiré avantage. Et même si l’épidémie avait nécessité quantité de matériels impossibles à stocker à l’avance, chaque hôpital aurait pu faire appel à plusieurs entreprises spécialisées, capables de réagir rapidement. Car dans un système de concurrence, les entrepreneurs se doivent d’avoir une bonne connaissance de leurs fournisseurs, expertise qui leur permet de réagir rapidement et de favoriser les plus efficaces. Ainsi, les filières efficaces auraient été privilégiées et les délais auraient été réduits.
Par ailleurs, la plupart des hôpitaux auraient sans doute pu mieux réagir, bénéficiant d’un personnel soignant plus nombreux et plus flexible. En effet, ce qui a ankylosé les hôpitaux c’est le poids de l’administration. Dans un système de marché, décentralisé, les directeurs d’hôpitaux n’auraient pas eu besoin d’avoir autant de personnels administratifs, dégageant un budget supplémentaire pour les soignants. Mais au-delà, ils auraient pu organiser leur hôpital comme ils le désiraient ; alors qu’actuellement, les infirmiers et aides-soignants sont cantonnés à un service particulier, perdant ainsi toute connaissance des autres services, dans un système moins administré, ces derniers auraient été habitués à tourner d’un service à l’autre, rendant possible la transformation rapide du fonctionnement d’un hôpital et lui permettant de gérer plus efficacement des situations de crise. Voilà ce qui a manqué jusqu’à présent dans notre réflexion sur le système de santé. La centralisation des décisions a conduit non pas à une économie de marché, tant s’en faut, mais à une logique de contrôle des coûts, au détriment de la qualité des soins et de la préparation des crises. Grâce à la décentralisation des décisions et à l’autonomie des hôpitaux, cette logique laisserait place à une approche centrée sur les besoins des patients et permettrait l’apparition de réponses aussi diverses qu’innovantes pour les satisfaire. C’est cela le marché, rien de plus ; un formidable instrument de révélation d’un savoir autrement inaccessible et pourtant vital pour le bon fonctionnement d’une société : comprendre les attentes de chacun pour mieux y répondre. Si la santé est notre bien le plus précieux, alors dans ce domaine plus qu’ailleurs, il nous faut pouvoir compter sur l’esprit d’entreprise et le marché.
[1] OCDE, Dépenses de santé, https://bit.ly/2O8W7Iv.
[2] Drees, Les dépenses de santé en 2018, Résultats des comptes de la santé, Edition 2019, p. 12, https://bit.ly/3gEZSSj.
[3] Le Monde, « Les infirmières font entendre leur colère », 20 novembre 2018, https://bit.ly/3iOwrPt. L’Express, « Hôpital : des médecins et des infirmières manifestent à Paris pour réclamer plus de moyens », 29 octobre 2019, https://bit.ly/313JLJE.
[4] Drees, Les établissements de santé, Edition 2019, https://bit.ly/2ZfvBDU.
[5] OECD, OECD Science, Technology and Innovation Outlook, 2016, https://bit.ly/2ObC0JY.
[6] France Biotech, Panorama France Health Tech, 2017.
[7] Vie publique, « Entre T2A et Ondam, quel financement pour l’hôpital ? », 22 janvier 2020, https://bit.ly/317073Z.
[8] Bikker J, « Competition and Scale Economy Effects of the Dutch 2006 Health-Care Insurance reform », The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice, 42: 53-78, 2017.
[9] Le reste à charge représente 1,2% du revenu moyen dans les deux pays. Voir, OCDE, Health spending, https://bit.ly/2VwHUcp et OCDE, Average annual wages, https://bit.ly/2NJCFC4.
[10] OCDE – Commission Européenne, Health at a glance : Europe 2018, https://bit.ly/3feUDs7. Concernant les soins dentaires, 24% des Français disent y renoncer pour des raisons financières contre 7% aux Pays-Bas, voir Eurostat, « Self-reported unmet needs for specific health care-related services due to financial reasons », https://bit.ly/38iQtNd.
 Pierre Bentata est économiste et essayiste. Depuis 2015, il est professeur à l’école de commerce de Troyes. Parallèlement, il dirige un cabinet d’études spécialisé dans les domaines de l’innovation et de la santé. Il intervient régulièrement dans les médias, notamment la presse écrite, et a publié quatre essais, dont le dernier, « Libérez-vous ! », en 2020 aux Éditions de l’Observatoire.
Pierre Bentata est économiste et essayiste. Depuis 2015, il est professeur à l’école de commerce de Troyes. Parallèlement, il dirige un cabinet d’études spécialisé dans les domaines de l’innovation et de la santé. Il intervient régulièrement dans les médias, notamment la presse écrite, et a publié quatre essais, dont le dernier, « Libérez-vous ! », en 2020 aux Éditions de l’Observatoire.