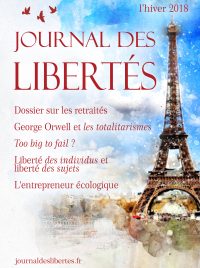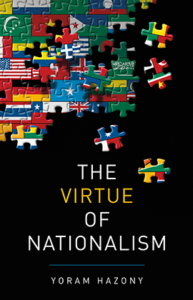 Dans cette défense ambitieuse des vertus du nationalisme, Yoram Hazony prend pour cible la « construction libérale émergente » qui, d’après lui, s’oppose à l’idée que les nations devraient avoir leurs « propres lois, traditions et politiques ». Hazony pense que l’élite mondiale est indûment biaisée contre le nationalisme. Selon lui, les différences et spécificités nationales sont considérées avec dédain par cette élite qui n’y voit que nuisance, et dont le cosmopolitisme auto-centrique reflète le mépris des habitudes et des affections du localisme et, partant, le manque de compréhension de l’histoire et des peuples.
Dans cette défense ambitieuse des vertus du nationalisme, Yoram Hazony prend pour cible la « construction libérale émergente » qui, d’après lui, s’oppose à l’idée que les nations devraient avoir leurs « propres lois, traditions et politiques ». Hazony pense que l’élite mondiale est indûment biaisée contre le nationalisme. Selon lui, les différences et spécificités nationales sont considérées avec dédain par cette élite qui n’y voit que nuisance, et dont le cosmopolitisme auto-centrique reflète le mépris des habitudes et des affections du localisme et, partant, le manque de compréhension de l’histoire et des peuples.
Si l’auteur des Virtues of Nationalism a raison d’être exaspéré par l’hypocrisie des élites contemporaines, il déforme également l’histoire européenne afin de rallier le lecteur à sa propre conception du nationalisme. Et il donne à ce concept de nationalisme une définition étroite et originale, que nous pourrions appeler le pluralisme. Son argument, pour l’essentiel, est qu’un monde de nations est un monde où chaque nation reconnaît aux autres nations le droit à la différence. Hélas, nous savons que cela n’a pas toujours été le cas : lorsque le principe de la nationalité occupe une place centrale, il a tendance à ne tolérer aucun autre idéal. Le nationalisme a tendance à devenir une obsession pour ses partisans et à revendiquer le monopole du bien dans la sphère publique.
 |
Alberto Mingardi est Directeur Général du think-tank italien, Istituo Bruno Leoni. Il est aussi Maître de Conférences en Histoire de la pensée politique à l’Université IULM de Milan et chercheur associé (Presidential scholar) en Théorie politique à Chapman University. Il est également contributeur associé au Cato Institute. Son dernier ouvrage est La verità, vi prego, sul neoliberism (Venezia, Marsilio, janvier 2019). |
Israélien, Hazony est un homme qui assume sa situation, et parfois fièrement. Il est manifestement frustré par « les efforts internationaux visant à discréditer Israël, à l’acculer, à le délégitimer et à le chasser de la famille des nations ». Sa loyauté nationale imprègne le livre et, bien que son sentiment d’appartenance soit louable, cela le conduit à argumenter de façon si partisane qu’il en est parfois illogique.
Hazony considère le libéralisme comme une approche internationale de la politique, une approche qui, selon lui, utilise des artifices comme l’idée d’une nature humaine universelle pour favoriser un gouvernement supranational. Ce dernier peut être considéré comme anti-démocratique : la démocratie exige que les personnes parlent une même langue ; un héritage durable du nationalisme. Ce n’est pas par hasard si le droit de vote universel est étranger aux agences internationales : ce sont au mieux des technocraties, dont l’action reflète l’idéologie d’une infime minorité plutôt que la sagesse du peuple tout entier. Hazony défend ainsi le nationalisme en tant que vaste vision du monde politique à laquelle adhèrent désormais Israël, l’Angleterre et les États-Unis, contrairement à l’ONU ou à l’Union européenne.
Une telle description du grand jeu du pouvoir tel qu’il se jouerait dans notre monde contemporain – un jeu qui opposerait les partisans et supporters d’organismes internationaux aux champions des nations – permet-elle de mieux comprendre l’histoire européenne dans son ensemble ? Les vertus du nationalisme essaie précisément de défendre cette idée. Pour Hazony, l’avènement du protestantisme en Europe au XVIe siècle a permis la création de « laboratoires nationaux pour le développement et la vérification des institutions et des libertés que nous associons maintenant à l’Occident ». Pour lui le pluralisme institutionnel et l’absence d’un pouvoir central qui aplanit sont les fruits du traité de Westphalie plutôt qu’une caractéristique de l’histoire européenne qui serait présente sur ce continent depuis au moins la chute de l’Empire romain.
Cela l’empêche de voir à quel point l’Europe était effectivement pluraliste au Moyen Âge. L’un des défauts de l’ouvrage de Hazony est qu’il ne considère les idées qu’à leur valeur brute. Il est vrai que l’Église catholique aspirait à être universelle. Mais c’est précisément cette prétention à l’universalité qui l’a conduite à s’opposer au pouvoir politique dans la querelle des investitures, et c’est à travers de telles luttes entre papes et empereurs que liberté et pluralisme ont été rendus possibles. En agissant de la sorte, en affaiblissant chacun les prétentions hégémoniques de l’autre, l’Église et l’Empire ont ouvert la voie à une multitude de villes autonomes à travers l’Europe.
Au lieu de cela, pour Hazony l’histoire de l’Europe devient « la longue lutte de nations telles que l’Angleterre, les Pays-Bas et la France pour se libérer des prétentions à un empire universel des Habsbourg allemands et espagnols (Le ‘Saint Empire Romain’) ». Cette histoire n’est guère convaincante. Oublions un instant que l’Angleterre et les Pays-Bas ont été, pendant plus de quatre siècles, de grands empires coloniaux eux-mêmes. L’histoire européenne peut-elle vraiment être perçue comme une lutte entre l’Angleterre et la France, d’une part, et l’Allemagne et l’Autriche, de l’autre ?
L’Angleterre était en guerre de façon intermittente avec la France du 13ème au 19ème siècle. En revanche, l’actuelle dynastie anglaise portait jadis le nom des « Hanovre ». L’union personnelle du royaume de Hanovre et du Royaume-Uni ne prend fin qu’en 1837, avec l’accession au trône de la reine Victoria. Et le mari de Victoria était allemand, le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha. La Grande-Bretagne et l’Autriche-Hongrie étaient des alliés dans la première moitié du 19ème siècle et plus tard, bien sûr, dans leur résistance contre la France et Napoléon.
L’histoire de l’Europe n’a pas commencé avec la Première Guerre mondiale. Et même si tel était le cas, cela pourrait difficilement déboucher sur un argument en faveur du nationalisme, et de ses prétendues vertus en tant que vecteur de tolérance et de coexistence pacifique.
Mais Hazony a un point de vue différent. On ne peut qu’admirer ses acrobaties intellectuelles. Il dissocie nationalisme et « national-socialisme ». Pour lui, « Hitler n’était pas un partisan du nationalisme », car le Führer voyait dans l’État national « un stratagème artificiel des anglais et des français ». Au lieu de cela, Hitler aspirait à sa propre version du Saint Empire Romain Germanique. « L’extermination par les nazis des Juifs en Pologne, en Russie, dans le reste de l’Europe et en Afrique du Nord n’était pas une politique nationale mais une politique globale… Elle n’aurait pu être conçue ou tentée en dehors du contexte des efforts de Hitler visant à raviver et à perfectionner les vieilles aspirations allemandes à un empire universel ».
Pour voir à quel point ce raisonnement est regrettable, il suffit de se souvenir de la célèbre devise nazie : « Ein Volk, ein Reich, ein Führer ». Le Volk ne devait pas être limité par les frontières de l’Allemagne telles qu’elles étaient ressorties de la Première Guerre mondiale, mais devrait revendiquer la place qui lui revient sur la scène mondiale. La nation devait donc créer l’État. Ce n’est là rien d’autre que le noyau du nationalisme, même si s’y ajoutent des nuances raciales distinctes.
Logiquement et historiquement, l’alternative aux États-nations n’est pas un empire national (ou super-État), mais plutôt un gouvernement dont le pouvoir ne tient pas sa légitimité du fait de gouverner une nation précise. Ce fut effectivement le cas avec l’ancien ordre composé d’empires multinationaux. Quoi qu’ Hitler ait voulu construire, ce n’était clairement pas un État multinational ou supranational.
Le Volk façonne le nouvel ordre politique ; il commande son homogénéité. L’adoption d’un seul point de vue, celui de « la nation », est ce qui définit le nationalisme. La tendance au nivellement et à l’homogénéisation est donc beaucoup plus forte dans le cas de l’Allemagne que dans le cas d’empires multinationaux tels que l’Autriche-Hongrie, qui comptait onze langues officielles. Ne serait-ce qu’à cause de sa taille, un tel empire a besoin d’une certaine tolérance vis-à-vis des différentes ethnies, religions et cultures. La quête d’une communauté homogène est précisément ce qui a rendu le nationalisme si attrayant dans les systèmes démocratiques — et c’est peut-être le moteur de sa renaissance dans nos sociétés multiculturelles.
Le livre de Hazony devrait être comparé au superbe travail d’Elie Kedourie sur le même sujet (Nationalism, 1966). Hazony offre une définition classique de la nation, « un certain nombre de tribus ayant en commun une langue ou une religion et ayant par le passé agi ensemble pour assurer leur sécurité commune ou pour d’autres entreprises à large échelle ». Kedourie a souligné que « dans la doctrine nationaliste la langue, la race, la culture et parfois même la religion constituent des aspects différents de la même entité primordiale, la nation. »L’idée de nation ne se contente jamais d’un statut auxiliaire une fois entrée en politique. Elle guide un mouvement pour l’indépendance politique qui fait de cet objectif la fin ultime de tout engagement politique. Cet objectif devient alors la contrainte ultime de toute politique publique et, pour beaucoup, la fin qui justifie tous les moyens. « Bien-être de la nation » : combien sont morts en votre nom ?Pendant une grande partie de l’histoire humaine, différentes ethnies ont cohabité dans des instances politiques supranationales. Ils n’étaient peut-être pas pleinement satisfaits de cette vie commune, mais ils ne pensaient pas pour autant que le secret de la sérénité politique résidait dans la constitution d’une « nation » homogène. Pour Hazony, le libéralisme est ipso facto une forme d’internationalisme. Mais en est-il vraiment ainsi ? Pour les liberals « modernes », du type John Rawls, l’État national est un mal nécessaire car aucune autre organisation ne s’est montrée aussi efficace dans la redistribution de la richesse. Pour les libéraux « classiques », du type Milton Friedman, la confiance dans le commerce international va souvent de pair avec une préférence pour un gouvernement local de plus petite taille. Certains, comme les Ordo-libéraux allemands, tentent de « contenir » le gouvernement national dans des projets constitutionnels supranationaux tels que l’Union européenne (ou au moins une version de celui-ci). Mais il y a des divergences entre libéraux, y compris sur cette question.De fait, de nombreux libéraux pensaient qu’un État national relativement homogène formait le réceptacle idéal pour des institutions libres et démocratiques. Ils espéraient que des États nationaux seraient en fin de compte plus pacifiques que ne l’étaient les grands empires ; en tant que républiques, ils seraient affranchis des liens dynastiques qui ont si souvent conduit à des conflits européens. Tel était l’idée qui guidait Ludwig von Mises alors qu’il esquissait, dans Nation, State and the Economy (1917), les contours d’un « nationalisme libéral ou pacifique ». « L’État princier n’a pas de frontière naturelle… Continuer à acquérir de nouveaux territoires jusqu’à ce que l’on rencontre un adversaire plus fort ou de force égale—tel était l’objectif des rois. »Il est donc particulièrement ironique de lire chez Hazony, qui ne cesse par ailleurs de mentionner les dangers que le libéralisme véhicule « lorsqu’il est détaché de ses origines biblique et protestante », que Mises s’est fait l’avocat d’un gouvernement mondial dans son Liberalism, un manifeste datant de 1927. Mises et Hayek, insiste Hazony, « ont soutenu qu’une application cohérente du point de vue libéral conduirait à un État fédéral international sans frontières significatives entre les nations ».Mises est généralement si obstinément clair qu’il devrait être impossible de le comprendre de travers. Pourtant, Hazony fouille soigneusement à la recherche d’une citation qui lui permettrait de faire de l’économiste libertarien le champion d’un ordre néolibéral prétendument agressif. Il choisit une section de Liberalism dans laquelle Mises ne parle de « rien d’autre que l’acceptation inconditionnelle et sans réserve du libéralisme » envahissant le monde et créant ainsi les conditions de la paix mondiale. Le grand autrichien critiquait en fait dans ce passage l’organisation internationale de l’époque (la Société des Nations), appelant de ses vœux l’avènement d’un « état d’esprit » qui chercherait à faire triompher les droits individuels, non seulement dans son pays, mais aussi à l’étranger. Alors qu’il utilisait le mot « super-État », il discutait en réalité d’une sensibilité libérale capable de traverser les frontières nationales.Cela participait d’une tentative de la part de Mises pour esquisser « une politique étrangère libérale ». Cette partie de Liberalism est en fait une remarquable collection de critiques émises à l’encontre de politiques prétendument favorables à la paix mais qui pourraient se retourner contre elle (depuis la « standardisation de l’éducation » jusqu’à la création de « zones économiques »). En effet, Mises pense qu’ « un ordre mondial doit être établi dans lequel les nations et les groupes nationaux seront tellement satisfaits de leurs conditions de vie qu’ils ne se sentiront pas obligés de recourir à la solution désespérée de la guerre». Une telle attitude humanitaire, qui est effectivement partie de l’héritage libéral classique, était-on ne peut plus convaincante alors que l’on sortait de l’expérience désastreuse de la Première Guerre mondiale.
« L’acceptation inconditionnelle et sans réserve du libéralisme » était, pour Mises, un « état d’esprit » à atteindre par le développement et la persuasion culturelle, et non une stratégie à mettre en œuvre à la pointe du canon. La fraternité mondiale ne devait pas résulter d’un nivellement coercitif des cultures, pas plus qu’elle ne pouvait être obtenue en enfermant les gouvernements nationaux dans des contraintes légales assimilables à des camisoles de force. Elle émergera plutôt de la prospérité engendrée par les échanges. Telle était, bien avant l’opinion de Cobden, de Bright ou de Spencer – et faut-il rappeler ici qu’aucun d’entre eux n’était un fervent supporter de l’empire britannique. Ils se méfiaient tout autant du colonialisme et de l’impérialisme que de l’émergence du nationalisme.
Hazony juge cette idée de fraternité mondiale « dogmatique et utopique » puisqu’elle suppose « que les dernières vérités concernant le destin de l’humanité ont été découvertes depuis longtemps et qu’il ne reste plus qu’à trouver le moyen de les imposer. » Un tel jugement peut être rapproché en effet de la pensée de Mises, à cela près que ce dernier n’a jamais considéré que le fait d’être plus riche et de vivre plus longtemps est « la vérité finale concernant l’humanité » et que pour lui « imposer » ne peut signifier autre chose que permettre aux gens de trouver leur propre route pour sortir de la misère.
On peut convenir avec Hazony qu’il est naïf de croire que «la vie politique est gouvernée en grande partie ou exclusivement par les calculs d’individus consentants ». Mais en déduire, en partant de ce constat, que les gouvernements ne sont finalement que des familles élargies est le plus vieux stratagème des apologistes de l’interventionnisme. Le « paternalisme » s’accommode mal d’un gouvernement limité.
Toute la profession de foi de Hazony dans le nationalisme est fondée sur l’idée que « la loyauté mutuelle des individus les uns envers les autres est la plus puissante des forces actives dans le domaine politique ». Mais la loyauté mutuelle doit-elle se cristalliser dans la fidélité à un État-nation ? N’est-il pas vrai que certains d’entre nous se sentent vraiment loyaux envers leur église, leur famille, leur ville ou leur club de football plus qu’envers une notion abstraite appelée « nation » ?
Dans sa sympathie pour l’Angleterre et les États-Unis, le nationalisme de Hazony a des teintes libérales plus fortes qu’il ne le reconnaît lui-même. Il est difficile de ne pas sympathiser avec sa critique de l’hypocrisie de l’élite mondiale. Mais même s’il admet qu’il existe un « néo-nationalisme » qui marche sur les pas de Rousseau et des révolutionnaires français et « est connu pour sa tendance à l’absolutisme », son portrait à l’eau de rose du nationalisme n’en est pas pour autant convaincant. Il envisage un « ordre international des États-nations » fondé sur l’indépendance nationale et sur ce qu’il appelle « le minimum moral biblique pour un gouvernement légitime ». Dans la Bible, « le roi ou le souverain, afin de gouverner de droit », doit « se consacrer à la protection de ses citoyens dans leur vie, leur famille et leurs biens, à la justice devant les tribunaux, au maintien du sabbat et à la reconnaissance par tous du Dieu unique ». Dans le jargon moderne, le souverain doit assurer « les conditions minimales pour une vie de liberté personnelle et de dignité pour tous ».Hélas, ce « tous » est limité par les frontières de ce que la nation est : une tribu plus grande, qui est très souvent impitoyable envers ceux qui n’en font pas partie.