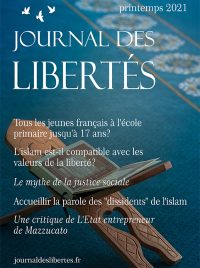Mariana Mazzucato est professeur en économie de l’innovation à l’Université du Sussex. Son best-seller, paru en 2013 aux États-Unis, vient d’être publié en français sous le titre : L’État entrepreneur : Pour en finir avec l’opposition public privé (Fayard, 2020)[1].
Sa thèse est abrupte : la politique industrielle est véritablement le facteur clé de l’innovation, pas le marché, et les entreprises à but lucratif ne font dans la plupart des cas que profiter des activités de recherche et développement financées par le gouvernement. Pour étayer sa thèse Mariana Mazzucato raconte de nombreuses histoires censées prouver l’efficacité de ces politiques et dépenses gouvernementales et force est de constater que cette rhétorique peut fonctionner sur des esprits peu critiques. De fait, le travail influent et primé de Mazzucato a été largement salué comme un tournant dans la recherche sur l’innovation. Martin Wolf (2013), par exemple, a fait valoir que le livre fournit une justification réussie du rôle du gouvernement dans la promotion de l’innovation qui, selon lui, avait été indûment « exclu de l’histoire ». En se basant sur L’État entrepreneur, Wolf en arrive à la conclusion que notre « incapacité à reconnaître le rôle du gouvernement dans la promotion de l’innovation pourrait bien être la plus grande menace pour une prospérité croissante ».

Nous devons confesser ne pas avoir succombé à la rhétorique proposée. Les preuves avancées par Mazzucato sont en fait extrêmement fragiles et sa thèse en faveur des politiques industrielles ne résiste pas à un examen sérieux. Une chose nous paraît claire cependant : l’auteur de l’État entrepreneur n’a pas compris grand-chose au rôle que jouent les entrepreneurs mais aussi les consommateurs dans les processus marchands.
Ce que l’on devrait au gouvernement (selon Mazzucato)
La thèse de Mazzucato n’est pas nouvelle. En 2012 le président Obama avait eu une formule sévère pour les entreprises privées : « Vous n’avez pas construit cela ! ». Mazzucato entend reprendre le flambeau et fournir au passage des munitions nouvelles pour combattre les partisans de l’austérité fiscale. Elle soutient en effet qu’il n’est pas nécessaire de réduire les dépenses publiques ; que la vision communément admise de la crise européenne comme une crise budgétaire est fondamentalement une construction d’idéologues intéressés à promouvoir l’image d’un gouvernement qui serait « lourd et à peine capable de corriger les ‘défaillances du marché’ » (Mazzucato 2013 : 6). Dans la même veine, elle déplore que l’on mette trop l’accent sur les échecs gouvernementaux, et que l’on oublie trop vite que l’intervention de l’État peut être motivée par des « visions » et des « ambitions » susceptibles de favoriser une économie plus innovante.
Pour construire un argument solide, Mazzucato doit donc prouver deux choses: premièrement, qu’il existe un trésor d’exemples montrant que l’intervention gouvernementale est omniprésente dans l’histoire du capitalisme moderne (un point qui ne sera pas controversé) ; et deuxièmement, qu’un type particulier d’intervention gouvernementale — la politique industrielle — a bien été efficace pour favoriser l’innovation. Pour elle ce second point ne fait aucun doute :
« la plupart des innovations radicales et révolutionnaires qui ont alimenté la dynamique du capitalisme — des chemins de fer à internet en passant par les nanotechnologies et les produits pharmaceutiques modernes, émanaient d’investissements “entrepreneuriaux” précoces et à forte intensité capitalistique initiés par l’État. »
Mais les exemples servis par l’auteur ont-ils quelque valeur ? La référence aux chemins de fer est tout particulièrement étonnante et parfaitement emblématique de sa démarche. Car si les grands projets contemporains, tels que les trains à grande vitesse, sont en effet financés par le gouvernement, les chemins de fer en tant qu’ « innovation » — ou plutôt quand il s’agissait d’innovation — étaient en grande partie la création du secteur privé. Ce n’est que plus tard que les chemins de fer, en Italie, aux États-Unis et en Angleterre où ils ont été initialement introduits, ont été nationalisés. Le gouvernement n’a pas été l’un des premiers investisseurs dans les compagnies de chemin de fer.
Il est intéressant de noter au passage que l’auteur puise bon nombre de ses exemples dans le 20ème siècle. Or, au cours de ce 20ème siècle, les dépenses publiques ont augmenté à un rythme vertigineux (passant d’environ 10% du PIB à plus de 40% dans pratiquement toutes les démocraties occidentales) à tel point qu’il eut été surprenant que cela ne débouche pas en chemin sur quelques projets innovants. Mais qu’en est-il du 19ème siècle ? L’industrialisation n’a t-elle pas été alimentée par des innovations et des découvertes et cela en l’absence de tout investissement public en R&D substantiel ? La vérité est que la révolution industrielle s’est d’abord installée en Grande-Bretagne, une région dans laquelle les dépenses publiques étaient essentiellement centrées sur la défense nationale et sur le service de la dette contractée pour mener des guerres (Hartwell 1981). Comme le note Mokyr (1999 : 46) :
« Une politique gouvernementale visant délibérément à promouvoir une croissance économique à long terme serait difficile à documenter en Grande-Bretagne avant et pendant la révolution industrielle… En Grande-Bretagne, le secteur public a renoncé à toute activité entrepreneuriale…»
Pour en revenir aux exemples fournis par Mazzucato, l’essentiel se trouve dans les quatrième et cinquième chapitres de son livre respectivement intitulés « The U.S. Entrepreneurial State » et « The State Behind the iPhone ». Elle y présente quatre supposées réussites gouvernementales : la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), le programme Small Business Innovation Research (SBIR), la réglementation des médicaments orphelins et les nanotechnologies. Ce que ces exemples partagent, selon Mazzucato, c’est une approche proactive de l’État pour façonner un marché afin de stimuler l’innovation (Mazzucato 2013: 73). Son idée est que les agences gouvernementales auraient envisagé l’innovation, puis l’auraient poursuivie. Les entreprises privées se seraient alors contentés, au mieux, d’attraper les fruits qui avaient été, grâce à l’action éclairée de l’État, placées à portée de leurs mains. Il suffit de revenir sur quelques-uns de ces exemples pour montrer que la thèse de Mazzucato ne tient pas la route.
L’invention d’Internet
Il est vrai qu’après la Seconde Guerre mondiale la recherche fondamentale aux États-Unis a été largement nationalisée. À cet égard, la DARPA a non seulement financé la recherche, elle a également « financé la création de départements d’informatique, fourni aux entreprises en démarrage un soutien à la recherche précoce, contribué à la recherche sur les semi-conducteurs et à la recherche sur l’interface homme-ordinateur, et supervisé les premières étapes de l’Internet » (Mazzucato 2013: 76). Mazzucato voit ainsi en la DARPA un modèle d’efficacité ; une « structure dynamique et flexible. . . [augmentant] le flux de connaissances entre les groupes de recherche concurrents,. . . [avec] les agents de la DARPA engagés dans le courtage commercial et technologique » (Mazzucato 2013: 77). Mais comment ces succès remarquables qu’elle évoque ont-ils été obtenus ? Mazzucato est plutôt parcimonieuse avec les détails administratifs et organisationnels et n’explique pas quels étaient les critères d’allocation des subventions, ni en quoi consistait concrètement l’aide apportée par la DARPA, ni la façon dont les agences publiques étaient organisées. Elle voudrait nous convaincre que « la clé est que le gouvernement de l’État entrepreneurial joue le rôle de chef de file » (Mazzucato 2013: 79), mais cela est déclaré plutôt qu’expliqué.
L’argument principal en faveur d’une telle déclaration semble résider dans l ’« invention » de l’Internet par la DARPA. La question clé, ici, réside dans l’intentionnalité derrière ces innovations : Le gouvernement a-t-il exercé en l’espèce le rôle de « directionnalité (choisir les domaines du changement, plutôt que simplement le ‘faciliter’) » que Mazzucato lui attribue (Mazzucato 2014: 4) ? Le gouvernement américain a-t-il jamais envisagé quelque chose de comparable à ce qu’est devenu l’Internet commercial ? Et si non, n’est-ce pas une grossière erreur que de faire de l’Internet la réussite d’une « politique industrielle » ? Voyons ce qu’il en est.
L’idée fondamentale derrière Internet, le « packet switching », a été développée par deux chercheurs du MIT, Joseph Carl Robnett Licklider et Leonard Kleinrock, qui ont finalement travaillé sur ARPANET, le réseau qui est devenu la base d’Internet. Avec le recul, peut-être que la DARPA avait choisi les bonnes personnes pour le poste. Mais il convient également de rappeler que le routeur TCI / IP a été développé (pour ARPANET) par une entreprise privée, Cisco, tandis que les fibres optiques qui ont permis à Internet d’atteindre des millions de maisons ont été développées par Corning Glass Works, une autre entreprise privée. Ainsi que le note l’historien Price Fishback, « personne ne peut nier les vastes répercussions des activités à motivation militaire » dans le développement d’Internet. Et il poursuit en notant que : « le rôle de l’armée était clairement suffisant pour développer les premières technologies, mais ce n’était sans doute pas nécessaire. Le mérite de ces technologies devrait aller aux personnes qui effectuent la recherche ». La question pertinente est donc de savoir si le développement d’Internet a eu lieu grâce à une certaine « directionnalité axée sur la mission » de la part du gouvernement, ou s’il vaut mieux le considérer comme une simple externalité positive de l’intervention publique. Toujours selon Fishback, le financement militaire a contribué aux retombées positives du développement de l’Internet commercial en n’essayant pas de contrôler étroitement les projets, en encourageant une large diffusion des résultats de la recherche et en finançant de petites entreprises. Cela suggère qu’il y avait bien peu de « directionnalité » derrière la création d’Internet.
En discutant de la DARPA, Mazzucato parle d’une « forme décentralisée de politique industrielle » (Mazzucato 2013: 78). Mais ce n’est là qu’un oxymore déguisé en innovation terminologique : en réalité, une politique gouvernementale relèvera soit de la « politique industrielle », soit elle sera décentralisée, mais elle ne peut relever des deux à la fois. Même si nous adoptons une définition très vague de la politique industrielle, nous devons convenir que nous n’avons de politique industrielle que lorsque « le gouvernement tente délibérément de promouvoir l’industrie » (Robinson 2009). Bien sûr, il est possible que, comme pour toute autre action humaine, une certaine politique puisse avoir des conséquences imprévues et néanmoins positives. Cependant, ces conséquences involontaires ne sont que cela : involontaires. Et lorsque Mazzucato croit une fois encore déceler la « directionnalité axée sur la mission » derrière ces innovations, elle confond en fait les conséquences involontaires, ou produits inattendus, avec les conséquences voulues, recherchées.
Le financement des start-ups
Un autre exemple que Mazzucato nous propose pour démontrer l’efficacité de la « politique industrielle décentralisée » dans un État entrepreneurial est celui du programme SBIR (Small Business Innovation Research). Lancé sous la présidence Reagan, le SBIR fournit aujourd’hui « plus de 2 milliards de dollars par an en soutien direct aux entreprises de haute technologie » (Mazzucato 2013: 80). Il peut être considéré comme un apport de capital-risque financé par les contribuables (Wallstein 2001), quoique d’une manière très particulière : le gouvernement fédéral exige simplement que toutes les agences gouvernementales disposant d’un budget de R&D supérieur à 100 millions de dollars (y compris l’armée) dépensent 2,8% de leur budget à la promotion de l’innovation par les petites et moyennes entreprises. L’idée que SBIR ait joué un « rôle unique » et « ait favorisé le développement de nouvelles entreprises et guidé la commercialisation de centaines de nouvelles technologies » (Mazzucato 2013: 80) est quelque chose que les lecteurs de Mazzucato doivent — cela devient rapidement une habitude à la lecture de cet ouvrage — prendre comme un acte de foi. L’État entrepreneurial n’offre pas un seul exemple d’une nouvelle technologie qui a été développée grâce à une subvention SBIR. En outre, il est difficile de comprendre comment le programme SBIR peut correspondre à une définition raisonnable de la politique industrielle : exiger des agences fédérales dotées de budgets de R&D supérieurs à 100 millions de dollars qu’elles dépensent une partie de cet argent sur les PME ne signale pas « une directionnalité axée sur la mission ». En fait, cela ne représente guère plus que l’obligation pour certains organismes publics de signer des chèques.
L’iPhone
Si Mazzucato réprouve le court-termisme du secteur privé, elle semble par ailleurs convaincue que les décideurs qui allouent des ressources pour et au sein du gouvernement sont uniformément intelligents et clairvoyants. Mais une fois encore, il est difficile d’éviter l’impression qu’il s’agit chez cet auteur d’une hypermétropie, qui consiste à voir dans l’action gouvernementale la cause d’événements bénéfiques, même lorsque ces derniers n’étaient pas voulus par le gouvernement au départ. Un exemple clair de cela est fourni par le chapitre dans lequel Mazzucato tente de nous convaincre que l’iPhone est le produit d’une intervention du gouvernement américain. Pour montrer à quel point les appareils à écran tactile sont quelque chose que nous devons à la politique industrielle, Mazzucato souligne que c’est un financement gouvernemental qui a permis à un jeune doctorant de l’Université du Delaware, Wayne Westerman, de terminer son diplôme et de co-fonder FingerWorks ; une entreprise qui allait « révolutionner l’industrie des appareils électroniques mobiles qui pèse plusieurs milliards de dollars » (Mazzucato 2013: 103). Mais peut-on sérieusement affirmer que si quelqu’un à un moment donné transforme sa propre thèse de doctorat en une fantastique idée entrepreneuriale, il est légitime de voir en cette dernière le fruit d’une politique industrielle ? Peut-on qualifier de politique industrielle le fait que l’université où Wayne Westerman a fait ses études soit subventionnée par le gouvernement et que son doctorat était en partie financé par une bourse de la National Science Foundation — comme celui de quelques 2 000 doctorants chaque année ?
Les médicaments orphelins
Une autre flèche dans le carquois de Mazzucato est supposée être la loi de 1983 sur les médicaments orphelins ; loi qui a permis aux petites sociétés pharmaceutiques et aux sociétés de biotechnologie « d’améliorer leurs plateformes technologiques et d’intensifier leurs opérations, leur permettant ainsi de devenir des acteurs majeurs de l’industrie biopharmaceutique ». (Mazzucato 2013: 81). L’idée qui a inspiré la loi sur les médicaments orphelins est que, dans des circonstances normales, il ne serait pas rentable pour une entreprise de dépenser des centaines de millions ou des milliards de dollars pour développer, tester et faire homologuer un médicament destiné à traiter des pathologies qui frappent une population de patients de moins de 200 000 personnes. Par conséquent, le gouvernement offre un éventail d ‘« incitations » pour pallier une défaillance du marché qu’il a lui-même cru identifier. (Cette idée n’a pas été appliquée aux États-Unis seulement : des législations sur les médicaments orphelins se retrouvent dans d’autres pays comme dans l’Union européenne depuis 1999.). Ce qu’il est intéressant de noter ici est que l’une des réussites présentées par Mazzucato pour étayer sa thèse — la loi sur les médicaments orphelins — est précisément un cas où, très clairement, le gouvernement tente de pallier une défaillance du marché. Nous sommes donc bien loin une fois encore du champ de la politique industrielle.
Une méconnaissance de l’entrepreneur
Le travail de Mazzucato peut être compris comme une tentative pour résoudre la grande énigme de l’économie capitaliste moderne : d’où vient l’innovation ? Pour elle, nous l’avons compris, la réponse est simple : l’énorme succès de l’innovation moderne s’explique par l’investissement du gouvernement dans la R&D de nouvelles technologies. Pour étayer sa thèse elle repart d’un article de Freeman (1995) qui compare les expériences du Japon et des États-Unis dans les années 70 et 80. Pour elle, la montée en puissance économique du Japon s’explique « par les nouvelles connaissances circulant à travers une structure économique plus horizontale, composée du Ministère du commerce international et de l’industrie (MITI), du monde universitaire et de la R&D des entreprises » (Mazzucato 2013 : 37). Bien que Mazzucato reconnaisse que, le Japon, contrairement par exemple à l’Union soviétique, « avait de solides liens utilisateurs-producteurs » (Mazzucato 2013: 37), l’existence d’entreprises privées à la recherche de profits et de parts de marché ne semble être rien de plus qu’un détail non pertinent. Une plus grande attention aux détails lui aurait pourtant permis de noter que, jusqu’en 1991, le gouvernement japonais « finançait moins de 20% de sa R&D et, remarquablement, moins de la moitié de la science universitaire de son pays — une exception extraordinaire au gouvernement moyen de l’OCDE, qui finançait environ 50 pour cent de sa R&D et 85 pour cent de la science universitaire de son pays » (Kealey 2008 : 287).
Dans sa perspective, le secteur privé reconditionne — dans le meilleur des cas — et commercialise des innovations précédemment développées par le gouvernement. C’est ainsi qu’elle comprend l’activité de Apple, et aussi la raison principale pour laquelle elle préconise une augmentation des impôts sur les sociétés : afin que l’entreprise privée puisse « rendre » ce qu’elle a obtenu grâce à l’intervention du gouvernement. Ce qui est le plus frappant, cependant, c’est que Mazzucato considère apparemment ce « dernier kilomètre » dans le parcours d’une innovation comme extrêmement banal.
Prêter, comme elle le fait, à l’État le rôle moteur de l’innovation c’est ignorer le personnage de l’entrepreneur et confondre progrès technique et innovation. Pour reprendre Kirzner, la « propension à la découverte et à l’innovation entrepreneuriale » trouve un terrain fertile dans une économie de marché. L’entrepreneur découvre de nouveaux produits et de nouvelles procédures à travers les informations qu’il reçoit sur les besoins des clients potentiels. Dans une économie de marché, l’entreprise privée ordonne les facteurs de production pour les mettre en cohérence avec ses anticipations concernant la demande des consommateurs. F. A. Hayek a dit un jour que « comparé au travail de l’ingénieur, celui du marchand est en un sens beaucoup plus “social” c’est-à-dire lié aux activités libres d’autrui ». Mais Mazzucato ignore le consommateur, les besoins personnels et la nature même de l’échange marchand qui est de connaître les besoins des autres pour satisfaire les siens propres. La demande n’entre pas en compte dans son analyse.
Ce qu’elle ne voit pas c’est que le rôle de l’entrepreneur n’est pas de créer de nouvelles inventions mais d’anticiper et de répondre aux demandes des consommateurs. Les innovations, quant à elles, sont utiles uniquement en raison des besoins et des désirs qu’elles peuvent satisfaire. Le gouvernement est généralement un mauvais entrepreneur, non pas parce que certains économistes ou philosophes politiques jugent qu’il en est ainsi, mais parce que les conditions dans lesquelles il opère sont radicalement différentes de celles auxquelles sont confrontés les entrepreneurs privés. Les économies de marché sont dynamiques car elles doivent l’être pour survivre. En comparaison, les économies dirigées par l’État — ce que l’économiste lauréat du prix Nobel Edmund Phelps (2013 : 127) appelle les « économies sociales » — « manquent cruellement de dynamisme ».
La politique industrielle : le public fait mieux que le privé ?
Parfois, Mazzucato semble être concernée par un problème légèrement différent — et peut-être plus grave — celui de la prétendue stagnation de l’innovation que nous traverserions. Pour elle, « la recherche fondamentale et appliquée à long terme ne fait plus partie de la stratégie des “grandes entreprises” » (Mazzucato 2013 : 178). Par contre, le secteur public serait en mesure d’identifier les « gagnants », grâce à des « écosystèmes collaboratifs » privilégiant les technologies « propres ». Et elle s’empresse de préciser que l’on néglige trop le fait que bien souvent lorsque l’État échoue dans ses investissements c’est parce qu’il essayait de faire quelque chose de beaucoup plus difficile que ce que font de nombreuses entreprises privées : soit essayer de prolonger la période de gloire d’une industrie mature (l’expérience Concorde ou le projet américain Supersonic Transport), ou s’activer pour lancer un nouveau secteur technologique (Internet ou la révolution informatique) [Mazzucato 2013: 18].
Une fois encore elle illustre sa thèse avec un argument en apparence convaincant. Elle compare le sort de deux entreprises, toutes deux spécialisées dans l’énergie solaire. L’une est américaine, Solyndra, et en dépit des subventions reçues elle fera faillite et disparaîtra. L’autre, Suntech, est chinoise et sera sauvée parce que le gouvernement va la nationaliser. Si de nombreux commentateurs ont vu dans la faillite de Solyndra une démonstration spectaculaire de l’incapacité du gouvernement à faire des investissements complexes dans les nouvelles technologies en « choisissant les gagnants » — en d’autres termes, un échec lamentable de la politique industrielle (Jenkins 2011, Taylor et Van Doren 2011), Mazzucato n’est pas du tout de cet avis. Elle est convaincue que la faute incombe aux rats qui quittent le navire en train de couler ; « lorsque le monde des affaires [perd] patience ou tolérance au risque » (Mazzucato 2013 : 130).
Dans l’histoire telle que la perçoit Mazzucato, les investisseurs impatients sont les vilains épouvantails et le héros n’est autre que le gouvernement chinois qui a nationalisé les actifs de Suntech afin de « protéger les intérêts de milliers de travailleurs, les banques publiques soutenant l’entreprise et l’État » (Mazzucato 2013 : 154). Ici, pour une fois, Mazzucato évoque bien quelque chose que nous pouvons reconnaître sans ambiguïté comme une politique industrielle. Une politique qui pèse sur la façon dont les facteurs de production sont employés aujourd’hui parce que ses instigateurs sont convaincus que c’est bien là la meilleure allocation possible des ressources et que l’on peut ainsi éviter la réallocation traumatisante qui fait suite à une faillite.
C’est finalement la raison pour laquelle Mazzucato affirme que le gouvernement peut « créer de nouveaux produits et de nouveaux marchés ». Il est vrai, en effet, que le gouvernement peut rester sur place, quel que soit le rendement des investissements qu’il a engagés. Mais n’y a-t-il pas un prix à payer pour cela ? De toute évidence, si le gouvernement soutient une certaine innovation ou une certaine entreprise, il ne pourra pas utiliser ces ressources pour soutenir d’autres activités ou entreprises — pas plus que le secteur privé, d’où proviennent les ressources du gouvernement, ne sera en mesure de le faire. Les arguments de Mazzucato flottent ainsi dans une atmosphère raréfiée où les investisseurs privés gèrent la rareté de manière imparfaite, tandis que le gouvernement ne se soucie pas du tout de la rareté. Une autre raison pour laquelle l’État entrepreneur de Mazzucato n’a rien d’entrepreneurial.
Bien sûr, il est possible que les investisseurs privés allouent mal leurs ressources, mais une mauvaise allocation privée a l’avantage évident pour la société d’être privée. Au contraire, les ressources gouvernementales sont retirées de la poche de tout le monde. Or Mazzucato ne tient même pas compte de ce simple fait. Elle déplore par contre que « seuls les actionnaires d’Apple sont autorisés à bénéficier financièrement du succès récent et actuel de la société » (Mazzucato 2013 : 171). Si le gouvernement est réellement derrière tant d’innovations qui ne sont finalement que mises sur le marché par des entreprises privées, n’est-il pas intolérable, pense Mazzucato, que ces entreprises ne rêvent que de cieux où la fiscalité leur est plus favorable et où elles n’ont pas à « reverser » aux autorités les ressources qui pourraient pourtant alimenter la R&D gouvernementale et enclencher de la sorte un cercle vertueux ? C’est pourquoi Mazzucato propose un ensemble de mesures qui ne nous est que trop familier : investissements directs du gouvernement dans des entreprises innovantes, rôle plus important pour les banques gouvernementales et une « part en or » réservée au gouvernement sur les brevets (privés) issus de la recherche financée par le secteur public.
Et Mazzucato d’en conclure (2013 : 156),
« L’un des plus grands défis pour l’avenir, à la fois dans les technologies propres et dans toutes les technologies qui les suivent, sera de s’assurer qu’en construisant des écosystèmes collaboratifs, nous ne socialisons pas seulement les risques mais aussi les récompenses. Ce n’est qu’ainsi que le cycle de l’innovation sera durable dans le temps, tant sur le plan économique que politique. »
Mazzucato n’accorde, on le voit, que peu d’attention à l’impact que les taxes nécessaires pour soutenir ces « écosystèmes collaboratifs » pourraient avoir sur les entreprises privées et sur la demande des consommateurs. Pourtant, les taxes sont un coût de production pour les entreprises. Comment croire que le prix d’un bien est à ce point déconnecté des coûts de production ? Et s’il ne l’est pas alors des taxes plus élevées peuvent éventuellement donner des prix plus élevés pour les consommateurs, ce qui se traduira par une demande plus faible et donc une innovation privée moins stimulée. Par ailleurs, est-il réaliste d’imaginer que les entreprises privées continueront de jouer leur rôle central dans l’innovation, alors même que leurs bénéfices sont écrasés par des impôts plus élevés ?
Mazzucato n’aborde pas ces problèmes car elle est persuadée que les coûts que ses propositions ne manqueraient pas d’engendrer sont faibles comparés aux coûts que devra subir une société dépourvue d’une infrastructure gouvernementale de R&D appropriée. Cette affirmation est aussi pratique qu’elle est floue et Mazzucato ne tente à aucun moment de quantifier le coût social qui serait engendré par une quelconque carence en R&D gouvernementale. En ce sens, Mazzucato appartient bien à ces intellectuels qui, pour citer McCloskey (2014 : 77), ne croient jamais nécessaire d’apporter la preuve que « l’intervention de l’État proposée fonctionnera comme elle est censée le faire ».
Conclusion
Mazzucato n’explique pas vraiment comment la bureaucratie gouvernementale serait en mesure de donner à l’innovation une « direction axée sur des missions ». De plus, elle ne semble pas percevoir le chemin qui sépare l’innovation du simple progrès technologique. Le fait que les innovations doivent se matérialiser dans des « produits » qui seront mis à la disposition d’êtres humains fait de chair et d’os, ne semble pas particulièrement pertinent dans son argumentation.
Bien entendu, si nous pouvions payer pour tous les projets de recherche possibles et imaginables, cela conduirait bien, à un moment ou à un autre, à certains résultats. Mais le Trésor public ne fonctionne pas comme le sac de Mary Poppins. La vraie question est précisément de savoir comment toutes ces dépenses s’intègreront-t-elles dans un monde de ressources rares et de compromis inévitables ? Dans un tel monde, les mornes jugements des investisseurs aident à distinguer les progrès technologiques qui promettent d’être utiles aux consommateurs, de ceux qui ne le sont pas et les consommateurs ne sont pas de simples sujets passifs : leurs choix indiquent la direction que doit prendre la production.
Comme ces guerriers sans cœur qui l’ont précédée, Mazzucato ignore tout cela ; elle ignore le fait que l’innovation n’est pas seulement une question de progrès technologique, mais plutôt relève de notre capacité à rendre la vie des gens meilleure et plus agréable. En fin de compte, l’État entrepreneurial de Mazzucato, malgré tout son zèle progressiste, semble fort mal adapté à cette tâche importante.
Références
Fishback, P. V. (2007) “Seeking Security in the Postwar Era.” In P. V. Fishback et al. (eds.) Government and the American Economy: A New History. Chicago: University of Chicago Press.
Hartwell, R. M. (1981) “Taxation in England during the Industrial Revolution.” Cato Journal 1 (1): 129–53.
Hayek, F. A. (1955) “Scientism and the Study of Society.” In The Counterrevolution of Science: Studies on the Abuse of Knowledge. New York: The Free Press.
Jenkins, H. W. Jr. (2001) “The Real Solyndra Scandal.” Wall Street Journal (29 September).
Kirzner, I. (2000) “The Ethics of Competition.” In The Driving Force of the Market: Essays in Austrian Economics, 88–102. London: Routledge.
McCloskey, D. N. (2014) “Measured, Unmeasured, Mismeasured, and Unjustified Pessimism: A Review Essay of Thomas Piketty’s Capital in the Twenty-First Century.” Erasmus Journal for Philosophy and Economics 7 (2): 73–115.
Mokyr, J. (1999) “Editor’s Introduction: The New Economic History and the Industrial Revolution.” In The British Industrial Revolution: An Economic Perspective. Boulder, Colo.: Westview Press.
Obama, B. (2012) “Remarks by the President at a Campaign Event in Roanoke, Virginia” (13 July). Available at https://bit.ly/3csVhDG
Phelps, E. (2013) Mass Flourishing: How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Robinson, J. A. (2009) “Industrial Policy and Development: A Political Economy Perspective.” Paper prepared for the Annual World Bank Conference on Development Economics. Available at : https://bit.ly/2P4f6by
Taylor, J., and Van Doren, P. (2011) “A Teachable Moment Courtesy of Solyndra.” Forbes.com (13 September).
Wallstein, S. (2001) “The Role of Government in Regional Technology Development: The Effects of Public Venture Capital and Science Park.” SIEPR Discussion Paper No. 00-39.
Wolf, M. (2013) “A Much-Maligned Engine of Innovation.” Financial Times (4 August).
[1] Cet article est basé sur un précédent travail publié au Cato Journal (Vol. 35, No. 3, Fall 2015) suite à la publication de l’ouvrage de Mariana Mazzucato : The Entrepreneurial State — Debunking Public vs. Private Myths in Risk and Innovation, London : Anthem Press (2013). Les références dans ce présent article renvoient à cet ouvrage de 2013 et non pas à la version française de 2020.