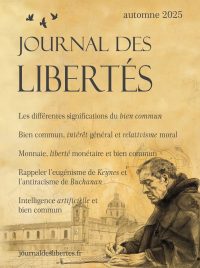Introduction
En 1984, lors d’une conférence en France, Margaret Thatcher, alors Premier ministre de Grande-Bretagne, a déclaré :
« Les pères fondateurs de la Communauté seraient horrifiés par le labyrinthe des réglementations bureaucratiques […] Horrifiés parce que le traité de Rome incarne la structure économique d’une société libre […] La première page parle d’un “marché intérieur caractérisé par l’abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux”. La Communauté a été créée pour développer les échanges et non pour protéger les marchés intérieurs. Elle a été conçue comme un organisme tourné vers l’extérieur, et non comme un organisme obsédé par les détails des procédures internes […]. L’Europe ne sera forte et capable de jouer le rôle qui lui revient dans le monde que lorsqu’elle atteindra la liberté économique qui était la vision des auteurs du traité de Rome ».

Thatcher a bien compris qu’une Europe économiquement et socialement prospère n’est possible que par la création d’une vaste zone de libre marché avec moins de bureaucratie et de réglementations. C’est ainsi que les gouvernements nationaux et les autorités de l’UE (Commission, Conseil, Parlement) se sont mis d’accord sur l’Acte unique, qui vise à réduire de manière significative les barrières non tarifaires au commerce intra-européen.
A l’occasion du quarantième anniversaire des propos inspirants de Thatcher, il convient de s’interroger sur le devenir de cette ambition de réaliser un espace européen de libre-échange et de libre concurrence des entreprises. Dans cet article, nous tentons de répondre à cette question sur deux fronts, en ayant à l’esprit la distinction entre régulations binaires et triangulaires. Dans la première catégorie – régulation binaire – deux parties sont impliquées, le régulateur d’une part et le régulé d’autre part, ce dernier subissant une limitation de sa liberté d’utiliser son capital humain et physique. Pour citer un exemple : l’autorité publique interdit aux particuliers d’installer des citernes à mazout, soi-disant pour limiter le réchauffement climatique. Dans la deuxième catégorie, trois parties ou plus sont impliquées. D’une part, l’autorité de régulation et, d’autre part, deux ou plusieurs parties impliquées dans une transaction commerciale, qu’il s’agisse d’une transaction entre le vendeur et l’acheteur d’un produit, ou entre le prestataire d’un service et son client.
Dans un premier temps, nous analyserons la réglementation des échanges de biens et de services et le choix entre la règle du pays d’origine, du pays de destination ou une règle imposée par les autorités européennes elles-mêmes. Ensuite, nous discuterons de l’impact des coûts de la réglementation européenne en nous référant aux expériences de la directive REACH et nous nous demanderons si les programmes de gestion de la réglementation (Regulation Management) sont efficaces pour limiter les coûts de la réglementation. Enfin, nous analyserons la montée des réglementations binaires en Europe et le piège des subventions lié à la soumission bureaucratique.
2. L’Europe et la réglementation commerciale : le principe de la règle du pays d’origine
Pour réaliser son ambition, l’Acte unique a fixé les objectifs suivants :
- Simplification des formalités douanières.
- Élimination ou équivalence des normes techniques par le biais d’une politique de normalisation.
- Équivalence des diplômes.
- Harmonisation de la TVA.
Cependant, au niveau du commerce international, la réalisation de ces objectifs se heurte encore à un obstacle juridique spécifique : lorsqu’un produit ou un service franchit une ou plusieurs frontières nationales, la question se pose de savoir à quelles exigences légales et réglementaires le produit ou le service doit se conformer ?
Pour répondre à cette question, il semble utile de rappeler une distinction importante basée sur l’origine et la nature des règles. D’une part, il y a les règles classiques du droit privé relatives à la formation des contrats, à la responsabilité contractuelle, aux motifs d’annulation des obligations contractuelles, etc. Comment choisir entre ces règles ? La tradition de droit privé a développé depuis des siècles des critères indiquant le régime à appliquer aux litiges relatifs aux transactions internationales. Cette tradition de droit international privé s’est développée à travers la jurisprudence, les traités internationaux (par exemple la Convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, la Convention des Nations unies de 2011 sur les contrats de vente internationale de marchandises) et les us et coutumes des commerçants (par exemple les Incoterms élaborés par la Chambre de commerce internationale). Ces règles sont généralement acceptées dans le commerce international et ne posent pas de problèmes pour leur application. Il s’agit en effet de règles « nomocratiques », pour reprendre le terme de Friedrich Hayek. Ce sont des règles qui n’imposent pas le choix de tel ou tel produit ou service, mais qui visent à mettre de l’ordre dans les transactions internationales et à minimiser les coûts de transaction.
Parallèlement à ces règles basées sur le droit privé, il existe une réglementation administrative par laquelle le gouvernement impose les produits qui peuvent être échangés, les services qui peuvent être fournis, les conditions de qualité auxquelles les produits et les services doivent répondre, etc. Alors que les règles de droit international privé organisent et facilitent le commerce international, les règles administratives le limitent. Pour justifier ces règles, les gouvernements invoquent des raisons très diverses, telles que la protection de la santé (notamment pour les denrées alimentaires), les garanties de sécurité (produits chimiques, risques d’incendie et d’explosion), la protection de l’environnement, les mesures visant à limiter les déchets et les emballages, la récupération des équipements usagés, etc. Beaucoup de ces règles sont antérieures à la mise en œuvre de l’Acte unique et ont un caractère purement national. Pour citer un exemple bien connu : le « Reinheitsgebot » allemand de 1516, qui stipule que les bières ne peuvent être brassées qu’avec de l’eau, de l’orge, du houblon et de la levure. Par conséquent, l’importation en Allemagne de bières non conformes au « Reinheitsgebot » était interdite. Dans deux affaires célèbres, la Cour européenne de justice a décidé que cette barrière au commerce international de la bière était une forme déguisée de protectionnisme et qu’elle était donc contraire aux principes du marché unique. Il s’agit des affaires Commission contre République fédérale d’Allemagne (affaire 178/84) et Brasserie du Pêcheur contre République fédérale d’Allemagne (affaires 46/93 et 48/93). Dans cette dernière affaire, la brasserie française réclamait des dommages-intérêts pour le manque à gagner causé par l’interdiction d’importation.
Étant donné que le produit ou le service passe par deux régimes réglementaires, celui du pays de production ou des pays dans lesquels le prestataire de services est établi, et celui du pays de destination, la question se pose de savoir quel régime réglementaire doit s’appliquer.
En ce qui concerne le commerce des marchandises, le traité de la Communauté économique européenne de 1957 a longtemps été interprété dans le sens de la règle du pays d’origine. Il suffisait que le produit soit conforme aux exigences réglementaires du pays dans lequel il était fabriqué. Ce principe a été confirmé par la Cour européenne de justice dans la célèbre affaire du Cassis de Dijon (affaire 120/78). L’Allemagne, le pays importateur, a fait valoir que la boisson ne contenait pas suffisamment d’alcool pour être considérée comme un spiritueux en Allemagne et qu’elle ne pouvait donc pas être importée. La Cour a décidé que la boisson répondait aux exigences réglementaires françaises, ce qui était suffisant pour qu’elle puisse être commercialisée dans tous les pays de la CEE. En principe, la règle du pays d’origine reste le principe directeur du marché intérieur européen des produits, mais ce principe souffre de nombreuses exceptions dues à l’évolution des réglementations des autorités européennes elles-mêmes.
Dans un projet de Directive, soumis par le commissaire européen Frits Bolkestein en 2004, il était proposé d’étendre le principe de la règle du pays d’origine aussi au secteur des services. Cela impliquait entre autres que le « plombier Polonais », exemple iconique dans ce cas, pouvait offrir ses services dans tous les pays-membres de l’Union européenne à condition qu’il soit qualifié selon les règles en vigueur en Pologne. Ce projet a fait l’objet d’une agitation massive de la part de la gauche et des syndicats. A en croire les agitateurs, le principe de la primauté du pays d’origine menaçait les acquis sociaux des pays les plus développés d’Europe, en l’occurrence les pays d’Europe occidentale. Les salariés des pays d’Europe centrale et orientale, moins protégés socialement et donc moins chers, feraient une concurrence déloyale à leurs collègues occidentaux. Le plombier polonais est devenu le symbole par excellence de ce danger.
L’agitation a porté ses fruits. Dans la directive finalement adoptée, un certain nombre de secteurs très importants seraient exclus du principe de la règle du pays d’origine. Il s’agit notamment de la radiodiffusion et de la télévision, des jeux de hasard, des agences pour l’emploi, des services juridiques et sociaux, des services postaux, de la santé publique et des transports publics. Cette longue liste d’exceptions est déplorable car le principe de la règle du pays d’origine est avant tout un avantage pour le producteur et le fournisseur, ce qui rend finalement l’ensemble du système économique plus efficace et plus avantageux pour les consommateurs. En effet, ce principe minimise les coûts d’information des agents économiques : les exportateurs de biens ou de services ne doivent consulter que le régime du pays dans lequel ils sont établis ; un régime qui est d’ailleurs celui qu’ils connaissent le mieux ayant souvent participé aux négociations préliminaires à l’établissement du règlement.
A l’opposé, le principe du pays de destination risque de multiplier les coûts d’information pour les producteurs et les fournisseurs. Si vous exportez vers plusieurs pays, ce qui n’est pas exceptionnel dans le marché intérieur européen, vous devez avoir connaissance de tous les régimes réglementaires concernés. En outre, les conditions réglementaires peuvent nécessiter une adaptation des produits. Ainsi, le principe du pays de destination risque fort de multiplier les coûts d’adaptation aux différents régimes réglementaires, voire à contraindre le producteur à développer plusieurs versions de son produit.
Outre les principes du pays d’origine et de destination, il existe également la possibilité d’une réglementation par les autorités européennes elles-mêmes. Cette solution, qui conduit à un système unique, réduit les coûts d’information et d’adaptation, mais présente d’autres inconvénients. Une norme unique pour toute l’Europe nécessite des négociations longues et ardues entre les pays et les secteurs. Cela profite sans doute au secteur immobilier à Bruxelles, qui loue beaucoup d’espace administratif aux lobbyistes qui gravitent autour des autorités politiques européennes. Pour les consommateurs, les résultats peuvent être désastreux car la distance entre l’autorité européenne et les sujets de la réglementation est si grande que le risque d’inefficacité et de manque d’adaptabilité aux circonstances particulières peut être considérable.
L’un des arguments souvent invoqués à l’encontre du principe de la règle du pays d’origine se réfère à ce que l’on appelle le « nivellement par le bas » (race to the bottom). Les pays exportateurs auraient intérêt à diluer les conditions réglementaires de leurs produits ou services exportés afin d’accroître leur potentiel concurrentiel sur les marchés internationaux. Étant donné que les consommateurs des pays importateurs souffrent d’une asymétrie d’information et connaissent mal la fiabilité des produits ou services étrangers, l’application radicale du principe de la règle du pays d’origine peut mettre en péril la santé et la sécurité des citoyens.
Cette critique peut être contestée par trois observations.
- Premièrement, si le pays exportateur est un grand pays (par exemple la France), il dispose d’un grand marché à l’intérieur duquel l’argument de l’asymétrie d’information a une moindre portée. Supposons en effet que la France néglige délibérément le contrôle de la sécurité alimentaire de quelques produits afin de conquérir les marchés internationaux ; les consommateurs français, qui connaissent mieux les produits en question, seront les premiers touchés, ce qui peut nuire à la réputation des autorités publiques et des entreprises concernées.
- Deuxièmement, l’absence de réglementation, qui entraîne de réels problèmes pour la santé et la sécurité des consommateurs, peut également être corrigée par les tribunaux sur la base des règles de droit privé. Même si le produit est conforme à toutes les exigences administratives du pays d’origine, mais qu’il peut effectivement nuire aux consommateurs, le juge peut considérer la vente du produit comme nulle et non avenue et condamner le vendeur-importateur à verser des dommages-intérêts.
- Troisièmement, les pays souhaitant devenir membres de l’UE doivent remplir de multiples conditions d’adhésion (par exemple, l’État de droit, le respect des droits de l’homme). L’UE a également toutes les cartes en main pour exiger des pays candidats qu’ils s’abstiennent de toute attitude « pirate » et qu’ils n’abusent pas du principe de la règle du pays d’origine en enfreignant les réglementations qui conduisent à une concurrence déloyale. Cette condition peut être renforcée par des sanctions telles que la suspension des subventions versées par l’UE.
Une adhérence générale au principe de la règle du pays d’origine aurait incarné la potentialité d’une création d’une zone authentique de commerce libre. Le principe exprime davantage une confiance mutuelle des états-membres de l’Union européenne. Finalement ce principe permet que la souveraineté du consommateur ne joue pas seulement sur les produits et les services mêmes mais aussi sur la réglementation, sous lesquelles les produits et les services sont soumis. Supposons que l’état-membre A et l’état-membre B introduisent un produit sur le marché européen et que la différence entre ces produits est due exclusivement à la réglementation auxquels ils sont soumis. Le jugement du consommateur porte dans ce cas sur l’efficacité de la réglementation. Ainsi le mécanisme du marché fonctionne non seulement come juge de produits et de services mais aussi comme juge des réglementations des pays d’origine. Graduellement cela contribuerait à une amélioration de la réglementations. Il s’agit dès lors de limiter autant que possible les exceptions au principe d’origine. Une belle mission pour le nouveau parlement Européen !
3. Règlementation par l’Europe : coûts excessifs et gestion difficile
La régulation par les autorités européennes elles-mêmes, soit par un règlement européen, soit par une directive européenne qui doit être transposée par des règles au niveau national, est une alternative à la règle du pays d’origine. Le risque inhérent à cette approche est que les autorités de Bruxelles négligent les contextes régionaux dans lesquels les entreprises européennes opèrent et que les entreprises disposant des moyens de lobbying les plus efficaces parviennent à faire imposer les règles qui leur conviennent le mieux, au détriment des petites et moyennes entreprises.
REACH (enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques), le règlement européen sur la fabrication et la transformation des substances chimiques, offre une parfaite illustration de coûts excessifs qu’une telle réglementation peut imposer aux PME. Étant donné que de nombreux coûts imposés par REACH sont fixes par nature, ils affectent de manière disproportionnée les PME, minant ainsi leur position concurrentielle. En 2013, le ministère néerlandais des infrastructures et de l’environnement a commandé un rapport sur l’impact de REACH sur les PME qui a révélé que ses coûts étaient de fait considérables :
| Type de coûts (annuels) | Montant |
| Coût de l’information | 3 300 €/ entreprise |
| Coût de Rédaction d’un FDS (fiche de données de sécurité) | 9 000 €/ entreprise |
| Lecture du FDS spécifique à l’organisation | 3 500 €/entreprise |
| Mise en œuvre de la FDS dans l’usine de production | 1 500 €/ entreprise |
| Systèmes d’« ICT » | 1 500 €/entreprise |
| Marquage des produits | 3 500 €/ entreprise |
Au total, la mise en œuvre de REACH a coûté 424 millions d’euros aux PME néerlandaises en 2012.
Depuis les années 1980, certains gouvernements ont tenté de contrôler les coûts de leur réglementation en mettant en place une « gestion de la réglementation » (Regulation management). Ils ont alors créé au sein de l’administration un département spécialisé dans l’estimation des coûts et des bénéfices des projets de réglementation. Cette évaluation ne se limite pas au projet lui-même, mais tente également de calculer les coûts-bénéfices des alternatives possibles au projet réglementaire (y compris, ne rien faire, se contenter de fournir l’information, s’en remettre à l’autorégulation par le secteur, ou mettre en œuvre un autre règlement). L’objectif de ces analyses coûts-bénéfices est clairement d’éviter d’imposer des réglementations qui grèvent le secteur en question plus que le montant attendu des bénéfices pour la société.
En 1984, le président Reagan a introduit, par le biais du décret 12291, l’obligation de préparer une évaluation de l’impact de la réglementation pour chaque règlement dont l’impact dépasse le seuil de 100 millions de dollars. Le président Clinton a poursuivi cette politique par le biais du décret 12866. Dans l’administration européenne, il existe également une obligation de préparer une évaluation d’impact. Ici, il n’y a pas de seuil, mais plutôt une politique d’analyse proportionnelle : l’effort engagé pour évaluer les coûts et bénéfices doit être proportionnel à l’importance de la réglementation proposée.
S’il est préférable que de tels rapports coût-bénéfice existent et puissent limiter le taux de surrèglementation, nous devons toutefois tempérer nos attentes à l’égard de ces efforts. Tout d’abord, les juridictions négligent souvent leur devoir de mener des évaluations approfondies des coûts et des bénéfices. Dans une analyse de Frank Vibert portant sur 20 analyses d’impact de l’UE, seule la moitié des analyses d’impact ont abouti à une quantification réelle et crédible des coûts et des bénéfices. Par conséquent, ces rapports ont très peu d’impact sur les décisions des décideurs politiques. Les « RIA » (Regulation Impact Analysis) et « IA » (Impact Analysis) sont en fait une tentative de « scientifisation » de la politique. Leur succès est souvent très faible car il est difficile d’arrêter le rythme d’une série de réglementations lorsqu’elles sont motivées, d’une part, par une idéologie constructiviste et, d’autre part, par des intérêts puissants qui se sentent servis par ces réglementations. La combinaison de l’idéologie et des intérêts ne peut pas être contrecarrée par des rapports « scientifiques », même lorsque ceux-ci sont rédigés par des personnes compétentes.
4. Le piège du cycle de subventions et réglementations
Depuis la création des institutions européennes, l’agriculture est le secteur le plus gâté et le plus subventionné, mais cela s’est accompagné d’une augmentation impressionnante des normes pour les agriculteurs à un point tel que l’on peut se demander ce qu’il reste de l’agriculteur, ce petit Dieu indépendant, maître de ses champs et de son bétail. Les subventions sont en effet énormes. Dans le budget multi-annuelle 2021-2027 de l’UE, 387 milliards d’euro sont alloués à l’agriculture, soit environ 37 % du budget total. Pour rappel : la population agricole de l’UE en 2023 était de 10,5 millions, soit environ 2,5 % de la population totale.
L’objectif de cette politique agricole, généreusement soutenue par des subventions, était avant tout économique. Les économies d’échelle sont utilisées pour rendre l’agriculture européenne plus efficace et assurer un revenu décent aux familles rurales. C’est la doctrine du célèbre commissaire néerlandais Sicco Mansholt. Mais il y aussi la recherche d’une sécurité alimentaire, qui peut être nécessaire en cas de guerre ou de contraction du commerce international. Au cours des deux dernières décennies, les objectifs de la politique agricole de l’UE ont toutefois clairement évolué vers des objectifs écologiques, plus particulièrement pour lutter contre le réchauffement climatique et protéger zones rurales et paysages. L’image de l’agriculteur en tant qu’entrepreneur indépendant et producteur de denrées alimentaires s’estompe ainsi progressivement au profit de l’image de l’agriculteur en « garde-forestier », protégeant les espaces où les promeneurs urbains peuvent se reposer le week-end.
Les subventions, longtemps accueillies favorablement par les agriculteurs et surtout par les conglomérats agro-industriels, deviennent peu à peu de véritables fléaux car elles sont liées à des conditions de plus en plus restrictives. L’agriculteur, qui a souvent utilisé des fonds européens pour financer ses investissements et développer sa production, se retrouve complètement dépendant de la « manne » européenne et n’a d’autre choix que d’accepter les contraintes réglementaires liées à l’octroi de ces fonds. Ainsi, l’agriculteur d’aujourd’hui n’est-il pas seulement un « garde-forestier », mais aussi un agent d’exécution d’une économie agricole planifiée.
La directive européenne relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (91/676/CEE) a fortement stimulé cette bureaucratisation de la profession agricole. En Flandre, la directive a été transposée par le Decreet Mestbank (« banque d’engrais»). Ce décret entraîne une multitude d’obligations administratives pour les agriculteurs. Il existe notamment des normes relatives à l’« équilibre de la fertilisation » qui imposent des utilisations limitées d’engrais, différentes pour chaque culture. L’utilisation d’engrais sur les pentes, les zones saturées, inondées ou enneigées est interdite. Saupoudrer des engrais à moins de cinq mètres des fossés et des rivières est interdit. Tous ces chiffres s’accompagnent d’une lourdeur administrative pour les agriculteurs qui sont tenus d’enregistrer méticuleusement l’utilisation de tous les engrais ainsi que toutes les transactions relatives aux engrais (achats et ventes). Le décret exige également la plantation de cultures intercalaires, afin d’absorber les effets des engrais utilisés pour les cultures principales (blé, maïs, avoine, orge, etc.). Les périodes pendant lesquelles ces cultures dérobées doivent être plantées sont minutieusement définies dans le décret. La date limite est tantôt fin novembre, tantôt fin janvier. La non-implantation de ces cultures entraîne des amendes considérables allant de 250 à 1500 euros par hectare. Cette fixation des périodes de semence conduit à ce que l’on appelle l’agriculture calendaire, où les périodes d’ ensemencement et de récolte ne sont plus déterminées par les circonstances climatiques, mais par des calendriers légaux. L’effet pervers de cette agriculture calendaire conduit souvent à une utilisation excessive d’engrais car, pour respecter les délais du décret, les agriculteurs forcent la croissance des cultures dérobées avec des doses supplémentaires d’engrais…
5. L’impérialisme réglementaire Européen
Le 15 mars 2024, l’Union européenne a promulgué la « Directive sur le devoir de vigilance en matière de développement durable ». Cette directive vise à obliger les entreprises européennes à gérer les impacts sociaux et environnementaux tout au long de leur chaîne d’approvisionnement. La directive s’applique aux entreprises qui emploient plus de 1 000 salariés et dont le chiffre d’affaires européen est supérieur à 450 millions d’euros.
Cette directive rompt avec les méthodes traditionnelles d’application des droits de l’homme et des exigences environnementales. Normalement, un État qui souhaite faire respecter les obligations des entreprises qui importent des biens ou des services cherche à y parvenir en concluant un traité avec l’État dans lequel ces entreprises sont établies. Si l’on veut s’assurer que les droits de l’homme des Ouïghours sont respectés en Chine, on stipule dans un traité une clause obligeant la Chine à garantir les conditions de travail des Ouïghours. L’Europe, en tant qu’importateur, pourra alors refuser l’entrée de produits dont la fabrication ne répond pas aux conditions stipulées dans le traité. Traditionnellement, il appartient aux autorités publiques, investies d’un pouvoir souverain, de veiller au respect des règles du droit international.
Avec cette Directive et la législation des États membres qui la transpose, la tâche de garantir le respect du droit international est transférée aux (grandes) entreprises qui deviennent alors des organisations non gouvernementales. Toutes les grandes entreprises deviennent de nouveaux « Greenpeace » qui sont censés jouer le rôle de policiers pour vérifier la conformité des produits importés – ou des parties de produits – avec les droits de l’homme et les exigences de durabilité. L’Europe étend ainsi ses griffes réglementaires à tous ses partenaires du commerce international. Sachant que la jurisprudence en matière de respect des droits de l’homme est très variable et parfois excessive, cette directive risque de devenir un facteur d’incertitude dans le commerce international et de rendre l’Europe moins attractive en tant que partenaire économique.
La politique de l’UE en la matière, comme c’est le cas nous l’avons rappelé avec sa politique agricole, consiste à transformer des acteurs privés, qui opéraient auparavant en tant qu’agents indépendants dans un marché plus ou moins libre, en agences d’État censées mettre en œuvre les règles dictées par les autorités politiques. Cette « politisation » du secteur privé risque de transformer le système de libre marché en une économie centralisée et planifiée, ne différant que peu des systèmes soviétiques du siècle dernier. Nous sommes en droit de nous demander dans quelle mesure cette tendance à la politisation pourra être stoppée. Il est à craindre que les secteurs intellectuels et culturels deviennent eux aussi progressivement les agents exécutifs d’une politique de centralisation au niveau européen. Si cette tendance se poursuit et que l’Europe se transforme en une nouvelle version, peut-être moins sinistre, de l’Union soviétique, comment motiver les gens à s’opposer à l’agression de Poutine ? Dès lors que notre système commence à ressembler de plus en plus au sien, cela vaut-il la peine de sacrifier des vies humaines et des moyens économiques pour le sauver ?
6. Conclusion
Comparé avec les ambitions de Thatcher, exprimées il y a quarante années, le bilan de la politique économique de l’Union européenne est plutôt mixte. Le commerce libre à l’intérieur de l’Europe a certainement contribué à la modernisation de nos entreprises et à la prospérité générale des citoyens-consommateurs. Néanmoins, comparé au marché interne des Etats-Unis, méticuleusement protégé par la fameuse ‘commerce clause’ de la Constitution, beaucoup de progrès restent à faire. Comme indiqué dans cet article, une application plus poussée du principe de la règle du pays d’origine, qui met les réglementations en concurrence, constitue le chemin le plus effectif pour espérer des progrès à moyen et à long terme.
Bien sûr, comme beaucoup de pays dans le monde, l’Europe se voit confrontée à des défis qui menacent notre prospérité et nos libertés. Pour n’en citer que quelques-uns, il y a la concurrence dite « déloyale » que nous livrent les Etats-Unis en subventionnant massivement ses entreprises par le fameux Inflation Reduction Act, il y a la politique de « dumping » que serait menée par le capitalisme d’état chinois à laquelle viennent s’ajouter les problèmes de sécurité liés à certains produits importés de la Chine, ou encore la nécessité de réarmement pour répondre à l’agression russe, ou les exigences de la politique du climat.
Il convient de faire face à ces défis d’une façon qui reste aussi proche que possible des ambitions d’origine du marché interne européen. Il serait déplorable de contrer le protectionnisme américain avec un protectionnisme européen de même envergure. Il faut bien comprendre que le protectionnisme mis en place par l’état exportateur nécessite que les contribuables de cet état subventionnent les produits importés, ce qui constitue un avantage pour les consommateurs des pays importateurs. Ce n’est que lorsqu’une politique de « dumping » menace vraiment le tissu économique d’un pays, que le recours à des mesures « anti-dumping » est recommandé. La même approche vaut pour les questions de sécurité. Ce n’est qu’en présence de preuves robustes sur la dangerosité d’un produit, tel, par exemple, qu’un software qui cacherait des éléments d’espionnage, que des mesures de protection sont justifiées. Malheureusement, l’atmosphère ambiante, nourrie par des politiciens protectionnistes, tend à suggérer que la quasi-totalité des importations en provenance de la Chine est contaminée par des méthodes d’espionnage.
La politique du climat, elle aussi, devrait être conduite selon des méthodes qui perturbent le moins possible le fonctionnement des marchés. Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES), par exemple, mieux vaut imposer une taxe carbone que de réglementer les entreprises en les obligeant à mener une politique dite de durabilité. Ainsi les entreprises chercheront spontanément des méthodes de production moins onéreuses ce qui peut conduire à la réduction, voire à l’abandon de l’utilisation des combustibles fossiles taxés. Si l’Europe parvient à naviguer d’une façon intelligente entre les défis mentionnés, tout en préservant le marché interne, les ambitions de prospérité et de liberté des citoyens Européens seront alors sauvegardées.
6. Postdata
Il y a quelques semaines, le rapport d’Enrico Letta a été présenté à la presse. Ce rapport, fruit de 400 réunions et visites dans 65 villes européennes, visait à évaluer l’état du marché européen, quarante ans après que Jacques Delors ait présenté son projet au reste du monde. Faute d’une lecture attentive de ce document, nous nous limitons ici à quelques premières impressions, mais le titre lui-même – « Bien plus qu’un marché » – peut déjà susciter quelques soupçons. L’accent du rapport n’a pas grand-chose à voir avec la libéralisation et la déréglementation des marchés, mais plutôt avec une politique d’expansion de la taille de nos entreprises et de nos institutions financières. Tout cela afin qu’elles puissent financer la politique climatique (électrification, énergie éolienne, etc.) et les besoins de réarmement de l’Europe face à la menace militaire russe. Bien entendu, rien n’empêche en soi les entreprises et les institutions financières de se développer. Mais la question se pose de savoir comment se fera cette expansion : par les choix des consommateurs qui financent les entreprises par leurs achats ou par les choix des politiques qui financent leurs « champions » par des subventions. Une lecture, même rapide et superficielle, de ce rapport suggère que c’est surtout cette dernière voie qui sera privilégiée. Ainsi, les « champions » de l’Europe, gonflés par la « manne » des subventions, pourraient devenir notre calvaire plutôt que notre rédemption.