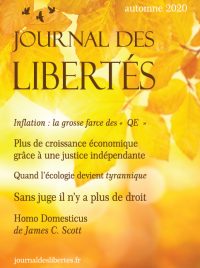Pourquoi l’inflation reste-t-elle faible alors que la masse monétaire augmente ? Pourquoi l’augmentation de la masse monétaire n’a -t-elle pas d’effets inflationnistes ? Telle est la question posée par François Facchini[1].

En économie, l’équation « création monétaire + plein emploi = inflation » a le statut d’une loi fondamentale, quelque chose qui ne peut pas ne pas se produire. D’où la perplexité des économistes devant l’insuccès des politiques non conventionnelles pour obtenir le retour d’une inflation à 2%[2]. Voici ce que nous disent en substance les économistes et qui est repris par les médias :
« La création monétaire, nous l’avons avec les politiques de Quantitative Easing. Il n’y a qu’à regarder l’explosion du bilan des banques centrales. Le plein emploi ? La croissance reste historiquement faible. Mais, enfin, le taux de chômage, au moins pour les États-Unis, est au niveau le plus bas jamais atteint. Et cela dure quasiment depuis 2015 (jusqu’à l’accident de la pandémie). Le PNB américain a de fait rattrapé en 2017 son niveau de plein-emploi potentiel (disparition du GDP Gap[3]), ce qui, techniquement parlant, met un point final à la crise ».
Ce point de vue est celui que l’on retrouve constamment depuis cette date dans les discours du Président Trump et de Jay Powell sur l’état de santé supposé magnifique de l’économie américaine. Ce n’est que dans sa toute récente intervention de la fin août que Powell reconnaît enfin qu’intoxiqués par leur fixation obsessionnelle sur le taux de chômage, ils avaient un peu, sinon beaucoup, forcé la dose. Leur conclusion : avant que la Covid ne frappe, les États-Unis avaient retrouvé le plein emploi. En 2018, ils étaient même passés au-delà, annonçant ainsi une possible surchauffe. Dans de telles conditions, la prochaine étape conjoncturelle ne pouvait être que le retour de l’inflation.
Ce n’est pas ce qui s’est passé ! Point d’inflation, mais la douche froide de l’automne 2018 et la progressive prise de conscience que les grandes économies mondiales étaient de nouveau engagées dans un processus de glissade déflatio-récessionniste dont les dirigeants américains, qui n’en comprennent pas l’origine, avaient beaucoup de mal à admettre la réalité. Exit le sujet de l’inflation. On n’en parle plus.
Pourtant, été 2020, paradoxalement, c’est au moment même où, du fait du Coronavirus, l’économie mondiale plonge dans le drame et dans l’anxiété absolue qu’il resurgit dans les commentaires et les médias.
« C’est bien. La Fed a formidablement bien réagi. Par ses décisions ultra-rapides et radicales elle a, nous dit-on, enrayé l’engrenage d’une apocalypse financière, mais, vue l’énormité des sommes en causes (en deux mois, le bilan de la Fed est passé de 3000 à plus de 7000 milliards de dollars), l’issue, affirment les commentateurs, est inévitable : une fois la crise passée, l’après Covid sera inévitablement marqué par le retour au galop, voire au grand galop de l’inflation ».
A la veille de la rentrée, les voix d’experts se sont multipliées pour crier « au loup ». Mais les anticipations des marchés, telles que mesurées par les eurodollars futures[4], le taux des obligations américaines protégées de l’inflation (TIPS), ou encore l’évolution de la courbe des taux (toujours plus aplatie, ce qui est très mauvais signe pour l’avenir) n’en donnent pas le moindre signe.
Après ce qui s’était déjà passé en 2011, puis en 2014-2015 (même type de scénario : hystérie réflationniste suivie d’une rechute totalement inattendue de la conjoncture alors même que les autorités se disaient convaincues de l’arrivée de la fin de crise), quelle est la cause de ces blocages à répétition de l’inflation – quatre au total en à peine dix ans ?
J’ai lu avec intérêt l’analyse de François Facchini dans les pages de ce Journal. Je l’ai bien aimée. J’y ai retrouvé des arguments, des analyses, des théories qui me sont familières. D’où un préjugé a priori favorable, à l’issue d’une première lecture rapide. Pourtant, au cours des relectures suivantes, j’ai éprouvé un sentiment d’insatisfaction. Si la question semble apparemment bien posée, de façon claire et nette, en revanche la réponse ne me semble pas prendre en compte des éléments essentiels de la situation présente. Ce qu’il nous offre est en fait une liste de facteurs et de théories qui, tous, pourraient expliquer pourquoi, d’une manière générale, nous vivons aujourd’hui dans un environnement où les phénomènes d’inflation tendent à s’estomper par rapport à l’expérience du passé. Mais son texte n’apporte aucune réponse au problème spécifique de l’expérience que, très concrètement, nous vivons depuis plus de dix ans à travers cette succession d’attentes inflationnistes apparemment justifiées par les canons traditionnels de l’analyse économique et pourtant à chaque fois déçues par la réalité. Qu’est-ce qui se passe ?
Si François n’y répond pas, me semble-t-il, de façon satisfaisante, c’est parce qu’en fait la manière même dont il formule sa question, et qui m’a parue si peu problématique à la première lecture, l’engage dès le départ dans une impasse. Le problème est que, telle qu’elle est rédigée, son explication endosse implicitement le narratif habituel qui sert de point d’ancrage à tous les commentaires, à tous les discours qui traitent actuellement de l’inflation. Ce narratif est celui de « l’inondation de liquidités », c’est-à-dire la croyance que le gigantesque gonflement des bilans des banques centrales est le symptôme d’un déluge mondial de liquidités alimenté par une planche à billets qui fonctionnerait en mode de plus en plus accéléré. Or cette croyance qui semble quasiment aller de soi, qui n’est jamais contestée, est fausse. Cette inondation est une illusion, un véritable fake (pour parler le langage à la mode).
Il en va de même de l’hypothèse, implicite dans le thème du « déluge de liquidités », qu’il y aurait une relation quasiment constante entre le volume des réserves bancaires qui figurent au bilan de la banque centrale et la création monétaire des banques commerciales (la théorie du multiplicateur). Bien qu’elle continue de faire partie des enseignements de première année en économie, du fait de la mondialisation et des transformations de l’industrie bancaire et financière qui y sont liées, c’est désormais une fable du passé[5].
Pourquoi les QE ne fabriquent pas de monnaie
Les opérations de QE n’ont en fait rien de bien exotique. Ce n’est après tout que l’extension d’une pratique assez ancienne exercée de manière routinière par les banques centrales pour piloter au jour le jour le taux d’intérêt des marchés monétaires, et ainsi ajuster les flux de liquidité aux besoins de leur politique : ce qu’on appelle l’open market ;une opération au cours de laquelle la banque centrale rachète à une banque commerciale des titres courts de la dette publique (bons du trésor) que celle-ci échange contre l’écriture d’un crédit venant augmenter le montant des réserves que cette banque commerciale consigne à la banque centrale. Cette transaction n’est pas réglée en monnaie commune, la monnaie commerciale de tous les jours, mais en « monnaie banque centrale » – c’est-à-dire un instrument de paiement purement comptable conçu pour faciliter les règlements interbancaires entre banques commerciales ayant un compte logé à la banque centrale, ou entre celles-ci et la banque centrale. La spécificité de cette sorte de monnaie est que personne ne peut s’en servir en dehors du monde bancaire. C’est en quelque sorte l’équivalent de ce que l’on appelle aujourd’hui un jeton dans les circuits de paiements de type cryptomonnaies où les échanges sont par construction limités à un nombre fermé de participants. C’est une monnaie qui n’est pas destinée à circuler, qu’on ne peut pas se passer de main en main, sauf si elle est d’abord convertie en espèces circulantes que sont les billets et la monnaie.
Dans ce type d’opération, la banque centrale inscrit au passif de son bilan une dette nouvelle (le crédit – créé à partir de rien – qui vient augmenter le volume des réservesde la banque commerciale), et porte à son actif la valeur du paquet de bonds ainsi acheté. Son actif global augmente du montant de la transaction. Quant à la banque privée, elle s’est séparée d’un paquet de créances sur le Trésor compensé, à l’actif, par l’acquisition d’une nouvelle créance sur la banque centrale (l’augmentation de ses réserves). Le total de son bilan ne change pas. Elle n’est ni plus riche, ni plus pauvre. Ce que l’on a est une opération dite de swap par laquelle la banque centrale échange une créance sur le trésor contre une créance équivalente sur le secteur privé, l’objet de cet échange étant d’exercer une action sur les taux courts. Sur le plan monétaire, le seul agrégat qui augmente est la monnaie de base (ce que l’on appelle encore la monnaie banque centrale).
Le QE diffère seulement en ce qu’il s’agit d’opérations portant sur des volumes de dettes publiques beaucoup, beaucoup plus élevées, des maturités beaucoup plus longues, et incluant aussi la reprise de créances privées (obligations émises par des entreprises, des banques ou des organismes financiers, et même des valeurs modernes plus exotiques comme des titres adossés à des actifs obtenus par titrisation). Mais, fondamentalement, cela reste le même type d’opération : un gigantesque swap d’actifs au cours duquel la banque centrale échange un portefeuille de titres financiers divers contre une création (à partir de rien) de réserves bancaires.
Le résultat est le même : le swap d’actifs ne change rien au bilan consolidé de l’ensemble du secteur bancaire commercial, si ce n’est sa composition (plus de réserves, moins d’actifs financiers), ce qui est exactement ce que la banque centrale recherche. Même chose pour la monnaie. Ces opérations se soldent par une augmentation de la monnaie de basecréée à partir de rien, un point c’est tout. Elles sont sans répercussion sur les autres agrégats. L’idée qu’il s’agirait d’un cadeau monétaire massif de l’État aux banques (le thème de « l’argent gratuit » largement exploité par la presse) est une légende.
On ne peut cependant en rester là. Prenons un second exemple. Un fond de pension entend saisir l’offre de la banque centrale et désire se délester d’un gros paquet d’obligations. Par définition une telle entreprise n’est pas admise à loger un compte bancaire à la banque centrale. Elle doit donc passer par un intermédiaire, sa banque. Celle-ci crédite le compte de son client d’un milliard de dollars en échange du portefeuille de valeurs dont il demande le rachat. La banque centrale va financer son achat en virant un milliard de dollars au compte courant que la banque du fonds de retraite détient chez elle. Ce milliard est payé en monnaie banque centrale crédité sur le compte de réserve bancaire de la banque. Mais elle ne peut pas transférer ce milliard de son compte banque centrale sur le compte de dépôt de son client, car cette transaction sort des limites de la sphère strictement interbancaire pour les besoins de laquelle la monnaie banque centrale a été conçue. Elle a toujours la possibilité de demander à la banque centrale de lui verser le milliard en billets de banque, puis de faire appel à un transporteur spécialisé pour le livrer dans ses coffres-forts ou dans ceux de son donneur d’ordre. Mais avouons qu’il s’agit d’une opération qui, de nos jours, n’est guère praticable. La banque va donc s’y prendre autrement. Elle va tout simplement créer (à partir de rien) un dépôt d’un milliard de dollars crédité sur le compte du fonds de pension. Au bilan, ses engagements (le dépôt est une dette vis à vis de ses déposants) progressent d’un milliard, contrebalancés par un nouvel actif (ses réserves bancaires augmentent d’un milliard)[6].
Quid des problèmes de cash flow et de trésorerie qui découleront de l’augmentation de son passif ? Avec quoi va-t-elle s’acquitter de sa dette ? A l’ère du Global Money[7] et de ses multiples innovations financières, la technique consiste à faire appel aux concours financiers des grands réseaux bancaires et non-bancaires off-shore (par exemple les départements de courtage des grandes banques internationales) spécialisés dans les opérations de transformation et de recyclage tous horizons des liquidités mondiales, via le vaste marché de gros des refinancements au jour le jour de type repos. Toutes ces activités sont grosses créatrices de dépôts assimilables à de la monnaie (désignés sous l’expression générique de shadow money). Mais il n’y a plus de canal reliant la création de liquidités bancaires aux mouvements d’une monnaie de base. Le QE reste confiné à la sphère de la banque centrale[8].
L’asphyxie de la shadow money
Nous vivons aujourd’hui dans un univers bancaire et monétaire radicalement différent de celui enseigné dans les cours d’économie. Dans ce nouveau monde 3.0 il existe bien un multiplicateur, mais d’une nature très différente du multiplicateur monétaire traditionnel attaché à la vision keynésienne obsolète d’un univers de systèmes monétaires domestiques fermés. Il trouve son origine dans la capacité légale des prêteurs, dans le cadre d’un contrat de repo, de réutiliser le gage collatéral qu’ils ontreçu de l’emprunteur pour, à leur tour, négocier un autre contrat de prêt à leur profit – procédure dite de ré-hypothéquation[9]. Ce collatéral joue dans la pyramide des dettes et créances du marché monétaire mondial un rôle d’ancrage analogue à la monnaie de base dans les systèmes monétaires fermés à banque centrale, mais avec une caractéristique très spécifique : sa valeur n’est pas fixe. Elle dépend des valorisations du marché. C’est un ancrage flexible qui joue aussi bien à la baisse qu’à la hausse – c’est-à-dire dans un sens aussi bien déflationniste destructeur de liquidité qu’inflationniste[10].
Actuellement ce multiplicateur est la cause d’une pénurie larvée et persistante de monnaie qui dure depuis dix ans (avec une intensité plus ou moins forte selon les moments). Nous ne disposons d’aucune statistique monétaire pour le confirmer[11]. Les données officielles des banques centrales et autres organismes de coordination internationale (comme la BRI) ne nous donnent d’estimations que pour certains facteurs de la création mondiale de liquidités (aux trois quarts libellées en dollars off-shore[12]) : les repos trilatéraux, le papier commercial, les parts de fonds monétaires de marché, mais pas les swaps, ni les repos bilatéraux qui ne sont repérables que par une lecture attentive des notes de bas de page des documents d’entreprise.
Pour évaluer l’état de cette création nous ne pouvons nous fier qu’à des informations indirectes, à la manière des physiciens qui repèrent l’existence d’une planète à la lecture des anomalies de sa trajectoire par rapport à ce que celle-ci devrait théoriquement être du fait des lois de la gravitation. Ces informations sont celles qui résultent des anomalies observées dans le fonctionnement des marchés financiers depuis dix ans : informations monétaires comme les écarts de taux et les variations de la courbe des taux ; les variations relatives de taux de change (comme la hausse tendancielle du dollar par rapport à toutes les autres monnaies qui, dans le contexte d’un système de paiements internationaux principalement fondé sur l’usage de celui-ci, est le signe par excellence d’une pénurie globale de liquidités) ; ou encore l’analyse des mouvements de fonds interbancaires entre les États-Unis et le reste du monde (TIC).
Dans les années précédant la GFC #1 (Great Financial Crisis #1), aux États-Unis, la monnaie banque centrale représentait environ 5 % du volume globale de monnaie tout compris, la monnaie de banquefaisant les 95% restant. Aujourd’hui la proportion banque centrale serait plutôt de l’ordre de 17 %. Malgré ce rattrapage la monnaie publique reste très minoritaire. La seule inflation de monnaie banque centrale par la Fed et la BCE suffirait-elle pour générer un « déluge mondial » de liquidités ? Ces chiffres disent que c’est impossible. Les ordres de grandeur ne sont pas comparables.
Tout dépend donc de la façon dont fonctionnent les robinets off-shore de la Shadow Money. Or les indications indirectes émanant globalement des marchés financiers, même six mois après les événements de mars-avril 2020, montrent que la pénurie mondiale de liquidités – et plus particulièrement d’instruments quasi monétaires collatéralisables, types USTs et T-Bills – reste toujours aussi intense, même si elle n’est plus au stade critique atteint au moment de la grande crise (GFC #2) du début du printemps.
Avec cette asphyxie des robinets de la Shadow Money, il apparaît clairement que, dans ce nouvel univers bancaire et monétaire mondial (Global Money System), les banques centrales ne sont, par construction, pas plus en mesure d’insuffler à elles seules l’inflation qu’elles souhaitent, qu’elles ne sont capables d’en contrôler les taux. Alors pourquoi s’entêtent-elles à pérenniser l’usage d’une technique qui a déjà amplement démontré son échec tout au long de la décennie ?
Les QE, instrument d’action psychologique
Les QEs sont des outils de politique monétaire conçus à l’origine pour produire de la relance économique par une action indirecte sur les taux. Mais l’intention n’est pas, n’a jamais été, d’agir directement par la création monétaire.
C’est cependant ce que croient la plupart des gens – en particulier les journalistes et commentateurs économiques -, car c’est à travers la lanterne de l’ancienne mécanique monétaire des manuels des années 60 qu’ils continuent de lire et de décrypter ce qui se passe. Il est étrange que nulle part, en particulier au niveau des banques centrales et de leurs experts, ne s’élèvent de voix pour les détromper.
On peut certes considérer que ces experts se trouvent eux-mêmes emprisonnés dans ces schémas anciens du fait des investissements intellectuels colossaux que ce genre de révélation conduirait à dévaloriser brutalement. Il est tout de même difficile d’imaginer qu’ils soient tous inconscients des mutations et changements en cours. Aussi y a-t-il une autre hypothèse. Après tout, même s’ils savent que ce qui s’écrit et se colporte dans les médias est faux, ils n’en sont pas fondamentalement mécontents. Pourquoi ? Parce que toute leur philosophie de l’action monétaire s’organise désormais autour de l’idée que ce qui est essentiel est la gestion des anticipations du public. Le tournant s’est joué lors de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole en 2009, avec le célèbre exposé de Ben Bernanke.
Comment relancer en situation de trappe à liquidité, avec des taux d’intérêt proches de zéro ? Pour qu’il y ait reprise, il faut que les gens y croient. Et ils n’y croiront vraiment que si les autorités s’engagent fermement, et de manière crédible, dans une voie qui leur laisse pressentir la réapparition d’une véritable reprise porteuse du retour d’une dose équilibrante de « bonne » inflation. La difficulté cependant est de déclencher et d’entretenir cette anticipation avant même que n’émergent les premiers signes et manifestations concrètes de ce retournement.
C’est là qu’intervient le QE. Compte tenu de ce que croient (faussement) les gens – en premier lieu les journalistes – faire du QE revient à envoyer un signal très fort à l’opinion, un signal qui doit déclencher des anticipations favorables même si on sait que l’effet réel d’un QE n’est pas ce que croient les gens sur la base de la conception qu’ils ont de la manière dont se fabrique la monnaie. Puisque, dans leur système de perception nourri par l’enseignement des années 1960, « QE = création monétaire = promesse d’inflation », le seul fait de faire du QE, et surtout d’en faire des volumes de plus en plus impressionnants, devrait normalement les conduire, dans leurs choix économiques personnels, à intégrer de manière endogène la prise en compte de ces perspectives. Si l’on veut véritablement que l’inflation rejoigne la cible des 2%, il ne faut surtout pas les contredire, ni leur révéler que les vertus monétaires qu’ils prêtent à la technique des QE ne sont en réalité qu’une illusion, un mirage.
Le plus remarquable est que cette stratégie semble avoir presque fonctionné par trois fois au cours des dix dernières années. Mais à chaque fois cela n’a duré que le temps d’un feu de paille, la déception la plus cruelle étant celle de 2019.
D’où viennent ces déceptions en série ? La réponse se trouve dans une double erreur de départ : en premier lieu, bien sûr, l’illusion du plus grand nombre quant aux effets monétaires du QE, mais aussi l’extraordinaire naïveté des autorités dans leur croyance en la puissance des effets d’anticipation. A chaque échec elles ont réagi en considérant que si cela n’avait pas marché c’est parce que le signal envoyé n’avait pas été assez fort pour être crédible et écouté. D’où la surenchère des QEs : à chaque fois qu’une nouvelle crise de liquidité s’annonce elles répondent en doublant, voire en triplant la donne. Non, de leur point de vue, il n’est pas question de douter un instant que ça ne marche pas.
Fed : l’acharnement dans l’erreur
C’est ainsi qu’on en arrive au soi-disant grand tournant de la conférence de presse de Jay Powell de la fin août : il s’agit de frapper encore plus fort, sans changer fondamentalement de cap. Il ne s’agit que de communication. Il ne s’agit plus seulement de perpétuer la politique des QE, et d’en gonfler les montants : la Fed fait publiquement savoir que désormais la cible des 2% d’inflation ne sera plus considérée comme un plafond dont elle s’efforce de se rapprocher au plus près, quitte à admettre certains dépassements temporaires (comme annoncé en 2018), mais qu’elle acceptera d’aller au-delà pendant tout le temps qu’il faudra pour permettre au chiffre moyen de l’inflation calculé sur plusieurs années de corriger son déficit par rapport à la norme visée. Elle espère que cela devrait finalement convaincre les incrédules. Son but est de renverser l’image que ses dirigeants croient solidement incrustée dans l’opinion publique (depuis la grande désinflation reaganienne des années 1980) d’une banque centrale dont la priorité des priorités resterait de toujours farouchement traquer l’inflation.
Dans les faits, on est loin de la grande nouveauté stratégique que décrivent les médias. Il n’y a pas à proprement parler de révolution. Cela reste essentiellement une opération psychologique à grand spectacle pour convaincre que, celle fois-ci, elle y met véritablement le paquet. Mais, fondamentalement, ce n’est que la continuation de la même approche politique mise en œuvre depuis dix ans et qui manifestement ne fonctionne pas. Comme si ce qui y manquait n’était qu’une question de quantum. Un acharnement dans l’erreur à faire envers et contre tout une forme soi-disant moderne de politique monétaire sans monnaie.
Les QE donnent ainsi le sentiment d’une colossale farce qui, avant même le déclenchement de la pandémie et indépendamment des effets supplémentaires du confinementgénéralisé dû au Coronavirus, a compromis pour au moins une décennie le retour à une normalité économique que tout le monde devrait raisonnablement souhaiter.
[1] Nous nous référons ici à son article publié dans ce même numéro : Journal des libertés, n°10, Automne 2020.
[2] Rythme annuel considéré par l’orthodoxie comme nécessaire pour maintenir la dynamique d’une reprise économique durable.
[3] GDP Gap = écart de la croissance effective du PNB avec son taux potentiel de croissance en plein emploi.
[4] Le marché des contrats à terme en euro.
[5] Sur ce sujet, voir le remarquable document de la Banque d’Angleterre : « Money Creation in the Modern Economy », Quarterly Bulletin, 2014 Q1. Voir aussi Manmohan Singh et Peter Stella: “Central Bank Reserve Creation in the Era of a Negative Money Multiplier”, Voxeu.org, 7 mai 2012.
[6] Le bilan de la banque, augmente mais les charges qui y sont liées aussi (ratio de capital, coefficient de liquidité, surcharge sur les banques dites systémiques).
[7] Pour comprendre le sens de cette expression, voir notre article : « L’ère du Global Money » dans le Journal des Libertés, numéro 7, hiver 2019. Lien : https://bit.ly/2GekOD8
[8] Toutefois l’augmentation de la taille des bilans des banques n’est pas neutre. Les charges d’exploitation liées à la réglementation ne sont pas autre chose qu’une taxe sur la production des banques. Celles-ci y répondent en réduisant leur offre de crédits et en redistribuant leurs portefeuilles de prêts. Il en résulte une lente décapitalisation du secteur et de son appareil de production de liquidités assimilables à du cash, dont les victimes sont les PME de l’économie réelle évincées par les industries de la finance (servies en priorité au titre des opérations de QE). Dans cette optique il est vraisemblable que la mise en place généralisée du nouveau ratio de liquidité – à partir de 2015 et devenue effective en 2018 – a joué un rôle dans le retournement surprise de la conjoncture à partir du premier semestre 2018.
[9] Pour bien comprendre le mécanisme de rehypothecation, ainsi que les rouages de l’économie du collatéral, voir surtout les travaux et publications de Manmohan Singh et Peter Stella. Notamment : « The (other) Deleveraging: What Economists Need to Know about the Modern Money Creation Process », Voxeu.org 2 juillet 2012; ainsi que les chapitres du livre édité par Manmohan Singh, Collateral and Financial Plumbing, deuxième édition, Risk books, Incisive Media, Londres 2016.
[10] …avec pour conséquence de faire apparaître une nouvelle forme de mini-cycles périodiques.
[11] …en nous donnant par exemple une évaluation fiable de ce que représente la Shadow Money. Les études qui s’intéressent au Shadow Banking et à la Shadow Money (Mehrling, Gorton, Poznar, Ricks, Singh, Stella, Gabor, Murau…) donnent des évaluations souvent très divergentes. Cela tient notamment à ce qu’ils ne sont pas d’accord entre eux pour définir ce qu’est exactement la Shadow Money et en définir le périmètre. A l’heure actuelle, les études les plus sérieuses qui concernent ce sujet sont celles, très récentes, de l’économiste allemand Steffen Murau. Voir par exemple : Murau et Pforr, « Private Debt as Shadow Money ? » (2020). Lien : https://bit.ly/34fmOmE
[12] Sur le concept de dollar off-shore, voir l’étude de Steffen Murau, Joe Rini et Armin Haas : « The Evolution of the Offshore US Dollar System », Journal of Institutional Economics, 2020.
 Henri Lepage est économiste. Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, il a également étudié à l’Université du Colorado et à la LSE. Journaliste économique de 1967 à 1976 il a depuis enseigné et fait du conseil en divers endroits (dont Paris-Dauphine). Il est membre de la Société du Mont Pèlerin et administrateur de l’ALEPS. Ses nombreux ouvrages incluent Demain le capitalisme (Pluriel 1978) ou encore Demain le libéralisme (Pluriel 1980).
Henri Lepage est économiste. Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, il a également étudié à l’Université du Colorado et à la LSE. Journaliste économique de 1967 à 1976 il a depuis enseigné et fait du conseil en divers endroits (dont Paris-Dauphine). Il est membre de la Société du Mont Pèlerin et administrateur de l’ALEPS. Ses nombreux ouvrages incluent Demain le capitalisme (Pluriel 1978) ou encore Demain le libéralisme (Pluriel 1980).