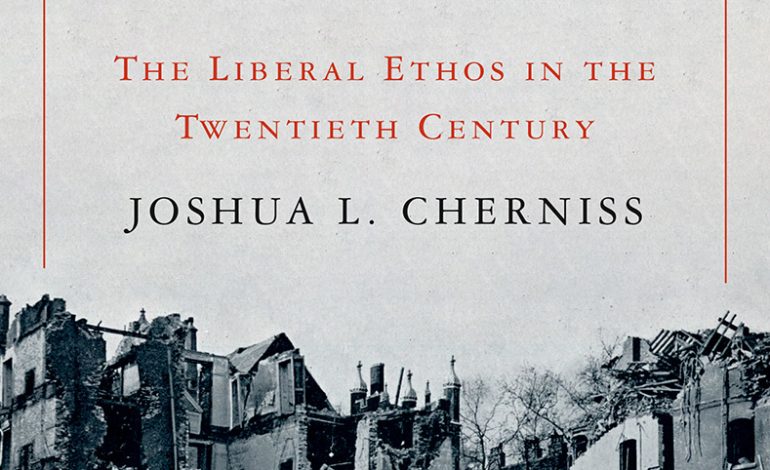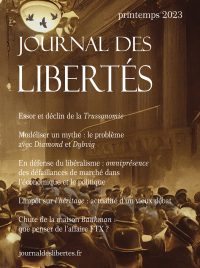de Francis Démier
CNRS éditions, 2022 (461 pages)
Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Paris-Nanterre et spécialiste de la France de la première moitié du XIXe siècle, Francis Démier vient de faire paraître un ouvrage relatif à la lutte entre les protectionnistes et les libre-échangistes sur la période du grand XIXe siècle, précisément du traité franco-anglais de 1786 à la veille de la Première Guerre mondiale.
Les seize chapitres strictement chronologiques du livre se lisent aisément et ce, en dépit d’un style sans relief. Nous pouvons résumer la thèse de l’auteur en le paraphrasant de la manière suivante : « L’enjeu réel des débats qui ont défini jusqu’à aujourd’hui les frontières douanières de la France est celui de la construction d’une nation. Le choix du protectionnisme au XIXe siècle n’a pas constitué un obstacle à la construction d’une société libérale car aucun pays, Angleterre exceptée, n’a été plus loin dans le démantèlement des cadres règlementaires de l’économie de l’Ancien Régime. Loin d’avoir constitué un obstacle à la métamorphose de la société française, la protection d’un marché national définie dans le droit fil des valeurs de 1789 en a été une des conditions essentielles parce qu’elle créait un « juste » espace dans lequel les producteurs acceptaient de prendre les risques du marché. Le libre commerce n’était pas un idéal rejeté, mais il ne devait pas porter atteinte à une « identité de la France » qui s’était dessinée lors de la période révolutionnaire. La protection du marché hexagonal était aussi celle des équilibres de l’ensemble de la société. L’objectif était de lier le développement du pays à l’organisation d’un marché national cohérent et protégé, capable de conjuguer, sans contradiction, le culte de la liberté et celui de ses limites. Le protectionnisme devait guider la politique économique de la France du XIXe siècle, un protectionnisme qui n’avait rien à voir avec le nationalisme contemporain : la plus grande liberté dans l’espace national et la plus grande protection aux frontières ».
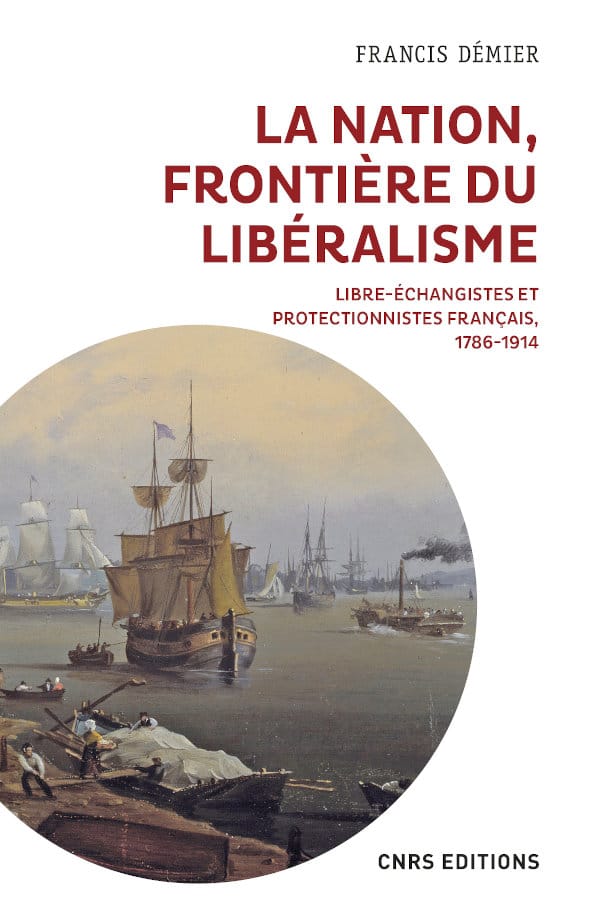
Le lecteur non averti trouvera dans cet ouvrage substantiel une synthèse commode et accessible de la question protectionniste de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe. Le lecteur averti, lui, n’y trouvera sans doute pas grand-chose dans la mesure où l’auteur reprend des sources bien connues, si bien que son intérêt primordial tient aux thèses, fort contestables, développées par Francis Démier. Les indications bibliographiques, même en notes de bas de page, sont pour la plupart dénuées d’originalité[1].
Revenons sur l’un des leitmotive de l’ouvrage : la politique économique de la France présenterait la plus grande liberté économique dans l’espace national et la plus grande protection aux frontières. De là, le titre de l’ouvrage : la « nation », qui préoccupe tant l’auteur, serait la « frontière du libéralisme ». Or, ce constat est inexact. Il n’y a jamais eu de libéralisme à l’intérieur des frontières françaises pour la simple et bonne raison que l’unité de la nation, chère à Francis Démier, s’est construite de manière centralisée et dirigiste depuis l’Ancien Régime.
L’appréciation que porte l’auteur sur les différents traités de commerce, parfois abusivement qualifiés de traités de libre-échange, apparaît elle-même discutable.
Un traité de 1786 néfaste ?
L’auteur livre une appréciation unilatéralement critique du traité franco-anglais de 1786. Il considère que les négociateurs français « ont partagé un optimisme tout à fait excessif sur les effets que pourrait avoir un traité de libre-échange » (p. 17). Pourtant, il rappelle à juste titre que « les effets directs du traité sur les échanges restent difficiles à mesurer et toujours débattus dans l’historiographie car il faut tenir compte du contexte de crise économique générale qui allait emporter la monarchie » (p. 26). Cela ne l’empêche pas de considérer que le traité fut une « application aventureuse d’une idée de libre-échange qui vouait alors la France à devenir un pays agricole et confiait, de fait, aux Anglais, la vocation de nation manufacturière » (p. 421).
Or, comme nous l’avons expliqué dans notre ouvrage Exception française, il est difficile de tirer les leçons d’une réforme économique isolée, particulièrement à court terme. La simple chronologie le démontre : comment juger des effets d’un traité de commerce signé en 1786, progressivement mis en application à partir de 1787, alors même que la France va connaître des bouleversements à partir de 1789 ? Dans le monde contemporain, il serait délicat d’en tirer des conclusions ; d’autant plus à une période lors de laquelle la vie des affaires est plus lente à tous égards. Nous avons donc saisi que l’idée exprimée par Francis Démier dès les premières pages de l’ouvrage est que le libre-échange non seulement ne pouvait être une option favorable aux intérêts français, mais encore ne pouvait être en pratique mis en place de manière réaliste. Le lecteur aura donc compris que le libre-échange généralisé n’a pas les faveurs de l’auteur. De là, par exemple, une appréciation des effets positifs de la protection du fer à la fin des années 1810 et dans la première moitié des années 1820 (p. 96).
Vive le tarif Méline !
L’ouvrage contient une appréciation nuancée du traité franco-anglais de 1860 et dont la synthèse apparaît intéressante (pp. 309 s.). Les propos se font en revanche plus polémiques lorsque le livre traite des débuts de la IIIe République. L’auteur prétend tout d’abord que l’agriculture — holisme habituel sous la plume de l’auteur — serait la « grande perdante » du tarif de 1881 (p. 342). Mais surtout, il loue le tarif Méline de 1892 (p. 372). D’autant plus qu’il témoigne d’une grande bienveillance à l’égard de Jules Méline auquel l’historiographie aurait été doublement « ingrate » : en ce qu’elle l’aurait rendu responsable de la survie inutile d’une France rurale dont l’inertie aurait freiné le rythme de modernisation du pays ; en ce qu’elle aurait mis sous le boisseau un projet autrement plus ample que le système douanier et consacré à la survie de la République (p. 373).
Ainsi l’auteur n’hésite-t-il pas à écrire : « Depuis 1892, le double tarif soutenu par la majorité méliniste avait permis à la France de reprendre place dans l’Europe de la seconde industrialisation en ménageant protection et ouverture commerciale » (p. 395). Francis Démier cite d’ailleurs Méline dans ses phrases les plus passéistes… sans réaction ! Ainsi quand l’homme politique prétend au début du XXe siècle que les industries automobiles et électriques ne vont pas continuer leur marche ascendante et que la période de la grande fabrication ne tardera pas à être close, la clientèle des automobiles étant servie pour quelques années (p. 378) ! Quelle prescience !
L’auteur a raison de considérer que le tarif Méline ne représente pas pour l’essentiel une rupture, mais une continuité avec un accroissement progressif du protectionnisme marqué à plusieurs reprises dans les années 1880 par une hausse des barèmes douaniers. Nous avions déjà constaté dans notre ouvrage Exception française que si la libéralisation avait été bien moindre qu’on ne le dit sous l’ « Empire libéral », le protectionnisme avait été beaucoup plus modéré qu’on ne le pense dans les premières décennies de la IIIe République. Le point essentiel — également relevé par Francis Démier — était que la protection de l’agriculture dépassait pour la première fois celle de l’industrie avec le tarif Méline.
En revanche, l’auteur ne se demande pas pour quelle raison, hormis la consolidation de la République, il y avait eu une prégnance de plus en plus forte du protectionnisme en France à la fin du XIXe siècle. Nous avions relevé dans notre ouvrage l’influence du suffrage universel qui avait mené à l’extension du « marché politique ». Comme le relevait Yves Guyot en 1905, « la protection remplace la concurrence économique par la concurrence politique ». Par ailleurs, le protectionnisme croissant s’explique par le fait que la libéralisation des échanges avait été conduite sous la férule de saint-simoniens et que la chute du Second Empire n’avait guère accru leur popularité. Si bien que l’établissement autoritaire de la libéralisation l’avait fragilisée et rendue plus facilement vulnérable aux coups de boutoir des protectionnistes, sans que l’opinion publique pèse dans le sens du libre-échange. Jules Méline, salué par Francis Démier, pouvait se vanter de « son » tarif de 1892 et des effets prétendument positifs qu’il avait pu avoir, au fil de ses discours et ouvrages d’un conservatisme et d’un passéisme éculés. Il n’en demeurait pas moins que, à la veille de la Première Guerre mondiale, notre pays se trouvait surclassé par l’Allemagne sur le plan industriel, par l’Angleterre sur le plan financier et par les Etats-Unis en termes de niveau de vie. La part de la France dans le commerce mondial se réduisait comme peau de chagrin : presque de moitié entre 1860 et la veille de la Première Guerre mondiale avec une chute du second rang en 1880 au quatrième aux prémices de la conflagration. Beaux résultats !
Libéraux ou libre-échangistes ?
Conceptuellement vide, l’ouvrage de Francis Démier ne se distingue pas par une connaissance fine du libéralisme. Adolphe Blanqui, le frère du révolutionnaire, l’économiste auquel l’auteur a pourtant consacré une thèse volumineuse, est considéré comme libéral. Pourtant, ce dernier rappelle la défiance de Blanqui envers la grande entreprise et son tropisme envers la petite, sans parler de ses appréciations peu libérales du travail (pp. 208 s.). En réalité, il confond trop souvent libéralisme et libre-échangisme. Or, si tous les libéraux sont par définition libre-échangistes, l’inverse n’est pas vrai.
Francis Démier parle d’une « aile droite des libre-échangistes » à laquelle appartiendrait par exemple un Frédéric Bastiat, peu en odeur de sainteté au demeurant dans le livre, parmi les « défenseurs d’un libéralisme intransigeant » (p. 210). La connaissance devient même superficielle lorsque l’auteur ose écrire que « la critique de Bastiat à l’égard de la politique douanière était parfaitement indifférente à la question sociale » (p. 203). Bastiat serait encore vivant, on penserait à une diffamation pure et simple. Un Bastiat qui aurait « pris la tête d’un courant libéral conservateur » en 1847 (p. 218) …
L’auteur parle en sous-titre « des économistes libéraux, soutien d’un régime autoritaire » sous le Second Empire (p. 292). Mais de qui s’agit-il ? Là encore, il y a confusion avec les libre-échangistes. Le fait de citer entre autres Louis Wolowski démontre que l’ouvrage ne traite pas des penseurs libéraux (p. 293). De même, lors des débats sur le futur tarif de 1892, il est indiqué : « Jules Simon, fidèle aux positions libérales qu’il défendait déjà sous le Second Empire, rejoignait Léon Say sur des positions très conservatrices et antisocialistes » (p. 369). C’est qu’il y aurait eu une « dérive conservatrice du groupe libre échangiste » avec Léon Say (p. 368). Entre-temps, l’auteur aura éreinté les libre-échangistes sous la Seconde République à l’ « itinéraire calamiteux » (p. 254).
Le traitement réservé à Guizot est assez révélateur. Bien entendu qualifié de libéral, « avocat d’une société issue du marché » selon une expression fort maladroite, l’homme politique, prétend l’auteur quelques lignes plus bas seulement, « appartenait à un courant d’idées pragmatique qui se distinguait des positions des économistes libéraux sans les condamner »… avant de constater que le « conservatisme » de Guizot « le conduisit politiquement à fixer des limites au jeu du marché » (p. 181) ! Pellegrino Rossi est, lui, qualifié de « libéral orthodoxe » (p. 268). Quant à Paul Cauwès, s’il n’est tout de même pas affublé du terme de libéral, il resterait « partisan du libéralisme économique » (p. 381) ! La confusion est totale.
Contre le libre-échangisme et le prohibitionnisme, pour un protectionnisme modéré !
Adversaire du prohibitionnisme, traduisons : du protectionnisme poussé à son acmé, Francis Démier loue une sorte de protectionnisme plus ou moins modéré. En témoigne son appréciation de la politique napoléonienne : « si le blocus a eu incontestablement un “ effet retardateur ”, la politique protectionniste, considérée dans son ensemble, a bien été le socle d’un changement technique, très inégal certes, mais qui a permis l’ancrage des premières formes d’entreprises capitalistes » (p. 52). L’auteur ajoute : « le protectionnisme constitua alors la seule alternative à la désindustrialisation et au déclin. Aucune industrie continentale à l’exception de celle de la soie ne pouvait être en mesure de soutenir la concurrence de ses rivaux anglais » (p. 53). Ou encore sous la Restauration : « le choix d’un protectionnisme qui confinait de plus en plus au prohibitionnisme [ici le terme est entendu par exception de manière positive…] avait donné à la France l’immense avantage de préserver son indépendance économique, ses acquis manufacturiers, ses emplois et de poursuivre la conquête méthodique des techniques qui avait permis à l’Angleterre de creuser l’écart sur le reste de l’Europe » (p. 105).
En dépit des opinions contraires soutenues par nombre d’hommes politiques français contemporains, le protectionnisme n’est jamais intelligent, patriotique ou encore solidaire. Il est néfaste. Mais, au-delà de l’utilitarisme, il est avant tout violateur des droits de l’homme. Francis Démier n’en dit mot pour la simple et bonne raison qu’il adopte une approche économique sous un angle utilitariste, et non pas une approche juridique en termes de droits de l’homme. Sa méthode est macro-économique et holistique. Mais le fait que le protectionnisme s’analyse en une interdiction d’importation ou d’exportation des individus, de leurs biens, capitaux, marchandises et autres services ne vient pas à l’idée de Francis Démier, obnubilé par la construction d’une nation républicaine et unie, de Napoléon aux républicains opportunistes et à leurs successeurs. L’auteur voit avec faveur les frontières, les limites, les nations, mais il en vient à oublier la dimension humaine de l’histoire économique qu’il conte. Il oublie également les valeurs pacifiques qui accompagnent le libre-échange et, en contrepoint, les tensions qui constituent l’ombre portée du protectionnisme. Une lecture des œuvres de Bastiat lui eût été profitable.
[1] Nous nous permettons de rappeler que notre ouvrage Exception française. Histoire d’une société bloquée de l’Ancien Régime à Emmanuel Macron, Odile Jacob, 2020, pp. 141 s., traitait sur plus de 50 pages du protectionnisme français de l’Ancien Régime à la période contemporaine. Il va de soi que notre livre n’est pas cité dans celui de Francis Démier…