de Alexis Karklins-Marchay
Les Presses de la Cité, 2023 (330 pages)
Le titre de l’ouvrage de Alexis Karklins-Marchay pourra agacer ou faire sourire – c’est selon – mais il se comprend par son sous-titre. En effet, depuis l’origine, dans les années 1920-1930, un courant de pensée allemand dit ordolibéral prétend que le libéralisme classique ou de laissez-faire serait suranné. Ce nouveau mouvement de « troisième voie » se situerait bien plus vers le libéralisme que le socialisme. Comme il y avait, paraît-il, un socialisme à visage humain, il y aurait un libéralisme à visage humain qui, c’est l’antienne de toute troisième voie, mêlerait les avantages réels ou supposés du libéralisme – l’efficacité – et du socialisme – la « justice sociale ». Autrement dit, il y aurait des libéraux humanistes et des libéraux qui ne les seraient pas, perclus d’égoïsme, de consumérisme et d’économisme. Ces derniers apprécieront…
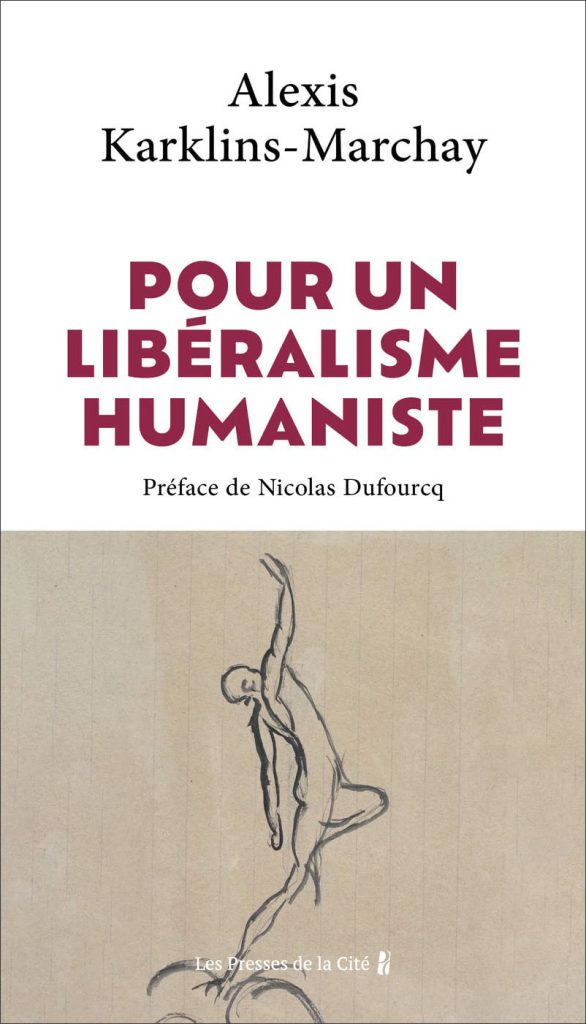
Alexis Karklins-Marchay part en introduction de l’idée que le libéralisme serait « en crise ». En effet, le « libéralisme économique » se trouve en accusation (pp. 18 s.), coupable des sept péchés capitaux (pp. 24 s.). Même s’il rejette la plupart de ces critiques, l’auteur en conclut de manière incohérente qu’il faudrait « un autre libéralisme ». De fait, il conviendrait de le réinventer sinon il disparaîtra (p. 76). Si l’on comprend bien, la question n’est donc pas de savoir si la ligne est bonne ou mauvaise ; il suffit de savoir que l’opinion publique la rejette. La solution trouvée s’évince d’elle-même : « Un libéralisme véritablement éthique et humaniste » (p. 37), qui ne soit plus « le libéralisme du laissez-faire, de la dérégulation, du “ tout-marché ” et de la “ croissance pour la croissance ” » (p. 36). Un libéralisme qui « reprendrait les fondamentaux (sic) » mais qui – le passage doit être cité in extenso –
« ne ferait pas de l’individualisme sa valeur de référence. Qui placerait la dignité de l’humain au-dessus de toute autre finalité, en privilégiant sa dimension culturelle et son engagement dans la société. Qui s’opposerait à la primauté de la recherche du profit, de la finance et du consumérisme tapageur dans l’économie. Qui redouterait la formation d’entreprises géantes et la constitution de monopoles. Qui s’insurgerait contre les rémunérations parfois extravagantes et les écarts trop importants de revenus ou de patrimoines. Qui réfléchirait avec réalisme à la place de l’Etat dans l’économie, à la fois en temps de crise économique et en période d’expansion. Qui défendrait la protection de l’environnement, la conservation de la nature et la vie en dehors des mégalopoles. » (pp. 36-37)
Dans sa conclusion, qui reprend le même thème « pour un autre libéralisme », la même pétition de principe se retrouve : la forme prise par le libéralisme depuis un demi-siècle sous l’influence de Hayek et plus encore de Friedman – il nous semblait que les pensées de ces auteurs étaient assez différentes, mais peu importe…– « appelée communément « néolibéralisme » est aujourd’hui arrivée « en bout de course » » (p. 287). Le propos est assez largement hypocrite car si l’auteur ne reprend pas à son compte explicitement les critiques initiales du libéralisme (pp. 24 s.), il le fait dans la conclusion (pp. 287-288). Un huron se demanderait en quoi, particulièrement en France, le libéralisme pourrait être « en crise » et accusé de tous les maux, alors même que l’auteur est obligé de reconnaître le poids de l’Etat, des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques dans notre pays…. Lorsqu’il soutient qu’il faudrait reprendre les éléments fondamentaux du libéralisme sans ses défauts, on pense au débat entre Bastiat et Lamartine : « Vous en êtes à la liberté, j’en suis à la fraternité », écrivait ce dernier ; « la deuxième partie de votre programme détruira la première », lui rétorqua, impérial, le Landais….
La conclusion de l’ouvrage aggrave la dérive ordolibérale. Il ne s’agit plus d’économie sociale de marché, mais d’ « économie sociale, culturelle et écologique de marché » (p. 289). Une troisième voie explicite (p. 289) à la Röpke (p. 307). Et lorsque l’auteur émet des réserves sur l’ordolibéralisme, c’est entre autres parce que l’antikeynesianisme de ce dernier serait trop prononcé et du fait d’une critique excessive de l’Etat providence (pp. 272-273) ! Le huron se demande alors ce qui séparerait vraiment les vœux de l’auteur de la situation présente de la France. Pour paraphraser Montesquieu, Alexis Karklins-Marchay bâtit Chalcédoine en ayant les rivages de Byzance sous les yeux… Les vœux de l’auteur ressemblent également aux ouvrages de John Stuart Mill et aux constitutions socialistes : un principe nanti d’exceptions qui le font disparaître. Ainsi l’auteur prône-t-il une « constitution budgétaire ». Fort bien, mais dans les situations exceptionnelles, l’équilibre budgétaire ne sera pas respecté (pp. 291-292). Ainsi l’auteur soutient-il le libre-échange, fût-ce de manière utilitariste (p. 294). Fort bien, mais il souffre de multiples exceptions « liées à certains secteurs ou situations », telle la « concurrence inéquitable d’entreprises présentant des bilans sociaux ou environnementaux détestables » (p. 295). Par ailleurs, l’auteur se dresse contre les inégalités de richesses trop importantes et il se prononce pour la progressivité comme pour la taxation des successions (p. 296). Nous lui apprendrons sans doute que la France est déjà à cet égard à la pointe du progrès… De plus, l’Etat doit intervenir pour financer la formation des citoyens, pour leur permettre l’accès au système de santé et au système éducatif. Là encore, il semblait que notre pays était déjà très généreux en la matière… Il est vrai que l’auteur doit penser que cette générosité n’est pas suffisante puisqu’il préconise, sans originalité au demeurant, une allocation de revenu universel (pp. 297-298). Toujours sous l’angle des prélèvements obligatoires, l’auteur soutient une fiscalité écologique et incitative, ainsi qu’une taxe carbone pour compenser les « externalités négatives » (p. 298). Il s’oppose aux monopoles – ceux du secteur privé – et il plaide en faveur du développement des petites et moyennes entreprises, de même qu’il se prononce en faveur de la participation (pp. 299-300). Pourtant, il s’émeut de la trop grande place de l’Etat (pp. 303 s.)… alors même que les orientations fiscales défendues versent dans le fiscalisme (pp. 296 s.) !
Le programme de réforme apparaît schizophrénique puisqu’il contrevient à l’Etat modeste pourtant souhaité (p. 318). On voit mal en effet comment l’Etat serait modeste avec des investissements en matière d’éducation, de santé et de sécurité au profit des « classes les plus défavorisées » (Ibid.). Modeste également cet Etat qui investirait massivement dans l’innovation et qui aurait une action vigoureuse pour accélérer la « transition écologique » (p. 320) ? Tous les poncifs y passent et rien ne sera manifestement épargné au lecteur. Lorsque l’auteur appelle de ses vœux une société de « classe moyenne » (p. 296) avec écart de richesses réduit (p. 318), citation d’Aristote à la clef, on pense au projet conservateur des républicains opportunistes de la IIIe République exaltant les petits propriétaires…
La dernière phrase de l’ouvrage retient l’attention : « Le néolibéralisme est mort. Vive l’ordolibéralisme ! » (p. 320). Or, historiquement et logiquement, celui-ci n’est-il pas la manifestation paradigmatique de celui-là ? Ce qui gêne à la lecture de l’ouvrage, c’est le fait que les principes libéraux, n’en déplaise à l’auteur, soient passés par pertes et profits. A commencer par la question nodale du libéralisme classique : quelles sont les limites de l’Etat ? Manifestement, l’auteur ne se la pose jamais. L’Etat doit être modeste, le pragmatisme est loué, l’interventionnisme doit être raisonnable, mais qui diable en juge ? Quelles sont les garanties ? Nul ne le sait. Et si les ordolibéraux mettaient en application leur programme avant d’être chassé du pouvoir, qu’est-ce qui garantirait au contribuable que le niveau des impôts et celui des dépenses serait ou resterait modeste (p. 195) ? Comme l’exprimait Alain Madelin, ne vous dites pas ce que vous feriez avec vos lois, mais ce que les autres pourraient faire avec… Alexis Karklins-Marchay ne se pose pas la question des limites de l’Etat car il partage la conception naïve de l’Etat des fondateurs de l’ordolibéralisme. L’Etat ne serait autre qu’un juste arbitre, l’incarnation de l’ « intérêt général » (p. 308). Son intervention, leitmotiv des ordolibéraux, serait légitime « pour veiller à ce qu’il n’y ait ni entente ni cartel ni monopole » (p. 294). Mais quid du monopole de l’Etat ?
Les pages rapides de l’ouvrage sur l’histoire du libéralisme et celle de l’ordolibéralisme apparaissent également peu cohérentes. L’auteur affirme que l’ordolibéralisme fut une réaction à la montée du nazisme. Ce n’est pas totalement exact. L’ordolibéralisme est un mouvement de pensée des années 1920-1930 en réaction à la déliquescence de la République de Weimar, tiraillée entre la peste et le choléra, autrement dit entre le communisme et le nazisme. De la crise de 1929 l’auteur tire l’idée que le laissez-faire aurait montré « de toute évidence ses limites » (p. 54), mais il rappelle ensuite que le protectionnisme l’aurait aggravée (pp. 136-137). Au-delà du laissez-passer largement à l’abandon, particulièrement dans une Allemagne très protectionniste, l’interventionnisme n’est pas pointé comme le responsable de cette crise. L’auteur se garde bien également de rappeler le passé parfois peu reluisant de certains des promoteurs de l’ordolibéralisme. En effet, si plusieurs d’entre eux ont été de courageux résistants au nazisme, si d’autres ont dû émigrer, certains ont été très sensibles au nazisme, voire à l’antisémitisme du régime hitlérien. Ce qui n’a pas empêché plusieurs d’entre eux d’occuper des postes de premier plan après la Deuxième Guerre mondiale…
Le quatrième des sept chapitres de l’ouvrage prétend que « l’ordolibéralisme est un libéralisme » (pp. 125 s.). Il est regrettable que l’édition ne soit pas scientifique et que le lecteur ait souvent du mal à séparer les opinions des ordolibéraux de celles propres à l’auteur. Étant précisé au demeurant que les fondateurs de l’ordolibéralisme puis leurs successeurs peuvent développer des idées parfois très sensiblement différentes et que la diversité de leurs opinions n’apparaît guère à la lecture de l’ouvrage. Mais il est indéniable que ce chapitre est essentiellement libéral : la méfiance à l’égard de l’interventionnisme étatique (pp. 143 s.), le refus d’une pression fiscale trop élevée (pp. 149-150), etc. Il est d’ailleurs peu compatible avec les vœux conclusifs de l’auteur pour un ordolibéralisme rénové (pp. 196 s.)… Quoi qu’en dise l’auteur, la défense d’un « Etat fort » écarte définitivement les ordolibéraux du libéralisme (pp. 170 s.). Quoi qu’en dise l’auteur, cet Etat fort n’a rien à voir avec celui de Benjamin Constant. Ce dernier souhaitait un pouvoir puissant dans ses attributions très limitées, et non pas dans des attributions extensives ! La conception naïve de l’Etat partagée par les ordolibéraux, leur étatisme profond et le rejet explicite de l’ordre spontané en témoignent, la liste à la Prévert des interventions légitimes de l’Etat également (pp. 184 s.).
Insistons encore sur l’absence de limites de l’Etat. Un anarcho-capitaliste lirait avec un sourire crispé la conception floue d’un Etat modeste, contradictio in adjecto pour lui, d’autant que ses limites sont ici plus qu’impressionnistes. Un partisan du Public Choice lirait également navré la tirade sur l’Etat incarnation du « bien commun » (p. 171) … Les autres chapitres montrent que certains des ordolibéraux ont une conception conservatrice, moralisatrice et passéiste de la société, Röpke étant évidemment au premier plan à cet égard.
Une dernière remarque pour souligner que les aspects religieux de l’ordolibéralisme reçoivent, comme souvent d’ailleurs, la portion congrue. Il faut attendre les pages 245 et suivantes pour voir enfin le thème abordé. Cela est d’autant plus regrettable que le succès posthume de l’ordolibéralisme a fréquemment tenu à ses fondements chrétiens. L’intérêt est aussi de montrer, pour reprendre notre dichotomie dans Exception française, ce qui peut distinguer un chrétien libéral d’un libéral chrétien….
Au terme de cet ouvrage, dont le lecteur pourra se passer de la lecture des premières et des dernières pages propres à un auteur qui aggrave les maux de l’ordolibéralisme et dans lesquelles il trouvera sans doute beaucoup plus d’humanisme que de libéralisme, nous pourrons nous dire que le pire pour le libéralisme n’est pas d’être attaqué, mais d’être mal défendu.





