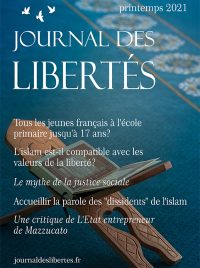Un homme politique peut-il décider froidement que tous les jeunes Français iront désormais à l’école primaire jusqu’à l’âge de 17 ans ? Qu’il n’y aura donc plus en France de véritable enseignement secondaire ? Avec comme conséquence que les études supérieures et la recherche scientifique seront grevées d’un handicap irréparable ? Peut-il prendre seul, sans débat public, une décision aussi absurde, aussi manifestement contraire à l’intérêt général ? Tout citoyen sensé répondra par la négative. Et pourtant, c’est ce que vient de faire M. Jean-Michel Blanquer en mettant en œuvre une catastrophique réforme du concours donnant accès à l’enseignement des collèges et lycées, le CAPES (« Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré »).

Le nouveau CAPES
Depuis sa création, ce concours était une agrégation-bis. Il était certes d’un niveau moins élevé, mais il poursuivait le même but : recruter des professeurs compétents dans leurs disciplines, capables d’enseigner valablement aux collégiens et lycéens les rudiments des lettres et les sciences. L’arrêté ministériel du 25 janvier 2021 le transforme dès l’an prochain en une épreuve de pédagogie et de conformité idéologique. En effet, il ne comportera plus que des épreuves dites « professionnelles ». Toute vérification des savoirs académiques disparaît, sauf dans une des épreuves de l’écrit à faible coefficient. Le poids de l’écrit avait déjà été réduit, depuis quelques années, à un tiers de la note. Seul compte désormais l’oral, qui ne vérifie que les savoir-faire pédagogiques et comporte, innovation notable, une épreuve commune à toutes les disciplines : un « entretien avec le jury » portant sur l’aptitude du candidat à « se projeter dans le métier de professeur au sein du service public de l’éducation » et vérifiant son « attachement aux valeurs de la République ». Pour la première fois dans l’histoire de ce type de concours, des personnels non-enseignants sont membres des jurys.
Le concours se réduit donc à une sorte d’entretien d’embauche à la tête du client. Le principe selon lequel les concours de la fonction publique doivent être strictement neutres est bafoué puisque, si l’on peut évaluer objectivement des connaissances scientifiques, notamment par des épreuves écrites anonymes, on ne peut vérifier l’aptitude à des pratiques que par une appréciation subjective dont on peut craindre, quand on connaît le milieu, qu’elle ne soit idéologiquement orientée. Quand il y a des entretiens dans les concours d’admission des écoles de commerce, la subjectivité est également à l’œuvre, mais il y a en France une trentaine d’écoles de commerce ; si l’on déplaît à l’une, on plaira à l’autre. Ici, il faut plaire à un employeur unique, qui déclare qu’il privilégiera désormais les savoir-faire au détriment des savoirs.
Ce choix est un non-sens pour l’enseignement secondaire. Certes, aucun enseignant ne peut se contenter de savoir, il doit aussi savoir transmettre. Mais mettre les techniques de transmission au premier plan n’a de pertinence qu’à l’école primaire. Là, en effet, les savoirs à acquérir sont, par définition, élémentaires. Et l’on a affaire à des enfants qu’il faut faire progresser de l’intelligence concrète à l’intelligence abstraite. Cela se fait ordinairement par des méthodes dites « inductives » ou « actives », images, dessins, chansons, jeux, leçons de choses, promenades éducatives, etc., tous procédés que l’enseignant doit savoir pratiquer. Comme, en outre, les modes de progression varient d’un élève à un autre, il est bon que l’enseignant ait aussi quelques lumières en psychologie de l’enfant et de l’apprentissage. Tel est l’ordre de compétences dont les écoles d’instituteurs ont toujours fait leur spécialité.
La tâche du professeur du second degré est bien différente. En effet, depuis les Grecs, et ensuite sans solution de continuité jusqu’à nos jours, on a toujours su que le stade de la pensée concrète pouvait être dépassé dès l’âge de dix-douze ans. Une fois ce stade « secondaire » atteint, la science de la transmission peut et doit céder la place à la science tout court, et l’enseignement peut devenir théorique. De fait, l’histoire de l’école montre que, depuis des siècles, les professeurs du secondaire ont réussi dans leur tâche sans avoir reçu d’enseignement pédagogique spécifique. Ils étaient attentifs, bien évidemment, aux bonnes manières de faire, qu’ils reprenaient de leurs maîtres et que les nouveaux professeurs amélioraient d’année en année en acquérant de l’expérience. Mais ils visaient surtout à exceller dans leur discipline. Car ils savaient que, dès lors que l’intelligence d’un jeune est en éveil, il n’y a rien de plus et de mieux à faire pour fixer son attention et mobiliser ses capacités de travail que de lui offrir jour après jour des savoirs solides et structurés. Ils pensaient qu’ils seraient écoutés et respectés de leurs élèves si et seulement si ils étaient compétents dans leur discipline. Le bon aloi de leur savoir était toute leur pédagogie. D’ailleurs si la pédagogie, entendue comme compétence séparée à laquelle on doit être formé par un entraînement spécial, avait été indispensable dans l’enseignement secondaire, comment y aurait-il eu, dans le passé de l’Europe, lorsque cette discipline n’était pas enseignée pour elle-même, tant d’élèves parfaitement instruits devenant, au sortir des facultés des Arts, des collèges ou des lycées, les excellents scientifiques et experts en tous domaines qui ont rendu notre civilisation possible ? Inversement, depuis qu’en France la pédagogie est explicitement enseignée aux futurs professeurs, qui osera prétendre que le niveau des collèges et lycées s’est élevé ? Il est clair que ce n’est pas le cas, les classements scolaires internationaux nous en donnent chaque année la cuisante leçon.
Par conséquent, l’idée que le cœur de la compétence des professeurs du secondaire serait la pédagogie et que celle-ci devrait donc devenir le critère principal de leur recrutement est une grave erreur intellectuelle. Comment le ministre de l’Éducation nationale peut-il la commettre ?
Les vraies raisons de la réforme
Il y est poussé, je crois, par trois (mauvaises) raisons. D’abord, c’est un fait que l’école élémentaire d’aujourd’hui ne parvient pas à donner à tous les enfants le socle de compétences qui était vérifié jadis par le certificat d’études primaires. En conséquence, puisque tous les élèves du primaire poursuivent aujourd’hui au collège et au lycée, il faut ressasser à tout moment, à ces niveaux, l’apprentissage des connaissances fondamentales — lire, écrire, compter, connaître un minimum d’histoire et de géographie. Il faut donc que les professeurs du secondaire fassent encore, une grande partie du temps, un métier d’instituteur. Ensuite, les lobbys et syndicats du primaire et des collèges ont, aujourd’hui comme toujours, un poids considérable dans l’Éducation nationale. En confiant la formation des professeurs aux pédagogues des INSPE (« Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation »), successeurs des IUFM qui succédaient eux-mêmes aux vieilles écoles normales primaires, et en la retirant aux universités, la réforme du CAPES satisfait ces lobbys et syndicats qui pourront récupérer des budgets et des postes et imposer leur philosophie pédagogiste à tout l’enseignement scolaire. Or il faut bien voir que cette philosophie n’est pas autre chose qu’une nouvelle forme d’ignorantisme content de soi et de misologie. Qu’elle triomphe aujourd’hui doit faire se retourner dans leur tombe les Jules Ferry, les Louis Liard, les Félix Pécaut et autres pères fondateurs de l’école républicaine qui avaient conçu celle-ci comme l’école des Lumières.
Mais la fuite en avant dans le pédagogisme est d’abord et avant tout l’effet pervers du choix idéologique qui a été fait, en France, de l’école et du collège uniques (prolongés aujourd’hui jusqu’à la seconde des lycées). Dès lors, en effet, que les jeunes ne sont plus séparés selon leurs aptitudes dans des filières différentes, des élèves de tous niveaux scolaires cohabitent dans les mêmes classes (on dit que les classes sont « hétérogènes »). Ce qui a pour conséquence mécanique qu’il est impossible d’y faire cours au sens classique du terme. Qu’un professeur parle devant 30 ou 40 élèves n’a en effet de sens que si tous peuvent à peu près comprendre de la même manière et au même rythme ce qu’expose l’enseignant. Si nombre d’élèves ne le peuvent, s’ils sont rebutés par des cours abstraits, s’ils « s’ennuient », ne sont pas « motivés » et « décrochent », et si l’on veut cependant, coûte que coûte, les maintenir dans le même bocal, il ne reste plus qu’à faire autre chose qu’enseigner sérieusement. On ne tentera donc plus d’assurer des cours continus et cohérents du début à la fin de l’année et de la 6ème à la terminale. On fera des « séquences » plus ou moins disparates, dont on escompte que le nombre, la variété, le caractère ponctuel, ne demanderont pas à l’attention flottante des élèves plus qu’elle ne peut absorber. On proposera aux jeunes tout un panel d’activités supposées attrayantes, des « projets », des « travaux de groupe », des discussions, des projections d’images et de films, le maniement d’ordinateurs et de tablettes, des visites à l’extérieur. On justifiera ces non-enseignements en soutenant, contre toute vraisemblance et malgré les avertissements des vrais pédagogues (il en existe), la lubie que les élèves pourraient « apprendre par eux-mêmes » les savoirs. Qu’ils pourraient redécouvrir à tâtons, et en s’amusant, les théorèmes des mathématiques, les lois de la physique, de la chimie ou de la biologie, l’histoire, la géographie, les langues, les déclinaisons latines… Il faudra également veiller à maintenir la bonne entente au sein de ces groupes qui ne sont plus soudés par le fait de suivre un cursus intellectuel exigeant. Gérer au mieux ce qu’on appelle la « vie scolaire » devient dès lors une nouvelle fonction importante de l’enseignant. Il doit s’intéresser de près à la psychologie et à la sociologie des élèves et bien connaître l’encadrement institutionnel, l’organisation administrative des établissements et du Ministère, les instances diverses auxquelles il peut faire appel en cas de problème.
Ainsi, ce que l’Éducation nationale souhaite désormais que ses enseignants possèdent n’est plus la connaissance confirmée d’une discipline académique, mais, comme le dit l’arrêté ministériel, l’aptitude à bien pratiquer le « métier de professeur au sein du service public de l’éducation », entendez le métier de professeur tel qu’il est devenu dans l’école massifiée. Les candidats au professorat devront consacrer deux années entières à acquérir ce know how au sein des nouveaux « INSPE ». Ils y suivront des cours de pédagogie, de didactique, de psychologie, de sociologie, et sans doute aussi de « valeurs de la république » puisque cette matière est désormais au programme (je serais curieux de connaître le contenu de ces enseignements portant sur un concept récemment inventé et qui n’a pratiquement aucun sens philosophique ni historique). Last but not least, les étudiants devront faire de nombreux stages dans les établissements scolaires. Il est clair qu’ils ne pourront suivre un tel cursus qu’en abandonnant très tôt les études académiques. Le ministre souhaite même que, pour susciter des vocations précoces d’enseignants, on engage des étudiants sur cette voie pratique immédiatement après le baccalauréat, en les payant et en leur faisant faire des stages dans les établissements auprès de tuteurs. Sans donc leur laisser le temps de faire les études supérieures sérieuses que ces jeunes pourraient et devraient faire à cet âge où l’on ne sait encore à peu près rien. Il est vrai qu’il importe assez peu qu’on ne leur enseigne rien sérieusement, puisque eux-mêmes ne devront pas vraiment enseigner. Mais on escompte qu’ainsi préparés, les futurs titulaires du CAPES sauront gérer passablement les classes hétérogènes dans le cadre d’une école aux ambitions intellectuelles toujours plus modestes. Comme on suppute, cependant, que de nombreux candidats n’approuveront pas intimement le genre nouveau de métier, bien éloigné de leurs aspirations initiales, qu’on leur propose, il convient de vérifier, avant qu’ils entrent dans le système où ils auront un emploi à vie, leur bonne volonté idéologique. D’où l’épreuve d’« entretien ».
On ne forme pas des professeurs par apprentissage
M. Blanquer a de la suite dans ses idées puisque, dans son livre L’École de demain (Odile Jacob, 2016), où il faisait cette proposition d’embaucher les futurs enseignants immédiatement au sortir du lycée (et où, par ailleurs, il prônait la fusion pure et simple de l’école primaire et du collège), il assimilait explicitement la formation des professeurs à un apprentissage. Il justifiait ce choix en se référant à la formation des médecins qui, en effet, comporte des stages et même des séjours à l’hôpital. Mais cette comparaison est irréfléchie. Il est vrai qu’une part de la formation des médecins doit être pratique, pour deux raisons. D’abord, la médecine n’est pas une science exacte, de sorte que la sûreté de diagnostic d’un jeune médecin ne peut s’acquérir que par l’expérience de la clinique. Ensuite, savoir ausculter des corps, faire des pansements, des piqûres, et prodiguer tout une gamme d’autres soins corporels délicats, sont des compétences pratiques qui ne peuvent s’acquérir que par la pratique. C’est pour ces raisons que les étudiants en médecine doivent être externes et internes à l’hôpital avant de pouvoir exercer de façon autonome. Il n’en demeure pas moins que leur formation consiste principalement en difficiles cours théoriques qui, d’ailleurs, se poursuivent pendant leurs stages et jusqu’à la fin de leurs études.
Les exigences de la formation des professeurs de lettres et de sciences sont bien différentes. Quels habitus pratiques sont-ils requis quand on enseigne les mathématiques, la physique, l’histoire ou la philosophie, sinon parler à haute et intelligible voix et savoir écrire au tableau mots et phrases, schémas et formules ? Il est vrai qu’un professeur n’est pas un pur esprit parlant à de purs esprits. Mais la spécificité de son métier (puisque les pédagogistes n’ont que ce mot de « métier » à la bouche) est de développer les potentiels intellectuels de ses élèves. Il doit les introduire dans le monde des savoirs, des théories scientifiques, des doctrines, qui est un monde intelligible, distinct du monde sensible. C’est parce que le travail fait à l’école se situe dans ce registre proprement intellectuel que les établissements scolaires ont toujours été, depuis l’Antiquité gréco-romaine jusqu’à nos jours, des univers à part, séparés à quelque degré de la vie sociale et des contingences matérielles. On a jugé en effet que cette séparation seule permettait aux élèves d’acquérir la culture de l’esprit, cette paideia qui est restée pendant des siècles, en Occident, le but de toute éducation libérale. Il faut certes aussi que les jeunes gens puissent développer les autres dimensions physiques et morales de leur personnalité et, pour cela, qu’ils aient également un pied dans des univers non-scolaires où ils puissent « apprendre la vie ». Ils devront sortir de l’école, découvrir la nature, voyager, pratiquer des sports, s’exercer à quelque travail manuel, apprendre à jouer d’un instrument de musique, participer à des mouvements de jeunesse, exercer des responsabilités dans diverses formes de vie associative, etc. Mais ce n’est pas l’affaire de l’école même, où, pour cette raison, les jeunes ne doivent passer qu’une partie de leur temps. Quand bien même ils mèneraient de telles activités extra-scolaires sous la responsabilité de l’institution scolaire où ils font leurs études, ces activités doivent être nettement distinguées des cours académiques et être encadrées par un personnel autre que celui qui assure ces derniers[1].
La comparaison avec la formation des médecins est donc fautive. D’abord, il va sans dire que les professeurs des disciplines académiques du secondaire n’ont pas vocation à s’occuper des corps de leurs élèves, comme les médecins des corps de leurs patients. Mais ils n’ont pas, non plus, et pour les mêmes raisons, vocation à gérer des psychologies, à guérir des pathologies, à animer des groupes, à être un nouveau genre de « travailleurs sociaux ». Et puisque leur compétence n’a décidément rien de pratique, il est radicalement faux qu’ils puissent y être formés par voie d’apprentissage ; ils ne peuvent l’être que par de solides études intellectuelles. À chacun son métier. Connaître une discipline est déjà quelque chose d’éminemment difficile et qui demande les soins persévérants de toute une vie. La faire découvrir à des jeunes est une chose si éminemment utile, à eux et à la société dans laquelle ils vivront, qu’il importe que les professeurs puissent accomplir cette tâche sans en être distraits par l’obligation d’assurer d’autres tâches étrangères à leur vocation. Demander aux professeurs d’être autre chose que des professeurs est un contre-sens profondément destructeur.
Ainsi, au total, la réforme du CAPES aura pour effet inéluctable d’écarter des collèges et lycées les derniers jeunes gens attirés par les lettres et les sciences en tant que telles, puisqu’ils seront recalés pour la plupart au concours tel qu’il sera devenu, au motif qu’ils seront jugés « trop » instruits et mal disposés au « métier ». Ne passeront plus le filtre que des personnes moins instruites, mais jugées capables de mettre en œuvre les méthodes pédagogiques propres à l’enseignement élémentaire. La réforme officialisera donc de jure ce qui était déjà à l’œuvre de facto depuis des lustres, la primarisation du secondaire. Et elle le fera — monopole éducatif de l’État et centralisation obligent — pour tous les jeunes Français sans exception, y compris les élèves de l’école privée sous contrat. D’où ce que nous énoncions au début de cet article en une formule provocatrice mais exacte : la réforme condamnera tous les jeunes Français à aller à l’école primaire jusqu’à l’âge de 17 ans.
La France appuie à fond sur le frein
Le coût social de cette incongruité sera immense. Quand on constate les efforts d’éducation que font les pays engagés dans la compétition scientifique, technologique, économique qui caractérise le monde d’aujourd’hui, on frémit à l’idée que la France, elle, en matière scolaire, souhaite appuyer à fond sur le frein. Quand on a vu ce que sont les lycées au Japon, en Corée, et bien sûr aussi dans les principaux pays occidentaux, Pays-Bas, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, États-Unis, tous pays où il n’y a pas d’« école unique » à la française, on souffre à l’idée que la France s’installe délibérément dans un retard qui sera bientôt irrattrapable, alors même que le système secondaire français était réputé, il y a peu de temps encore, comme un des meilleurs du monde. Dans les pays cités, on accepte a priori l’idée que tous les jeunes n’aillent pas dans l’enseignement secondaire long. Mais ceux qui y vont se voient proposer, dès les premières classes des junior high schools, un enseignement académique rigoureux couvrant méthodiquement les différentes disciplines des lettres et les sciences. Chez nous, le début d’un tel enseignement sera donc différé jusqu’aux classes terminales ou aux classes préparatoires où les élèves rencontreront enfin des professeurs formés sur le modèle de l’agrégation ? Mais alors, comment pourront-ils atteindre le même niveau que leurs camarades et virtuels concurrents des pays que j’ai cités ? C’est une folie de leur mettre au pied un tel boulet.
Je sais bien que beaucoup de gens avisés, en France, pensent pouvoir perpétuer une vieille hypocrisie, le maintien discret de bons établissements que pourra toujours fréquenter la progéniture de l’élite — des lycées privés, quelques lycées publics situés dans les beaux quartiers. On sait d’ailleurs que, d’ores et déjà, le collège et le lycée uniques sont largement des fictions. La carte scolaire enferme les milieux populaires dans des établissements de piètre réputation, et les parents ambitieux utilisent tous les moyens, y compris illégaux, pour faire inscrire leurs rejetons dans les établissements les moins mal cotés de leur ville. Moyennant quoi, pensent ces optimistes, il y aura toujours moyen, pour leurs enfants, d’entrer le jour venu à l’École Polytechnique, à HEC et dans les autres grandes écoles d’ingénieurs ou de management, ou dans les écoles normales supérieures, ou de faire des études correctes de médecine, de droit, d’économie, de sciences politiques, etc. Il suffira de perpétuer ce système à deux vitesses sans trop le dire, et en comptant sur le fait que les directeurs des bons établissements continueront, sans le proclamer urbi et orbi, à avoir sous le coude des classes et des filières d’excellence où l’on s’affranchit allègrement des méthodes pédagogiques fantaisistes préconisées par le Ministère (avec souvent la complicité de l’Inspecteur qui ferme les yeux). Répondons à ces Machiavel au petit pied que leur espérance est aussi vaine qu’elle est moralement problématique. Car si, dès la prochaine rentrée 2021, on ne forme plus de jeunes professeurs réellement qualifiés pour le secondaire, il est fatal que, d’ici quelques années, même les collèges et lycées réputés aujourd’hui privilégiés ne pourront plus soutenir leurs privilèges. Lorsque leurs derniers enseignants compétents et ayant connu la « vieille » école seront partis à la retraite, par qui les remplaceront-ils, dès lors que les INSPE n’auront formé que des animateurs-pédagogues, et que les jeunes formés aux disciplines académiques par les classes préparatoires et l’université se seront vu sèchement barrer l’accès aux carrières de l’enseignement secondaire ?
Il est difficile de croire que M. Blanquer ne comprenne rien à la menace que constitue sa réforme. Mais on lui accordera qu’il a un problème plus immédiat à résoudre. L’Éducation nationale a tant et si bien fait, depuis des lustres, pour changer du tout au tout le métier d’enseignant, que de plus en plus rares sont les jeunes qui veulent l’exercer. Les salaires sont faibles, les conditions d’exercice difficiles, voire dangereuses (l’actualité le démontre), le prestige du métier s’est effondré. Or il faut un contingent donné de nouveaux enseignants à chaque rentrée. L’Éducation nationale a de plus en plus de peine à les trouver. Il y a chaque année, au CAPES, de nombreux postes non pourvus. On recrute d’ailleurs de plus en plus de personnels contractuels hors concours, jusqu’à remettre en cause la notion même de « corps enseignant ». On fait appel à Pôle emploi pour recruter in extremis des chômeurs dont la qualification laisse évidemment à désirer. On conçoit que, confrontés à ce problème, les bureaucrates du Ministère aient cru opportun de baisser les exigences du concours et de recruter, à la limite, n’importe qui voulant bien tenter l’aventure. Or le fait est que « n’importe qui » n’est pas très à l’aise avec les épreuves écrites en général, ni avec des épreuves académiques difficiles. Qu’à cela ne tienne, il suffira de supprimer ou d’édulcorer ces épreuves. L’ « entretien avec le jury » suffira pour vérifier que le candidat possède une culture minimum et est psychologiquement bien disposé à jouer le rôle d’animateur qu’on lui demande. Il est certain, hélas, que ce souci de rétablir les statistiques du recrutement d’enseignants en baissant les exigences a grandement pesé dans la décision du Ministère de dénaturer le CAPES.
Mais a-t-on le droit, quand on gouverne, de ne regarder que le court terme et de sacrifier l’avenir ? Dès lors que la réforme modifie la formation et le recrutement, non pas d’une certaine catégorie de professeurs de collèges et de lycées, mais de tous, elle aura, si elle est adoptée telle quelle et sans contre-mesures, des conséquences dramatiques. En obligeant tous les candidats au professorat public et privé à acquérir, en lieu et place de compétences académiques de bon aloi, une sorte de sous-culture pédagogique scientifiquement inconsistante, pur produit endogène d’une corporation habituée depuis des lustres à vivre en circuit fermé et à ne devoir rendre de comptes à personne à l’extérieur, elle aboutira à la baisse du niveau intellectuel du corps enseignant d’abord, des élèves ensuite, enfin — une terrible logique dicte cette conclusion — de la société tout entière.
Le poids des idéologies
Il existe pourtant des moyens d’éviter ce scenario-catastrophe et de rétablir la bonne qualité de l’enseignement français. Mais il est vrai qu’on ne peut les discerner qu’à condition de s’affranchir de certaines œillères idéologiques.
Voici comment il convient de raisonner. Puisque l’expérience des dernières décennies a démontré que, décidément, une école unique ne peut être qu’une école primaire, et puisque le pays a besoin d’un enseignement secondaire, il faut supprimer l’école unique.
Je rappelle que ce projet politique date des années 1920, à une époque où le socialisme totalitaire était à la mode dans de nombreux pays d’Europe et où, en France, il prédominait dans le monde radical-socialiste, socialiste et communiste qui contrôlait déjà en grande partie l’instruction publique. Le projet fut mis officiellement à l’ordre du jour par le Cartel des Gauches en 1924, reçut un début d’application sous le Front populaire, fut précisé ensuite par le plan Langevin-Wallon de 1947 dont les deux rapporteurs étaient communistes. Rejeté deux fois par les parlements de la IVe République, il fut adopté en partie par la Ve. En effet De Gaulle crut — contre l’avis de certains de ses ministres qui connaissaient mieux que lui le secteur de l’éducation, dont Georges Pompidou — que l’unification de l’école consisterait essentiellement à généraliser un enseignement secondaire réservé jusque-là à une minorité et permettrait donc de recruter les élites sur une base sociale élargie. Le développement quantitatif du secondaire aboutirait, par lui-même, à un progrès général, à une augmentation des qualifications moyennes de la population, à un « alignement par le haut ». Qui pouvait s’opposer à une si prometteuse « démocratisation de l’enseignement » ? À la fin des années 1960, cependant, les sociologues de l’éducation ayant constaté qu’une majorité d’élèves ne pouvait suivre avec profit l’enseignement secondaire traditionnel, les syndicats et partis de gauche obtinrent qu’on bouleversât complètement les contenus et les méthodes dans le sens du pédagogisme, et qu’on le fît, égalité oblige, pour tous les élèves, même pour ceux qui réussissaient parfaitement avec les méthodes classiques. Le pédagogisme, dès lors, triompha. On présenta les nouvelles pédagogies comme un acquis majeur des sciences humaines modernes dont il fallait d’urgence faire profiter l’enseignement, selon la même logique de progrès qui a conduit à remplacer le cheval par l’automobile ou le pigeon voyageur par les ondes hertziennes. Il fallait bien être de son temps et jeter dans les poubelles de l’Histoire l’ « école de papa » qui n’avait plus de raison d’être, ni socialement en raison de son « élitisme », ni techniquement en raison de ses pédagogies réputées surannées.
En réalité, c’était une décision tactique. Il s’agissait de rendre possible coûte que coûte l’école unique dont les échecs commençaient à être discernés et mesurés, mais à laquelle les idéologues ne voulaient pas renoncer, puisqu’ils en attendaient une transformation révolutionnaire profonde de la société. Or les nouvelles pédagogies fournissaient très exactement les outils techniques permettant de gérer tant bien que mal des classes hétérogènes, et ainsi de maintenir viable le projet même d’une école sans filières. Au passage, rendons cette justice aux nouvelles pédagogies qu’elles n’eurent jamais pour intention d’élever le niveau de l’enseignement ; elles ne furent conçues que dans le but de permettre l’école massifiée, but caché au grand public et aux journalistes peu curieux, mais explicité et promu dans les publications militantes. Ainsi débuta la primarisation du secondaire. Ainsi l’école unique produisit-elle, non l’alignement par le haut espéré par De Gaulle, mais l’alignement par le bas que sanctionnent aujourd’hui les classements désastreux du système scolaire français dans les enquêtes internationales.
Ce qui est fait est fait, et il ne faut pas compter sur les bureaucraties de l’Éducation nationale pour se repentir. Mais la question est de savoir combien de temps encore la classe politique française se croira obligée, avec un bel ensemble, de continuer à penser dans le cadre d’idéologies qui ont fait la preuve de leur caractère utopique et montré quels effets pervers redoutables elles provoquent. Combien de temps encore les hommes politiques resteront-ils interdits et comme pris de panique à l’idée de remettre en cause une structure scolaire manifestement inadaptée, qu’aucun pays comparable n’a adoptée telle quelle, et avec laquelle certains pays qui avaient tenté l’expérience ont délibérément rompu au vu de ses résultats (comme la Grande-Bretagne) ? Est-ce un vain fantasme de supposer qu’un jour prochain quelques-uns au moins de nos hommes politiques, ayant enfin daigné se pencher sérieusement sur les questions d’éducation, comprendront qu’il faut changer de paradigme ?
Un secondaire différencié
Changer le paradigme, cela signifie qu’il faut permettre que se recréent en France, au sein, en marge ou à l’extérieur de l’Éducation nationale (je n’en discute pas ici), des types d’établissements, ou des filières, officiellement (donc sans hypocrisie) voués à assurer un enseignement réellement secondaire dès la classe de 6ème. En admettant ce pluralisme, la France ne fera que retrouver ses propres traditions scolaires éprouvées, seulement interrompues par quelques décennies d’aveuglement idéologique. Surtout, elle rejoindra les pays démocratiques cités plus haut dans lesquels il y a toujours, grosso modo, le schéma suivant.
Après l’enseignement primaire, on propose aux jeunes un enseignement secondaire divisé en plusieurs branches : un enseignement secondaire long, accessible aux élèves qui le souhaitent et qui satisfont certains critères de compétences académiques ; et un enseignement plus court suivi de formations professionnelles réellement qualifiantes (grâce au fait que le plus souvent, dans ces pays, elles sont organisées en partenariat avec les organisations professionnelles ou assurées directement par celles-ci). Des passerelles permettent de passer à tout niveau d’une filière à une autre afin de corriger les erreurs d’orientation toujours possibles.
Or personne ne prétendra que les pays cités sont des pays fascistes, antidémocratiques et antisociaux. Leurs systèmes scolaires diversifiés ne visent nullement à favoriser je ne sais quel conservatisme social égoïste, mais, au contraire, à servir de façon juste et efficace l’intérêt général (puisqu’il est certes d’intérêt général de fournir à la société les scientifiques, ingénieurs, techniciens, médecins, managers, administrateurs, juristes, économistes, etc., dont elle a évidemment un besoin vital). Bien loin que ce type de système ait pour effet et encore moins pour but de « reproduire les inégalités sociales », selon le fantasme récurrent des disciples des sociologues marxistes Bourdieu et Passeron, il peut seul permettre un brassage social par le libre choix, l’émulation et la méritocratie. L’accession aux études longues sur critères de mérite permet en particulier aux élèves de tous milieux sociaux ayant de forts potentiels d’accéder aux diplômes et carrières correspondants, alors qu’il est avéré que l’égalitarisme scolaire français s’est traduit par une aggravation continue des inégalités.
Ce dernier effet pervers diabolique, qui était certes difficile à prévoir, se comprend aisément après quelques années d’expérience. Quand l’école républicaine fonctionnait avec efficacité, nombre d’enfants issus de milieux modestes, dont les potentiels intellectuels étaient repérés par le système méritocratique, pouvaient gravir tous les échelons des études et parvenir jusqu’aux plus hauts diplômes. D’où un effet sociétal de démocratisation qui s’est poursuivi, lentement mais sûrement, tout au long des IIIe et IVe Républiques. Les bons élèves des milieux modestes pouvaient, grâce à l’école, doubler leurs petits camarades des milieux plus aisés qui avaient été renvoyés du lycée pour insuffisance scolaire. En revanche, dès le moment où l’école unique s’est mise en place, avec ses effets de non-enseignement, elle n’a plus été un atout pour les jeunes issus de milieux modestes. Comment auraient-ils doublé désormais les jeunes « bourgeois », puisqu’on ne leur apprenait rien à l’école, alors que lesdits « bourgeois » qui, eux non plus, n’apprenaient rien à l’école, bénéficiaient cependant, par simple imprégnation, des apports culturels de leur famille et de leur milieu ? De fait, au long des décennies de la fausse démocratisation conçue sur le modèle de l’école massifiée, le poids relatif de l’héritage culturel familial dans la réussite scolaire puis sociale n’a cessé de croître par rapport à celui des apports scolaires. De sorte que les inégalités sociales se sont aggravées au lieu de s’atténuer. Alors que la proportion d’enfants issus des milieux populaires parvenant aux plus hauts diplômes n’avait cessé d’augmenter pendant des décennies, la courbe s’est inversée au moment précis (fin des années 1970, mise en œuvre du « collège unique » de René Haby) où toutes les institutions de l’école unique achevaient d’être mises en place. D’où le constat particulièrement cruel des tests internationaux : l’école française d’aujourd’hui est non seulement une des plus faibles des pays comparables en niveau scolaire, mais aussi une des plus inégalitaires. Combien de temps encore allons-nous persévérer dans l’erreur ?
Il faut plusieurs corps professoraux
C’est à la lumière de ces analyses qu’il faut envisager le problème de la formation et du recrutement des professeurs du secondaire. Qu’on mette au point une formule nouvelle de CAPES pour mieux assurer l’enseignement secondaire court et pour pouvoir recruter un plus grand nombre d’enseignants, soit. Bon vent à cette réforme et aux « INSPE » qui en seront le cœur. Mais si l’on pose qu’il doit exister aussi un enseignement secondaire long préparant aux études universitaires, il faut, pour assurer cet enseignement, un autre corps professoral, formé aux disciplines académiques. Pour le recruter, il faut soit le vieux CAPES conservé tel quel sous un autre nom, soit l’agrégation dont on augmenterait les promotions, soit n’importe quel concours nouveau vérifiant l’acquisition des disciplines académiques et rien qu’elles. Un concours que les universités prépareraient, comme elles l’ont toujours fait dans le passé et comme c’est leur vocation.
Bon vent aussi à cette réforme-là, même si, aujourd’hui, elle n’est pas dans l’air du temps. Mais le vent tournera, et peut-être plus vite qu’on ne croit. Car les signaux montrant les performances faiblissantes de notre appareil scolaire et universitaire se multiplient. Les chefs et cadres d’entreprise, les responsables d’administrations et autres employeurs sont de plus en plus nombreux à se plaindre du niveau de formation de leurs jeunes collaborateurs, manifestement dégradé par rapport à celui qu’ils avaient à leur âge ; ils en ressentent les effets néfastes pour la marche normale de leurs activités. Le nombre des étudiants en sciences ne cesse de baisser. Les prix Nobel français se raréfient. Un Médaille Fields français de mathématiques, et des professeurs étrangers invités, se plaignent que le niveau en mathématiques des élèves de l’École Polytechnique ait baissé, non certes qu’ils aient moins de potentiels et de mérites que leurs prédécesseurs, mais parce qu’ils n’ont pas commencé assez tôt, et avec d’assez bonnes méthodes, l’étude intense qu’on doit faire de cette discipline si l’on veut y exceller. Les universités françaises sont mal classées dans les comparaisons internationales, même si l’on essaie de masquer ces mauvais résultats par des artifices statistiques peu glorieux (et s’il y a tout de même quelques exceptions). Et ces mois-ci, tout le monde a éprouvé un certain malaise en voyant les résultats décevants de la recherche scientifique française dans la crise du Covid. C’est peut-être un fait contingent, mais… Le problème du niveau des études aujourd’hui en France étant ainsi posé, je ne peux croire que personne, dans les milieux universitaires, scientifiques, politiques, économiques, ne se soucie de cette évolution défavorable, humiliante et dangereuse pour le pays, et ne soit prêt à envisager des solutions nouvelles pour y remédier[2].
[1] Sur cette idée que les enseignements académiques ne doivent constituer qu’une part de l’éducation des adolescents, et que l’éducation doive être « intégrale », il faut lire le remarquable livre récent de M. François-Xavier Clément, La Voie de l’éducation intégrale, Artège, 2021.
[2] En effet, je ne suis pas le seul à m’inquiéter. Voir les analyses indignées d’un millier de philosophes et autres universitaires (https://bit.ly/3tLFhT0), ainsi que l’article « CAPES 2002, préparez vos mouchoirs… » sur le site de l’École des Lettres (https://actualites.ecoledeslettres.fr/concours-2/capes-2022/).