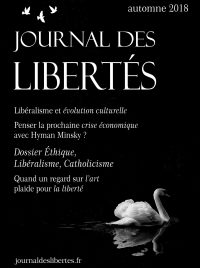C’est très exactement le 7 août 2007 que se sont manifestés les premiers signes de la grande crise financière mondiale. Il y a donc déjà onze ans. L’intervention massive des banques centrales a enrayé l’engrenage vers la dépression déclenché par la grande récession qui a suivi (2008/2009). L’expérience ayant montré que, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, plus une récession était prononcée, plus la reprise était forte, personne ne doutait que c’était ce qui allait se reproduire. Pourquoi en aurait-il été autrement ? Mais ce n’est pas ce qui s’est passé.
La reprise tant attendue n’est jamais arrivée. La croissance est redevenue faiblement positive, à un rythme n’ayant plus rien à voir avec les performances auxquelles on était habitué. La crise marque une claire rupture. Par exemple, depuis 2009 le taux de croissance de l’économie américaine a été divisé par deux. C’est pire en Europe : le PIB de la zone euro n’a retrouvé son niveau de 2007 qu’en 2016, soit neuf ans après le déclenchement de la crise (contre six ans aux USA). Tout se passe comme si un plafond invisible sabrait régulièrement les espoirs d’une reprise durable. 2018 n’échappe pas à la règle. Quelle est la cause de cette situation inédite ?

Pourquoi une croissance en panne ?
L’explication la plus en vogue est celle de la « stagnation séculaire », proposée par le professeur Larry Summers, l’ancien conseiller économique du Président Bill Clinton[1]. L’effondrement du taux de croissance serait le produit de trois facteurs structurels de long terme : 1. la démographie (le vieillissement) ; 2. la montée des inégalités ; 3. la baisse du coût relatif du capital (lié au développement des technologies à coûts marginaux quasiment nuls (type Apple ou Google). A quoi s’ajoute un quatrième argument dont Summers ne parle pas directement, mais qui représente l’élément central d’une variante de sa théorie : l’épuisement des perspectives de progrès de la productivité dénoncé par le professeur Robert Gordon[2].
Les économistes de la Banque des règlements internationaux (la B.R.I., installée à Bâle, connue comme étant la banque des banques centrales) évoquent une toute autre cause. Leurs recherches mettent en évidence l’existence, en parallèle du très classique cycle des affaires, d’un autre type de fluctuation économique dont la périodicité serait de 15 à 20 ans (au lieu des 8 années en moyenne du cycle conjoncturel habituel)[3]. Ce « cycle financier » serait la conséquence d’une asymétrie systématique dans le comportement des banques centrales : pour des raisons liées à des préoccupations politiques, celles-ci réagissent toujours beaucoup plus vite lorsqu’il s’agit de relancer la conjoncture que lorsque le problème est de freiner un emballement inflationniste. D’où une accumulation de dettes et de déséquilibres financiers qui se termine inévitablement par une panne économique de longue durée.
Troisième piste : l’hypothèse monétaire traditionnellement associée aux travaux des économistes disciples de Milton Friedman.
Le cœur de la théorie monétariste est qu’il existe, dans le très long terme, une étroite corrélation entre la croissance du pouvoir d’achat des citoyens (mesurée par la progression du Produit intérieur brut) et la croissance de l’ensemble des moyens de paiement utilisés par la population. Si l’on observe sur une période de plusieurs années une rupture dans le rythme de croissance de la masse monétaire globale par rapport au trend moyen de long terme, il faut s’attendre à ce qu’une rupture identique apparaisse au niveau de la croissance économique. Or, constate Steve Hanke, professeur à l’Université Johns Hopkins de Baltimore, c’est précisément ce que l’on observe depuis la fin de la grande récession, tant aux Etats-Unis qu’en Europe (Grande-Bretagne compris)[4].
Après le grand trou d’air des années 2008-2009, le volume global de la masse monétaire américaine s’est remis à croître mais à un rythme annuel moyen particulièrement faible : +1,7 % contre un trend moyen de long terme, avant la crise, de l’ordre de 4%. C’est une énorme rupture, équivalente à celle enregistrée pour la croissance économique. Pour les monétaristes ce parallélisme indique que l’économie est victime d’une situation monétaire trop restrictive pour qu’elle maintienne son rythme tendanciel de croissance. C’est le signe que la croissance est en quelque sorte prisonnière d’un nœud coulant qui l’étouffe via une offre insuffisante de liquidités.
Nœud coulant monétaire
Pourtant, sur la même période, les banques centrales ont partout mis en place des programmes gigantesques de rachats d’actifs financiers qui ont conduit par exemple à multiplier par quatre la taille du bilan de la Fed américaine, et même par cinq celui de la Banque d’Angleterre. Comment expliquer ce paradoxe : une monnaie de base créée par les banques centrales qui explose, et une masse monétaire globale qui se traine, comme si les liquidités ainsi injectées se perdaient en route ?
L’explication tient à l’incohérence des politiques monétaires qui, depuis la crise, visent d’un côté à stimuler une reprise de la croissance, certes, mais de l’autre s’accompagnent d’un alourdissement considérable des contraintes de bilan imposées aux banques pour, dit-on, renforcer leur solidité face aux imprévus d’une nouvelle crise (Accords de Bâle III publiés en décembre 2010, Dodd-Frank Act signé par le Président Obama en juillet 2010).
Pour répondre aux nouvelles règles de capitalisation et de liquidité prévues par les accords financiers internationaux les banques peuvent soit augmenter leur capital, soit diminuer leurs actifs. Mais dans les deux cas, en raison du jeu du classique « multiplicateur bancaire » associé à toute opération de crédit, ces opérations conduisent à réduire le rythme de croissance des agrégats monétaires. Si par exemple les banques décident d’augmenter leur capital, cela détruit en effet de la monnaie dans la mesure où lorsqu’un investisseur achète des actions bancaires nouvellement émises, il le fait avec des fonds tirés sur une autre banque, ce qui réduit la masse des dépôts en circulation dans le système bancaire, et fait donc disparaître de la monnaie. Sachant que la monnaie de banque (par opposition à la monnaie banque centrale) représente dans le monde d’aujourd’hui encore au moins 80% du stock global de monnaie (c’était 95 % il y a dix ans), l’effet non anticipé de ce mécanisme multiplicateur négatif sur la croissance des agrégats monétaires peut être considérable.
D’après les chiffres mis en évidence par le Professeur Hanke, c’est exactement ce qui s’est passé. Le spectaculaire gonflement du bilan des banques centrales est allé de pair avec une destruction encore plus massive de monnaie privée – la monnaie qui résulte des activités de crédit du secteur privé (banques + établissements financiers à statut non-bancaires) ; destruction qui a neutralisé les efforts de relance de la banque centrale. En conséquence de quoi l’idée complaisamment véhiculée par les médias que les opérations d’ajustement quantitatif (Quantitative easing) noieraient l’économie sous une avalanche de liquidités n’est qu’une illusion[5].
L’eurodollar monnaie mondiale
La réalité est que, depuis la fin de la Grande récession, et malgré le bas niveau des taux d’intérêt pendant toute cette période, les politiques monétaires non-conventionnelles des banques centrales ont entretenu une situation de relative pénurie monétaire (tight money) alors que leurs dirigeants étaient convaincus de l’inverse et que les médias absorbent sans aucun esprit critique tout ce qu’ils disent.
Dans la foulée de cette analyse, une dernière explication est en train d’émerger : et si c’était l’aveuglement des banques centrales face aux mutations de la monnaie et de l’ordre monétaire mondial qui était responsable de la grande panne économique ? C’est la thèse que martèle notamment un économiste américain non universitaire, Jeffrey Snider[6].
Le problème viendrait de leur logiciel de pensée qui ne tient aucun compte de ce que la mondialisation industrielle et marchande a entraîné dans son sillage une non moins profonde mutation de notre environnement bancaire et monétaire : l’émergence au niveau trans-national, en surplomb des organisations bancaires nationales de type hiérarchique, d’un nouveau système de crédit et de création monétaire relevant d’une logique de marché libre, totalement déterritorialisé, et fonctionnant à l’échelle mondiale hors-contrôle de toute banque centrale. Il s’agit d’un marché principalement interbancaire (mais pas exclusivement), réservé aux grands groupes disposant de vastes réseaux d’activité mondiaux. Une sorte de « marché de gros » de la liquidité mondiale que les anglo-saxons désignent sous l’étiquette de Global Wholesale Money Market (plus brièvement dit Global Money)[7] dont l’innovation est d’apporter aux entreprises du monde entier des formules et stratégies complexes d’endettement qui leur permettent de se financer à moindres coûts par rapport à ce qu’il leur en coûterait de passer par des mécanismes traditionnels de marché financier (émissions d’obligations, augmentations de capital). Cette « finance de marché » est ainsi un lieu de transformation où l’empilement des crédits, comme dans tout système bancaire moderne, donne naissance, par un jeu classique de multiplicateurs, à un processus complexe de création monétaire ex nihilo.
Ce processus de création monétaire est toutefois très particulier. Certes, on y crée principalement des « dollars », mais des « dollars » – ou, plutôt, ce que l’on appelle de manière générique des eurodollars [8] – qui n’ont en fait aucun lien avec le dollar américain, sinon la dénomination. Ce qu’on y échange ne sont pas des dollars, physiques ou digitaux ouvrant un droit de créance légal sur le Trésor US ou sur la banque centrale américaine ; mais des titres de dette privée, libellés en dollars (parce que c’est une habitude, une convention comptable qui a été prise du fait de la prédominance du dollar US dans les échanges mondiaux depuis la guerre), qui, grâce aux nouvelles technologies financières, bénéficient sur le marché de caractéristiques de liquidité, d’interchangeabilité et de stabilité de prix quasiment équivalentes à celles d’un signe monétaire classique, ce qui leur confère une valeur de quasi-monnaie. Ce qui s’échange et constitue donc la monnaie de ce système sont des titres électroniques représentatifs de contrats d’opérations financières dont la plupart des citoyens n’ont commencé à découvrir l’existence qu’à l’occasion de la crise : repos[9], swaps[10], papier commercial, fonds monétaires, CDS et CDO, produits structurés, produits dérivés, etc… Ceux-ci sont au nouvel univers de l’Eurodollar l’équivalent de ce que les dérivés de l’ancienne monnaie-or tels que le billet de banque, le chèque, un compte de dépôt à vue, ou encore un bon du Trésor sont au monde de la banque classique ; c’est à dire, en principe, un passeport pour l’accès à la liquidité[11].
Le miracle de la monnaie qui manque
Que représente cette création de monnaie ? Quel est le volume des eurodollars ? Paradoxalement, personne n’en sait rien. Pour les autorités monétaires il s’agit de « dollars » qui, par définition, n’existent pas ! Ce sont bien de la monnaie puisqu’il s’agit d’instrument d’échange et de paiement (et même de réserve, largement utilisés par la Chine). Mais comme il s’agit d’outils qui n’entrent dans aucune des catégories conceptuelles traditionnelles de la théorie monétaire enseignée dans les facultés, c’est de la monnaie qui ne figure nulle part dans les statistiques, qui ne peut pas être décomptée et donc prise en compte. Et pour cause : la plupart de ces opérations n’apparaissent même pas dans les comptes et les bilans des entreprises de banque. On ne peut accéder à leur connaissance qu’en allant fouiller au tréfonds des notes de bas de bilan (comme c’est par exemple le cas pour les CDS[12]). La seule chose dont on dispose c’est des bribes d’informations partielles qu’il faut compléter et recouper.
Les évaluations les plus courantes donnaient jusqu’à récemment un chiffre global de l’ordre de 10.500 milliards de $. Mais, l’an dernier, les spécialistes de la BRI ont révélé qu’il manquait dans ce chiffre une masse d’environ 14.000 milliards de $ qui, jusqu’à présent, n’étaient jamais apparus comptablement[13]. Autrement dit, le véritable volume du marché de l’Eurodollar serait aujourd’hui de l’ordre de 25.000 milliards de $. Pour comprendre ce que cela représente il faut comparer à la masse monétaire américaine : 13.000 milliards de $ pour l’agrégat M2.
Ce chiffre de 25.000 milliards est énorme, surtout pour une monnaie-fantôme. Il signifie en effet que désormais quasiment deux dollars sur trois en circulation dans le monde sont en vérité des « dollars » made in world, et non des dollars made in USA. Lorsque la Fed fait tourner ses modèles et présente ses prévisions, elle le fait en négligeant tout simplement de prendre en considération l’existence d’une masse de « dollars » qui, économiquement parlant, ne sont pas moins réels que les siens, et pèsent en fait plus lourd dans la balance de l’évolution économique et monétaire. Nulle surprise, dès lors, si elle se trompe si souvent, si elle n’atteint jamais ses objectifs, et si ses efforts pour faire revenir la croissance, mais aussi l’inflation, se révèlent aussi improductifs. Les économistes continuent d’écrire comme si le monde était toujours en régime d’étalon-dollar alors qu’en réalité celui-ci a déjà muté en un étalon-eurodollar.
Cette fermeture d’esprit des autorités monétaires est cruciale car elle les empêche de voir la réalité en face. Pendant près d’une vingtaine d’années elles se sont creusées la cervelle pour comprendre l’origine de cette période économique bénie des dieux baptisée « la grande modération »[14]. Pas un instant elles n’ont imaginé que la source de ce miracle se trouvait non dans l’hyper-épargne des pays émergents (la thèse du saving glut portée par Ben Bernanke), ni dans le génie supposé de son prédécesseur à la tête de la Fed (Alan Greenspan), mais tout simplement dans une explosion exponentielle – à partir des années quatre-vingt-dix – de la production mondiale d’eurodollars à laquelle elles n’avaient aucune part (et qu’elles ne soupçonnaient même pas).
L’aveuglement des banques centrales
Malheureusement elle les empêche aussi de percevoir que, si l‘Eurodollar, pendant des années, a présenté la grande qualité de répondre pro-activement aux énormes besoins de liquidités qu’exigeait la libération des échanges et la mondialisation, il fonctionne depuis la crise en sens exactement inverse. Pour des raisons liées en particulier – mais pas uniquement – aux effets déflationnistes de l’hystérie réglementaire sur l’offre du petit nombre de groupes bancaires transnationaux (Global banks) dont dépend le réglage du débit des chaînes de crédits à l’origine de l’émission comptable des monnaies made in world[15], il ne produit plus suffisamment de monnaie – ou, plus exactement, de créances assimilables à de la monnaie – pour autoriser le retour des économies mondiales à des rythmes de croissance du type de ceux auxquels les populations occidentales étaient habituées. Le monde souffre de nouveau d’une pénurie structurelle de dollars (Dollar Short). Mais, cela, les banques centrales ne le savent pas, car elles ne se sont pas dotées des instruments pour le savoir (et elles n’ont jamais cherché à le savoir). La croissance est morte car elles ont ainsi cassé le ressort du régime monétaire mondial.
Alors, stagnation séculaire ou pas ? Comme les précédentes, cette dernière analyse converge pour nous avertir que le retour à une situation économique « normale » (par rapport aux attentes) n’est pas encore pour demain. A cette réponse elle ajoute cependant un élément nouveau : c’est au niveau de l’organisation de l’ordre monétaire de la nouvelle économie mondiale que se décideront les perspectives pour les vingt, trente prochaines années ou plus.
Avec la globalisation le monde est subrepticement entré dans un nouveau régime monétaire à caractère hybride où une régulation horizontale par des mécanismes bancaires de marché se superpose, se combine et englobe la régulation hiérarchique et territoriale traditionnelle par le monopole des banques centrales. Ce système s’est révélé à l’expérience d’une grande fragilité. Le retour à des trends de croissance durable suppose donc que l’on en élimine les facteurs d’instabilité. Mais quels sont-ils ? Est-ce le surdéveloppement de la part « marché » qui en est responsable ? Ou au contraire le sur-encadrement réglementaire par les banques centrales et autres organismes publics de tutelle bancaire ?
La réponse la plus classique est de considérer que cette instabilité est inscrite dès l’origine dans les gênes mêmes d’une finance de marché non régulée. D’où la nécessité d’un encadrement réglementaire. Ce qui, dans le contexte actuel, devrait se traduire par la volonté de faire rentrer l’Eurodollar dans le giron des banques centrales. C’est déjà ce à quoi s’attelle la Fed américaine en essayant de récupérer à son profit les énormes collectes de liquidités des fonds communs de placement mondiaux. C’est aussi la motivation qui inspire les projets d’une gouvernance monétaire mondiale (par exemple via l’utilisation, souhaitée par la Chine, du mécanisme des Droits de tirage spéciaux institués par le FMI)[16].
Eurodollars et cryptomonnaies
A l’opposé, les économistes libéraux plaident pour un retournement de perspective. Il est possible de démontrer que la plupart des excès financiers couramment présentés comme étant à l’origine de la Grande crise résultent en fait d’une série d’incitations perverses que l’on doit aux réglementations bancaires type « accords de Bâle »[17]. Une véritable réforme devrait donc comporter une vigoureuse déréglementation allant de pair avec une réappréciation (ici une limitation) du rôle des banques centrales et l’acceptation de la concurrence de nouveaux instruments monétaires (comme les crypto-monnaies, dernière étape technologique dans le développement de nouvelles quasi-monnaies virtuelles, en continuité avec les précédentes[18]).
Entre les deux il y a enfin ceux qui, comme le Professeur Perry Mehrling [19] (Barnard College, N.Y.), pensent que cette remise à jour et réinitialisation (reset) des conditions fondamentales de l’ordre monétaire international serait déjà en train de s’échafauder, sans tambours ni trompettes, sur la base du présent régime d’hybridité. Leur espérance est que l’élargissement de l’actuel réseau d’accords de swaps automatiques entre les principales banques centrales occidentales à d’autres grands pays émergents comme la Chine permette enfin de stabiliser de manière durable cette imbrication entre systèmes bancaires hiérarchiques et finance de marché global.
L’avenir leur donnera-t-il raison ? On pourrait l’espérer, mais il est sérieusement permis d’en douter. Ce scénario exigerait en effet que les actuelles banques centrales procèdent d’abord à un formidable aggiornamento de leur cadre habituel de pensée, en abandonnant par exemple leur culture essentiellement monopolistique de la monnaie. A cet égard, il est à craindre que l’intérêt que certaines d’entre elles montrent actuellement pour mieux s’informer sur l’univers des crypto-monnaies ne vise en réalité à détourner l’innovation technologique de la blockchain sur laquelle elles se fondent au profit d’un rétablissement renforcé de leur monopole traditionnel (par exemple via l’interdiction définitive des espèces et leur remplacement par une crypto-monnaie banque centrale électronique accessible à tous).
[1] Lawrence H. Summers, Secular Stagnation and Monetary Policy, REVIEW, Federal Reserve Bank of St Louis, Second Quarter 2016. Gustaf Gimdal and Cemal Karakas, Secular Stagnation and the euro area, European Parliamentary Research Service, Briefing note February 2016.
[2] Voir Martin Neil Baily and Nicholas Montalbano, Why is US productivity growth so slow? Possible explanations and policy responses, The Brookings Institution, Hutchins Center working paper n°22, September 2016. Pages 18 et suivantes.
[3] Cf Claudio Borio, Secular Stagnation or Financial Drag?, conférence devant la National Association for Business Economics, Washington D.C., 5-7 mars 2017.
[4] Steve H. Hanke, How Bank Regulations Hinder the U.S. Recovery, Forbes.com, May 31, 2017.
[5] Steve H. Hanke & Matt Sekerke, Bank Regulation as Monetary Policy: Lessons from the Great Recession, CATO journal, vol. 37, n°2 (Spring/Summer 2017).
[6] Jeffrey Snider est directeur de la firme Alhambra Investment Partners sur le site de laquelle il tient une chronique économique quotidienne publiée en plusieurs articles.
[7] A noter que cette expression recoupe celle, plus largement connue, de Shadow banking (en français : la finance de l’ombre). Pour explication, voir la note xii.
[8] Les comptes eurodollar sont des comptes en dollars ouverts dans les livres d’établissements situés en dehors des Etats-Unis. Le préfixe euro attaché à ces dollars vient de ce qu’au début de leur multiplication la quasi-totalité de ces comptes étaient hébergés dans des banques européennes. Mais aujourd’hui on trouve des comptes eurodollar dans les banques du monde entier : vous pouvez aussi bien détenir des eurodollars dans une banque à Londres, à Paris, à Shanghai, Moscou ou Sydney, aux Bahamas, etc… On devrait plutôt parler de global dollars ou dollars off-shore. Mais l’habitude a été prise de conserver globalement la dénomination d’Eurodollars. L’origine des euro-dollars date des années cinquante. On raconte que ce sont les soviétiques qui les auraient plus ou moins inventés en préférant mettre leurs dollars à l’abri dans des banques suisses pour échapper à d’éventuelles sanctions financières américaines. Mais la vraie cause de l’essor des eurodollars tient aux différences de législation bancaire et fiscale entre les deux côtés de l’Atlantique. Celles-ci font que lorsque l’on a des dollars il est plus avantageux de les conserver dans un compte bancaire britannique que dans une banque américaine à New-York. Pour répondre à la concurrence que leur font les banques londoniennes du fait de ces conditions plus avantageuse dans la collecte des dépôts en dollars, les banques US traversent alors l’Atlantique pour installer leurs succursales et entrer à leur tour dans le business des eurodollars. A partir des années soixante le marché des eurodollars change alors progressivement de nature. Au lieu d’être de simples instruments de règlement du commerce international (qui était alors fondé sur le mécanisme des lettres d’acceptation supposant que l’importateur préfinance lui-même l’achat des devises que sa banque utilisera pour régler son fournisseur étranger), les eurodollars sont peu à peu utilisés comme base de développement de toute une activité de crédit bancaire fonctionnant comme tout système bancaire : c’est à dire sur la base d’un principe de réserves fractionnaires qui permet de bénéficier d’un mécanisme multiplicateur de crédit. C’est ce mécanisme qui, dans les années soixante, apporte enfin une solution au problème de la pénurie de dollars qui a marqué tout l’après-guerre. Bénéficiant progressivement de toute une série d’innovations techniques et financières, l’Eurodollar entame alors sa mutation en un véritable système bancaire-bis, parallèle et hors-norme, qui fabrique des dollars comptables privés (c’est à dire pas autre chose que des chiffres dans un ordinateur) acceptés par les opérateurs du commerce international.
[9] Le repo (terme français = pension livrée) est un mécanisme de refinancement interbancaire par lequel vous cédez à un partenaire un certain volume d’actifs négociables (obligations, actions, certificats de dépôts, papier commercial) que celui-ci s’engage à vous revendre au même prix (+ le taux d’intérêt) à une date déterminée à l’avance. Il s’agit d’une technique de financement à court terme (de un jour à un mois) qui se substitue aux dépôts interbancaires classiques et dont l’usage croissant supplante le marché monétaire traditionnel (en raison de sa plus grande sécurité).
[10] Le swap est un produit dérivé financier qui consiste en un échange de flux financiers entre deux parties qui sont généralement des banques ou des institutions financières. Par exemple, l’échange d’un flux futur d’intérêts fixes contre un flux d’intérêts variables (l’échange se faisant parce que les deux parties n’ont pas les mêmes anticipations sur le comportement futur des taux). Autre exemple : le swap de devises est un accord conclu entre deux parties qui s’échangent un montant déterminé de devises étrangères, et s’engagent à se verser mutuellement les intérêts correspondant à chaque devise ainsi qu’à se rendre les montants ainsi échangés à une date fixée à l’avance. Il s’agit d’une technique qui permet à l’importateur de contourner l’ancien mécanisme qui consistait pour lui à préfinancer auprès de sa banque l’achat des devises que celle-ci devra régler plus tard à l’exportateur étranger.
[11] Voir le livre de Morgan Ricks, The Money Problem : Rethinking Financial Regulation, The University of Chicago Press, mars 2016.
[12] Les Credit Default Swaps – en français « couvertures de défaillances » – sont des contrats de protection financière entre acheteurs et vendeurs, mis sur le marché par J.P. Morgan à partir de 1994. Il s’agit d’outils monétaires qui, en raison des structures comptables existantes et non ajustées à l’évolution technologique, sont produits « dans l’ombre » des bilans – d’où l’expression Shadow banking, généralement connotée à tort à une double idée de clandestinité et d’évasion comptable. Que ces outils aient été largement utilisés comme instruments de contournement réglementaire, c’est incontestable. Mais ceci était une conséquence de la manière dont les règles bilantielles de Bâle I concernant les ratios de risque (Tiers one) ont été appliquées : à titre d’exception on a permis aux entreprises de ne compter les produits dérivés de ce type qu’à vingt pour cent de leur engagement au lieu de les inscrire pour un risque à 100% – d’où l’incitation, dans le cadre d’une gestion rationnelle, à se financer avec un maximum de dette de ce type plutôt qu’avec des moyens d’endettement comptablement plus visibles. Cette substitution permettait à la firme d’obtenir des taux de levier (et donc des niveaux d’affaires) beaucoup plus élevés tout en respectant les nouvelles règles comptables concernant le relèvement du ratio de capital minimal.
[13] Claudio Borio, Robert Neil McCauley and Patrick McGuire, FX Swaps and Forwards: Missing Global Debt? BIS Quarterly Review, September 2017.
[14] Il s’agit des années 1990 jusqu’à 2008, période marquée par une réduction de l’instabilité cyclique et une faible inflation.
[15] Une quinzaine de grandes firmes de courtiers-intermédiaires (dealer-brokers) internationaux – type Goldman-Sachs, J.P. Morgan, Citibank, H.S.B.C, Deutsche Bank, Crédit Suisse…- dont l’activité de « faiseurs de marché » (market making) est la poutre-maîtresse sur laquelle repose le fonctionnement du système d’émission monétaire privé.
[16] Il est à noter que, depuis la crise, la Chine, et plus globalement l’Asie du sud-est, sont à leur tour devenues des partenaires majeures de ce système monétaro-bancaire mondial. La croissance des pays émergents en a considérablement profité jusqu’en 2013 (via un accroissement record de leur endettement). Mais, depuis 2014 et l’épidémie récessive qui s’en est suivie (Chine, Brésil, Russie), elle est elle-aussi profondément impactée par l’inversion de son mode de fonctionnement, la pénurie de dollars (dollar shortage) qui en est la conséquence, et l’alourdissement des déséquilibres financiers qui en résulte pour leurs entreprises. Tout laisse penser que ces pays sont à leur tour gagnés par le syndrome de l’effondrement du taux de croissance.
[17] Cf. l’exemple des C.D.S. cité à la note xii.
[18] Les eurodollars sont déjà une forme de crypto-monnaie virtuelle sans la technologie de la blockchain.
[19] Perry Mehrling, The New Lombard Street: How the Fed Became the Dealer of Last Resort, Princeton University Press, 2011. Voir aussi : Global money a work in progress, Perry Mehrling’s blog, 12 June 2016.